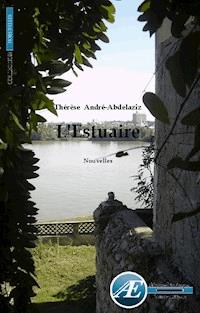Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Hors d'Elles
- Sprache: Französisch
Quand histoire et fiction s'entremêlent.
Ni biographie, ni roman de cape et d’épée, ce récit ne prétend aucunement raconter l’histoire véridique de Julienne David mais, m’appuyant sur des faits relatés, dates historiques, actes de naissance, de décès, extrait du bordereau de recensement du 3ème canton de la ville de Nantes en 1841, j’ai réinventé l’existence tumultueuse de cette corsaire nantaise. Ce récit s’articule autour des manques, des silences et des interrogations, mêlant histoire et fiction. L’écriture est née de tout cela. Au plus serré.
« Les bons romanciers écrivent dans les blancs de l’histoire. » (François Busnel, l’Express)
J'ai été particulièrement captivée par le destin de cette femme haute en couleurs, qui malgré son époque a su se forger un passage dans le monde des hommes au fil de son épée et de sa volonté. Le reniement de sa féminité est une invite à se pencher sur le destin des femmes dans les sociétés d'hommes...
Mais là ne s'est pas arrêté le talent de Thérèse André-Abelaziz qui nous emmène dans une magnifique balade, poignante de réalisme, mais d'où la poésie et la violence des émotions n'est jamais absente. En voici l’expression dans ce court extrait : « Ta peau que Guillaume a trouvée si douce, mais qui est recouverte de scarifications, l’aimerait-il encore ? Ah, soupires-tu, s’ensevelir au moins une fois jusqu’au vertige dans cette tiédeur pour oublier le faible renflement de tes mamelles, dont les pointes encore sensibles sont en train de devenir grises avant d’être incolores. Oublier ce bas-ventre désert que tu fouilles encore certaines nuits à grands coups jusqu’à hurler d’impuissance. » Laurence Schwalm - Editeur
Grâce à ce roman historique, découvrez l'existence tumultueuse d'une corsaire nantaise ayant réellement vécu.
EXTRAIT
« La rouquine est capable de réveiller un mort ! » Avec les herbes des sorcières et des magiciens : jusquiame noire, belladone sans tige, « les plantes du Malin » dit-on, comme la mandragore qui a forme humaine… Julienne les connaît toutes. Ortie pour soulager les menstrues des femmes. Coquelicot et moutarde pour calmer la toux. Armoise et épilobe contre la fièvre. Menthe pouliot pour les méninges. Chardon de Marie si précieux en cas d’intoxication alimentaire. Julienne a grandi. On commence à la connaître dans le pays. On fait appel à ses médecines. D’ailleurs, elle les porte toujours à même la peau, dans une bourse de toile retenue par une cordelette. Leur odeur est si forte qu’elle suffit à éloigner les importuns. On craint cette femelle rousse des terres noires à la beauté sauvage, haute stature, œil vif, visage piqué de taches de son.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ecrivain pluri-indisciplinaire, Thérèse André-Abdelaziz explore toutes les formes d’écriture, de la poésie à la dramaturgie en passant par les nouvelles, le roman et les faits de société. Elle a publié sept ouvrages dont Quelque part une île (1980) Ed. du Cerf, Je, femme d’immigré (1987) Ed. du Cerf, réédition (2004) La Part Commune, Je m’appelle Atlantique (2006) Ed. La Part Commune, ainsi que L’Estuaire (2011) et Moi, Julienne David, corsaire nantaise jamais soumise (2012) Ed. Ex Æquo.
Elle est l’auteur également de sept pièces radiophoniques et neuf pièces théâtrales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Moi, Julienne David,
Femme, corsaire, jamais soumise…
Thérèse André-Abdelaziz
Roman historique
Dépôt légal avril 2012
ISBN : 978-2-35962-277-5
Collection Hors d’Elles
ISSN : 2115-970X
©couverture Lydie Itasse / Hubelywebconcept
©illustrations intérieures de
Thérèse André-Abdelaziz
©Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
Éditions Ex Aequo
Avertissement
Ce roman est très librement inspiré de la vie d’une femme corsaire nantaise, Julienne DAVID, mêlant éléments biographiques (recherches personnelles) et imaginaires.
Table des matières
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sources biobibliographiques
ANNEXES
1
La maison de la rue de la Commune…
Tout part de moi. Et d’elle.
Moi, mes poumons, mes boyaux étroits, mes membranes, mes racines. Elle, ses cheveux roux et ses pieds nus.
Moi, cette odeur de moisi que l’on respire dans les cryptes ou les caves. Ces murs aujourd’hui lézardés et ce jour médiocre à travers les vitres sales. L’odeur forte des peaux et cuirs tannés qui transpire de l’échoppe du corroyer et du cordonnier au rez-de-chaussée.
Elle. Anguleuse. Sa grande taille voûtée et amaigrie. Ses mouvements un peu brusques. Son odeur aigre.
Moi, cet escalier encore beau aux marches de granit usées en leur milieu, sa rampe de bois à balustres et cette porte marron au troisième étage à droite. Verrouillée à l’aide d’un loquet mal ajusté, elle ouvre sur une enfilade de pièces hautes de plafond dont une fenêtre donne sur la façade. Les vers ont grignoté les poutres ; la cheminée murée est entourée d’un manteau de marbre noir. Des pigeons blessés, captifs de la cour intérieure en entonnoir, tournoient et se heurtent aux arêtes vives des murs. La lumière les aveugle. Épuisés, quelques-uns agonisent sur le rebord de la fenêtre de la cuisine.
Elle. Elle observe les pigeons et, comme jadis, recueille ceux qui ne peuvent plus vivre. Ils semblent la connaître. Ses mains rudes se font douces pour les nettoyer de leurs fientes et caresser leur cou. Il lui arrive de leur parler. Ainsi ils ne meurent pas seuls.
Elle va et vient, pieds nus sur les dalles et le plancher, toujours vêtue d’habits masculins, cheveux roux coupés courts. « Souvent, écrit un contemporain, nous avons pu la voir avec son pantalon gris, sa blouse bleue, son bonnet de coton légèrement incliné sur l’oreille. » C’est le soir, elle a fini sa journée de palefrenier chez le loueur de fiacres qui l’emploie. Une fois ses chevaux dételés et menés à l’abreuvoir, elle a fait un tour sur le port. « Jacquot, hé Jacquot ! » On la connaît sous ce nom. On l’interpelle, on l’invite à prendre un pot à la taverne. Elle trinque volontiers, capable dit-on d’absorber de grandes quantités d’alcool sans être incommodée ni même dérangée. « Sa taille haute et forte, quoique courbée et amaigrie par l’âge, annonce une constitution vigoureuse, et la vivacité de son regard dénote une grande énergie. » Ce qui est nuisible au plus fort de ses compagnons de travail ne la gêne en rien. Elle paie toujours sa tournée avant de partir. Une fois chez moi, elle se déchausse, se dévêt et s’immobilise devant sa table de toilette, face aux murs sombres de la cour. Elle fait couler l’eau du broc dans la cuvette émaillée. Été comme hiver, elle s’étrille à l’eau froide, longuement, pour chasser d’elle l’acidité qui imprègne sa peau, peu soucieuse du regard des voisins. Elle ne dort pas beaucoup et ils se sont habitués à la voir déambuler la nuit dans son logement. Nue le plus souvent. Les muscles durs comme ceux des garçons, la poitrine plate, le visage émacié et l’œil perçant.
Tous m’ont quittée depuis longtemps, mais mon âme, c’est elle.
Elle a pris l’apparence d’une femme debout derrière une fenêtre. Qui ne mange ni ne boit, ne marche ni ne dort, ne parle ni ne rit ni ne pleure. Qui scrute la rue et les bruits de la rue. Peut-être n’est-elle qu’un reflet du soleil sur un tesson de bouteille. Ou, la nuit venue, un éclat de réverbère. Qu’importe ! J’entends ses pas ; on les dirait extraits de la terre et de la pierre. Mes parquets grincent, mes carrelages résonnent, mes murs craquent, mes portes claquent, mes serrures cliquettent. Ce ne sont qu’allées et venues. À croire qu’une foule arpente mes escaliers, mes paliers, mes corridors, mes chambres et mes cuisines dans l’obscurité. Du sol au plafond, il y flotte comme des relents de sépulcre.
Plus tard, dans le silence, la voix de la femme dit tout bas son ventre meurtri et désert. Et prononce son nom de femme : Julienne.
2
La fille du diable
Savoir ce que ça lui fait à la petite rouquine quand on l’appelle comme ça ! Savoir à quoi elle pense quand elle joue toute seule dehors en toute saison. Si elle joue ! Les travaux n’attendent pas chez les D. Claquent ses sabots sur les pierres du chemin, virevoltent autour d’elle ses jupes et jupons trop larges et mal taillés. Flamboient ses longs cheveux raides et roux autour de son visage à la peau claire, constellé d’éphélides, « la marque du diable », dit-on au village.
Elle est née à Saint-Mars-du-désert au lieu-dit « Places » dans l’arrière-pays, fin 1773 ou février 1774. On ne sait plus très bien, et vit dans une maisonnette basse, murs de torchis, sol de terre battue, entourée de terres incultes désertifiées par les crues de l’Erdre détournée de son cours au 6ème siècle par St Félix alors évêque de Nantes. Son père se gage à l’année dans les fermes voisines, laboureur, commis. Sa mère fait des lessives et des gros travaux chez les uns et chez les autres, dont les gens à chevelure poudrée du château. Julienne l’accompagne souvent et l’aide à transporter ses baquets, son battoir et ses sabots neufs - car elle enfile une paire de socques usagés pour ménager les autres - dans une vieille brouette qui tressaute à chaque tour de roue. François, le petit frère, est juché dessus et pleurniche quand il fait froid ou qu’il pleut. Mais il ne peut rester seul à la maison, il est trop jeune. Julienne prend soin de lui aussi, l’aide à manger, pisser, nettoyer sa morve, s’habiller. Lui raconte des histoires à l’occasion quand ils s’endorment en hiver, blottis l’un contre l’autre sur leur paillasse, près du foyer où reste un peu de braise. Quand il y a eu une flambée ! Lui parle des loups et des chiens sauvages qui dévorent les enfants.
— Tout crus ?
— Tout crus !
Lui parle des garnements du village qui ne cessent de la poursuivre.
— Un jour, François, je serai plus forte qu’eux ! jure-t-elle, l’œil rempli de haine. Je les battrai et les embrocherai au sabre ou à l’épée, je… je les regarderai crever !
Ils se moquent de sa tignasse de feu, disent que leurs parents ne sont pas ses parents à elle ou bien que sa mère a forniqué avec le démon une nuit de pleine lune alors quelle était saignante. D’ailleurs elle s’habille en rouge, souvent. Pas comme les paysannes du village et des alentours, portant coiffes, affûtiaux et châle noirs… Elle, elle a les cheveux défaits, en plus, et si maigre ! Une vraie tcheuvarson ! » Non, elle ne leur ressemble pas, elle sait même pas travailler la terre, elle trimballe ses baquets et son battoir d’un bout à l’autre de la commune par tous les temps.
— D’où qu’elle vient ? L’est pas d’la paroèsse, c’est sûr !
— Des landes de l’aut’côté de l’Erdre ou ben un p’tit pu lin.
— L’est-elle seulement de Nan-ette, hein ?
— Une galvoadeuse, oui !
— Une bâtarde !
On dit que le gars Pierre l’aurait ramenée chez lui un soir, juste après les vendanges. C’est un terreux, un pierreux, un qu’a pas de terre et pas de bêtes. Même pas d’oueille et de traille, juste une chèvre et quelques poules. Qu’a rien à rouché.
— Et yelle, on sait pas son âge !
Jolie, pas jolie, on la trouve trop fière pour une moins que rien. Y’en a qui disent en se signant qu’Anne c’est pas son nom : « Le nom de la Bonne Mère, quel sacrilège !!! » C’est le Pierre qui lui aurait donné ce prénom de chrétienne. D’ailleurs elle communie jamais ! Forcément si elle a vendu son âme au Malin… Jusquiame, digitale, ortie, coquelicot ou chardon de Marie… Millefeuilles, marc de raisin, liseron, et gui aussi. Les breuvages et les mixtures qu’elle prépare à partir des plantes et des herbes en inquiètent plus d’un. Pourtant ils viennent la voir en cachette la nuit pour les bêtes qui crèvent, les hommes qu’ont la trique trop molle, les femmes qui saignent trop souvent ou les nourrices qu’ont plus de lait. On achète son silence avec un cruchon de gnôle ou quelques hardes : jupon de laine, braies, fichu, et rarement de l’argent, sinon quelques pistoles.
— Jamais je leur pardonnerais ! répète Julienne à son petit frère, jamais !
Ils sont cinq ce dimanche de fin septembre. Cinq garnements qui la guettent à la sortie de la messe. Le plus vif lui crochète le pied, les autres la coincent par-derrière dans les communs du presbytère. Face au mur, et à quatre pattes. Impossible de se dégager. Deux s’installent à califourchon sur elle histoire de lui maintenir les coudes repliés dans le dos, un autre lui soulève la tête en la tirant par les cheveux. Ils sentent le purin et le poil mouillé des chiens. Elle se débat et crie. Un quatrième la bâillonne d’une main pour l’empêcher de « couiner comme les truies » et un cinquième trousse ses jupons jusqu’à la taille. « T’as-t’y la queue du diable, la rouquine ?» qu’il ricane en lui écartant les fesses et les cuisses. Elle gigote et pleure, ça les excite. Elle hurle quand il introduit un bâton dans son anus puis les doigts dans sa fente de fille et la fourrage sous les quolibets de ses camarades.
— L’a juste ses herbes de sorcière à la ceinture, la garce de rouquine ! L’a pas la queue du diable ! dit-il en se relevant.
— T’as bien cherché ?
— L’a mise où alors ?
— L’a cachée au fond de son trou, j’suis sûr, la bougresse !
— L’est comment d’abord ?
— Velue à ce qu’on dit.
— Suffira d’y mettre la tienne pour…
— Pour qu’elle me la garde, nenni !
Et de ricaner en abandonnant « la gueuse ! » sur le sol avec quelques bourrades.
Savoir ce que ça lui fait à la petite Julienne d’être là, à moitié écartelée dans la boue avec ce feu dans son ventre, cette plaie dans sa fente et son rectum, ce sang qui poisse ses jambes. Elle n’est que douleurs et frissons. Soudain elle se relève, court jusqu’aux marécages sans s’arrêter, s’enfonce dans les roseaux, s’approche de l’Erdre, « la jaune rivière des tourbières » où elle entre tout habillée, tâtonne du pied pour trouver les pierres de gué. Elle s’arrête quand l’eau froide atteint ses genoux et fléchit, tremblante, accrochée aux herbes de la rive. Se mouille jusqu’à la taille, se redresse. Comme elle aimerait se rouler dans ce grand ruisseau et le boire encore et encore à larges goulées pour se laver du dedans ! Aimerait que l’eau la pénètre encore et encore jusqu’à la laver de toute souillure ! Jusqu’à l’engloutir et gonfler sa peau. L’éclater. Être sans chair et sans écho avant de disparaître ainsi que les terres alentour, désertifiées par les inondations répétées de l’Erdre. Devenir désert. Se perdre dans les roselières envahies par les saulaies. Se liquéfier dans ce pays de bois et d’eau. Mourir.
Ce premier dimanche d’automne la petite Julienne de 11 ans fait serment d’abandonner un jour ce cotillon gris qui l’entrave et de porter des braies comme les garçons. Pour protéger sa fente. Quand elle se met à rire comme on pleure, par à-coups si rauques qu’elle ne reconnaît plus sa voix, quelque chose en elle se libère. Elle jure de se venger de ceux dont elle n’oubliera pas les visages : leur coupera les couilles, les leur enfoncera dans la gorge et leur pissera dessus. Puis elle les laissera crever sur le parvis de l’église. Comme des cochons…
Rentrer chez elle, vite ! Éviter l’église et le village. François est seul à la maison. Assis sur un tabouret devant les briques chaudes du foyer, il grignote un quignon de pain sec avec un oignon cru. Regards qui se croisent. Silence. Envie de brûler ses vêtements devenus si lourds. Elle les ôte avec rage, les suspend sur une corde, sous l’œil apeuré de François. Réajuste à sa taille le lien de cuir trempé qui entaille sa peau et vérifie la petite bourse de tissu grossier sur son bas-ventre. Les herbes que sa mère lui a confiées sont là, mais leurs pouvoirs n’ont pas empêché ces fils de chien de forcer sa fente de femelle. Hoquets, vomissements dans l’âtre.
Plus tard, agenouillée près de son jeune frère, elle secoue ses longs cheveux roux qui serpentent dans son dos. Ils sentent la vase. Elle est nue et grelotte. François l’enveloppe dans une couverture. Quand il essaie de la prendre par le cou, elle l’écarte brutalement, saisit un couteau que son père a aiguisé la veille et lui ordonne de couper ses mèches de fille. Il refuse, elle le repousse, penche la tête et les tranche elle-même avec rage. Puis les piétine du pied avant de les jeter au feu.
Les jours qui suivent se confondent avec la nuit. Julienne n’est que tremblements. Elle serre les dents et les genoux quand ses parents la questionnent et que les mains calleuses de sa mère se font douces sur son corps et enduisent d’onguent sa poitrine déchirée par la toux.
L’été suivant, Julienne devient saignante.
Il est midi. Le manège d’un chien qui la suit dans la cour et renifle le sang coulant entre ses jambes alerte sa mère. Elle chasse l’animal et remet à sa fille un paquet de linges pour éponger les impuretés qui sortiront de sa fente tous les mois. Ses seins ont forci, Julienne les déteste et les aplatit avec des bandages. Ses hanches s’arrondissent, son ventre se bombe. Elle les déteste aussi, car les mâles la fouillent des yeux et leurs yeux sont troubles. Des poils poussent autour de son entaille. Sa mère et les femmes qui viennent la voir en secret parlent tout bas d’humeurs, de moiteurs et de garçailles. Julienne les maudit, et rase son pubis un soir, jambes écartées au-dessus d’une bougie.
« Désormais, lui dit sa mère, tu me seconderas partout. »
Ça veut dire les plus grosses corvées : cuisine en plus des lessives au ruisseau ou au lavoir, ravaudage des vêtements, soins en cas de maladie, nettoyage de la fosse où son père et son frère vident leurs intestins… Lui sont interdites, en alternance, à chaque menstrues, la préparation de certains plats : son état de saignante, donc d’impure, fait tourner les sauces et corrompt le vin dans les fûts. Son haleine et son odeur en sont la cause, dit la croyance populaire.
La révolte fermente en elle.
3
La maison de la rue de la commune…
« La rouquine est capable de réveiller un mort ! » Avec les herbes des sorcières et des magiciens : jusquiame noire, belladone sans tige, « les plantes du Malin » dit-on, comme la mandragore qui a forme humaine… Julienne les connaît toutes. Ortie pour soulager les menstrues des femmes. Coquelicot et moutarde pour calmer la toux. Armoise et épilobe contre la fièvre. Menthe pouliot pour les méninges. Chardon de Marie si précieux en cas d’intoxication alimentaire. Julienne a grandi. On commence à la connaître dans le pays. On fait appel à ses médecines. D’ailleurs, elle les porte toujours à même la peau, dans une bourse de toile retenue par une cordelette. Leur odeur est si forte qu’elle suffit à éloigner les importuns. On craint cette femelle rousse des terres noires à la beauté sauvage, haute stature, œil vif, visage piqué de taches de son. Les durs labeurs de la terre ont développé en elle une force peu commune. On l’épie, on l’observe quand elle arpente la campagne, tête nue, sans fichu ni sabots, à grandes enjambées. Elle le sait. Elle a envie d’ôter sa camisole, de détacher les tissus qui écrasent sa poitrine et de jeter au fossé ses cotillons. Envie de se montrer telle qu’elle se veut : comme un garçon, les seins plats, avec la pointe à peine visible, le ventre dur, les jambes solides.
Au village, on sacrifie au dieu Mars tous les ans au printemps. Ça se passe sur les bords de l’Erdre au milieu des bois du Petit-Mars, dédié au dieu gallo-romain de la guerre. « Superstitions païennes ! vocifèrent les curés dans leurs prêches. C’est un culte impie, vous offensez Nostre Seigneur ! » Mais qui les écoute ? Le dieu de la guerre est vénéré ici depuis le Xème