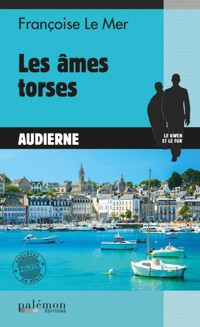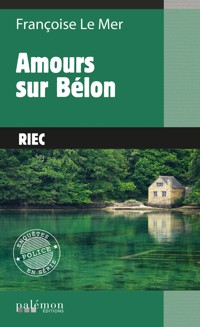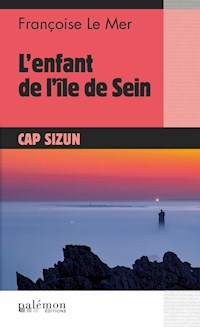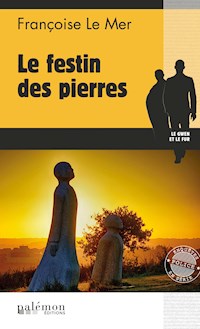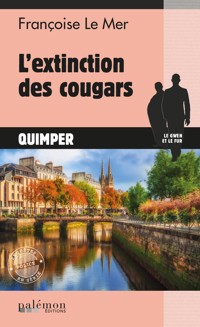Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Interne en médecine, Marine Le Gwen, fille du commissaire de police brestois, côtoie dans son service un anesthésiste-réanimateur, Jules Dupuy. Ce dernier possède un don pour le moins original dans ce milieu réputé pragmatique et rigoureux : depuis l’enfance, il est médium. Or, une vision récurrente obsède ce médecin : une jeune femme assassinée le supplie de retrouver sa petite sœur qui a été enlevée. L’intuition du futur médecin mise à part, les pistes sont minces. Aucun signalement de disparition n’a été porté à l’attention de la police. Néanmoins, l’opiniâtreté de Jules Dupuy aura raison de l’équipe du commissaire qui enquêtera sur deux affaires de prostitution adolescente, sans liens apparents…
Dans ce roman policier flirtant avec l’ésotérique, Françoise Le Mer nous plonge – toujours avec autant de talent – dans le domaine du paranormal, sujet dont elle est férue… Passionnant !
À PROPOS DE L'AUTEURE
Avec vingt-trois titres déjà publiés,
Françoise Le Mer a su s’imposer comme l’un des auteurs de romans policiers bretons les plus appréciés et les plus lus. Sa qualité d’écriture et la finesse de ses intrigues, basées sur la psychologie des personnages, alternant descriptions poétiques, dialogues humoristiques et suspense à couper le souffle, sont régulièrement saluées par la critique. Son roman
Le baiser d’Hypocras a obtenu le Prix du Polar Insulaire à Ouessant en 2016. Née à Douarnenez en 1957, Françoise Le Mer enseigne le français dans le Sud-Finistère et vit à Pouldreuzic.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Retrouvez tous nos ouvrages sur www.palemon.fr.
CE LIVRE EST UN ROMAN.Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
PROLOGUE
Brest, 12 mai 1987
Le petit Jules détestait être le dernier enfant à rester en halte-garderie. Peu à peu, la vaste salle carrelée se vidait de ses hôtes bruyants, au grand dam du garçonnet. Non pas qu’il aimât tant la compagnie des autres – Jules était plutôt solitaire – mais, timide, il répugnait à se faire ainsi remarquer.
Tout en piochant dans le baril jaune les briques de plastique nécessaires à la construction de son édifice, l’enfant lorgnait la porte d’entrée. Il ne restait plus que quatre copains. Un grand de CE1 que Jules craignait car il était brutal et mal élevé : il disait des gros mots aux adultes, et trois filles dont Candice. Il aimait assez bien Candice, même si c’était une fille, parce qu’elle était rigolote et qu’elle avait des lunettes rondes et rouges. La fillette, qui commençait à s’ennuyer, s’approcha de lui.
— Tu fais quoi, là, Jules ?
— Ben, tu vois bien ! La tour Eiffel !
— Tu veux faire de la balançoire avec moi ?
— Non, j’ai pas fini…
Déçue par cette fin de non-recevoir, la jolie rousse à la langue bien pendue s’éloigna et partit tailler une bavette à Geneviève, la cantinière, qui gardait les enfants après la classe. Celle-ci mettait déjà les petites chaises sur les tables débarrassées des reliefs du goûter. Détail de mauvais augure. Il devait être tard. Quand elle irait chercher le seau bleu et la serpillière, ce serait la catastrophe ! L’heure des parents serait passée.
Jules n’avait pas vu la dame entrer. Il releva la tête vers elle quand elle s’adressa à lui. Il la trouva très jolie, presque aussi belle que sa maman. Lumineuse. Sa robe verte allait bien avec ses cheveux noirs. Il repéra aussitôt la broche qui scintillait sur le corsage. Un magnifique dragon orange. Il n’avait jamais vu la dame. Pourtant, il gardait cette impression qu’elle ne lui était pas étrangère.
— Tu t’appelles comment ?
— Anne-Lise. Écoute-moi bien, mon petit. Je ne vais pas rester longtemps. Peux-tu faire une commission à papa et maman de ma part ?
— Oui, je veux bien. C’est quoi ?
— Tu vas leur dire de téléphoner ce soir à grand-père. Nanie ne doit pas faire de chimiothérapie demain. Elle n’a pas de cancer. C’est une aspergillose. Tu te souviendras ?
L’enfant ferma les yeux pour mieux se remémorer ces mots qu’il n’avait jamais entendus. Chimiothérapie… Aspergillose… Curieusement, c’était facile, comme si les mots étaient imprimés dans son cerveau. Et puis, le deuxième était rigolo. Papa et maman adoraient les asperges. Pas lui, beurk !
Quand il rouvrit les yeux, la dame était partie. Jules n’eut pas le temps de s’en étonner car au même moment, sa maman, un peu essoufflée, poussait la porte de la halte-garderie. Le cœur de Jules bondit d’allégresse et de reconnaissance. C’était bizarre. La visite de la dame n’avait pas duré plus de quelques secondes. Pendant ce court laps de temps, les autres enfants, à part Candice, s’étaient éclipsés et Geneviève avait déjà lavé le sol à la vitesse d’une fusée !
Tandis qu’il courait vers sa mère, celle-ci se confondait en excuses auprès de la cantinière.
— Je suis désolée, Geneviève. Ma voiture ne démarrait pas. Plus de batterie. J’ai dû appeler mon mari qui passait d’abord à la crèche chercher Hortense avant de venir me prendre. Tu vas bien, mon bonhomme ? ajouta-t-elle en se penchant vers son fils qui enlaçait ses jambes.
— Pas grave, Caroline ! répondit la femme de service avec sa bonhomie naturelle. Ne vous en faites pas pour ça ! Il me reste encore ma p’tite commère ! Mademoiselle Candice !
Comme les verres de la fillette s’embuaient de chagrin, Jules quitta aussitôt les jambes de sa mère pour aller consoler sa camarade de classe. Il lui retira doucement ses lunettes rondes qu’il essuya d’un pan de son t-shirt puis enlaça la petite rouquine.
— T’en fais pas, Candice. Ta maman est en retard aussi, mais elle va arriver !
— Comme il est gentil, votre gamin, Caroline ! s’attendrit la cantinière. Quelle bonne pâte !
— Je dois avouer que Jules, en effet, est très empathique. Un peu trop, parfois.
— Oui, mais il parle tout seul ! renifla la petiote, revigorée par cette attention masculine.
— Ah bon ? s’amusa Caroline Dupuy. Tu m’en diras tant !
— C’est même pas vrai ! s’insurgea Jules.
— Si, d’abord ! persista Candice. Quand Kévin et Anna sont partis, je suis allée te voir pour jouer et tu parlais tout seul ! Tu m’as pas répondu !
— J’étais pas tout seul ! Je parlais à la jolie dame.
— Quelle dame, mon bonhomme ? s’étonna alors la cantinière. Personne n’est entré ici. Tu as beaucoup d’imagination.
L’enfant ouvrit la bouche, décontenancé. Ses parents lui avaient appris à ne pas contredire un adulte. Pourtant, l’injustice était flagrante ! Comme, à présent, c’était lui qui était prêt à pleurer, selon le principe des vases communicants, sa mère abrégea la conversation et, d’une voix gaie, déclara à la cantonade que tout cela n’était pas très grave. Son mari et son bébé les attendaient dans la voiture. Caroline ébouriffa les cheveux de son fils qui suivit sa mère en trottinant.
Attaché à l’arrière du véhicule, Jules ne fit plus attention à la conversation de ses parents. Il s’amusait à faire éclater de rire sa petite sœur de quinze mois, en la chatouillant au cou à chaque fois que la petite bébête montait, montait, et faisait guili-guili.
— Mais tu sais, mon chéri, tous les enfants ont eu un ami imaginaire ! Le mien s’appelait Grouik ! C’était un cochon avec un nœud papillon. Il était adorable !
— Soit, Caroline. Mais entre un cochon mignon, ce qui, entre nous soit dit, ne m’étonne pas trop de ta part, bref, passons, et « une dame », il y a tout de même un sacré décalage, non ? Attends, laisse-moi l’interroger. Eh là ! Du calme, les enfants ! On ne s’entend plus ! Jules, maman me dit que tu as eu la visite d’une dame… Tu peux m’en parler ?
— J’sais pas, papa. Vous allez encore me dire que je suis un menteur, comme Candice.
— Je te promets que non, fiston. C’était qui, la dame ?
— Elle s’appelle Anne-Lise, papa. Très jolie. Elle est venue me voir parce qu’elle avait un message pour vous.
— Anne-Lise… répéta Olivier Dupuy. C’est drôle, ce n’est pourtant pas un prénom si courant, murmura-t-il pour lui. C’était quoi, son message ? Elle ne pouvait pas venir nous le dire à la maison ?
— J’sais pas, moi, soupira Jules, agacé.
Caroline Dupuy se retourna vers le siège arrière et rassura son fils.
— On ne te gronde pas, mon chéri. Papa et moi, on est juste intrigués. Elle t’a dit quoi, la jolie dame ? Tu t’en souviens ?
Olivier Dupuy observait son garçon dans le rétroviseur. La mine crispée, l’enfant avait fermé les yeux. Seules ses lèvres remuaient. Après quelques secondes de réflexion, il reformula son message, haut et clair.
— Il faut téléphoner ce soir à grand-père. Nanie ne doit pas faire de chimiothérapie demain. Elle n’a pas un cancer mais une aspergillose.
Un coup de frein brutal salua les mots de l’enfant de cinq ans. Olivier avait failli emboutir la voiture qui le précédait. Sa femme, aussi livide que lui, posa une main tremblante sur son genou.
— On en reparle chez nous, mon amour. Essaie juste de te concentrer sur ta conduite…
La fin du trajet fut silencieuse, ponctuée seulement par les gazouillis du bébé. Arrivés devant leur maison, qui dominait le port de commerce, Olivier et Caroline paraissaient si perturbés qu’ils avaient oublié de détacher Hortense du siège-auto. Ce fut Jules qui rappela ses parents à l’ordre alors qu’ils ouvraient la porte d’entrée. Penaud, Olivier fit demi-tour.
Les enfants étaient à présent assis sur le tapis d’éveil d’Hortense. Rox, le chien à la généalogie incertaine, participait à leurs jeux. Jules aurait bien aimé regarder un dessin animé en même temps, mais ce n’était pas le jour de la télé. Ses parents se montraient très stricts sur le sujet, moins sur d’autres…
— Une fois n’est pas coutume, Olivier, mais j’ai besoin de boire un verre ce soir. Je te prépare un kir, chéri ?
— Non, merci. Je vais me servir un whisky bien tassé. Je téléphone à mon père et à Annie tout de suite ?
— Attends un peu… Jules ! Tu peux nous dire comment était la jolie dame ?
— Oui, maman. Des cheveux noirs en chignon. Des yeux bleus. Et puis, elle portait une robe verte avec une broche dessus. Un dragon orange, trop beau !
Depuis que Jules avait raconté son histoire, il trouvait son papa vraiment bizarre. Là, il venait de lâcher son verre qui s’était brisé par terre. Sa maman ne le grondait même pas ! Elle l’aidait à ramasser les morceaux. Si c’était lui qui avait fait cette bêtise, il se serait fait disputer ! Et puis, ils chuchotaient. Soudain, sa maman se redressa, tout sourire.
— Jules, ça te dirait quelques dessins animés pendant que je vais préparer le repas ? C’est exceptionnel, mais aujourd’hui, tu as le droit !
L’enfant trépigna de joie. Qu’avait-il fait pour mériter une telle faveur ? Par mimétisme, Hortense s’était roulée par terre et gigotait des jambes en signe de contentement, tout en appelant son frère : « Iul ». Caroline Dupuy introduisit une cassette dans le lecteur. Ravi, le petit garçon ne se rendit pas compte que sa mère ne se dirigeait pas vers la cuisine mais qu’elle montait à l’étage. Alors que les enfants, les yeux rivés sur l’écran, gloussaient de rire devant les facéties de Donald, leur maman revint, baissa un peu le son du téléviseur et demanda à son fils :
— Après, je ne t’embête plus, mon Jules. Mais peux-tu nous dire si tu reconnais la dame sur cette photo ?
Obéissant, le garçon prit le cliché des mains de sa mère et regarda toutes les personnes de la noce qui posaient dans un beau jardin.
— C’est elle ! Je suis sûr ! affirma l’enfant en pointant son index potelé sur une jeune femme au premier rang. Mais elle n’est pas habillée pareil !
— Qui ? intervint Olivier, resté un peu à l’écart.
— La mariée… répondit sa maman d’une voix étranglée. Merci, Jules.
Elle remonta le son du poste et rejoignit son mari à l’autre bout de la pièce.
Olivier Dupuy, blême, décrocha le combiné du téléphone, composa un numéro et attendit quelques secondes.
— Allô ? Papa ? … Oui, bonjour aussi… Est-ce qu’Annie est à tes côtés ? … Tu peux mettre le haut-parleur pour qu’elle écoute ? Moi, je ne peux pas, les enfants sont là. Il faut que je te raconte un truc incroyable, complètement dingue, même. Je ne sais pas quel sens donner à tout cela…
La conversation s’interrompit dix minutes plus tard et Olivier rejoignit sa femme dans la cuisine.
— Ne t’embête pas à préparer le repas, ma chérie. On va ouvrir une boîte, ce sera très bien comme ça !
— Alors ? Leur réaction ?
— Beaucoup plus sereine que je ne l’aurais cru. Il respirait très fort et j’entendais Annie qui le pressait de questions. Je crois que la description de la broche a achevé de le convaincre. Après un long silence, il m’a dit que Jules avait le don, comme maman…
— Hein ? Ta mère aussi ? Tu ne m’en as jamais parlé…
— Je l’ignorais, ou j’avais oublié… Je la revois, avec son pendule, devant une carte d’état-major. Mais tu sais, c’est flou. Je pensais qu’il s’agissait d’un jeu. Et puis, je n’avais que sept ans quand elle est décédée… Lorsque, plus tard, j’interrogeais papa sur la femme qu’elle était, il oblitérait ce côté-là de sa personnalité, sans doute pour me protéger et ne pas me flanquer la frousse.
— Sers-moi aussi un double whisky, Olivier. J’ai les jambes en coton. Ce qui m’effraie le plus, égoïstement, ajouta Caroline, les larmes aux yeux, ce n’est pas tant l’avenir de l’adorable Annie que celui de notre fils. Tu imagines sa vie si de tels phénomènes se reproduisent ? Ce sera un enfer pour lui… Je ne comprends pas ce qui se passe. Jules ne peut pas avoir trouvé tout seul les mots de « chimiothérapie » et « aspergillose » ! Je ne sais même pas s’il connaît celui de « cancer ». On a toujours évité de parler de la maladie d’Annie devant les enfants. De la simple télépathie ? Tu sais, toi, ce qu’est au juste l’aspergillose ? Pour ma part, je n’en ai qu’une vague idée.
— Moi également. Un champignon qui se loge dans les cavités pulmonaires. Cela se soigne. Mais comment à l’hôpital on n’aurait pas fait la différence entre cette maladie et le cancer des poumons ? Annie a dû passer un tas d’examens, je suppose !
Tandis qu’ils dégustaient leur whisky à petites gorgées, chacun d’eux se retira dans un silence introspectif. Caroline songeait à son fils, Olivier à sa mère.
Les jeunes enfants, en grande partie, ont les yeux de Chimène lorsqu’ils considèrent leur maman. Olivier n’échappait pas à la règle. Et, avec le recul, lorsqu’il lui arrivait de regarder d’anciennes photos, il admettait qu’Anne-Lise Dupuy, décédée d’un mélanome à l’âge de trente-quatre ans, était en effet une très belle femme. Elle ressemblait à la cantatrice Kathleen Ferrier. Brune aux yeux bleus. Comme son père, son petit frère et lui-même avaient pu pleurer lorsque cette délicieuse fée avait déployé ses ailes diaphanes pour s’envoler au pays des songes ! La mort d’Anne-Lise, à laquelle la famille s’attendait pourtant, avait foudroyé son petit monde. C’était le 21 juin 1959, jour du solstice d’été. Maurice préparait le dîner de ses fils. Lui, accablé, sautait volontiers un repas sur deux. Le téléphone en ébonite avait alors sonné. Chez eux, les appels étaient rares à cette époque, et Maurice, l’air égaré, regardait l’appareil comme s’il se fût agi d’un noir démon. Olivier s’était levé pour répondre à l’opératrice des PTT qui les mettait en relation avec l’hôpital. Son père lui avait alors pris le téléphone des mains. Il retrouvait, après quelques secondes d’hébétude, le sens de ses responsabilités. L’infirmière du service lui annonçait que le décès de son épouse était imminent. Il fallait lui apporter une chemise de nuit ou des vêtements pour la mise en bière. Maurice répondait par monosyllabes, incapable de formuler une phrase.
— Comment va-t-on habiller maman, les enfants ? avait-il murmuré quelques minutes plus tard, d’une voix ensanglotée.
À leurs âges, Olivier et son petit frère Pierre n’avaient qu’une vague idée de la mort. Ce qui les effrayait bien davantage était le puits de chagrin dans lequel sombrait leur père. Aussi, par dérivatif, s’intéressèrent-ils à la question.
— Sa jolie chemise de nuit rose avec un col en dentelle ? proposa Maurice.
— Non, décréta Pierre du haut de ses quatre ans. Maman aura trop froid !
— Et la belle robe verte qu’elle portait à Noël ? proposa Olivier.
Ainsi, d’un commun accord, en fut-il décidé. Et comme Anne-Lise adorait aussi la broche en forme de dragon que son mari lui avait offerte pour l’anniversaire de leur mariage, père et fils l’emportèrent également dans la Dyna Panhard qui les conduisit à l’hôpital Morvan.
Jules et Hortense étaient couchés depuis une heure quand Maurice Dupuy rappela son fils et sa belle-fille. Annie avait joint son médecin traitant pour lui faire part de ses doutes. Évidemment, elle ne pouvait pas lui avouer la vérité au risque de passer pour une illuminée. « Mon petit-fils a reçu cet après-midi la visite du fantôme de sa grand-mère biologique car elle se souciait de mon sort. » Elle lui avait demandé donc, tout simplement, s’il était sûr et certain qu’il s’agissait d’un cancer des poumons. N’aurait-elle pas pu contracter une aspergillose en élevant ses pigeons voyageurs ? Le médecin, au départ sceptique, avait décrété qu’en effet, l’hypothèse méritait plus amples examens…
1
Brest, le 23 avril 2022
Lorsque l’anesthésiste réanimateur pénétra dans la chambre 12 pour sa tournée du soir, Nelly Loussouarn se trouvait déjà au chevet de la jeune femme de vingt-cinq ans, polytraumatisée et plongée dans le coma à la suite d’un accident de la route. Le docteur Jules Dupuy appréciait beaucoup de travailler avec cette infirmière aussi compétente qu’expérimentée. Proche d’une retraite qu’elle répugnait à envisager, Nelly était une femme petite et menue, aux cheveux grisonnants et courts. Contrairement aux autres membres de l’équipe où le tutoiement était de rigueur, qu’ils fussent internes, médecins, aides-soignants ou infirmiers, elle échappait à la règle et tenait au vouvoiement. Les plus jeunes la respectaient et la craignaient. Nelly était aussi imperméable à l’humour qu’un chicot au dentifrice. Et toutes les blagues qui pouvaient fuser en salle de repos tombaient toujours à plat.
L’infirmière, qui regardait le scope, se retourna aussitôt vers le médecin.
— Docteur ! Venez voir. La patiente dé-sature. Elle est à 93 %.
— Zut ! Pas de sécrétion à l’aspiration, Nelly ? Il me semble que la radio pulmonaire était bien et l’auscultation claire, ce matin…
— Non, pas de sécrétion. Je viens de vérifier. J’augmente la FiO2 ?
— Oui, allez-y. Montez à 60 %. Bon, c’est un sujet à risque… Il faut éliminer l’éventualité d’une embolie pulmonaire. Je vais demander un scanner thoracique.
— Très bien, docteur. Je vérifie s’il y a assez de midazolam et de sufentanil dans les seringues et je préviens l’aide-soignante de préparer le brancard de transport.
Une heure et demie plus tard, le docteur Jules Dupuy, avant de quitter l’hôpital de La Cavale Blanche, faisait un saut dans la salle de repos. Distrait de nature, il était persuadé d’avoir déposé le matin même, dans son vestiaire, un sac plastique contenant la thèse d’un étudiant. Peut-être l’avait-il emportée pour la feuilleter en buvant son café ? Et, en effet, il aperçut aussitôt le sac rouge et blanc sur la table, près du percolateur. Il était seul dans la pièce et prit le temps de consulter ses messages sur son portable. Rien de très important. Un SMS de sa mère pour le rappeler de retenir la date du 19 juin. Ses parents, Olivier et Caroline, fêtaient leurs quarante ans de mariage. Ils avaient loué une salle pour l’occasion et s’étaient assurés les services d’un traiteur. Ils tenaient, par-dessus tout, à ce que leurs trois enfants soient réunis ce jour-là. Blanche, la petite dernière, encore étudiante, ne posait pas problème. Hortense et son compagnon, tous deux vétérinaires, feraient le voyage depuis la Savoie où le couple s’était installé. Restait lui, Jules, et les aléas des gardes. Il répondait à sa mère en pianotant sur son clavier lorsque Marine, l’une des internes, entra à son tour dans la salle de repos. Hasard ou coïncidence ? Depuis plusieurs jours, le docteur Dupuy se devait de lui parler. Mais il était timide et le sujet épineux… De plus, c’était une ravissante jeune femme aux yeux bleus et rieurs, ce qui n’arrangeait pas les choses… Elle pouvait se méprendre et l’envoyer paître. Depuis trois mois qu’il avait intégré cet hôpital breton, il n’avait pas encore eu l’occasion de s’entretenir avec elle, seul à seule. Il se sentit soudain poussé par une force mystérieuse et l’aborda alors qu’elle se préparait un café après lui avoir souri.
— Marine ? Tu as terminé, là ? Ça te dirait de venir boire un pot avec moi quelque part ? J’aimerais bien discuter avec toi, et c’est important…
La jeune femme rougit jusqu’à la racine des cheveux. L’inconvénient des blondes à peau claire. Pour se donner une contenance, elle porta le gobelet fumant à ses lèvres et faillit se brûler au contact du breuvage.
— Heu… Oui… Pas de souci. Tu es libre quand ?
— Maintenant ; c’est possible ? Tu prends ta voiture et on se rejoint sur le port ? Aux Mouettes ? Et puis après, si tu n’as rien contre les fruits de mer, on peut aller manger un morceau au Crabe Marteau. Je t’invite.
— Très bonne idée, je commence à avoir faim ! Et puis, je n’avais rien de prévu ce soir… ajouta-t-elle à la légère pour ne pas laisser croire à cet homme qui faisait tourner la tête à toutes les célibataires du service qu’elle succombait aux charmes du premier venu.
Les prémices de leur rendez-vous déçurent la jeune femme qui, malgré tout, s’attendait à un autre préambule. Le docteur Dupuy venait de commander deux bières à la terrasse de cette institution brestoise quand il lui déclara à brûle-pourpoint :
— Je discutais l’autre jour avec Nicolas, l’un des kinés, lorsque tu es passée dans le couloir. Il m’a dit alors que tu étais la fille du commissaire Le Gwen. C’est exact ?
Marine se contenta d’acquiescer d’un signe de tête. Le charme était rompu. Ce n’était pas la première fois qu’un homme s’immisçait dans son cercle intime pour obtenir une faveur ou un passe-droit. Elle revécut en pensée l’instant fort désagréable où Alexandre, son ex-petit ami, l’avait suppliée d’intercéder auprès de son père. Flashé à moto sur la voie express à 180 km/heure, il avait perdu son permis.
— Alcool ou stup au volant ? Excès de vitesse ? Incivilités ? le questionna-t-elle, la mine revêche.
Incrédule, il la sonda de son regard noisette si clair que ses iris paraissaient presque dorés. Insoutenable… Elle baissa les yeux.
— Je crois que tu te méprends sur mes intentions, Marine, déclara-t-il d’une voix douce. Une jeune fille me harcèle tous les jours pour que ton père retrouve sa petite sœur…
— Ben, pourquoi ne se rend-elle pas elle-même au commissariat ?
— Parce qu’elle est morte…
Il allait ajouter autre chose mais se tut parce que le serveur apportait leur commande. Face à son demi pression, la jeune femme, malgré le temps clément, était parcourue de frissons. En digne fille de son père, Marine Le Gwen n’était en rien trouillarde. Mais cette déclaration abracadabrantesque la laissait pantoise. Pourtant, le nouvel anesthésiste leur avait paru à tous sain d’esprit…
Jules Dupuy regarda le serveur s’éloigner et reprit :
— Je dois t’avouer quelque chose, Marine. J’aimerais bien que cela reste entre nous et ne fasse pas le tour du service. Voilà… Je ne l’ai pas choisi, pas voulu ; c’est un poids plus qu’un don mais c’est ainsi : je suis médium.
— Voyant, tu veux dire ?
— Non, médium. Je vois ou j’entends les défunts. Je ne lis pas l’avenir dans les cartes ou une boule de cristal. D’habitude, je n’aime pas que les sceptiques me testent, même s’ils sont légion. Je l’accepte lorsque je travaille avec la police ou la gendarmerie dans des cas de disparition. Mais pour toi, je ferai une exception parce que je tiens à ton estime… Tout à l’heure, quand tu es arrivée, tu étais accompagnée d’un chat. Il est toujours là, d’ailleurs, et dort la tête posée sur ta chaussure droite…
Livide, Marine regarda machinalement ses pieds. La position peu banale du chat endormi la bouleversait, et pour cause…
— Tu peux me le décrire ? balbutia-t-elle.
— Bien sûr ! C’est un beau matou gris, un chartreux aux yeux jaunes. Le bout de sa queue est cassé. Une mobylette l’a heurté lorsqu’il était jeune. Il porte au cou un collier turquoise orné d’un pompon rouge. Il s’appelle Momisa.
La jeune femme cacha son visage de ses mains. Elle pleurait son chat qu’elle avait dû faire piquer six mois auparavant. Tout concordait, même le nom. Personne, hormis ses parents, ne savait qu’elle l’appelait Momisa en privé et non Mimosa, vestige d’une légère dyslexie enfantine. Il y avait quelque chose d’effrayant chez cet homme… Parce qu’elle ne comprenait pas, et qu’elle détestait ne pas comprendre. Télépathie ? Elle n’avait plus pensé à son chat décédé depuis quelques jours. Ce n’était donc pas là l’explication. Aurait-il eu ces renseignements précis en consultant ses réseaux sociaux ? D’anciennes photos de Momisa ? Étant donné sa filiation particulière, elle utilisait un pseudo pour plus de sécurité. Un voyou ou malfrat, arrêté par son père, aurait pu avoir la mauvaise idée de se venger sur elle. Décontenancée, les larmes aux yeux, Marine s’entendit prononcer :
— Est-ce qu’il va bien ?
— Très bien. Il vit sa vie de chat ailleurs mais il aime beaucoup t’accompagner, aussi, de temps en temps. Rassure-toi sur son sort.
— Vous… heu… Tu as, bafouilla-t-elle, ce don depuis longtemps ? C’est merveilleux !
Le docteur Dupuy but une gorgée de bière et lui sourit.
— Le terme est mal choisi et, lorsque j’ai eu ma toute première visite un peu spéciale, à l’âge de cinq ans, je te jure que je m’en serais bien passé… Je ne comprenais pas pourquoi les autres ne voyaient ou n’entendaient pas ce dont j’étais témoin.
Et de lui raconter l’expérience psychique quand, enfant, il avait réussi à sauver sa « Nanie » grâce à l’intervention de sa grand-mère biologique.
— Elle était bien atteinte d’une aspergillose et non d’un cancer. Un traitement à base de corticostéroïdes et d’antifongique fit l’affaire et tout fut réglé quinze jours plus tard. Cette fois-là, j’étais devenu un « héros » malgré moi. En revanche, ça s’est furieusement gâté deux ans plus tard, en CP. J’étais en classe lorsque j’ai eu une deuxième visite. Un homme effrayant, couvert de sang. Je n’ai pas crié parce qu’il était doux et triste. Il venait d’être victime d’un accident à l’arsenal et voulait que j’embrasse son fils pour lui. En toute innocence, j’ai traversé la classe et je me suis penché vers Nicolas pour l’embrasser. La maîtresse m’a demandé ce que je fichais là. Pris en faute, j’ai déclaré devant tous mes camarades : « Ce n’est pas de ma faute, maîtresse ! Le papa de Nicolas vient de mourir. Il me demande de lui faire un bisou et de lui dire qu’il l’aime. » Je te laisse deviner la suite…
— J’imagine, en effet… Tu as dû effrayer tout ce petit monde…
— D’autant plus qu’on est venu chercher Nicolas au moment où nous nous rangions pour aller à la cantine. Raison familiale… Deux incidents du même acabit et j’ai été rejeté par tous mes copains qui m’appelaient « le sorcier ». Mes parents, avec l’assentiment du directeur de l’école et du rectorat, ont été forcés de me déscolariser en milieu d’année de CE1. Dans mon malheur, j’ai eu de la chance d’avoir des parents intelligents, bienveillants et drôles. Maman, architecte d’intérieur, a pris une dispo et m’a fait l’école à la maison. Mon père prenait le relais, le soir et le samedi. J’ai appris des tas de choses en m’amusant et en me promenant. Mon seul chagrin était de ne pas avoir de copains.
— Je comprends, murmura Marine. Ton auto-exclusion a duré longtemps ?
— Le temps d’apprendre à être autre chose qu’une éponge, à discipliner mes visions, à faire la différence entre la réalité terrestre et celle de l’au-delà, à reconnaître les signes corporels qui annoncent ces visites particulières, comme des acouphènes dans l’oreille gauche, par exemple. Et surtout, apprendre à me taire ! Tu connais sûrement ce proverbe juif à propos de l’éducation des enfants ? Les parents doivent leur donner des racines et des ailes. Mes ailes étaient sur-dimensionnées… J’ai travaillé à approfondir mes racines pour garder les pieds sur terre. Il m’a fallu deux ans.
— Quelqu’un de ta famille a les mêmes dispositions ?
— Non, personne, excepté ma grand-mère, Anne-Lise, celle qui m’est apparue lorsque j’avais cinq ans. D’après mon grand-père, elle tirait les cartes, avait un don de voyance mais pas de médiumnité. Sinon, ma plus jeune sœur, Blanche, a autant d’intuition qu’un caillou en ce qui concerne ses choix sentimentaux… On en rit en famille mais on frémit lorsqu’elle veut nous présenter un garçon « trop génial ». Des dadais boutonneux, pseudo-artistes, pleins de suffisance et qui se shootent à la colle « Cléopâtre » pour faire genre… J’exagère à peine !
Jules Dupuy s’étira, un sourire attendri aux lèvres. Il était clair pour la jeune femme qu’il avait la chance d’être un maillon d’une famille unie et aimante. Très beau garçon au demeurant, intelligent, sensible et totalement atypique, il ne devait pas être en reste, lui non plus, niveau conquêtes. Donc, méfiance…
— Mais comment expliques-tu ce don, alors ?
— Je n’en sais fichtre rien. Tout au plus une hypothèse élaborée avec l’aide de mes parents. Ma naissance a été problématique. Je suis sorti du ventre de ma mère inconscient, étouffé par trois tours de cordon. Il a fallu me réanimer. Évidemment, je n’ai aucun souvenir, mais il est possible que j’aie fait une EMI.
— Une expérience de mort imminente ?
— Oui, même si les expérimentateurs, pas plus de 3 % de personnes réanimées après un arrêt cardiaque, se souviennent de leur aventure… Ou du moins, osent l’avouer, corrigea-t-il. Les Français sont un peuple de sceptiques. On est très en retard dans ce domaine au sein de l’Europe. Et que dire par rapport aux États-Unis… Tu n’as pas faim, Marine ?
2
Il racle les semelles de ses bottes sur le paillasson avant d’entrer dans la cuisine. Geste aussi machinal qu’inutile, du reste. L’intérieur est aussi sale que l’extérieur. Ou aussi propre. Question de point de vue. Sa mère n’est pas une fée du logis, loin s’en faut. D’ailleurs, avec sa patte folle, dernière petite gâterie du père avant de mourir, elle aurait du mal à faire le ménage. Au fond de la cour, dans la pénombre crépusculaire, se détache la silhouette noire du hangar. Tout semble calme de ce côté.
L’ampoule nue du plafonnier éclaire mal la cuisine. Sa mère est aux fourneaux. Elle a posé sa béquille, « sa troisième jambe » comme elle se plaît à plaisanter, contre la table. Il la salue de l’encadrement de la table. Pas d’embrassades entre eux. Vieille habitude. Ils savent qu’ils peuvent compter l’un sur l’autre et c’est l’essentiel. Un agréable fumet embaume la pièce et il s’aperçoit qu’il a faim.
— T’as fait quoi à dîner, m’an ?
— Civet de lapin. Il en restait un au congèle.
Le couvert est mis et l’homme s’assied à sa place, face à la fenêtre. Même si la saison de chasse est terminée depuis belle lurette, il ne lui répugne pas d’attraper un lapin au collet de temps en temps. À l’autre bout de la table, il avise alors les deux gamelles en métal posées sur la toile cirée.
— Tu as nourri les chiennes aujourd’hui ?
— Non, il ne reste plus de boîtes de pâtée. Mais hier soir, je leur ai fait une soupe avec ce que j’ai trouvé : du vieux pain, du lait et des restes de viande. Séréna a tout lapé mais la petite n’a pas touché à sa gamelle. Elle n’a pas l’air en forme.
— Ah bon ? s’inquiète l’homme. Tu crois qu’elle est malade ?
— Non, mais je pense qu’elle manque d’exercice. Je la trouvais rouillée.
— OK. Je la sortirai un peu après dîner.
Quand il avait récupéré ses chiennes, l’année précédente, c’était l’année des S. Aussi les a-t-il baptisées Séréna pour l’une et Sonia pour l’autre.
Ils mangent en silence devant l’écran de télévision. Aux informations, le sempiternel reportage sur la guerre en Ukraine le laisse de marbre. À dire vrai, le malheur des autres ne l’intéresse pas. Cependant, le visage d’une jeune réfugiée le touche. Elle est arrivée d’Odessa avec sa mère il y a deux mois et toutes deux ont été accueillies dans une famille nantaise. La gamine se débrouille déjà bien en français, il doit l’admettre. Elle raconte sa nouvelle vie au lycée mais il ne l’écoute pas, charmé par sa voix mélodieuse, ses cheveux blonds soyeux et ses grands yeux bleus. Elle l’inspire, cette petite… Inutile d’en parler à sa mère. Elle ne voudrait pas…
Il a bien mangé, repousse son assiette devant lui, essuie son canif avec le torchon et le replie pour le fourrer dans sa poche. Puis il se lève, va chercher l’arrosoir dans la petite pièce attenante à la cuisine et qui sert vaguement de buanderie, le remplit d’eau. En sifflotant, il retourne ensuite prendre les deux gamelles sur la toile cirée, laisse sa mère devant la télé et sort de la maison. La nuit est tombée mais il n’a aucun souci pour se déplacer dans l’obscurité. Son côté félin, comme il aime le répéter à qui veut l’entendre. Être nyctalope n’est pas donné à tout un chacun et il apprécie ce don de la nature à sa juste valeur. Pour être honnête, il a aussi travaillé et développé cette aptitude depuis l’enfance, quand il quittait la maison endormie pour noctambuler sans but précis dans les bois environnants ou marauder dans quelque ferme isolée.
Il dépose son arrosoir et les gamelles sur la terre battue pour fourrager dans la vaste poche de son bleu de travail, à la recherche de la clé qui ouvre le cadenas de la porte du hangar. Les chiennes doivent entendre le cliquetis de la chaîne mais elles se taisent. Pure question de dressage. À l’intérieur du bâtiment désaffecté, il allume l’interrupteur. Une lumière blafarde laisse deviner plus qu’elle ne les éclaire les machines agricoles mises au rebut depuis des décennies. La graisse et la poussière accumulée les enveloppent d’une gangue grisâtre intéressante, tel le voile d’une mariée centenaire. Il se dirige vers le fond du hagard, là où sont les cages grillagées, et siffle. Dans la pénombre, la tête de Séréna apparaît.
— S’il vous plaît, murmure-t-elle d’un filet de voix, j’ai soif…
— Et tu as prononcé le petit mot magique ? Moi, je n’ai rien entendu…
— S’il vous plaît, Maître…
— Tss, tss, tss… hoche-t-il la tête. On dirait que tu le fais exprès. Combien de fois devrai-je le répéter ? Toutes vos phrases doivent commencer par « Maître ». Ce n’est pas compliqué tout de même !
La jeune fille n’est pas dupe du ton doucereux. Il présage des violences pires que lorsqu’il se met en colère.
— Maître, s’il vous plaît, de l’eau…
L’homme, jambes légèrement écartées, poings sur les hanches, la regarde, sourire carnassier aux lèvres. Si elle veut tenter d’apaiser sa gorge qui la brûle, elle doit anticiper les désirs du monstre. Alors, elle se met à quatre pattes, les bras bien en avant, les fesses en l’air, position qu’adopterait un chien obéissant quémandant sa pâtée. Elle attend ainsi quelques minutes. Elle ne doit pas le regarder. Le bruit de l’eau giclant contre le métal de la gamelle lui fait monter des larmes de reconnaissance aux yeux. Mais elle ne bouge pas avant qu’il ne lui en donne l’autorisation. Il ouvre sa cage et place la gamelle entre ses mains, posées à plat sur le ciment rugueux.
— Tu peux…
Elle se précipite sur le récipient et se met à laper l’eau avec avidité. Si Séréna s’était emparé de la gamelle et avait porté ses lèvres sur les bords afin de boire normalement, il la lui aurait confisquée immédiatement après lui avoir jeté l’eau à la figure. Par bonheur, le monstre quitte son champ de vision. Par malheur, il s’intéresse à présent à Sonia, parquée dans une cage jumelle, attenante à la sienne. Le moral de la petite inquiète beaucoup son aînée de deux ans. Sonia se laisse dériver. Elle veut mourir. Ou, tout du moins, en finir une bonne fois pour toutes ; ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Leur captivité partagée crée forcément des liens entre elles deux. Toutefois, Séréna doit admettre que ces liens peuvent être ténus lorsqu’elles se retrouvent en présence de leurs bourreaux : le monstre ou sa mère. Lequel est le pire des deux ? Elle ne saurait le dire. Mais dans ces moments-là, le sauve-qui-peut est de mise. Ce fichu instinct de survie prévaut alors sur leur légitime solidarité.
— Sonia, approche du grillage, ma petite chienne chérie… La mère ne te trouve pas en forme… Viens, que je t’examine…
La voix sirupeuse de l’homme donne des nausées à Séréna qui s’arrête de laper pour mieux écouter. Sonia dort-elle ou fait-elle semblant ? Dans la seconde hypothèse, elle va prendre cher.
— Ah ! Voilà ! Gentille petite bête… Tends-moi ton collier pour que je t’attache à la laisse. On va faire une promenade tous les deux. Tu vas pouvoir te dégourdir les pattes. Après, tu auras le droit de boire aussi. Pour manger, il faudra attendre demain. La mère a oublié d’acheter des boîtes.
Séréna a entendu le cliquetis du cadenas. Même si la promenade se résume à faire trois ou quatre fois le tour du hangar, elle permet néanmoins d’apaiser un instant leurs muscles douloureux. La deuxième partie du programme est beaucoup moins réjouissante. Tout dépend de la forme physique du monstre. Le viol n’est pas automatique. Machinalement, la jeune fille pose son regard sur le vieux matelas éventré et puant qui trône au milieu du hangar, à même le sol en terre battue.
Sonia ne peut s’empêcher d’émettre un cri douloureux lorsqu’elle sort de la cage et qu’elle s’étire. À deux mètres d’elle, à l’autre bout de la chaîne, un fouet à la main, l’homme la menace.
— Attention, petite ! Pas de simagrées avec moi ! Ça ne marche pas ! Si tu veux retourner tout de suite au chenil, continue à te plaindre ! Je rajoute de la longe. Tu vas pouvoir courir comme dans un manège. Mais pas un mot !
Séréna est arrivée, la première des deux, dans cet endroit qu’elle ne connaît pas, le 30 décembre de l’année passée. La troisième cage, vide à présent, était occupée par une fille prénommée Rosa. Elles ont passé trois jours ensemble avant que Rosa ne disparaisse à tout jamais. La jeune fille se doute de la raison de son élimination mais refuse d’y penser.
Ce jour-là, le monstre lui a expliqué la conception de leurs geôles. Il s’était inspiré d’un roi de France… un Louis quelque chose. Louis XI, croit-elle se souvenir. Ce monarque gardait ces prisonniers dans des cages appelées « fillettes ». Elles n’étaient pas tout à fait assez hautes pour que l’on puisse tenir debout ni tout à fait assez longues pour que le corps puisse s’allonger. Et c’est dans ce « pas tout à fait » que résidait la finesse de ce supplice. Personne, hormis sans doute les paralytiques, songe Séréna, ne pense à l’extrême bonheur de pouvoir étirer son corps quand le besoin lui en prend. C’est un geste naturel lorsque l’on se réveille, par exemple. Malgré la rage et la douleur qui l’étreignent, la jeune fille s’oblige à regarder sa cadette trottiner en rond autour du monstre. La longe est attachée au collier en mailles de fer que chacune d’elles porte. Impossible de l’enlever. Elles ont essayé sans succès. Si elles s’éloignent un tant soit peu du cercle consenti, un simple rappel à l’ordre suffit. Leur bourreau diminue aussitôt la longueur de la longe et elles manquent de s’étrangler ou de se briser la nuque.
Sonia s’arrête, à bout de souffle. Le manque d’exercices se lit sur son jeune corps. Elle a encore maigri et perd du muscle. Elle est nue depuis près d’une semaine et ne porte que ses tennis blanches. Quel jour était-ce ? L’une comme l’autre ne sauraient le dire : elles ont perdu la notion du temps. Pas totalement pourtant, grâce à leurs règles. Le jour où elles ne saignent plus, elles ont le droit de se laver. Une fois par mois, donc. C’est une toilette très sommaire. L’homme pose un seau d’eau froide près de l’une des cages et un bout de savon de Marseille usé. Il faut procéder par ordre. Shampoing rudimentaire d’abord, puis le reste du corps. Il n’y a jamais eu de serviettes pour s’essuyer. Elles ont juste la possibilité de s’étriller avec une poignée de paille du tas posé au sol, la même qui sert à changer leur litière, une fois par semaine. Elles attendent toutes deux le dimanche avec une impatience inavouée et inavouable. Ce jour-là, le tordu arrive en poussant une brouette, suivi de la boiteuse. Le même rituel s’installe entre mère et fils, les mêmes blagues qui ne font rire qu’eux.
— C’est dimanche, mes p’tites chiennes ! On vient vous mettre au propre et au sec !
— Pour sûr ! répond la vieille. Faudrait pas que t’attrapes une maladie, fiston, à gâter comme tu le fais ces salissures !
À tour de rôle, chacune est sortie de sa cage et surveillée au bout de sa laisse par la mère, pendant que le rejeton manie la fourche, retire la paille souillée pour la remplacer par une litière propre.
Sauf que, dimanche dernier, il s’est passé une chose insolite. Une proposition qui n’avait jamais eu lieu auparavant.
— C’est le jour de bonté de la mère, mes pt’ites chiennes. Elle trouve que vous puez trop et votre odeur de pisseuses la dérange. Elle n’a pas trop de travail aujourd’hui et veut bien faire tourner la machine à laver et le sèche-linge. Si ça vous tente, foutez-vous à poil. Jetez vos fringues dans la brouette. Vous les retrouverez propres et secs dans l’après-midi. Je ne peux pas vous promettre que vos frusques seront repassées ! Faut pas exagérer non plus !
Et l’un comme l’autre de s’esclaffer d’un rire gras.
Aussitôt, Sonia s’est déshabillée. C’était devenu une obsession pour la petite qui ne pouvait plus supporter ses vêtements raidis par la crasse. Séréna, quant à elle, a hésité puis s’est abstenue, prétextant qu’elle ne résisterait pas au froid. Le goret l’a regardée d’un air méprisant.
— La mère ! Reluque-moi un peu cette petite bourge !