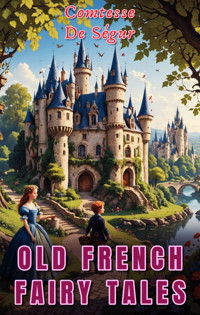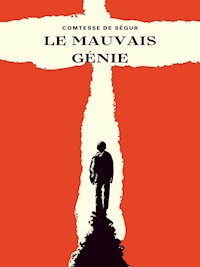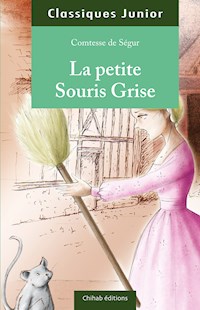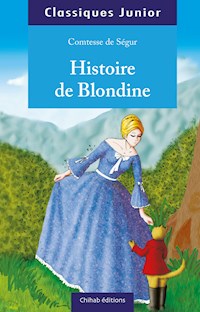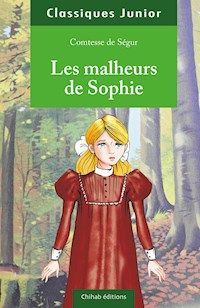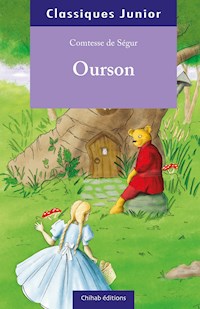Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Pauvre Blaise" de la Comtesse de Ségur est un roman qui explore la vie d'un jeune garçon nommé Blaise, dont la bonté et la générosité sont mises à l'épreuve dans un monde souvent indifférent à la vertu. Le récit débute dans un petit village français où Blaise, issu d'une famille modeste, se distingue par son altruisme et son désir d'aider autrui. Orphelin de mère, il vit avec son père, un homme simple et honnête, mais la vie les pousse à quitter leur village pour Paris, à la recherche d'une existence meilleure. Dans la capitale, Blaise fait face à de nouveaux défis : la tentation de la facilité, les moqueries de ses camarades de classe, et les injustices du monde adulte. Malgré ces obstacles, il reste fidèle à ses valeurs, trouvant des alliés inattendus en la personne de personnages aussi variés qu'un instituteur bienveillant et une vieille dame excentrique. La Comtesse de Ségur, avec son talent habituel pour peindre des portraits vivants et nuancés, illustre à travers Blaise l'importance de la bonté et de la résilience. Ce roman, tout en étant une critique sociale subtile, est également une ode à la force morale et à l'innocence de l'enfance dans un monde en mutation. L'AUTEUR : La Comtesse de Ségur, née Sophie Rostopchine en 1799 à Saint-Pétersbourg, est une figure emblématique de la littérature pour enfants du XIXe siècle. Fille du comte Fiodor Rostopchine, elle quitte la Russie pour la France à l'âge de 19 ans. Mariée au comte Eugène de Ségur, elle se consacre à l'éducation de ses huit enfants, ce qui l'inspire dans l'écriture de ses célèbres ouvrages pour la jeunesse. Publiée pour la première fois à l'âge de 58 ans, elle rencontre le succès avec des titres comme "Les Malheurs de Sophie" et "Les Petites Filles Modèles". Ses oeuvres, souvent marquées par un mélange de réalisme et de moralité, dépeignent les joies et les peines de l'enfance avec une sensibilité unique. La Comtesse de Ségur, décédée en 1874, a laissé un héritage littéraire durable, ses livres continuant à être lus et appréciés par des générations de jeunes lecteurs. Sa capacité à capturer les nuances de l'enfance et à aborder des thèmes universels avec une telle délicatesse fait d'elle une auteure incontournable dans le domaine de la littérature enfantine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
LES NOUVEAUX MAITRES
PREMIERE VISITE AU CHATEAU
LA RÉPARATION ET LA RECHUTE
LE CHAT-FANTOME
UN MALHEUR
VENGEANCE D'UN ELEPHANT
LA MARE AUX SANGSUES
LES FLEURS
LES POULETS
LE RETOUR DE JULES
LE CERF-VOLANT
L'ACCENT DE VÉRITÉ
LE REMORDS
LES DOMESTIQUES
L'AVEU PUBLIC
L'OBÉISSANCE
LA CORRESPONDANCE
LA COMTESSE DE TRÉNILLY
L'ENTORSE
L'EPREUVE
LE GRAND JOUR
CONCLUSION
Pauvre Blaise
I
LES NOUVEAUX MAITRES
Blaise était assis sur un banc, le menton appuyé dans sa main gauche. Il réfléchissait si profondément qu'il ne pensait pas à mordre dans une tartine de pain et de lait caillé que sa mère lui avait donnée pour son déjeuner.
«A quoi penses-tu, mon garçon? lui dit sa mère. Tu laisses couler à terre ton lait caillé, et ton pain ne sera plus bon.
BLAISE
Je pensais aux nouveaux maîtres qui vont arriver, maman, et je cherche à deviner s'ils sont bons ou mauvais.
MADAME ANFRY
Que tu es nigaud! Comment veux-tu deviner ce que sont des maîtres que personne de chez nous ne connaît?
BLAISE
On ne les connaît pas ici, mais les garçons d'écurie qui sont arrivés hier avec les chevaux les connaissent, et ils ne les aiment pas.
MADAME ANFRY
Comment sais-tu cela?
BLAISE
Parce que je les ai entendus causer pendant que je les aidais à arranger leurs harnais; ils disaient que M. Jules, le fils de M. le comte et de Mme la comtesse, les ferait gronder s'il ne trouvait pas son poney et sa petite voiture prêts à être attelés; ils avaient l'air d'avoir peur de lui.
MADAME ANFRY
Eh bien, cela prouve-t-il qu'il soit méchant et que les maîtres sont mauvais?
BLAISE
Quand de grands garçons comme ces gens d'écurie ont peur d'un petit garçon de onze ans, c'est qu'il leur fait du mal.
MADAME ANFRY
Quel mal veux-tu que leur fasse un enfant?
BLAISE
Ah! voilà! C'est qu'il va se plaindre, et que son père et sa mère l'écoutent, et qu'ils grondent les pauvres domestiques. Je dis, moi, que c'est méchant.
MADAME ANFRY
Et qu'est-ce que ça te fait, à toi? Tu n'es pas leur domestique; tu n'as pas à te mêler de leurs affaires. Reste tranquille chez toi, et ne va pas te fourrer au château comme tu faisais toujours du temps de M. Jacques.
BLAISE
Ah! mon pauvre petit M. Jacques! En voilà un bon et aimable comme on n'en voit pas souvent. Il partageait tout avec moi; il avait toujours une petite friandise à me donner: une poire, un gâteau, des cerises, des joujoux; et puis, il était bon et je l'aimais! Ah! je l'aimais!... Je ne me consolerai jamais de son départ.»
Et Blaise se mit à pleurer.
MADAME ANFRY
Voyons, Blaise, finis donc! Quand tu pleurerais tout ce que tu as de larmes dans le corps, ce n'est pas cela qui les ferait revenir. Puisque son père a vendu aux nouveaux maîtres, c'est une affaire faite, et tes larmes n'y peuvent rien, n'est-ce pas? Moi aussi, je regrette bien M. et Mme de Berne, et tu ne me vois pourtant pas pleurer...»
Mme Anfry fut interrompue par le claquement d'un fouet et une voix forte qui appelait:
«Holà! le concierge! Personne ici?»
Mme Anfry accourut; un domestique à cheval et en livrée était à la grille fermée.
«C'est vous qui êtes concierge, ici? Tenez la grille ouverte; M. le comte arrive dans cinq minutes, dit-il d'un air insolent.
—Oui, Monsieur, répondit Mme Anfry en saluant.
—Tout est-il en état au château?
—Dame! Monsieur, j'ai fait de mon mieux pour satisfaire les maîtres, répondit timidement Mme Anfry.
—C'est bon, c'est bon», reprit le domestique en fouettant son cheval.
Mme Anfry ouvrit la grille tout en suivant des yeux le domestique, qui galopait vers le château.
«Il n'est guère poli, celui-là, murmura-t-elle; il aurait pu tout de même parler plus honnêtement. Blaise, mon garçon, continua-t-elle plus haut, cours au château et préviens ton père que les nouveaux maîtres arrivent, qu'il vienne vite me rejoindre pour les recevoir à la grille.
—Où le trouverai-je, maman? dit Blaise.
—Dans les chambres du château, qu'il arrange et nettoie depuis ce matin; va, mon garçon, va vite.»
Blaise partit en courant; il entra dans le vestibule, où il trouva cinq ou six domestiques qui allaient et venaient d'un air effaré.
«Halte-là, petit! lui cria un des domestiques; les blouses ne passent pas. Qui demandes-tu?
—Je cherche mon père, Monsieur, pour recevoir les maîtres, répondit Blaise.
Maman m'a dit qu'il était au château.»
Et Blaise voulut entrer dans l'appartement; le domestique le saisit par le bras:
LE DOMESTIQUE
Je t'ai dit, gamin, qu'on ne passait pas en blouse. Ton père n'est pas au château; ce n'est pas sa place ni la tienne non plus. Va le chercher ailleurs.
BLAISE
Mais pourtant maman m'a dit...
LE DOMESTIQUE
Vas-tu finir et t'en aller, raisonneur! Si tu ajoutes un mot, je t'époussetterai les épaules du manche de mon plumeau.»
Le pauvre Blaise se retira le cœur un peu gros, et retourna tristement à la grille, où l'attendait sa mère.
«Ils n'ont pas voulu me laisser entrer, maman; ils ont dit que papa n'était pas au château, et que je n'y pouvais pas entrer en blouse. Du temps de M. Jacques, j'y entrais bien, pourtant.
—Je crains que tu n'aies deviné juste, mon pauvre Blaise, dit Mme Anfry en soupirant. On dit: tels maîtres, tels valets. Les valets ne sont pas bons, il se pourrait que les maîtres ne le fussent pas non plus... Comment allons-nous faire? Ils ne seront pas contents si ton père n'est pas ici pour les recevoir.
Un concierge doit être à sa grille.
BLAISE
Voulez-vous que je retourne au château, maman? Je le trouverai peut-être aux écuries.
MADAME ANFRY
Trop tard, mon ami, trop tard; j'entends claquer des fouets. Ce sont les maîtres qui arrivent.»
Comme elle achevait ces mots, elle vit accourir Anfry, essoufflé et suant, juste au moment où un nuage de poussière annonçait l'approche de la voiture de poste.
Anfry se plaça, le chapeau à la main, d'un côté de la grille; Mme Anfry se rangea avec Blaise de l'autre côté: la berline attelée de quatre chevaux de poste apparut, tourna au galop et enfila l'avenue du château. Elle passa si rapidement que Blaise eut à peine le temps d'apercevoir un monsieur et une dame au fond de la voiture, un petit garçon et une petite fille sur le devant.
Ils passèrent sans répondre aux révérences de Mme Anfry et aux saluts du concierge; la petite fille seule salua.
Quand la voiture fut hors de vue, le mari et la femme se regardèrent d'un air chagrin; ils fermèrent lentement la grille, rentrèrent sans mot dire dans leur maison et s'assirent près d'une table sur laquelle était préparé leur frugal dîner. Blaise vint les rejoindre et, de même que ses parents, se plaça silencieusement près de la table.
«Mon ami, dit enfin Mme Anfry, comment trouves-tu les domestiques des nouveaux maîtres?
—Mauvais, répondit Anfry; grossiers, mauvaises langues. Mauvais, répéta-t-il en soupirant.
MADAME ANFRY
Blaise craint que les maîtres ne soient guère meilleurs.
ANFRY
Cela se pourrait bien! Ce ne sera pas comme avec les anciens qui n'y sont plus. Blaise, mon garçon, ajouta-t-il en se tournant vers lui, ne va pas au château; n'y va que si on te demande, et restes-y le moins possible.
BLAISE
C'est bien ce que je compte faire, papa; je n'ai pas du tout envie d'y aller.
Quand mon cher petit M. Jacques y demeurait, c'était bien différent; je l'aimais et il voulait toujours m'avoir... Je ne le reverrai peut-être jamais!
Mon Dieu! mon Dieu! que c'est donc triste d'aimer des gens qui vous quittent.»
Et le pauvre Blaise versa quelques larmes.
ANFRY
Allons, Blaise, du courage, mon garçon! Qui sait? tu le reverras peut-être plus tôt que tu ne penses. M. de Berne m'a bien promis qu'il tâcherait de me placer dans son autre terre, où il va habiter.
BLAISE
Et puis il la vendra encore, et il nous faudra encore changer de maîtres.
ANFRY
Mais non; tu ne sais pas et tu parles comme si tu savais. L'autre terre est une terre de famille, qui ne doit jamais être vendue; tandis que celle-ci était de la famille de Madame, et ils ne pouvaient pas habiter deux terres à la fois. Est-ce vrai?
—A quoi sert de parler de tout cela? dit Mme Anfry. Mangeons notre dîner; veux-tu du fromage, Blaisot, en attendant la salade aux œufs durs?»
Blaise accepta le fromage, puis la salade, et, tout en soupirant, il mangea de bon appétit, car, à onze ans, on pleure et on mange tout à la fois.
Le reste du jour se passa tranquillement pour la famille du concierge; personne ne les demanda. Quand la nuit fut venue, ils mirent les verrous à la grille, le concierge fit sa tournée pour voir si tout était bien fermé, et il rentra pour se coucher. Sa femme et son fils dormaient déjà profondément.
II
PREMIERE VISITE AU CHATEAU
«M. le comte demande le concierge», dit d'une voix impérieuse un des domestiques du château.
C'était de grand matin. Mme Anfry faisait son ménage, Blaise nettoyait la vaisselle, et Anfry était allé scier du bois pour les fourneaux de la cuisine et de la lingerie.
Le domestique avait ouvert bruyamment la porte et restait sur le seuil; il regardait le modeste mobilier du concierge.
«Votre mobilier ne fait pas honneur à vos anciens maîtres, dit le valet en ricanant; si M. le comte passait par ici, il vous ferait bien vite changer tout cela.
—Qu'est-ce que vous trouvez à mon mobilier qui parle contre les anciens maîtres? répondit vivement Mme Anfry. Est-ce qu'il y manque quelque chose? Tout n'est-il pas en bon état? C'était de bons maîtres, ceux qui n'y sont plus, et je n'en demande pas de meilleurs au bon Dieu.
LE DOMESTIQUE
Ha! ha! le bon Dieu! Comme s'il se mêlait d'un concierge et de son mobilier.
MADAME ANFRY
Le bon Dieu se mêle de tout, et d'un pauvre concierge tout comme d'un prince et d'un roi; et je n'entends pas qu'on se raille du bon Dieu chez moi, entendez-vous bien!
LE DOMESTIQUE
Voyons, voyons, Madame la concierge, il ne faut pas vous emporter pour un mot dit en plaisanterie; mais M. le comte demande le concierge et je ne le vois pas ici.
MADAME ANFRY
Il est au château à scier du bois; allez le chercher là-bas, vous lui ferez la commission.
LE DOMESTIQUE
Si vous y envoyiez votre garçon, cela me donnerait le temps d'aller faire un tour au village et de faire connaissance avec les cafés.
MADAME ANFRY.
Mon garçon n'a que faire au château; on lui a dit hier qu'on n'y entrait pas en blouse; il ne se mettra pas en prince pour y aller, et il n'ira pas.
LE DOMESTIQUE.
Vous êtes maussade, Madame la concierge; mais prenez-y garde, on pourrait bien chercher à vous remplacer et à vous faire partir.
MADAME ANFRY
Comme vous voudrez. Si les maîtres sont comme les valets, je ne tiens pas à y rester; nous sommes connus dans le pays, et nous ne manquerons pas de travail ni de place, mon mari et moi.»
Le domestique vit qu'il n'y avait rien à gagner en continuant la conversation; il se retira en grommelant, et remonta lentement l'avenue du château. Il trouva le concierge au bûcher, comme le lui avait dit Mme Anfry.
«M. le comte vous demande, lui dit-il brusquement.
—Je ne suis guère en toilette pour me présenter chez M. le comte, répondit Anfry.
—Puisqu'il vous demande, c'est qu'il vous veut comme vous êtes, reprit le domestique d'un ton bourru.
—C'est vrai», se borna à répondre Anfry.
Et, laissant son travail, il remit sa veste, secoua la poussière de ses pieds, et se dirigea vers le château.
«Où allez-vous? lui dit rudement un domestique qui balayait l'escalier.
—M. le comte m'a fait demander.
—Est-ce bien sûr?... Passez alors, quoique vous soyez bien mal vêtu pour paraître devant M. le comte.
—Qu'à cela ne tienne; j'aime autant ne pas y aller.»
Et Anfry se mit à redescendre l'escalier qu'il avait monté à moitié.
«Mais non, je ne dis pas cela. Puisque M. le comte vous a demandé, c'est qu'il veut vous voir.
—Alors, gardez vos réflexions pour vous», dit Anfry en remontant l'escalier.
Il arriva à la porte du comte de Trénilly et frappa discrètement.
«Entrez!» lui cria-t-on.
Anfry entra; il vit un homme de trente-cinq à trente-six ans, d'assez belle apparence, l'air hautain, mais le regard assez doux. Anfry salua; le comte répondit par un léger signe de tête.
«Vous avez des enfants? dit-il d'un ton bref.
ANFRY
Un seul, monsieur le comte.
LE COMTE
Garçon ou fille?
ANFRY
Garçon.
LE COMTE
Quel âge?
ANFRY
Onze ans.
LE COMTE
Envoyez-le au château.
ANFRY
Pour quel service, Monsieur le comte?
LE COMTE
Pour le mien, parbleu, puisque je vous dis de me l'envoyer.
ANFRY
Pardon, Monsieur le comte, mais je ne comprends pas comment mon garçon de onze ans pourrait faire le service de Monsieur le comte. Et s'il faut tout dire, je n'aimerais pas à le mettre en contact avec vos gens.
LE COMTE
Et pourquoi, s'il vous plaît? Le fils de mon concierge est-il trop grand seigneur pour se trouver avec mes gens?
ANFRY
Au contraire, Monsieur le comte, il ne serait pas assez grand seigneur pour eux; ils l'ont chassé hier, ils le chasseraient bien encore.
—Je voudrais bien voir cela, s'écria le comte avec colère, quand ce serait par mon ordre qu'il viendrait ici.
ANFRY
Enfin, Monsieur le comte, mon garçon pourrait voir et entendre des choses qui me feraient de la peine en lui faisant du mal, et j'aime autant qu'il reste à la maison et qu'il n'entre pas au château.»
Le comte fut étonné de cette résistance. Il regarda attentivement le concierge et parut frappé de l'air décidé, mais franc, ouvert et honnête, qui donnait à toute sa personne quelque chose qui commandait le respect. Il hésita quelques instants, puis il reprit d'un ton plus doux:
«C'était pour mon fils que je vous demandais le vôtre; mais peut-être avez-vous raison... Quand mon fils voudra jouer avec votre garçon, il ira le chercher chez vous. Au revoir, ajouta-t-il en faisant de la main un geste d'adieu. Quel est votre nom?
—Anfry, Monsieur le comte, à votre service, quand il vous plaira.»
Anfry sortit, redescendit l'escalier et fut arrêté dans le vestibule par des domestiques, curieux de savoir ce que leur maître avait pu vouloir à un homme d'aussi petite importance qu'un concierge de château; Anfry leur répondit brièvement, sans s'arrêter, et rentra chez lui.
Blaise était devant la grille; il époussetait et nettoyait quand son père rentra.
«As-tu vu le garçon de M. le comte? lui demanda Anfry.
BLAISE
Non, papa; je n'ai vu personne, qu'un domestique, qui est venu me dire d'aller voir M. Jules.
ANFRY
Tu n'y as pas été, j'espère bien?
BLAISE
Non, papa, vous me l'aviez défendu; d'ailleurs, je n'ai guère envie de lier connaissance avec ce M. Jules. Je me figure qu'il ne doit pas être bon.
—Tu pourrais avoir raison; travaille, va à l'école, ce sera mieux pour toi que courailler et paresser toute la journée. En attendant, va me chercher ma serpe que j'ai laissée au bûcher; il y a des branches qui avancent sur la grille et qui gênent pour l'ouvrir. Je veux les couper.»
Blaise, toujours prompt à obéir, partit en courant; il entra au bûcher et y trouva Jules de Trénilly, qui essayait de couper des rognures de bois avec la serpe, qu'il avait ramassée.
«Voulez-vous me donner cette serpe, Monsieur? lui dit Blaise poliment.
JULES
Elle n'est pas à toi, je ne te la rendrai pas.
BLAISE
Pardon, Monsieur, elle est à papa; il m'a envoyé pour la chercher.
JULES
Je te dis que j'en ai besoin; laisse-moi tranquille.
BLAISE
Mais papa en a besoin aussi, je dois la lui rapporter.
JULES
Vas-tu me laisser tranquille; tu m'ennuies.»
Blaise insista encore pour avoir sa serpe; Jules continuait à la refuser; Blaise s'approcha pour la retirer des mains de Jules, qui se mit en colère et menaça de la lancer à la tête de Blaise. Il fit, en effet, le mouvement de la jeter; la serpe, trop lourde, retomba sur son pied et lui fit une entaille au soulier, au bas et à la peau; Jules se mit à crier; Michel, le garçon d'écurie, accourut et s'effraya en voyant du sang au pied de son jeune maître.
«Comment vous êtes-vous blessé, Monsieur Jules? lui demanda-t-il.
JULES, criant
C'est ce méchant garçon qui m'a fait mal. Il m'a coupé avec la serpe.
MICHEL, avec rudesse
Méchant garnement! que viens-tu faire ici? Tu es le fils du concierge; va à ta niche et n'en sors pas... Ne pleurez pas, pauvre Monsieur Jules; nous allons bien faire gronder ce mauvais sujet qui vous a fait mal.
JULES
Tu diras, Michel, qu'il m'a donné un coup de serpe.
MICHEL
Mais est-ce bien vrai? Je n'ai rien vu, moi.
JULES
C'est égal, dis toujours, puisque c'est sa faute; si tu ne veux pas, je dirai que c'est toi, et je te ferai chasser.
MICHEL
Non, non, Monsieur Jules, non, non, il ne faut pas me faire chasser; je dirai comme vous me l'ordonnez.»
Et Michel prit Jules dans ses bras et l'emporta au château.
Le pauvre Blaise était resté immobile, stupéfait. Enfin il ramassa la serpe et se dit:
«Faut-il que ce garçon soit méchant! Je vais vite tout raconter à papa, pour qu'il connaisse la vérité et qu'il sache bien que ce n'est pas moi qui l'ai blessé.»
Il courut vers la grille; son père l'attendait avec impatience.
«Tu y as mis du temps, mon garçon, dit-il en recevant la serpe. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps?»
Blaise, tout essoufflé, raconta à son père ce qui s'était passé; il avait à peine terminé son récit, que M. de Trénilly parut en haut de l'avenue, marchant d'un pas précipité vers la grille.
«Anfry! cria-t-il avec colère, amenez-moi ce petit drôle, qui s'est caché dans la maison quand il m'a aperçu.»
Anfry marcha seul vers M. de Trénilly.
«Monsieur le comte, dit-il le chapeau à la main, je crois savoir ce qui vous amène ici, et je sais que mon fils n'est pas coupable de ce qui est arrivé.
M. DE TRÉNILLY
Comment, pas coupable? Mon fils a au pied une grande entaille que lui a faite votre garçon avec sa serpe, et vous trouvez qu'il n'est pas coupable?
ANFRY
Ce n'est pas mon garçon, c'est le vôtre qui se l'est faite lui-même.
M. DE TRÉNILLY
Ceci est trop fort, par exemple! Me faire croire que mon fils s'est coupé pour le plaisir d'avoir une plaie et d'en souffrir pendant huit jours.
ANFRY
Non, Monsieur le comte, mais par imprudence et par colère.»
Alors Anfry raconta à M. de Trénilly ce que venait de lui apprendre Blaise.
«Faites-le venir, dit M. de Trénilly, je veux l'entendre raconter à lui-même.»
Anfry alla chercher Blaise, qu'il trouva blotti derrière un rideau.
ANFRY
Allons, Blaisot, viens parler à M. le comte; il veut que tu lui racontes ce qui s'est passé avec M. Jules.
BLAISE
Oh! papa, j'ai peur. Il a l'air en colère; il va me battre.
ANFRY
Te battre! Sois tranquille, mon garçon, je suis là, moi; s'il fait mine de te toucher, je t'emmène et nous quitterons la maison, seulement le temps d'emporter nos effets.»
Blaise sortit de sa cachette et, tout tremblant, suivit son père, qui l'emmena devant M. de Trénilly. Blaise n'osait lever les yeux; M. de Trénilly le regardait avec colère.
«Raconte-moi comment mon fils a reçu sa blessure, dit-il enfin avec dureté.
BLAISE
Il ne voulait pas me rendre la serpe que papa m'avait envoyé chercher, Monsieur; j'ai insisté, il s'est fâché, il a voulu m'en donner un coup; la serpe est lourde, elle est retombée malgré lui et l'a blessé au pied.
M. DE TRÉNILLY
Tu mens! je te dis que tu mens!
BLAISE, vivement
Non, Monsieur, je ne mens pas; je ne mens jamais. Si j'avais blessé M.
Jules, je l'aurais dit sans attendre qu'on me le demandât.»
L'honnête indignation de Blaise parut faire impression sur M. de Trénilly; il regarda alternativement Blaise et Anfry, et s'en alla en se disant à mi-voix:
«C'est singulier! Il a l'air franc et honnête; mais pourquoi Jules aurait-il fait ce conte, et pourquoi Michel l'aurait-il soutenu?... C'est ce que je vais tâcher de me faire expliquer...»
Quand il fut parti, Anfry rentra avec Blaise et lui répéta la défense d'aller au château sans nécessité.
III
LA RÉPARATION ET LA RECHUTE
Huit jours après, Blaise était dans le jardin avec son père; ils bêchaient tous deux une plate-bande de salades, lorsque la voix de M. de Trénilly se fit entendre; il appelait Anfry.
«Me voici, Monsieur le comte», répondit Anfry; et il courut vers le comte, qui tenait Jules par la main.
«Anfry, dit le comte, voici Jules qui vient faire ses excuses à votre garçon pour ce qui s'est passé la semaine dernière: votre garçon avait raison, c'est Michel qui a menti; Jules s'est blessé lui-même, il l'a avoué, et il est bien fâché d'avoir accusé à tort votre garçon; de peur d'être grondé pour avoir touché la serpe, il a fait un mensonge et une méchanceté, mal conseillé par Michel, que j'ai renvoyé de mon service et qui est retourné dans son pays; Jules ne recommencera pas, il me l'a bien promis. Jules, va chercher Blaise; tu le lui diras toi-même.»
Jules alla à pas lents dans le potager où travaillait Blaise; il était honteux des excuses que son père lui avait ordonné de faire, et il ne savait de quelle manière commencer. Il restait immobile et silencieux devant Blaise, qui le regardait d'un air surpris.
«Qu'y a-t-il pour votre service, Monsieur Jules? lui demanda-t-il enfin.
—Rien, répondit Jules.
—Mais puisque vous êtes venu ici près de moi, Monsieur Jules, c'est que vous avez besoin de moi.
—Non, répondit Jules.
BLAISE
Alors je vais me remettre à bêcher, sauf votre respect, Monsieur Jules. Papa n'aime pas que je perde mon temps.
JULES, avec embarras
Blaise!
BLAISE
Monsieur Jules.
JULES, très embarrassé
Blaise!... Je suis venu... Papa m'a dit... Je ne sais pas comment dire... Je veux..., non, je dois... te demander pardon.
BLAISE, avec surprise
A moi, pardon! et de quoi donc?
JULES
Pour l'autre jour..., la serpe... Michel..., tu te souviens bien?
BLAISE
Ah! pour le mensonge! Tiens, je n'y pensais plus. Je ne vous en veux pas bien sûr, Monsieur Jules, et je suis bien fâché que vous ayez pris la peine de faire des excuses. C'est juste, à la vérité, mais cela coûte, et je vous en remercie.»
Jules, enchanté de se trouver débarrassé de cette tâche pénible, releva la tête, qu'il avait tenue baissée, et, regardant la bonne figure réjouie de Blaise, il lui proposa de venir jouer avec lui au château.
BLAISE
Cela, c'est impossible, Monsieur Jules, car papa m'a défendu d'y aller.
JULES
Pourquoi donc?
BLAISE
Il dit que ce n'est pas ma place, que je ne dois pas m'habituer à fainéanter, mais à l'aider par mon travail.
JULES
Oh! que c'est ennuyeux! Attends, je vais le demander à papa.»
Jules courut à M. de Trénilly et lui demanda la permission d'emmener Blaise.
LE COMTE
Je ne demande pas mieux, mon ami, je suis bien aise que tu joues avec Blaise, qui me semble être un bon et brave garçon.
JULES
C'est que son père veut qu'il travaille, et ne veut pas qu'il vienne au château.
LE COMTE
Son père a raison, mais il lui donnera bien un congé pour terminer votre raccommodement.—Nous donnez-vous Blaise pour l'après-midi, Anfry; nous vous le renverrons ce soir.
ANFRY
Je n'ai rien à refuser à Monsieur le comte, pourvu que Blaise ne gêne pas.
Je vais l'amener tout à l'heure, quand il sera nettoyé et qu'il aura changé de vêtements.
LE COMTE
Pourquoi faire, changer de vêtements? Laissez-lui sa blouse; ce n'est pas fête aujourd'hui.
ANFRY
C'est fête pour lui, Monsieur le comte, puisque c'est la première fois qu'il est admis près de Monsieur le comte et de M. Jules. Mais, puisque Monsieur le comte l'aime mieux ainsi, il ira en blouse.»
Et il alla au jardin, où Blaise bêchait toujours.
«Blaisot, va te débarbouiller les mains et le visage, et donner un coup de peigne à tes cheveux. Tu vas accompagner M. Jules et jouer avec lui au château.»
Blaise rougit, moitié de peur et moitié de plaisir, et courut se débarbouiller au baquet. Quand il fut lavé, peigné, il alla rejoindre Jules et le comte, qui l'attendaient dans l'avenue. Ils marchaient devant; Blaise suivait; il n'était pas à son aise, il n'osait parler, et il aurait voulu pouvoir retourner à sa bêche et à son jardin. En arrivant au perron, ils trouvèrent la comtesse avec sa fille qui les attendaient.
«Vous amenez Blaise! dit la comtesse en s'avançant vers eux. Je suis bien aise de le connaître; on m'a dit du bien de lui. N'aie pas peur, petit, ajouta-telle, Hélène ne te mangera pas, et Jules sera content de jouer avec un garçon de son âge.
—Je n'ai pas peur, Madame, dit Blaise; seulement je ne suis pas à mon aise.
—Eh bien, tu vas t'y mettre en nous aidant à bêcher et à arranger notre jardin, Blaise, dit Hélène avec un sourire aimable. Venez avec moi, Jules et Blaise, et mettons-nous à l'ouvrage.»
Et, passant entre eux deux, elle les prit chacun par la main et courut vers un petit jardin que M. de Trénilly leur avait fait arranger près du château.
«Mais il n'y a rien dans votre jardin, dit Blaise.
HÉLÈNE
C'est précisément pour cela que nous voulons l'arranger: tu vas nous aider.
BLAISE
Qu'est-ce que vous voulez y mettre: des fleurs ou des légumes?
—Des fleurs! s'écria Hélène; j'aime tant les fleurs!
—Des légumes! s'écria Jules! les fleurs m'ennuient.
HÉLÈNE
Des fleurs seraient bien plus jolies et viendraient plus vite.
JULES
Des légumes sont bien plus utiles; d'ailleurs, je veux des légumes, et si tu mets des fleurs; je les arracherai.
HÉLÈNE.
Fais comme tu voudras; je sais qu'il faut toujours te céder.
BLAISE.
Pourquoi faut-il que vous cédiez, Mademoiselle?
HÉLÈNE
Pour ne pas être battue par lui et grondée par papa, qui croit tout ce que Jules lui dit.
JULES
Allons, vite à l'ouvrage! Bêchez, ratissez, pendant que je vais chercher des graines au jardin.»
Blaise avait envie de résister à Jules et de soutenir Hélène; mais il n'osa pas, et, prenant une bêche, il se mit à l'ouvrage avec une telle ardeur que le jardin fut retourné en moins d'une demi-heure; Hélène l'aidait, mais moins vivement.
Jules revint avec un sac plein de graines de toute espèce de légumes.
«Voilà, dit-il, des choux-fleurs, des pois, des radis, des asperges, des navets, des carottes, des laitues, des cardons, des épinards...
BLAISE
Mais, Monsieur Jules, tout cela doit être semé sur couche et repiqué quand c'est levé.
JULES
Du tout, du tout, je ne veux pas; je veux semer les graines dans mon jardin.
BLAISE
Comme vous voudrez, Monsieur Jules; mais il faudra les attendre bien longtemps.
JULES
C'est égal, je veux les semer; j'aime mieux attendre.»
Hélène ne disait rien; elle était habituée aux caprices de son frère; sa bonté et sa douceur la portaient à toujours lui céder pour éviter les disputes.
Blaise hochait la tête, mais se taisait, voyant Hélène consentir de bonne grâce à sacrifier les fleurs qu'elle avait désirées. Avec sa bêche il fit des traînées de petites rigoles, dans lesquelles Jules semait la graine.
BLAISE
Qu'avez-vous semé par ici, Monsieur Jules?
JULES
Je n'en sais rien; j'ai tout mêlé.
HÉLÈNE
Mais comment sauras-tu où sont les radis, les choux-fleurs, les carottes, et le reste?
JULES
Je les reconnaîtrai bien en les mangeant.
HÉLÈNE
Mais quand nous voudrons manger des radis, comment les trouverons-nous?
JULES
Ah! je n'en sais rien! Tu m'ennuies avec tes raisonnements.
BLAISE
Ecoutez, Monsieur Jules, vous n'êtes pas raisonnable; ce ne sera pas un jardin, cela; on n'y verra rien pendant plus d'une quinzaine. Laissez votre sœur y mettre quelques fleurs.
JULES, frappant du pied
Non, non, non, je ne veux pas; je n'aime pas les fleurs, et je n'en mettrai pas.»
Hélène était rouge; elle avait envie de pleurer, Blaise en eut pitié et lui dit:
«Ne vous affligez pas, Mademoiselle, je vous arrangerai un autre jardin, et je vous y planterai de belles fleurs toutes venues.
HÉLÈNE
Merci, Blaise, tu es bien bon.
JULES
Et moi! je suis donc mauvais, moi?
HÉLÈNE
Tu n'es pas mauvais, mais Blaise est très bon.
JULES, avec colère
Je ne veux pas que Blaise soit meilleur que moi; je ne veux pas que tu le dises.
HÉLÈNE
Je ne le dirai pas si cela te contrarie, mais...
JULES, de même
Mais quoi?
HÉLÈNE
Mais... Blaise est très bien.»
Jules se mit à crier, à taper des pieds; il courut pour battre Hélène; elle se sauva; il s'élança sur Blaise, qui esquiva le coup en sautant lestement de côté. Jules tomba sur le nez et redoubla ses cris; la bonne d'Hélène accourut.
«Qu'y a-t-il? pourquoi ces cris?
JULES, pleurant
Blaise est méchant; il veut arracher mes légumes pour mettre des fleurs; ils disent que je suis méchant; c'est lui qui est méchant, il veut arracher mes légumes.
LA BONNE
Pourquoi contrariez-vous M. Jules, et comment osez-vous lui arracher ses légumes, Blaise?
BLAISE
Je vous assure, Madame, que je ne veux rien arracher, et que je ne veux pas contrarier M. Jules. C'est lui-même qui se contrarie.
LA BONNE
C'est cela! toujours la même chanson! C'est M. Jules qui se fait pleurer lui-même, n'est-ce pas?»
Blaise voulut répondre, mais la bonne ne lui en laissa pas le temps; elle le saisit par le bras, le fit pirouetter et lui ordonna de s'en aller chez lui et de ne plus revenir. Blaise partit sans mot dire, se promettant bien de refuser à l'avenir toute invitation du château.
IV
LE CHAT-FANTOME
Blaise était courageux; il n'avait pas peur de l'obscurité, et, quand il faisait beau, il aimait à se promener tout seul, le soir, dans les prairies traversées par un joli ruisseau.
Qu'est-ce qui lui plaisait tant dans la prairie?
D'abord il était seul, il allait où il voulait; ensuite, en suivant le chemin qui bordait le ruisseau, il voyait une longue rangée de fours à plâtre creusés dans la montagne qui borde les prés et la grande route. Ces fours étaient en feu tous les soirs; il en sortait des gerbes d'étincelles; les hommes occupés à enfourner du bois dans ces brasiers lui semblaient être des diables au milieu des flammes de l'enfer. Un autre enfant aurait eu peur, mais Blaise n'était pas si facile à effrayer; il s'arrêtait et regardait avec bonheur ces feux allumés, ces longues traînées d'étincelles, ces hommes armés de fourches attisant le feu. Il suivait tout doucement la rivière jusqu'au moulin, dont il traversait la cour pour revenir par la grande route, en longeant les fours à chaux.
Quelques jours après sa première visite au château, Blaise se préparait à faire sa promenade favorite, lorsqu'il vit accourir Jules.
«Blaise! Blaise! lui cria-t-il, veux-tu venir jouer avec moi? Je suis seul, je m'ennuie.
—Merci, Monsieur Jules, répondit Blaise, je vais me promener dans la prairie; je ne veux pas venir chez vous, pour que vous inventiez encore quelque histoire qui me fasse gronder!
JULES
Oh! Blaise, je t'en prie, viens; je serai très bon, je ne dirai rien du tout à personne.
BLAISE
Non, Monsieur Jules, j'aime mieux me promener que jouer.
JULES
Alors j'irai avec toi.
BLAISE
Je ne veux pas vous emmener sans la permission de votre papa, Monsieur Jules.
JULES