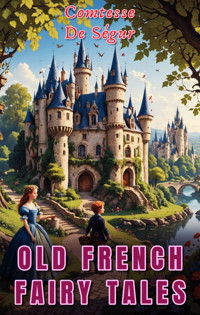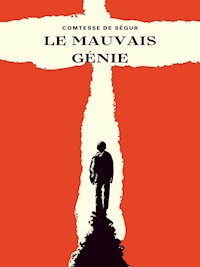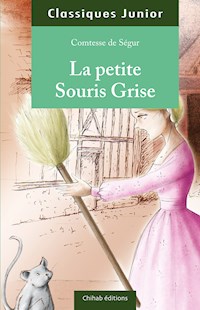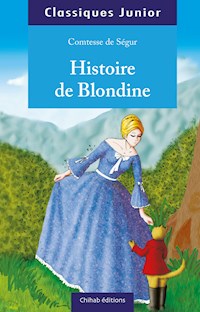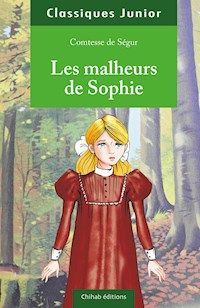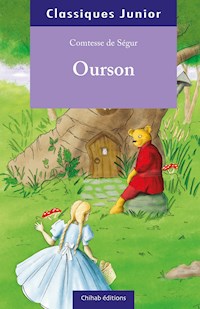comtesse de Ségur
L’auberge de l’Ange-Gardien
Illustrations de
Ghalia Tonkin
CHIHAB EDITIONS
© Editions Chihab, 2016.
ISBN : 978-9947-39-200-3
Dépôt légal : 2e semestre 2016.
Avant-propos
Lire est du meilleur profit à tout âge. Il ressort notamment que la lecture, outre son caractère ludique et divertissant, est le meilleur moyen pour l’apprentissage et la maîtrise d’une langue et l’éveil de l’esprit critique.
Partant du constat fait par les pédagogues et chercheurs sur les bienfaits de la lecture perçue comme base première des apprentissages à venir pour les jeunes et les étudiants, les Editions Chihab se proposent de mettre à la portée de tous, notamment les jeunes apprenants de l’Education nationale et les étudiants, une collection de livres classiques.
Cette collection se veut une réponse appropriée aux demandes exprimées par les enseignants de français des différents cycles de formation à savoir favoriser la pratique de la lecture, en dehors du temps scolaire, et en faire un outil indispensable pour progresser dans l’apprentissage de la langue française.
L’objectif de cette collection est de faire connaître les chefs-d’œuvre de la littérature classique dans une version intégrale.
Nous espérons voir cette jeune « collection de livres classiques » s’enrichir au profit de tous.
Bonne lecture.
À
mes petits-fils,
Louis et Gaston de Malaret
Chers enfants, vous êtes de bons petits frères, et je suis bien sûre que, si vous vous trouviez dans la triste position de Jacques et de Paul, toi, mon bon petit Louis, tu ferais comme l’excellent petit Jacques ; et toi, mon gentil petit Gaston, tu aimerais ton frère comme Paul aimait le sien. Mais j’espère que le bon Dieu vous fera la grâce de ne jamais passer par de pareilles épreuves, et que la lecture de ce livre ne réveillera jamais en vous de pénibles souvenirs.
Comtesse de Ségur,
née Rostopchine.
1. À la garde de Dieu
Il faisait froid, il faisait sombre ; la pluie tombait fine et serrée ; deux enfants dormaient au bord d’une grande route, sous un vieux chêne touffu : un petit garçon de trois ans était étendu sur un amas de feuilles ; un autre petit garçon, de six ans, couché à ses pieds, les lui réchauffant de son corps ; le petit avait des vêtements de laine, communs, mais chauds ; ses épaules et sa poitrine étaient couvertes de la veste du garçon de six ans, qui grelottait en dormant ; de temps en temps un frisson faisait trembler son corps : il n’avait pour tout vêtement qu’une chemise et un pantalon à moitié usés ; sa figure exprimait la souffrance, des larmes à demi séchées se voyaient encore sur ses petites joues amaigries. Et pourtant il dormait d’un sommeil profond ; sa petite main tenait une médaille suspendue à son cou par un cordon noir ; l’autre main tenait celle du plus jeune enfant ; il s’était sans doute endormi en la lui réchauffant. Les deux enfants se ressemblaient, ils devaient être frères ; mais le petit avait les lèvres souriantes, les joues rebondies ; il n’avait dû souffrir ni du froid ni de la faim comme son frère aîné.
Les pauvres enfants dormaient encore quand, au lever du jour, un homme passa sur la route, accompagné d’un beau chien, de l’espèce des chiens du mont Saint-Bernard. L’homme avait toute l’apparence d’un militaire ; il marchait en sifflant, ne regardant ni à droite ni à gauche ; le chien suivait pas à pas. En s’approchant des enfants qui dormaient sous le chêne, au bord du chemin, le chien leva le nez, dressa les oreilles, quitta son maître et s’élança vers l’arbre, sans aboyer. Il regarda les enfants, les flaira, leur lécha les mains et poussa un léger hurlement comme pour appeler son maître sans éveiller les dormeurs. L’homme s’arrêta, se retourna et appela son chien :
« Capitaine ! ici, Capitaine ! »
Capitaine resta immobile ; il poussa un second hurlement plus prolongé et plus fort.
Le voyageur, devinant qu’il fallait porter secours à quelqu’un, s’approcha de son chien et vit avec surprise ces deux enfants abandonnés. Leur immobilité lui fit craindre qu’ils ne fussent morts ; mais, en se baissant vers eux, il vit qu’ils respiraient ; il toucha les mains et les joues du petit : elles n’étaient pas très froides ; celles du plus grand étaient complètement glacées ; quelques gouttes de pluie avaient pénétré à travers les feuilles de l’arbre et tombaient sur ses épaules couvertes seulement de sa chemise.
« Pauvres enfants ! dit l’homme à mi-voix, ils vont périr de froid et de faim, car je ne vois rien près d’eux, ni paquets ni provisions. Comment a-t-on laissé de pauvres petits êtres si jeunes, seuls, sur une grande route ? Que faire ? Les laisser ici, c’est vouloir leur mort. Les emmener ? J’ai loin à aller et je suis à pied ; ils ne pourraient me suivre. »
Pendant que l’homme réfléchissait, le chien s’impatientait : il commençait à aboyer ; ce bruit réveilla le frère aîné ; il ouvrit les yeux, regarda le voyageur d’un air étonné et suppliant, puis le chien, qu’il caressa, en lui disant :
« Oh ! tais-toi, tais-toi, je t’en prie ; ne fais pas de bruit, n’éveille pas le pauvre Paul qui dort et qui ne souffre pas. Je l’ai bien couvert, tu vois ; il a bien chaud.
– Et toi, mon pauvre petit, dit l’homme, tu as bien froid ! »
L’Enfant. – Moi, ça ne fait rien ; je suis grand, je suis fort ; mais lui, il est petit ; il pleure quand il a froid, quand il a faim.
L’Homme. – Pourquoi êtes-vous ici tous les deux ?
L’Enfant. – Parce que maman est morte et que papa a été pris par les gendarmes, et nous n’avons plus de maison et nous sommes tout seuls.
L’Homme. – Pourquoi les gendarmes ont-ils emmené ton papa ?
L’Enfant. – Je ne sais pas ; peut-être pour lui donner du pain ; il n’en avait plus.
L’Homme. – Qui vous donne à manger ?
L’Enfant. – Ceux qui veulent bien.
L’Homme. – Vous en donne-t-on assez ?
L’Enfant. – Quelquefois, pas toujours ; mais Paul en a toujours assez.
L’Homme. – Et toi, tu ne manges donc pas tous les jours ?
L’Enfant. – Oh ! moi, ça ne fait rien, puisque je suis grand.
L’homme était bon ; il se sentit très ému de ce dévouement fraternel et se décida à emmener les enfants avec lui jusqu’au village voisin.
« Je trouverai, se dit-il, quelque bonne âme qui les prendra à sa charge, et quand je reviendrai, nous verrons ce qu’on pourra en faire ; le père sera peut-être de retour. »
L’Homme. – Comment t’appelles-tu, mon pauvre petit ?
L’Enfant. – Je m’appelle Jacques, et mon frère, c’est Paul.
L’Homme. – Eh bien, mon petit Jacques, veux-tu que je t’emmène ? J’aurai soin de toi.
Jacques. – Et Paul ?
L’Homme. – Paul aussi ; je ne voudrais pas le séparer d’un si bon frère. Réveille-le et partons.
Jacques. – Mais Paul est fatigué ; il ne pourra pas marcher aussi vite que vous.
L’Homme. – Je le mettrai sur le dos de Capitaine ; tu vas voir.
Le voyageur souleva doucement le petit Paul toujours endormi, le plaça à cheval sur le dos du chien en appuyant sa tête sur le cou de Capitaine. Ensuite il ôta sa blouse, qui couvrait sa veste militaire, en enveloppa le petit comme d’une couverture, et, pour l’empêcher de tomber, noua les manches sous le ventre du chien.
« Tiens, voilà ta veste, dit-il à Jacques en la lui rendant ; remets-la sur tes pauvres épaules glacées, et partons. »
Jacques se leva, chancela et retomba à terre ; de grosses larmes roulèrent de ses yeux ; il se sentait faible et glacé, et il comprit que lui non plus ne pourrait pas marcher.
L’Homme. – Qu’as-tu donc, mon pauvre petit ? Pourquoi pleures-tu ?
Jacques. – C’est que je ne peux plus marcher ; je n’ai plus de forces.
L’Homme. – Est-ce que tu te sens malade ?
Jacques. – Non, mais j’ai trop faim, je n’ai pas mangé hier ; je n’avais plus qu’un morceau de pain pour Paul.
L’homme sentit aussi ses yeux se mouiller ; il tira de son bissac un bon morceau de pain, du fromage et une gourde de cidre, et présenta à Jacques le pain et le fromage pendant qu’il débouchait la gourde.
Les yeux de Jacques brillèrent : il allait porter le pain à sa bouche quand un regard jeté sur son frère l’arrêta :
« Et Paul ? dit-il, il n’a rien pour déjeuner ; je vais garder cela pour lui.
– J’en ai encore pour Paul, mon petit ; mange, pauvre enfant, mange sans crainte. »
Jacques ne se le fit pas dire deux fois ; il mangea et but avec délices en répétant dix fois :
« Merci, mon bon Monsieur, merci… Vous êtes très bon. Je prierai la sainte Vierge de vous faire très heureux. »
Quand il fut rassasié, il sentit revenir ses forces et il dit qu’il était prêt à marcher. Capitaine restait immobile près de Jacques : la chaleur de son corps réchauffait le petit Paul, qui dormait plus profondément que jamais. L’homme prit la main de Jacques, et ils se mirent en route suivis de Capitaine, qui marchait posément sans se permettre le moindre bond, ni aucun changement dans son pas régulier, de peur d’éveiller l’enfant. L’homme questionnait Jacques tout en marchant ; il apprit de lui que sa mère était morte après avoir été longtemps malade, qu’on avait vendu tous leurs beaux habits et leurs jolis meubles ; qu’à la fin ils ne mangeaient plus que du pain ; que leur papa était toujours triste et cherchait de l’ouvrage.
« Un jour, dit-il, les gendarmes sont venus chercher papa ; il ne voulait pas aller avec eux ; il disait toujours en nous embrassant : “Mes pauvres enfants ! mes pauvres enfants !” Les gendarmes disaient : “Il faut venir tout de même, mon garçon ; nous avons des ordres.” Puis un gendarme m’a donné un morceau de pain et m’a dit : “Reste là avec ton frère, petit ; je reviendrai vous prendre.” J’ai donné du pain à Paul et j’ai attendu un bout de temps ; mais personne n’est venu ; alors j’ai pris Paul par la main et nous avons marché longtemps. J’ai vu une maison où on mangeait, j’ai demandé de la soupe pour Paul ; on nous a fait asseoir à table, et on a donné une grande assiette de soupe à Paul, et à moi aussi ; puis on nous a fait coucher sur de la paille. Quand nous avons été éveillés, on nous a mis du pain dans nos poches, et on m’a dit : “Va, mon petit, à la garde de Dieu.” Je suis parti avec Paul, et nous avons marché comme cela pendant bien des jours. Hier la pluie est venue : je n’ai pas trouvé de maison : j’ai donné à Paul le pain que j’avais gardé. Je lui ai ramassé des feuilles sous le chêne ; il pleurait parce qu’il avait froid ; alors j’ai pensé que maman m’avait dit : “Prie la sainte Vierge, elle ne t’abandonnera pas.” J’ai prié la sainte Vierge ; elle m’a donné l’idée d’ôter ma veste pour couvrir les épaules de Paul, puis de me coucher sur ses jambes pour les réchauffer. Et tout de suite il s’est endormi. J’étais bien content ; je n’osais pas bouger pour ne pas l’éveiller et j’ai remercié la bonne sainte Vierge ; je lui ai demandé de me donner à déjeuner demain parce que j’avais très faim et je n’avais plus rien pour Paul ; j’ai pleuré, et puis je me suis endormi aussi ; et la sainte Vierge vous a amené sous le chêne. Elle est très bonne, la sainte Vierge. Maman me l’avait dit bien souvent : “Quand vous aurez besoin de quelque chose, demandez-le à la sainte Vierge ; vous verrez comme elle vous écoutera.” »
L’homme ne répondit pas ; il serra la main du petit Jacques plus fortement dans la sienne, et ils continuèrent à marcher en silence. Au bout de quelque temps, l’homme s’aperçut que la marche de Jacques se ralentissait.
« Tu es fatigué, mon enfant ? lui dit-il avec bonté.
– Oh ! je peux encore aller. Je me reposerai au village. » L’homme enleva Jacques et le mit sur ses épaules. « Nous irons plus vite ainsi », dit-il.
Jacques. – Mais je suis lourd ; vous allez vous fatiguer, mon bon Monsieur.
L’Homme. – Non, mon petit, ne te tourmente pas. J’ai porté plus lourd que toi, quand j’étais soldat et en campagne.
Jacques. – Vous avez été soldat ; mais pas gendarme ?
L’Homme,souriant. – Non, pas gendarme ; je rentre au pays, après avoir fait mon temps.
Jacques. – Comment vous appelez-vous ?
L’Homme. – Je m’appelle Moutier.
Jacques. – Je n’oublierai jamais votre nom, monsieur Moutier.
Moutier. – Je n’oublierai pas non plus le tien, mon petit Jacques ; tu es un brave enfant, un bon frère.
Depuis que Jacques était sur les épaules de Moutier, celui-ci marchait beaucoup plus vite. Ils ne tardèrent pas à arriver dans un village à l’entrée duquel il aperçut une bonne auberge. Moutier s’arrêta à la porte.
« Y a-t-il un logement pour moi, pour ces mioches et pour mon chien ? demanda-t-il.
– Je loge les hommes, mais pas les bêtes, répondit l’aubergiste.
– Alors vous n’aurez ni l’homme ni sa suite », dit Moutier en continuant sa route.
L’aubergiste le regarda s’éloigner avec dépit ; il pensa qu’il avait eu tort de renvoyer un homme qui semblait tenir à son chien et à ses enfants, et qui aurait peut-être bien payé.
« Monsieur ! Hé ! monsieur le voyageur ! cria-t-il en courant après lui.
– Que me voulez-vous ? » dit Moutier en se retournant.
L’Aubergiste. – J’ai du logement, Monsieur, j’ai tout ce qu’il vous faut.
Moutier. – Gardez-le pour vous, mon bonhomme ; le premier mot, c’est tout pour moi.
L’Aubergiste. – Vous ne trouverez pas une meilleure auberge dans tout le village, Monsieur.
Moutier. – Tant mieux pour ceux que vous logerez.
L’Aubergiste. – Vous n’allez pas me faire l’affront de me refuser le logement que je vous offre.
Moutier. – Vous m’avez bien fait l’affront de me refuser celui que je vous demandais.
L’Aubergiste. – Mon Dieu, c’est que je ne vous avais pas regardé ; j’ai parlé trop vite.
Moutier. – Et moi aussi je ne vous avais pas regardé ; maintenant que je vous vois, je vous remercie d’avoir parlé trop vite, et je vais ailleurs.
Moutier, lui tournant le dos, se dirigea vers une autre auberge de modeste apparence qui se trouvait à l’extrémité du village, laissant le premier aubergiste pâle de colère et fort contrarié d’avoir manqué une occasion de gagner de l’argent.
2. L’Ange-Gardien
« Y a-t-il du logement pour moi, pour deux mioches et pour mon chien ? recommença Moutier à la porte de l’auberge.
– Entrez, Monsieur, il y a de quoi loger tout le monde », répondit une voix enjouée.
Et une femme à la mine fraîche et souriante parut sur le seuil de la porte.
« Entrez, Monsieur, que je vous débarrasse de votre cavalier, dit la femme en riant et en enlevant doucement le petit Jacques de dessus les épaules du voyageur. Et ce pauvre petit qui dort tranquillement sur le dos du chien ! Un joli enfant et un brave animal ! il ne bouge pas plus qu’un chien de plomb, de peur d’éveiller l’enfant. »
Pourtant le bruit réveilla enfin le petit Paul ; il ouvrit de grands yeux, regarda autour de lui d’un air étonné, et, n’apercevant pas son frère, il fit une moue comme pour pleurer et appela d’une voix tremblante :
« Jacques ! veux Jacques ! »
Jacques. – Je suis ici ; me voilà, mon Paul. Nous sommes très heureux ! Vois-tu ce bon monsieur ? Il nous a amenés ici ; tu vas avoir de la soupe. N’est-ce pas, monsieur Moutier, que vous voudrez bien donner de la soupe à Paul ?
Moutier. – Certainement, mon garçon ; de la soupe et tout ce que tu voudras.
La maîtresse d’auberge regardait et écoutait d’un air étonné.
Moutier. – Vous n’y comprenez rien, ma bonne dame, n’est-il pas vrai ? C’est toute une histoire que je vous raconterai. J’ai trouvé ces deux pauvres petits perdus dans un bois, et je les ai amenés. Ce petit-là, ajouta-t-il en passant affectueusement la main sur la tête de Jacques, ce petit-là est un bon et brave enfant ; je vous raconterai cela. Mais donnez-nous vite de la soupe pour les petits, qui ont l’estomac creux, quelque fricot pour tous, et je me charge du chien ; un vieil ami, n’est-ce pas, Capitaine ?
Capitaine répondit en remuant la queue et en léchant la main de son maître. Moutier avait débarrassé Paul de la blouse qui l’enveloppait et il l’avait posé à terre. Paul regardait tout et tout le monde ; il riait à Jacques, souriait à Moutier et embrassait Capitaine. L’hôtesse, qui avait de la soupe au feu, apprêtait le déjeuner ; tout fut bientôt prêt ; elle assit les enfants sur des chaises, plaça devant chacun d’eux une bonne assiette de soupe, un morceau de pain, posa sur la table du fromage, du beurre frais, des radis, de la salade.
« C’est pour attendre le fricot, Monsieur ; le fromage est bon, le beurre n’est pas mauvais, les radis sont tout frais tirés de terre, et la salade est bien retournée. »
Moutier se mit à table ; Jacques et Paul, qui mouraient de faim, se jetèrent sur la soupe ; Jacques eut soin d’en faire manger à Paul quelques cuillerées avant que d’y goûter lui-même. Paul mangea tout seul ensuite, et le bon petit Jacques put satisfaire son appétit. Après la soupe il mangea et donna à Paul du pain et du beurre ; ils burent du cidre ; puis vint un haricot de mouton aux pommes de terre. La bonne et jolie figure de Jacques était radieuse ; Paul riait, baisait les mains de Jacques toutes les fois qu’il pouvait les attraper. Jacques avait de son frère les soins les plus touchants ; jamais il ne l’oubliait ; lui-même ne passait qu’en second. Moutier ne les quittait pas des yeux. Lui aussi riait et se trouvait heureux.
« Pauvres petits ! pensait-il, que seraient-ils devenus si Capitaine ne les avait pas dénichés ? Ce petit Jacques a bon cœur ! quelle tendresse pour son frère ! quels soins il lui donne ! Que faire, mon Dieu ! que faire de ces enfants ? »
L’hôtesse aussi examinait avec attention les soins de Jacques pour son frère et la belle et honnête physionomie de Moutier. Elle attendait avec impatience l’explication que lui avait promise ce dernier, et lui servait les meilleurs morceaux, son meilleur cidre et sa plus vieille eau-de-vie. Moutier mangeait encore ; les enfants avaient fini ; ils s’étaient renversés contre le dossier de leurs chaises et commençaient à bâiller.
« Allez jouer, mioches, leur dit Moutier.
– Où faut-il aller, monsieur Moutier ? » demanda Jacques en sautant en bas de sa chaise et en aidant Paul à descendre de la sienne.
Moutier. – Ma foi, je n’en sais rien. Dites donc, ma bonne hôtesse, où allez-vous caser les petits pour qu’ils s’amusent sans rien déranger ?
– Par ici, au jardin, mes enfants, dit l’hôtesse en ouvrant une porte de derrière. Voici au bout de l’allée un baquet plein d’eau et un pot à côté, vous pourrez vous amuser à arroser les légumes et les fleurs.
Jacques. – Puis-je me servir de l’eau qui est dans le baquet pour laver Paul et me laver aussi, Madame ?
L’Hôtesse. – Certainement, mon petit garçon ; mais prends garde de te mouiller les jambes.
Jacques et Paul disparurent dans le jardin ; on les entendait rire et jacasser. Moutier mangeait lentement et réfléchissait. L’hôtesse avait pris une chaise et s’était placée en face de lui, attendant qu’il eût fini pour enlever le couvert. Quand Moutier eut avalé sa dernière goutte de café et d’eau-de-vie, il leva les yeux, vit l’hôtesse, sourit, et, s’accoudant sur la table :
« Vous attendez l’histoire que je vous ai promise, dit-il ; la voici : elle n’est pas longue, et vous m’aiderez peut-être à la finir. »
Il lui fit le récit de sa rencontre avec les enfants ; sa voix tremblait d’émotion en redisant les paroles de Jacques et en racontant les soins qu’il avait eus de son petit frère, son dévouement, sa tendresse pour lui, le courage qu’il avait déployé dans leur abandon et sa touchante confiance en la sainte Vierge.
« Et à présent que vous en savez aussi long que moi, ma bonne dame, aidez-moi à sortir d’embarras. Que puis-je faire de ces enfants ? Les abandonner ? Je n’en ai pas le courage ; ce serait rejeter une charge que je puis porter, au total, et refuser le présent que me fait le bon Dieu. Mais j’ai une longue route à faire : je quitte mon régiment et je rentre au pays. C’est que je n’y suis pas encore ; j’ai à faire quatre étapes de sept à huit lieues. Et comment traîner ces enfants si jeunes, par la pluie, la boue, le vent ? Et puis, je suis garçon ; je ne suis pas chez moi ; personne pour les garder. Mon frère est aubergiste, comme vous, et n’a que faire de moi ; mon père et ma mère sont depuis longtemps près du bon Dieu, mes sœurs sont mariées et elles ont assez des leurs, sans y ajouter des pauvres petits sans père ni mère, et sans argent. Voyons, ma bonne hôtesse, vous m’avez l’air d’une brave femme… Dites… que feriez-vous à ma place ? »
L’Hôtesse. – Ce que je ferais ?… ce que je ferais… Parole d’honneur, je n’en sais rien.
Moutier. – Mais ce n’est pas un conseil, cela. Ça ne décide rien.
L’Hôtesse. – Que voulez-vous que je vous dise ?… D’abord, je ne les laisserais certainement pas vaguer à l’aventure.
Moutier. – C’est bien ce que je me suis dit.
L’Hôtesse. – Je ne les donnerais pas au premier venu.
Moutier. – C’est bien mon idée.
L’Hôtesse. – Je ne les emmènerais pas à pied si loin.
Moutier. – C’est ce que je disais.
L’Hôtesse. – Alors… je ne vois qu’un moyen… Mais vous ne voudrez pas.
Moutier. – Peut-être que si. Dites toujours.
L’Hôtesse. – C’est de me les laisser.
Moutier regarda l’hôtesse avec une surprise qui lui fit baisser les yeux et qui la fit rougir comme si elle avait dit une sottise.
« Je savais bien, dit-elle avec embarras, que vous ne voudriez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous vous dites que je ne suis peut-être pas la bonne femme que je parais ; que je rendrais les enfants malheureux ; que vous les auriez sur la conscience et que sais-je encore ?
– Non, ma bonne hôtesse, je ne dirais ni ne penserais rien de tout cela. Seulement… seulement… je ne sais comment dire… je vous suis obligé, reconnaissant… mais, vrai, je ne vous connais pas beaucoup… et…, et…
L’Hôtesse. – Vous pouvez bien dire que vous ne me connaissez pas du tout ; mais vous n’en pourrez pas dire autant si vous voulez aller prendre des informations sur la femme Blidot, aubergiste de l’Ange-Gardien. Allez chez M. le curé, chez le boucher, le charron, le maréchal, le maître d’école, le boulanger, l’épicier, et bien d’autres encore : ils vous diront tous que je ne suis pas une méchante femme. Je suis veuve ; j’ai vingt-six ans ; je n’ai pas d’enfants, je suis seule avec ma sœur qui a dix-sept ans ; nous gagnons notre vie sans trop de mal ; nous ne manquons de rien ; nous faisons même de petites économies que nous plaçons tous les ans ; il me manque des enfants ; en voilà deux tout trouvés. Je ne vous demande rien, moi, pour les garder ; je n’en fais pas une affaire. Seulement, je sais que je les aimerai, que je ne les rendrai point malheureux et que vous aurez la conscience tranquille à leur égard.
Moutier se leva, serra les mains à l’hôtesse dans les siennes et la regarda avec une affectueuse reconnaissance.
« Merci, dit-il d’un accent pénétré. Où demeure votre curé ?
– Ici, en face ; voici le jardin du presbytère ; poussez la porte et vous y êtes. »
Moutier prit son képi et alla voir le curé pour lui parler de Mme Blidot et lui demander un bon conseil. Il faut croire que les renseignements ne furent pas mauvais, car Moutier revint un quart d’heure après, l’air calme et joyeux.
« Vous aurez les petits, mon excellente hôtesse, dit-il en souriant. Je vous les laisserai… demain ; vous voudrez bien me loger jusqu’à demain, pas vrai ? »
L’Hôtesse. – Tant que vous voudrez, mon cher Monsieur ; c’est juste : je comprends que vous vouliez vous donner un peu de temps pour savoir comment je suis et pour voir installer mes enfants… car je puis bien dire à présent mes enfants, n’est-ce pas ?
Moutier. – Ils restent un peu à moi aussi, sans reproche ; et je ne dis pas que je ne reviendrai pas les voir un jour ou l’autre.
L’Hôtesse. – Quand vous voudrez ; j’aurai toujours un lit pour vous coucher et un bon dîner pour vous refaire. Et à présent je vais voir à mes enfants ; ne voilà-t-il pas les soins maternels qui commencent ? D’abord il me faut les coucher pas loin de moi et de ma sœur. Et puis, il leur faudra du linge, des vêtements, des chaussures.
Moutier. – C’est pourtant vrai ! Je n’y songeais pas. C’est moi qui suis honteux de vous causer ces embarras et cette dépense ; ça, voyez-vous, ma bonne hôtesse, inutile de m’en cacher : je n’ai pas de quoi payer tout cela ; j’ai tout juste mes frais de route et une pièce de dix francs pour l’imprévu ; un cigare, un raccommodage de souliers, une petite charité en passant, à plus pauvre que moi. Par exemple, je peux partager la pièce, et vous laisser cinq francs. J’arriverai tout de même ; je me passerai bien de tabac et de souliers. Il y en a tant qui marchent nu-pieds ! on se les baigne en passant devant un ruisseau, et on n’en marche que mieux.
L’Hôtesse. – Gardez votre pièce, mon bon Monsieur ; je n’en suis pas à cinq francs près. Gardez-la ; votre bonne intention suffit, et les enfants ne manqueront de rien.
L’hôtesse se leva, fit en souriant un signe de tête amical à Moutier et sortit.
3. Informations
Mme Blidot appela sa sœur Elfy, qui lavait la lessive, lui raconta l’aventure qui venait d’arriver et la pria de venir l’aider à préparer, pour les enfants, le cabinet près de la chambre où elles couchaient toutes deux.
« C’est le bon Dieu qui nous envoie ces enfants, dit Elfy ; la seule chose qui manquait pour animer notre intérieur ! Sont-ils gentils ? Ont-ils l’air de bons garçons, d’enfants bien élevés ? »
Madame Blidot. – S’ils sont gentils, bons garçons, bien élevés ? Je le crois bien ! Il n’y a qu’à les voir ! Jolis comme des Amours, polis comme des demoiselles, tranquilles comme des curés. Va, ils ne seront pas difficiles à élever ; pas comme ceux du père Penard, en face !
Elfy. – Bon ! Où sont-ils, que je jette un coup d’œil dessus. On aime toujours mieux voir par ses yeux, tu sais bien. Sont-ils dans la salle ?
Madame Blidot. – Non, je les ai envoyés au jardin.
Elfy courut au jardin ; elle y trouva Jacques occupé à arracher les mauvaises herbes d’une planche de carottes ; Paul ramassait soigneusement ces herbes et cherchait à en faire de petits fagots.
Au bruit que fit Elfy, les enfants tournèrent la tête et montrèrent leurs jolis visages doux et riants. Jacques, voyant qu’Elfy les regardait sans mot dire, se releva et la regarda aussi d’un air inquiet.
Jacques. – Ce n’est pas mal, n’est-ce pas, Madame, ce que nous faisons, Paul et moi ? Vous n’êtes pas fâchée contre nous ? Ce n’est pas la faute de Paul ; c’est moi qui lui ai dit de s’amuser à botteler l’herbe que j’arrache.
Elfy. – Pas de mal, pas de mal du tout, mon petit ; je ne suis pas fâchée ; bien au contraire, je suis très contente que tu débarrasses le jardin des mauvaises herbes qui étouffent nos légumes.
Paul. – C’est donc à vous ça ?
Elfy. – Oui, c’est à moi.
Paul. – Non, moi crois pas ; c’est pas à vous ; c’est à la dame de la cuisine qui donne du bon fricot ; moi veux pas qu’on lui prenne son jardin.
Elfy. – Ha, ha, ha ! est-il drôle, ce petit ! Et comment m’empêcherais-tu de prendre les légumes du jardin ?
Paul. – Moi prendrais un gros bâton, puis moi dirais à Jacques de m’aider à chasser vous, et voilà !
Elfy se précipita sur Paul, le saisit, l’enleva, l’embrassa trois ou quatre fois, et le remit à terre avant qu’il fût revenu de sa surprise et avant que Jacques eût eu le temps de faire un mouvement pour secourir son frère.
« Je suis la sœur de la dame au bon fricot, s’écria Elfy en riant, et je demeure avec elle ; c’est pour cela que son jardin est aussi le mien.
– Tant mieux ! s’écria Jacques. Vous avez l’air aussi bon que la dame ; je voudrais bien que M. Moutier, qui est si bon, restât toujours ici.
– Il ne peut pas rester ; mais il vous laissera chez nous, et nous vous soignerons bien, et nous vous aimerons bien si vous êtes sages et bons. »
Jacques ne répondit pas ; il baissa la tête, devint très rouge, et deux larmes roulèrent le long de ses pauvres petites joues.
Elfy. – Pourquoi pleures-tu, mon petit Jacques ? Est-ce que tu es fâché de rester avec ma sœur et avec moi ?
Jacques. – Oh non ! au contraire ! Mais je suis fâché que M. Moutier s’en aille ; il a été si bon pour Paul et pour moi !
Elfy. – Il reviendra, sois tranquille ; et puis il ne va pas partir aujourd’hui : tu vas le voir tout à l’heure.
Le petit Jacques essuya ses yeux du revers de sa main, reprit son air animé et son travail interrompu par Elfy. Capitaine, qui faisait la visite de l’appartement, trouvant la porte du jardin ouverte, entra et s’approcha de Paul, assis au milieu de ses paquets d’herbes. Capitaine piétinait les herbes, les dérangeait ; Paul cherchait vainement à le repousser, le chien était plus fort que l’enfant.
« Jacques, Jacques, s’écria Paul, fais va-t’en le chien ! il écrase mes bottes de foin. »