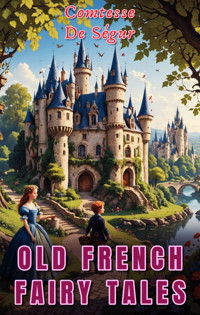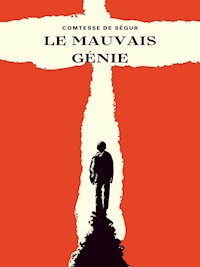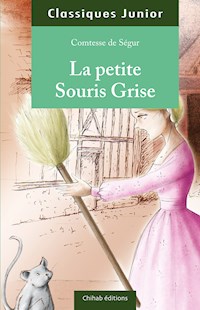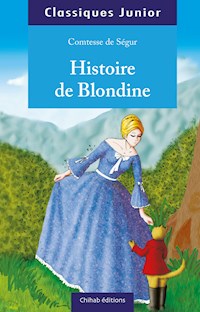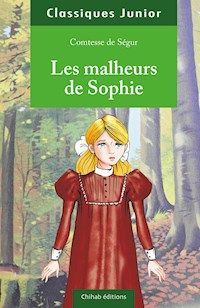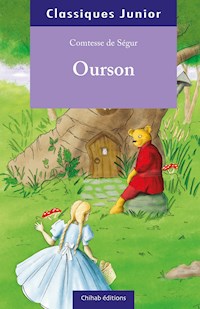Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Les Bons Enfants raconte l'histoire de Sophie, qui, avec ses deux frères Léonce et Arthur, ont des idées qui tournent toujours à la catastrophe. Malgré cela, leurs cousins sont avec eux pour passer les vacances en se racontant des histoires plus drôles les unes que les autres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les bons enfants
Les bons enfantsÀ mes petits-enfantsI – Une mauvaise plaisanterieII – Le premier avrilIII – La soirée du poisson d’avrilIV – Moyen nouveau pour teindre en noir un moutonV – Le mauvais conseilVI – La leçonVII – MinaVIII – La campagne. Les marrons.IX – La récompenseX – La souricièreXI – Les ChinoisXII – Le petit voleurXIII – Le cochon ivre mortXIV – Visite aux singesXV – La fée Prodigue et la fée BonsensXVI – Les loups et les oursXVII – Récit d’HenrietteXVIII – Le voyageXIX – La pêche aux écrevissesXX – Le chienPage de copyrightLes bons enfants
Comtesse de Ségur
À mes petits-enfants
Pierre, Henri, Marie-Thérèse de Ségur, Valentine, Louis de Ségur, Camille, Madeleine, Louis, Gaston de Malaret, Élisabeth, Henriette, Armand Fresneau, Jacques, Jeanne, Marguerite, Paul de Pitray.
Je voudrais, mes chers petits-enfants, que chacun de vous eût son nom en tête d’un de mes ouvrages, mais votre nombre, toujours et rapidement croissant, a dépassé mon courage, et je vous réunis tous en une seule dédicace, qui ne sera, je l’espère, pas la dernière, quoique tous les ans je perde une année de vie, comme le dirait le bon M. de La Palice. Encore un peu de temps, et je garderai le silence, pour cacher au public les infirmités de mon esprit ; vous en serez les seuls chers petits confidents.
Votre grand-mère,
Comtesse de SÉGUR,
née ROSTOPCHINE.
I – Une mauvaise plaisanterie
Plusieurs enfants jouaient dans le jardin de Mme Dupuis ; il faisait beau temps, presque trop chaud.
Jacques, Louis, Nicolas et Jules se reposaient sur un banc. Jacques s’essuyait le front avec son mouchoir ; il avait bêché, arrosé, ratissé, et il se reposait en causant avec ses amis.
JACQUES. – Quelle chaleur il fait aujourd’hui ! c’est presque comme en été.
LOUIS. – Nous sommes bien près de l’été.
NICOLAS. – Non, puisque nous commençons le printemps.
LOUIS. – Eh bien ! est-ce que le printemps ne touche pas à l’été.
NICOLAS. – Oui, comme il touche à l’hiver.
JACQUES. – Ce n’est pas la même chose ; l’hiver est en arrière, et l’été est en avant ; la preuve, c’est que c’est demain le 1er avril.
JULES. – Le 1er avril demain ! je n’y pensais pas. C’est le jour des attrapes. Tâchons d’attraper quelqu’un.
JACQUES. – Pas moi d’abord. Je n’aime pas à tromper.
JULES. – Que tu es bête ! Ce n’est pas pour tout de bon ; c’est pour rire.
NICOLAS. – Je crois bien ! J’ai joué beaucoup de tours du 1er avril, très drôles et très innocents.
LOUIS. – Quels tours as-tu faits ?
NICOLAS. – Un jour, j’ai écrit à un vieux M. Poucque, ami de ma tante Dupont, qu’elle l’attendait pour dîner avec un missionnaire qui avait été martyrisé en Chine et qu’il désirait beaucoup connaître. Précisément, ce jour-là, 1er avril, ma tante dînait chez nous. Le vieux monsieur est arrivé en belle toilette ; il avait pris une voiture, parce qu’il pleuvait. Le portier lui dit que ma tante était sortie ; il veut monter pour l’attendre ; le portier assure qu’elle doit rentrer tard dans la soirée ; M. Poucque se fâche ; le portier se fâche aussi ; ils se disputent longtemps ; le monsieur monte, ne trouve personne ; la pluie tombait par torrents ; pas de voiture pour retourner chez lui ; le bonhomme est obligé de s’en aller à pied ; il rentre ruisselant d’eau et fort en colère ; son domestique était sorti ; pas de dîner ; il n’a que du pain et des confitures, et le lendemain il écrit à ma tante une lettre furieuse à laquelle elle ne comprend rien ; elle le prie de venir la voir ; il lui montre sa lettre d’invitation ; elle devine que c’est un tour qu’on lui a joué ; ils cherchent et ne trouvent pas le coupable (car j’avais fait copier ma lettre par un de mes camarades de collège, pour qu’on ne reconnût pas mon écriture). Ma tante nous a raconté l’histoire ; j’étais enchanté d’avoir si bien réussi, et voilà pourquoi je voudrais cette année-ci encore faire une attrape à quelqu’un.
LOUIS. – Tu appelles cela un tour innocent ? C’est très méchant pour ce pauvre M. Poucque, qui n’a pas dîné, qui a été trempé et qui a passé une triste soirée.
JACQUES. – Sans compter qu’il est pauvre et qu’il a dépensé de l’argent pour une voiture.
NICOLAS. – Bah ! bah !… On ne s’amuserait jamais si on regardait à tout.
LOUIS. – C’est que je ne trouve aucun amusement à faire de la peine à quelqu’un.
NICOLAS. – Que tu es bête ! Ce n’est pas une grande peine d’être attrapé !
JACQUES. – Non, mais c’est un ennui ; on est vexé de s’être laissé attraper.
JULES. – Alors, tu ne veux pas m’aider à jouer un petit tour à la bonne de tes cousins Pierre et Henri ? Tu sais comme elle est ennuyeuse ! elle emmène toujours tes cousins au plus fort de nos jeux.
JACQUES. – Ce n’est pas pour les tourmenter ; il faut qu’ils rentrent pour apprendre leurs leçons.
JULES. – Voyons ! veux-tu ou ne veux-tu pas être des nôtres pour le 1er avril ?
JACQUES. – Non, je ne veux pas.
LOUIS. – Ni moi non plus.
JULES. – Vous êtes deux nigauds ; nous allons nous amuser, Nicolas et moi, et vous serez bien fâchés d’avoir refusé.
JACQUES. – Nous nous amuserons de notre côté, et bien plus que vous, car nous ferons du bien en tâchant de déjouer vos tours.
NICOLAS. – C’est ce que nous verrons, monsieur. Quand je m’y mets, il n’est pas facile de m’empêcher de faire ce que je veux.
JACQUES. – Tant pis pour toi si tu veux le mal.
En disant ces mots, Jacques se leva ainsi que Louis, et ils recommencèrent leurs travaux de jardinage.
Nicolas et Jules reprirent leurs vestes et s’en allèrent pour comploter le tour dont ils avaient parlé.
II – Le premier avril
PIERRE, huit ans. – HENRI, six ans. – LA NOURRICE de Pierre, restée comme bonne près des enfants.
(La chambre des enfants : Pierre se lève ; Henri se détire et reste près de sa cuvette sans y toucher.)
LA NOURRICE. – Allons, mes enfants, dépêchez-vous, nous sommes en retard.
HENRI, bâillant. – J’ai encore sommeil. C’est si ennuyeux de se laver !
PIERRE, riant. – Tu dis tous les jours la même chose.
HENRI, avec vivacité. – Je dis la même chose parce que c’est tous les jours la même chose ; il faut se lever, se laver, s’habiller. Crois-tu que ce soit amusant ?
PIERRE. – On dirait que tu es le seul. Je le fais bien, moi, tous les jours, et je ne grogne pas comme toi.
HENRI. – D’abord, toi tu es vieux ; ainsi ce n’est pas étonnant. PIERRE. – Non, je ne suis pas vieux ; mais je suis raisonnable, tandis que tu ne l’es pas, toi.
HENRI. – Tu es raisonnable parce que papa dit que tu as l’âge de raison ; sans cela tu ne le serais pas.
Pierre rit, la nourrice rit, Henri se fâche ; ses grands yeux noirs commencent à briller ; ses joues rougissent, il regarde Pierre et la nourrice avec un air de lion en colère ; la nourrice ne rit plus et arrête l’explosion en disant :
« Voyons, voyons ; nous perdons tous notre temps ; Mlle Albion va venir pour les leçons, et aucun de vous ne sera prêt. Vite, Pierre ; vite, mon petit Henri ; finissez de vous débarbouiller et de vous habiller. » Pan, pan, on frappe à la porte.
LA NOURRICE. – Qu’est-ce que c’est ? Entrez.
UN DOMESTIQUE. – C’est le déjeuner des enfants, et une lettre pour vous, nourrice.
LA NOURRICE. – Bien ; donnez. Pendant que les enfants déjeuneront, je lirai ma lettre.
La nourrice aide les enfants à s’habiller ; elle verse le chocolat dans les tasses, les pose sur la table, met une chaise devant chaque tasse. Les enfants font leur prière et se mettent à table.
Après avoir rangé dans la chambre, la nourrice ouvre la lettre, lit quelques lignes, pousse un cri et tombe dans un fauteuil. Les enfants se précipitent vers elle et lui demandent avec anxiété ce qu’elle a. La nourrice sanglote et ne peut répondre. Henri se jette sur la nourrice en pleurant et en la serrant dans ses bras. Pierre court chez sa maman ! il arrive pâle et suffoquant.
LA MAMAN. – Pierre, mon cher enfant ! qu’est-ce que tu as ?
PIERRE. – Maman, maman, venez vite chez ma nourrice ; on lui a apporté une lettre ; quand elle l’a eu lue, elle est tombée dans un fauteuil en sanglotant, et elle ne nous parle pas.
LA MAMAN. – Quelque malheur, sans doute, qu’on lui annonce.
PIERRE. – C’est peut-être un de ses enfants qui est mort.
LA MAMAN. – Ou bien son mari. Allons la voir et tâchons de la consoler.
PIERRE. – Je vais prendre de la fleur d’oranger pour lui en faire boire quelques gouttes.
LA MAMAN. – Que peut faire la fleur d’oranger contre un chagrin ? La meilleure consolation sera de lui témoigner notre amitié.
PIERRE. – C’est vrai, maman ; pourtant, Henri l’embrasse, et cela ne la console pas.
LA MAMAN. – Non, pas dans le premier moment ; mais plus tard, ce sera un grand soulagement à sa peine.
Ils arrivent chez la nourrice ; elle sanglote toujours en embrassant Henri, qui pleure autant qu’elle.
LA MAMAN. – Vous avez donc reçu une bien triste nouvelle, pauvre nourrice ? Est-ce de votre mari, de vos enfants ?
LA NOURRICE, sanglotant. – Non, madame… C’est…, c’est… de mon père.
LA MAMAN. – Votre père est-il malade ?
LA NOURRICE. – Non,… madame,… c’est… ma mère.
PIERRE, avec émotion. – Ta mère est malade ?
LA NOURRICE. – Morte, mon enfant ! Morte en deux heures, d’une attaque d’apoplexie.
Les deux enfants poussent un cri et pleurent tous deux. La maman cherche à consoler la nourrice et les enfants.
LA MAMAN. – Ma pauvre nourrice, il faut remercier le bon Dieu de vous avoir donné la consolation de passer quinze jours avec elle tout dernièrement et de l’avoir vue se confesser et communier le dimanche qui a précédé votre départ. Pieuse comme elle l’était, vous êtes certaine de son bonheur ; elle est avec le bon Dieu, la Sainte Vierge et les anges, et elle remercie Dieu de l’avoir retirée de ce monde.
LA NOURRICE. – C’est vrai, madame, mais c’est tout de même bien triste pour moi de ne plus la revoir.
LA MAMAN. – Pas dans ce monde, nourrice, mais dans l’autre ! toujours, pour ne plus la quitter.
LA NOURRICE. – C’est tout de même bien triste. Et mes pauvres enfants qui l’aimaient tant !
LA MAMAN. – Ils vont rester avec leur grand-père et leur tante.
HENRI, sanglotant. – Quel malheur que ce ne soit pas le beau-père de nourrice qui soit mort ! elle n’aurait pas pleuré alors.
La nourrice ne put s’empêcher de sourire malgré son chagrin ; elle embrassa tendrement le bon petit Henri.
HENRI. – Console-toi, ma chère nourrice, je te donnerai toutes mes pièces d’argent.
LA NOURRICE. – Ce n’est pas cela qui me consolera, mon cher petit.
HENRI. – Et puis je t’achèterai du pain d’épice, tu sais, ce pain d’épice que tu aimes tant,… et puis je te donnerai…, je te donnerai… Quoi donc ? ajouta-t-il en regardant autour de lui avec angoisse. Je n’ai rien,… rien que des joujoux.
LA MAMAN. – Donne-lui ton cœur, mon Henri ; c’est ce que tu pourras lui donner de plus agréable.
– Mon cœur ? dit Henri en déboutonnant son habit et en ouvrant sa chemise. Mais comment faire ? il me faudrait un couteau.
– Mon cher petit, dit la maman en souriant et le prenant dans ses bras, ce n’est pas le cœur qui bat dans ta poitrine que je veux dire, mais la tendresse de ton cœur, ton affection.
La nourrice embrassa en souriant ce bon petit Henri, qui avait été prêt à se laisser ouvrir la poitrine pour consoler sa nourrice.
Pierre, pendant ce temps, avait réfléchi au moyen d’adoucir un chagrin qui l’affligeait profondément, et il avait trouvé.
« Nourrice, dit-il, j’ai cinq francs, je ferai dire cinq messes pour ta pauvre mère, et nous irons prier pour elle, afin qu’elle soit bien heureuse près du bon Dieu. »
LA NOURRICE. – Merci, mon ami ; j’accepte ton offre si madame veut bien le permettre, car mon deuil va m’enlever tout ce que j’ai d’argent, et…
LA MAMAN. – Ne vous inquiétez pas de votre deuil, nourrice, je le payerai en entier ; gardez votre argent pour vos enfants.
LA NOURRICE. – Madame est bien bonne ; ce sera un grand soulagement pour moi.
La maman resta encore quelque temps avec la nourrice, qui continuait à pleurer, mais avec plus de calme. Elle se retira ensuite dans sa chambre ; Pierre l’accompagna ; Henri ne voulut pas quitter sa nourrice, qu’il cherchait à consoler par tous les moyens possibles ; il répétait souvent :
« Quel dommage que ce ne soit pas ton beau-père qui soit mort ! Si j’avais été le bon Dieu, j’aurais fait mourir ton beau-père et j’aurais fait vivre ta mère jusqu’au jour où nous mourrions tous ensemble. C’est ça qui eût été bien, n’est-ce pas, nourrice ? »
La nourrice souriait à travers ses larmes, embrassait Henri et pleurait toujours ; le pauvre enfant se désolait et ne savait qu’imaginer pour la distraire. Sa maman vint le chercher pour laisser la nourrice sortir et acheter son deuil. Il alla s’asseoir dans la chambre de sa maman et la regarda ranger des affaires qui étaient en désordre.
Quand elle voulut remettre en place les différents objets qu’elle avait retirés des armoires et de la commode, elle chercha vainement un châle et une robe en laine noire.
« C’est étonnant, dit-elle, que je ne les trouve pas ! Je viens de les poser sur le canapé avec mes autres effets. »
HENRI. – Que cherchez-vous, maman ?
LA MAMAN. – Un châle et une robe noirs ; je ne peux pas les trouver.
HENRI. – C’est moi qui les ai pris, maman.
LA MAMAN. – Toi ? Où les as-tu mis ? Pourquoi les as-tu pris ?
HENRI. – Je les ai portés dans la chambre de nourrice, maman. Vous ne les mettez jamais : alors j’ai pensé que vous n’en aviez pas besoin et que cela ferait grand plaisir à ma pauvre nourrice.
LA MAMAN. – C’est précisément pour elle que je les cherchais, mon petit Henri ; c’est très bien à toi de vouloir la consoler par tes présents, mais tu n’aurais pas dû prendre mes affaires sans ma permission.
HENRI. – Je vais aller les chercher et je vous les rapporterai, maman ; seulement j’aurais été bien content de les donner à nourrice, parce que j’ai remarqué que lorsqu’on lui donnait quelque chose, ça la consolait beaucoup.
LA MAMAN. – Laissez-les chez elle, puisque tu les y as portés, mon enfant ; je voulais les lui donner, ce sera toi qui les donneras, car tu en as eu, comme moi, la pensée.
Le visage d’Henri devint radieux.
PIERRE. – Maman, nous allons dîner aujourd’hui chez grand-mère ?
LA MAMAN. – Oui, mon ami, vous dînerez avec vos cousins et cousines.
HENRI. – Moi, je n’irai certainement pas.
PIERRE. – Et pourquoi cela ?
HENRI. – Parce que ce n’est pas un jour à s’amuser aujourd’hui. Je resterai avec ma nourrice.
PIERRE. – Mais nourrice viendra avec nous ; tu sais qu’elle vient toujours avec nous chez grand-mère.
HENRI. – Oui, mais pas aujourd’hui ; elle a trop de chagrin pour rire et jouer.
PIERRE. – Au contraire, ça la distraira, elle ne pensera pas à sa mère pendant qu’elle s’occupera de nous.
HENRI. – Tu crois ? Alors j’irai ; mais avant je lui demanderai si elle aime mieux venir chez grand-mère ou rester avec moi à la maison.
LA MAMAN. – Je suis sûre, cher enfant, qu’elle aimera mieux vous accompagner tous les deux que de te priver du plaisir que tu te promettais de dîner avec tes cousins et cousines.
Mais j’approuve beaucoup le sacrifice que tu voulais faire et qui prouve ton bon cœur.
Peu de temps après, la nourrice rentra ; Henri lui donna, de la part de sa maman, le châle et la robe qu’il avait portés par avance dans sa chambre, et lui demanda si elle voulait qu’il restât à dîner avec elle.
HENRI. – Vois-tu, ma pauvre nourrice, tu es triste ; cela te fera de la peine de voir jouer et rire les autres. Je voudrais bien ne pas jouer ni rire et rester près de toi, mais j’ai peur de ne pas pouvoir ; je rirai malgré moi en voyant rire les autres.
LA NOURRICE, l’embrassant. – Cher, excellent enfant, tu joueras et tu riras avec les autres ; ce sera pour moi une distraction et un plaisir que de vous voir vous amuser.
HENRI. – Oh ! merci, nourrice ! Je suis content, très content que cela t’amuse. Je vais courir le dire à maman et à Pierre.
« Maman, cria Henri tout essoufflé en entrant dans la chambre de sa mère, j’irai dîner chez grand-mère avec Pierre ; nourrice veut bien venir ; elle veut que je joue ; elle dit que de nous voir rire et jouer cela la consolera, au lieu de lui faire du chagrin. »
LA MAMAN. – J’en étais bien sûre ; alors votre journée est arrangée : vous irez vous promener à deux heures après vos leçons ; vous reviendrez à quatre heures faire vos devoirs ; à six heures vous irez dîner chez votre grand-mère, et le soir nous irons chez votre tante de Rouville.
PIERRE, entrant. – Maman, voici Mlle Albion qui vient nous donner notre leçon.
HENRI. – Ah ! mon Dieu ! et moi qui n’ai pas appris ma fable et les mots anglais.
PIERRE. – Voilà ce que c’est ; tu remets toujours au dernier moment. Si tu avais appris tes leçons hier, en même temps que moi, tu les saurais comme moi.
HENRI. – Est-ce que je pouvais savoir que ma pauvre nourrice aurait du chagrin ? Comment veux-tu que je le devine ?
PIERRE. – Tu ne pouvais pas deviner cette chose-là ; mais tu aurais pu croire à une autre chose.
HENRI. – Quoi ? Quelle chose ?
PIERRE. – Je n’en sais rien ; c’était toujours plus sûr d’apprendre tes leçons hier au soir. Tu vas être en pénitence, à présent.
HENRI, pleurant. – Ce n’est pourtant pas ma faute si je n’ai pas eu le temps ce matin.
La maman ne disait rien ; elle faisait semblant de ne point entendre et continuait à se coiffer.
Mlle Albion entre ; c’est une grande Anglaise à longues dents ; elle salue, dit bonjour aux enfants et prend sa place à la table de travail ; Pierre présente bravement ses cahiers, que Mlle Albion examine.
MADEMOISELLE ALBION. – Très bien ! Very well, my dear. Et vous, my little Henry, quoi vous avez eppris ?
HENRI, pleurant. – Je ne sais rien ; je n’ai pas eu le temps.
MADEMOISELLE ALBION. – Oh ! fy ! mister Henry ! Comment ! vous avez eu pas le temps ? Oh ! mister Henry ! Shocking, shocking ! Vous méritez une pénitence, et je demande à medem votre mama que vous dînez tout seul dans votre appertement.
HENRI, sanglotant et courant à sa maman. – Maman, maman, Mlle Albion ne veut pas que je dîne chez grand-mère ; elle veut que je dîne tout seul. Ce n’est pas ma faute, ce n’est pas ma faute !
LA MAMAN, embrassant Henri. – La punition ne serait pas juste, mademoiselle ; Henri aurait appris ses leçons sans un malheur imprévu arrivé à la nourrice de Pierre et qui la empêché de s’occuper d’autre chose que du chagrin de la nourrice.
MADEMOISELLE ALBION. – Pourtant, medem, mister Piêre a tout fait ses devoirs, et je pense mister Henry povait parfaitement faire le sien. Mon opinion est qu’il fallait un pénitence.
LA MAMAN. – Soyez sûre, mademoiselle, que s’il fallait une pénitence, je ne m’y opposerais pas ; mais il n’en faut pas, et je vous prie de n’y plus penser.
MADEMOISELLE ALBION. – Very well, medem ; c’est votre volonté. Seulement, je croyais qu’un pénitence fait toujours bien aux enfants.
LA MAMAN. – Quand elle est juste, c’est possible ; autrement, elle fait plus de mal que de bien.
PIERRE. – Maman a bien raison ; une pénitence injuste ou trop forte met en colère et donne envie de mal faire pour se venger.
MADEMOISELLE ALBION. – Hooo ! Quoi vous feriez donc à votre frère, alors ?
PIERRE. – Je ne ferais rien du tout, parce qu’il n’a rien fait de mal.
MADEMOISELLE ALBION, piquée. – Very well, mister Piêre ; vous jugez comme une étourneau.
Pierre allait répondre ; mais la maman lui imposa silence et pria Mlle Albion de commencer la leçon. Les enfants travaillèrent très bien. Dans les moments de repos, Henri courait chez la nourrice pour voir si elle pleurait. Il était heureux quand il la trouvait calme et occupée à son ouvrage du matin ; quand il la voyait triste, il cherchait à la consoler par ses caresses et par des projets riants pour l’avenir.
Les leçons finies, Mlle Albion mit son châle et son chapeau, salua et sortit ; le déjeuner était servi ; les enfants étaient sérieux et mangeaient à peine. Ils allaient se lever de table quand la porte s’ouvrit, et Jacques et Louis entrèrent précipitamment avec leur bonne. Ils jetèrent un regard sur leurs cousins, virent leurs visages tristes et les yeux d’Henri rouges encore des larmes qu’il avait répandues.
« Qu’est-ce que tu as ? Pourquoi as-tu pleuré, Henri ? Pourquoi êtes-vous tristes tous les deux ? » dit Jacques avec vivacité.
PIERRE. – Parce que la pauvre nourrice a perdu sa mère.
LOUIS. – Perdu sa mère ? Comment l’a-t-elle su ? Qui le lui a annoncé ?
PIERRE. – C’est par une lettre de son père, qu’elle l’a appris ce matin.
JACQUES. – Je parie que ce n’est pas vrai. C’est une méchanceté de Jules et de Nicolas.
LA MAMAN. – Jacques, mon enfant, ce que tu dis là n’est pas bien. Comment Jules et Nicolas auraient-ils inventé une méchanceté pareille.
LOUIS. – Justement, ma tante, nous venions vous dire qu’ils ont parlé d’un tour à jouer à la pauvre nourrice ; ils appellent cela un poisson d’avril, et nous avons refusé de le faire avec eux.
LA MAMAN. – Mais pourquoi auraient-ils causé un si grand chagrin à la nourrice, qui ne leur a jamais rien fait ?
JACQUES. – Ils veulent la punir d’avoir emmené mes cousins des Tuileries à l’heure où l’on joue le mieux.
LA MAMAN. – Ce serait abominable. Venez chez la nourrice, mes enfants ; je verrai si la lettre est marquée de la poste de Meaux, où demeure son père.
Les enfants coururent en avant ; la maman les suivit plus lentement.
HENRI, essoufflé. – Nourrice, nourrice, donne-nous vite la lettre. Jacques et Louis disent que ce n’est pas vrai ; que c’est Jules et Nicolas qui sont des méchants.
LA NOURRICE. – Quoi, pas vrai ? Comment, méchants ?
HENRI. – Tu vas voir, tu vas voir ; ta mère n’est pas morte ; je te dis que c’est Jules et Nicolas.
La nourrice devint pâle et tremblante ; elle tira avec peine de sa poche la lettre fatale, que saisit Pierre pour la passer à sa maman, qui venait d’entrer. La maman regarda l’adresse ; c’était le timbre de Paris. Elle ouvrit avec précipitation, et vit en haut de la lettre 1ER AVRIL en gros caractères, et au-dessous, au lieu de MEAUX : CRACSHOURIE.
« C’est une attrape ! s’écria Mme d’Arcé avec indignation ; une méchante et misérable attrape ; Nourrice, votre mère n’est ni morte ni malade. Jacques et Louis viennent nous prévenir que Jules et Nicolas se proposaient de vous faire une méchanceté pour le 1er avril ; et, en effet, la voilà, abominable et noire comme le cœur de ces malheureux enfants. »
La nourrice ne pouvait en croire ses oreilles ; elle voulut voir la lettre, mais ses mains tremblaient si fort qu’il lui fut impossible d’en lire un mot. Les enfants riaient et sautaient ; ils embrassaient la nourrice, leur maman, leurs cousins. La nourrice commençait à se remettre de son saisissement. Le visage de Mme d’Arcé exprimait une vive indignation.
« Ces enfants seront punis de leur méchante action ! Ils l’auront bien mérité », dit-elle avec calme et force.
PIERRE. – Comment seront-ils punis, maman ?
MADAME D’ARCÉ. – Tu verras ; vous assisterez tous à leur punition.
LOUIS. – Quand cela, ma tante ?
MADAME D’ARCÉ. – Ce soir, mon enfant, à la réunion qui aura lieu chez votre tante de Rouville.
JACQUES. – Que ferez-vous, ma tante ?
MADAME D’ARCÉ. – Tu le sauras ce soir ; en attendant, racontez-moi bien en détail comment vous avez appris le projet de ces mauvais garçons.
Louis et Jacques racontèrent la conversation de la veille, sans oublier l’histoire de M. Poucque. Nous verrons avec les enfants quelle fut la punition de Jules et de Nicolas.
III – La soirée du poisson d’avril
Madame de Rouville avait invité plusieurs de ses neveux et nièces et quelques-uns de leurs amis pour passer la soirée du 1er avril. Jacques, Louis, Jules et Nicolas, Pierre et Henri étaient du nombre des invités. Camille et Madeleine de Rouville préparaient de quoi amuser leurs cousins et amis. Sophie et Marguerite, leurs amies les plus intimes, les aidaient
CAMILLE. – Assez d’images, Sophie ; tu en couvres toute la table.
SOPHIE. – Les images les amuseront beaucoup ; il n’y en a jamais trop.
MARGUERITE. – Mais si ! il y en a trop quand c’est trop.
SOPHIE. – Cela est parfaitement vrai, mais je dis qu’il n’y en a pas trop.
MARGUERITE. – Tu vois bien qu’il n’y a de place pour rien mettre. SOPHIE. – Que veux-tu mettre de plus ?
MARGUERITE. – Des livres, des couleurs, des dominos, des jonchets, des cartes, des ballons, des volants, des raquettes, des…
SOPHIE, d’un air moqueur. – Des provisions, des affaires de toilette, des lits, des…
MARGUERITE. – Du tout, mademoiselle ; moi, je dis des choses raisonnables et vous, vous dites des bêtises.
CAMILLE. – Au lieu de vous disputer, aidez-nous à tout ranger ; j’entends mes cousins qui montent.
En effet, Pierre, Henri, Jacques et Louis entrèrent en courant ; ils embrassèrent leurs cousines après avoir dit bonjour à leur tante et à leur oncle.
JACQUES. – Qu’est-ce que vous faites ? Pourquoi arrangez-vous tout cela ?
MADELEINE. – Pour vous amuser tous ce soir.
LOUIS. – Ah bah ! nous nous amuserons à jouer à colin-maillard, à cache-cache, à d’autres jeux courants ; c’est bien plus amusant.
– C’est vrai ! c’est vrai ! s’écrièrent ensemble Camille, Madeleine, Sophie et Marguerite.
D’autres enfants arrivèrent, et parmi eux Jules et Nicolas, qui regardèrent d’un air méchant Pierre et Henri ; Louis et Jacques avaient déjà raconté aux Tuileries le mauvais tour qu’on avait joué le matin à la pauvre nourrice de Pierre et de Henri, mais sans dire que les coupables étaient Jules et Nicolas, car Mme d’Arcé leur avait défendu de les nommer. Tous les enfants qui avaient bon cœur furent indignés de la méchanceté de cette attrape ; ils en parlaient devant Jules et Nicolas, sans remarquer leur embarras et leur silence. Le soir, les papas et les mamans avaient abandonné aux enfants le grand salon et la salle à manger, et s’étaient mis à l’abri du tapage dans un plus petit salon.
Au plus fort des jeux, la porte de l’antichambre s’ouvre à deux battants ; un domestique annonce : « Monsieur le commissaire de police ! » Les jeux cessent ; les enfants se groupent au fond de la salle à manger ; Jules et Nicolas se placent prudemment derrière tout le monde.
Le commissaire de police tenait une lettre à la main. Il regarde les enfants d’un air sévère, s’avançant vers eux.
« Lequel de vous, dit-il, a écrit la lettre que je tiens à la main ?
– C’est celle qui a tant fait pleurer ma nourrice ce matin », dit Pierre reconnaissant la lettre.
HENRI. – Et moi aussi, elle m’a fait pleurer très longtemps.
– Voyons, voyons la lettre ! dirent les enfants s’approchant du commissaire de police.
Jules et Nicolas seuls restaient près du mur et paraissaient terrifiés.
« Savez-vous, mes enfants, qui a écrit cette lettre ?
– Je ne sais pas ! » s’écrièrent les enfants en chœur.
Jacques et Louis ne disaient rien.
« Voilà deux petits messieurs bien gentils qui doivent savoir quelque chose, dit le commissaire. Approchez, mes petits messieurs. »
Louis et Jacques s’approchèrent sans crainte, car ils se sentaient innocents.
« Connaissez-vous ces deux messieurs qui se tiennent collés contre le mur là-bas, comme s’ils voulaient y entrer ? »
Jacques se retourna, sourit et répondit :
« C’est Jules et Nicolas de Bricone.