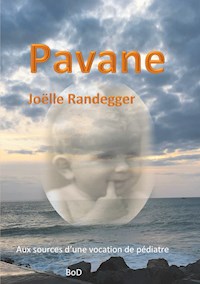
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
A l'âge de quinze ans j'ai voulu devenir médecin d'enfants. Mais assurément je n'ai pas choisi d'être confrontée à leur mort, je désirais seulement les soigner et leur rendre le sourire. Pourquoi alors, ai-je quitté la la sécurité d'un ancrage en France pour lutter avec les enfants d'Afrique décimés par la malnutrition, la rougeole, le paludisme et, pour combler la mesure, atteints par le sida. En 2008, une visite au mémorial des enfants de Yad Vachem en Israël provoque en moi un tel choc que je me mets en marche pour comprendre ce qui m'a mise sur des rails où je ne n'ai cessé de me sentir impuissante, voire responsable de la mort d'êtres si jeunes. Avec l'aide d'un psychanalyste, j'interroge d'abord les circonstances de ma naissance en 1942, année de la Rafle du Vel d'HIV, puis les nombreux deuils familiaux qui ont émaillé ma jeunesse et mon âge mûr. Je cherche aussi la signification de rêves répétitifs de noyade, mettant en scène une fillette inconnue, sans pouvoir les rattacher à des souvenirs précis. Dans l'impasse où je semble m'enliser, je m'arrête un instant pour "jouer au jeu du contentement" : retrouver les éléments et les personnes qui m'ont aidée à faire face au tragique de mon existence. J'évoque aussi mes interrogations existentielles sur la mort, ayant bousculé les fondements de ma foi chrétienne, de tradition protestante. Mystérieusement, des portes vont s'ouvrir, des rencontres fortuites vont venir éclairer les zones enfouies de mon histoire. La première révèle la présence à mes côtés, les premiers mois de ma vie, d'une enfant accueillie dans notre famille, dont le destin dramatique quelques années plus tard explique la trame de ce rêve récurrent. Puis, une deuxième porte s'ouvre sur des hypothèses qui me feraient rejouer encore et encore des situations d'attachement suivies d'un deuil brutal. Elles seraient l'écho d'un abandon subi par l'une de mes grands mères à l'âge de 18 mois et de la perte très précoce d'une jumelle ignorée. La quête aboutit à une libération de mes énergies engluées par la tristesse, et à des retrouvailles avec la joie tout simple de la vie et de la beauté du monde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autres publications de l’auteur
Frémissement de l’aube.
Sept paroles de vie et d’espérance pour un temps de souffrance. Aquarelles de Henri Lindegaard Olivétan, 1999
Dans le mitan du lit, la rivière est profonde Eloge de la fidélité.
Olivétan, 2007
Porteuses d’eau vive
Contempler les icônes et cheminer sur les pas des femmes de l’Evangile Médiaspaul, 2009
Parle nous des enfants
Médiaspaul, 2011
Le Mariage dans tous ses ébats- Lettre à une amie « psy » et « catho » Une voix protestante.
Olivétan, 2013
Le temps de vivre et le temps de mourir : Pour une fin de vie et une mort non-violentes.
Olivétan 2014
Une Bonne Nouvelle :Un évangile prié avec les icônes.
Passiflores, 2019
Table des matières
Chronologie
Les ombres
Sarah
Edouard et Marguerite
Henriette et Roger
La Tunisie, ma terre natale
Dix huit ans
Roger, mon père
Le Kibboutz Amir
Geneviève, Yves et Christian, la fratrie morcelée
Les rêves
Ophélie
Thérèse
Ossian
Choisis la vie, afin que tu vives
Les enfants, mes maîtres
La vie familiale, un ancrage
L’amitié sans frontières
Les Ancolies
La culture comme un jardin anglais
La foi, ma boussole
L’Au Delà et son mystère
Blanche, l’enfant défunte
La couleur Blanche
Journal de guerre
Léo
Alfreda
La jumelle perdue
Stéphanie
Judith
Gabrielle
Marie Jacobé et Marie Salomé
L’automne, l’hiver et puis…le printemps !
Louise
Que ma joie demeure
Septantaine
Chronologie
1942 Naissance en Tunisie
1953 Décès de mon grand père Roger Labarde
1956 Départ de Tunisie
1957 Installation de la famille Randegger au Havre
1961 Décès de mon père Roger Randegger. Installation de ma mère Thérèse à Marseille
1961 Début de mes études de médecine Faculté de Rouen puis Paris
1963 Décès de ma sœur Geneviève
1965 – 1973 Mariage avec Hubert NICOLAS et naissances de nos 4 enfants.
1968 Certificat de Pédiatrie Faculté de médecine de Paris
1969 Arrivée à Mostaganem en Algérie. Médecin du bled puis pédiatre de PMI
1975 Arrivée en Côte d’Ivoire. Pédiatre de PMI et à l’hôpital
1983 Arrivée à Pointe Noire au Congo. Chef de service hospitalier de pédiatrie
1988 Retour en France.
1989 Installation à Montpellier. Praticien hospitalier au CHU de Montpellier
1992 Naissance de ma première petite fille, Héloïse
1993 Décès de mon frère Yves
1995 Décès de mon frère Christian
2003 Décès de ma mère, Thérèse Labarde. Je prends ma retraite
2004 – 2012 Nombreuses missions humanitaires en Afrique et à Madagascar
1998 - 2010 Naissances de cinq autres petits enfants : Doriann, Erwann, Théa, Méloé, Elyes
2007 Naissance et décès de mon petit fils Ossian
2008 Voyage en Israël et Palestine
2009 Début de mon parcours à la recherche des sources de ma vocation. Découverte de Blanche
2011 Evocation de Louise
2013 Soixante dixième anniversaire
I- Les ombres
Ce qui est sous vos pieds vit, se réveille, se tord, souffre peut-être ou s'ébroue. La terre tremble d'un long silence retenu, d'un cri jamais poussé.
Danser les ombres
Laurent Gaudé
1- Sarah
Visiter Yad Vachem, le 12 Octobre 2008, n’était sûrement pas la meilleure façon de fêter mon anniversaire ! Mais comment pouvais-je imaginer l’orage qu’allait déclencher en moi la vue du visage sculpté en bas relief sur le mur d’entrée du mémorial des enfants ?
Le voyage en Palestine dans lequel je me suis inscrite sur un coup de cœur à l’appel de mon amie Suzanne, touche à sa fin. Déjà s’estompent les images trop touristiques : le désert du Néguev et la source que Moïse fit jaillir d’un coup de bâton ; le plateau de Massada battu par le soleil et les vents ; la mer Morte réduite à un bout de miroir strié de trainées blanchâtres, déposé entre des collines arides ; le Jourdain devenu un serpent paresseux à force d’être pompé de ses forces vives ; le lac de Tibériade aux vagues rougeâtres sous la bourrasque et le mont des Béatitudes où la voix du Fils de l’Homme se fait encore entendre dans la brise caressant les grands cyprès ; Nazareth, déchiré par les conflits entre ses communautés et le mont Thabor, gardien de la plaine de Galilée ; Bethléem, grouillante de foules dont on sent effleurer à chaque instant la tension, et aujourd’hui Jérusalem, la mythique et la réelle entremêlées, son dôme scintillant au milieu des remparts comme un bijou dans son écrin. Le parcours est riche de paysages et de sites que ma culture protestante m’a rendus familiers, comme si les découvrant pour la première fois, je les retrouvais intacts, après une promenade vers l’amont de ma rivière jusqu’à sa source. Dans chaque lieu, nous sont proposées des rencontres avec des chercheurs de cette paix introuvable entre musulmans, juifs et chrétiens de Palestine. D’émerveillements en indignations, nous sommes soumis depuis dix jours à un bombardement d’émotions, qui nous a mis le cœur en capilotade. Le détour par Yad Vashem, le jardin de la Shoah, n’est pas prévu au programme. Mais certains pèlerins ont tant insisté auprès de nos guides qu’ils nous l’ont accordé, presqu’à contre cœur, entre deux visites de monuments chrétiens.
Nous voilà donc, le long des allées bordées par les arbres des Justes du monde entier. Ils rappellent la droiture et le rayonnement de ceux qui ont résisté aux menaces et aux imprécations de la dictature hitlérienne, en cachant des amis, des voisins, des inconnus. La chambre de mémoire où brûle la flamme des suppliciés de la Shoah, au centre de la dalle gravée des noms des différents camps de concentration, m’a déjà emplie d’une angoisse claustrophobe que je domine douloureusement. Mais lorsqu’au détour du chemin apparaissent les pierres taillées de l’entrée du mémorial des enfants, je me fige, mes pas se bloquent et mon cœur s’affole dans une salve de pulsations. Une voix intérieure me glace : « N’y entre pas, Joëlle ! Tu n’y résisteras pas… » Mais la foule me presse, derrière et devant moi. Ils sont là, tous mes amis du voyage, aussi émus que moi, mais plus vaillants. A moi qui suis statufiée, ils me prêtent leurs jambes, leurs yeux et leurs oreilles comme si un grand corps protéiforme m’empêchait de reculer. Impossible de m’extraire du mouvement de reptation qui nous conduit tous au fond du gouffre où gît la mémoire de ces myriades d’enfants, massacrés du seul fait qu’ils étaient juifs !
J’y plonge comme une masse de plomb, sentant toute l’énergie de mon corps s’écouler en cascade, dans une chute sans fond. D’innombrables points lumineux, reflets de cinq bougies allumées dans un écrin de miroirs invisibles ne parviennent pas à chasser l’obscurité totale, épaisse, d’un noir plus sombre que la suie qui envahit tout : la vue mais aussi la bouche, la gorge et le cerveau. L’ombre ruisselle sur mes bras qui s’accrochent à la rampe invisible, elle s’étale sous mes pas hésitant à fouler le sol rocailleux. Elle recouvre mon visage d’une boue infâme, que mes larmes et celles des mères du monde entier ne suffiront jamais à nettoyer. Seule mon ouïe accueille les noms égrenés un à un, des milliers de victimes, suivis de leur ville d’origine et du camp où elles avaient été déportées.
Cette voix, grave, chaude, au rythme monotone semble ne jamais pouvoir se taire. Elle crie depuis un demi siècle la même litanie mais vient du fond des âges pour dénoncer la cruauté humaine, depuis le meurtre d’Abel, d’une éternité à l’autre éternité. Elle envahit tout l’espace, pénètre et creuse le magma où sont englués les battements de mon cœur. Aucune échappatoire à l’émotion n’est possible, aucune distance ne peut être prise avec le martyre de ces enfants. Aucun autre souffle ne peut s’exhaler que la lamentation de Rachel, à Rama, Bethléem ou Jérusalem, qui pleure et ne veut pas être consolée. Hérode n’en finit pas de pourchasser et de massacrer les saints innocents et je suis l’une de leurs grand-mères, moi qui tente, une fois encore, de sauver désespérément des petits voués à la mort puis à l’oubli…
La lueur vacillante des flammes révèle des ombres venues du passé. Voici que montent du puits de mon angoisse, des guerriers laissant sous leurs bottes des monceaux de ruines, des cadavres vrombissant de mouches, des carcasses de tanks ou d’avions dentelés par la rouille… Des fantômes traînent leurs valises le long des quais de gare et des silhouettes clandestines chavirent sur des bateaux de fortune. J’entends le hululement des trains dans la nuit. Leur cahotement couvre les cris des déportés, des réfugiés, de pourchassés.
Je discerne avec horreur des enfants aux yeux écarquillés, aux membres écartelés, dont les corps sans vie, encore potelés, sont abandonnés au bords des routes. Des mutilés claudiquent appuyés sur leurs béquilles de bois et les gueules cassées des adolescents enrôlés dans les tranchées se figent dans d’horribles rictus.
Les drames de l’histoire tournent dans ma tête, sous mes paupières, dans une danse fantastique. La peste et le choléra se sont donné la main et ricanent avec force grimaces. Les maquis algériens succèdent à la Shoah. La jungle du Vietnam s’enflamme pour laisser apparaître les montagnes arides d’Afghanistan où se terrent encore les suppôts du Grand Barbu. L’Irak explose en milliers de débris sur les murs de nos villes. L’Iran attend son heure de bombes, tandis que les cailloux désertiques du Darfour recouvrent les tombes.
Combien d’enfants, combien de mères sont tombés sous les coups de ces combats fous furieux sans qu’aucun mémorial ne leur soit jamais dressé ?
Tout près de moi, s’avancent en tête, les petits palestiniens tués, les pierres à la main, sous les balles israéliennes et les bébés mort-nés dont les mères, retenues aux barrages de sécurité, n’ont pu franchir la ligne qui les séparait de l’hôpital où elles avaient prévu d’accoucher. Le Père Rahed de Taïbeh et Sœur Sophie ont évoqué devant nous, pèlerins du journal la Vie, ces drames inconcevables pour nous, mais familiers d’une société intoxiquée par la peur de l’autre. La visite de l’orphelinat dirigé par cette religieuse française, à Bethléem, l’avant-veille, a déjà soulevé en moi une nausée qui m’a fait fuir pour m’asseoir à l’écart dans les jardins ombragés de l’hôpital restauré par l’Ordre de Malte. Que m’est-il arrivé déjà ce jour là ? Pourquoi cette sensibilité à fleur de peau chez moi, la pédiatre aux mains nues, qui a soigné tant d’autres enfants en détresse, dans les pays du tiers monde où j’ai longtemps exercé mes talents?
J’ai mis ce dégout sur la mise en scène de la charité qui nous était infligée. La religieuse, toujours à court de moyens pour faire fonctionner sa structure d’accueil, compte sur les touristes chrétiens que nous sommes pour renflouer ses caisses et organise en toute bonne foi un tour opérateur de la larme aux yeux, ouvrant comme par miracle nos porte-monnaie bien garnis… Elle draine les flots de pèlerins vers la salle de jeux où s’entassent pêle-mêle une quarantaine de nourrissons apeurés et une vingtaine de « dames en rose » aux visages immobiles et aux gestes mécaniques. Des montagnes de jouets et de peluches sont censées leur apporter la douceur des bras maternels oubliés. Car leurs mères, dans ce pays, sont encore frappées d’ostracisme voire menacées de mort, si leur grossesse survient en dehors des lignes établies par une tradition patriarcale bien ancrée, justifiée par les textes sacrés : lapidation pour les femmes adultères, indulgence pour leurs séducteurs. Elles préfèrent donc traverser les barrages hérissés dans tout le pays pour aller confier à Sœur Sophie le fruit de leurs amours illicites, voire des viols et des incestes familiaux commis dans la plus grande hypocrisie…
Et voilà qu’ici, dans la grotte du mémorial, j’entends à nouveau les pleurs de ces enfants rejetés se mêlant à ceux des enfants martyrisés… Derrière eux, têtes brunes, grands yeux sombres ouverts sur l’infini, surgit une autre cohorte. Cachés sous les noms des enfants juifs, je reconnais tous ceux que j’ai tenus dans mes bras, palpés, auscultés, soignés, caressés et qui pourtant, ont un jour ou une nuit, basculé vers l’obscurité. Je revois les visages des enfants d’Afrique et du Maghreb, ceux qui avaient été confiés à mes soins et à mes pauvres outils, incapable que j’étais d’arrêter le bras de la Camarde qui se levait sur eux. Amaigris par le marasme, bouffis des œdèmes de la malnutrition, les yeux brillants des fièvres tropicales et la peau tigrée par la rougeole, combien sont-ils à me demander des comptes ? A moi, impuissante à les sauver et à tous ceux qui les ont laissé mourir par négligence, malhonnêteté, corruption, incompétence, ignorance et indifférence, bref par tous les maux dont notre belle planète est défigurée depuis qu’existe notre humanité ! Ils apparaissent tous, un à un, au fil du lamento des prénoms, dont les consonances européennes et juives se transforment peu à peu en d’exotiques dénominations : Slimane, Khadidja, Yasmina, Koffi, Nzoussi, Jean de Dieu, Mélodie, Ornella, Korotimi, Euphrasie, Prince, Chaudry, Bendarel… Et tant d’autres dont le petit corps fripé s’est inscrit dans ma mémoire. Au fond de ma rétine, je retrouve leurs cernes excavés, les côtes saillantes et les membres grêles, étalés sur le pagne qui recouvrait le matelas de plastique mais ne cachait pas les ressorts du lit, dont la peinture écaillée datait de l’époque coloniale.
Voici encore un dernier groupe d’enfants, plus restreint mais dont le souvenir est encore si vif que résonne encore en moi la musique de leur voix et rayonne la lumière de leurs sourires et de leurs dessins. Enfants de France, atteints de leucémie, de cancer, de SIDA, je vous accueillais en hôpital de jour dans l’un des meilleurs services de pédiatrie. Malgré les soins les plus pointus, malgré la volonté arqueboutée des parents et de l’équipe médicale vers votre guérison, vous n’avez pas pu rester parmi nous, les habitants de la Terre. Tout au long des mois de chimiothérapie puis de soins palliatifs, j’ai tenté de vous écouter et d’atténuer vos souffrances, je me suis approchée de vos familles pour soulager leur peine. Un jour, il a fallu vous dire adieu, dans un déchirement qui ne pouvait se dire. Sinon, comment rester capable d’accueillir les nouveaux et lutter avec eux dans l’espoir de la guérison ?
Mes larmes coulent maintenant sans retenue et n’empêchent aucune de ces visions de se dissoudre. Au contraire, le torrent de ces images semble ruisseler avec l’eau de mes yeux pour atteindre toujours plus profond les moindres recoins de mon être. Je pleure à gros sanglots, pour tous les deuils que mon métier m’a appris à refouler. Je deviens la mère de tous ces enfants morts. Je suis celle dont la dignité blessée se cadenassait dans le silence de la sidération, celle qui levait dans une longue plainte, son poing vers le ciel pour réclamer réparation ou celle qui déchirait ses vêtements et se roulait dans la poussière de la cour de l’hôpital, entourée d’un grand cercle de spectatrices compatissantes. Je deviens Marie debout au pied de la croix et Madeleine plongée dans l’obscurité du tombeau vide…
Et quand revient le jour, à la sortie sur l’esplanade dont la vue domine les montagnes de Judée, la lumière du plein soleil brûle mes paupières. Je titube et m’assieds sur le bord d’un rocher, à l’écart. J’entends d’autres sanglots derrière moi mais la voix grave, au moins s’est tue. Ne reste en moi qu’un pauvre tas d’émotions totalement enchevêtrées, un embrouillamini de fatigue, de nausée et de vide, complètement inconnu de moi, même aux instants les plus douloureux de mon existence.
Je poursuis le voyage dans cet état second. L’après midi, un guide nous emmène sur les hauteurs de Jérusalem Est, constater les ravages de la démolition des habitations palestiniennes au profit de la construction de colonies toutes neuves, pimpantes et confortables, destinées à faire de la ville toute entière la capitale de l’Etat d’Israël. Assourdies par la boule cotonneuse qui a remplacé mon cerveau, j’écoute à peine les explications de Sarah, cette jeune juive militante qui se bat de toute sa ferveur contre les injustices commises par ses gouvernants. J’ai oublié ma caméra à l’hôtel et mon calepin de notes reste vide. Seul subsiste de cet instant, l’ovale d’un beau visage, aux cheveux courts et aux yeux vifs que j’ai crayonné sur le vif. Suzanne, ma belle vieille amie qui m’a entrainée dans cette aventure, s’inquiète en silence car elle a compris le choc que j’ai subi, sans bien sûr, comme j’en suis incapable moi-même, comprendre sa source et son intensité.
Le lendemain, nous n’avons pas le temps de nous appesantir sur l’événement car nous attend le moment du retour vers la France. La fatigue est à son comble après cinq heures de contrôle des papiers, de fouille itérative des bagages à l’aéroport de Tel Aviv puis six heures de vol jusqu’à Roissy, dont l’univers de béton, métal et verre ne fait qu’aggraver mon malaise. Suzanne et moi repartons vers Montpellier en train mais chacune dans une rame différente. J’aurai donc tout mon temps pour somnoler et retrouver mes esprits. Tant s’en faut ! Car selon mon habitude, j’entre dans la boutique Relay pour choisir une lecture qui pourrait m’abstraire des émotions de ce voyage. C’est toujours la meilleure façon de me changer les idées ! Parmi la profusion à l’étalage de journaux et brochures en tout genre, mon regard est attiré par un titre : « Elle s’appelait Sarah ». En hommage à cette jeune israélienne entrevue hier, émergeant de la brume ou à cette amie d’enfance qui avait choisi après une expérience spirituelle, de se prénommer ainsi, abandonnant celui que ses parents lui avait donné ? Ou parce la couverture illustrée d’un visage d’enfant a capté mon attention ? Je ne connais ni l’auteur, ni l’histoire même si depuis, elle a fait le tour du monde et a été récemment mise à l’écran. Je paye et j’empoche sans hésiter.
Foin de repos et de sérénité ! A peine assise dans mon fauteuil, dès les premières lignes, je sens que rien ne pourra me faire lever les yeux de cet ouvrage. L’entourage disparaît, je ne voyage plus dans ce train, je cours, je vole dans ces pages qui une à une défilent sous mes yeux fascinés.
« Le monde pourrait crouler, Joëlle ne sortirait pas de son livre » s’exclamait ma mère, au temps de mon adolescence… Ma lecture ininterrompue durant les trois heures et quart du trajet en TGV me replonge dans l’époque de la dernière guerre mondiale, dans l’horreur que je désirais à tout prix oublier. Elle me fait vivre la rafle du Vel d’Hiv, la traque des enfants juifs, les camps de Beaune la Rolande et de Pithiviers, l’évasion de la jeune héroïne et son accueil dans une courageuse famille rurale, la découverte macabre de son petit frère, resté enfermé dans un placard à double fond de leur appartement parisien, la confiscation des biens juifs et la quête des descendants pour reconstituer leur histoire ! Bref, tout ce qui convient à mon esprit traumatisé pour bouillonner de plus belle au risque d’éclater.
Au point où j’en suis, le hasard n’a plus de réalité. Qui donc a guidé ma main, quelle puissance mystérieuse a préparé pour moi cet ouvrage, quel appel me parvient d’un passé si lointain ? Je me sens si proche de cette petite Sarah, emprisonnée dans un camp et destinée à la chambre à gaz qu’il me faut trouver les correspondances secrètes qui nous ont réunies. Je suis au début d’un sentier de montagne qu’il me faudra gravir pour découvrir quels paysages de mon enfance et de mon avenir se dévoileront, donnant sens et cohérence au chemin déjà parcouru… Et peut-être, y suis-je attendue par quelqu’un, un(e) inconnu(e) qui me fait signe et m’appelle ?
Trois jours après mon retour, une sensation de brûlure intercostale droite me réveille : un zona s’est déclaré dont je n’ignore pas la composante psychosomatique. Les clins d’œil continuent : mon cœur essoré comme une serpillère à Yad Vashem, mon esprit éveillé à la connaissance de Sarah et mon corps maintenant boursoufflé par ce virus, mémoire d’une varicelle infantile, sont autant de cailloux blancs semés dans la forêt de mes souvenirs qui m’entraînent à la compréhension de ma propre histoire. Serai-je sur ce sentier conduite vers un ogre ou au contraire vers une douce fée ?
J’ai l’intime conviction qu’il s’agit de comprendre les fondements de mon choix professionnel, de ma vocation de pédiatre et de l’appel à l’exercer dans des lieux extrêmes où les enfants sont en danger mortel. Qui me l’a lancé par delà le temps, qui a orienté mes pas vers eux, et quelle force me pousse à vouloir les arracher au trépas ? Qui me conduit à ce face à face répétitif avec la perte brutale d’un être auquel on ne peut que s’attacher parce qu’il est petit, fragile, aimé et aimable ?
Le 16 juillet 1942, jour de la rafle, ma mère me portait depuis six mois. Les convois vers Auschwitz s’étaient succédés tout l’automne. Sarah aurait pu mourir le jour de ma naissance, si elle ne s’était pas enfuie du camp de Pithiviers. Mais parmi les 4051 enfants arrêtés, combien d’autres fillettes ont-elles subi la torture du wagon à bestiaux et l’asphyxie dans la chambre à gaz, sans qu’aucun roman ne leur soit consacré ? Peut-être l’une de ces ombres hantait-elle le mémorial de Jérusalem pour venir à ma rencontre ? Mais dans ce cas, quel message cherche-t-elle à me communiquer, aujourd’hui, sur ma vie, mon destin, ma vocation, qui provoque en moi un tel bouleversement ?
Le plus étonnant, à ce stade de ma recherche, est le décalage entre la violence des émotions ressenties dans l’obscurité du Mémorial et l’aveuglement quasi total dans lequel je me suis complue jusqu’alors, concernant l’histoire de la rafle et le sort réservé aux enfants juifs pendant ces années de barbarie. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir lu des témoignages et des livres d’histoire sur les atrocités du IIIème Reich, dès les premières années de mes études, si incompréhensible était la cruauté de ceux qui les avaient commises et de ceux qui s’en étaient faits les complices. Dès sa première diffusion, j’avais appris par cœur plusieurs couplets de la chanson de Jean Ferrat « Nuits et brouillards » dont le rythme s’accordait à mes émois de jeune étudiante en médecine, devant la souffrance des malades et l’agonie des mourants. Les premières photos des charniers de Treblinka ou de Dachau m’avaient plongée comme tant de mes contemporains, dans la stupeur : comment cette « Chose » avait-elle pu exister ? Je savais que des hommes (et quelques femmes aussi) y avaient participé activement ou simplement avaient permis qu’elle étende son ombre sur toute l’Europe et je n’avais pas cherché à l’occulter. Cela faisait partie du mystère du mal absolu, tapi devant la porte de notre âme, que les théologiens et les psychanalystes décrivent mais qu’aucun d’eux n’arrive à expliquer.
Mais pour moi, la Bête n’avait pu s’attaquer qu’à des adultes, des cohortes d’adultes, juifs, résistants, tziganes, personnes handicapées, homosexuels dont je pouvais, devant les images atroces publiées peu à peu, imaginer les souffrances. Mon esprit s’était fermé à l’idée du martyre des enfants. Qu’ils aient pu représenter un danger quelconque et que des hommes, des humains comme vous et moi, aient décidé de les éliminer, cela dépassait tout entendement. Bien sûr, j’avais vu « la Colline aux mille enfants » qui relatait le courage du pasteur Trocmé et des habitants du Chambon sur Lignon, capables d’organiser le sauvetage d’une centaine d’entre eux. J’avais frémi aux dernières séquences du film « Au revoir les enfants ! ». Mais la Rafle ! La rafle et ses quatre mille victimes de moins de quinze ans que les nazis n’avaient pas réclamées mais que les responsables de la Police française n’avaient pas voulu séparer de leurs parents, faute d’aménager des structures d’accueil qui les auraient protégées de l’ignominie …
Pire ! Durant les cinq premières années de notre mariage, Hubert et moi, nous avons habité… rue Nélaton, Paris 15ème. Nous étions heureux de roucouler sous les toits, dans notre deux-pièces-cuisine, au sixième sans ascenseur, loué sans commission à un prix abordable pour nos maigres revenus d’étudiants. Mes deux ainés y ont vu le jour, faisant de nous de jeunes parents comblés. Quelques personnes âgées s’exclamaient bien : « Rue Nélaton ? La rue de l’ancien Vel d’Hiv ? Cela ne vous gêne pas ? » avec l’air compassé de la divulgation d’un secret de famille. Je ne cherchais pas à comprendre ce que signifiaient ces sous-entendus. J’avais décidé qu’ils évoquaient seulement des souvenirs de compétitions sportives ou peut-être de spectacles un peu osés de la Belle Epoque, dont je n’avais cure. Parisienne depuis peu et décidée à m’en échapper le plus vite possible, concentrée sur la réussite de mes études et les soins à mes bébés, je n’avais ni le goût ni le temps de m’appesantir sur l’histoire de mon quartier. Un immeuble de verre et de béton occupait l’espace de l’ancien stade. Il abritait un bureau de poste ultramoderne, des salles de réunion et le siège de la compagnie Elf, avant qu’elle ne construise l’orgueilleuse tour de la Défense. Dans les années 60, aucune plaque ni stèle commémorative ne pouvait attirer mon attention. Elles n’ont été placées dans le métro et sur les lieux même du crime national que trente ans plus tard !
Evelyne, ma sœur ainée occupait avec son époux et ses deux jeunes enfants, l’appartement du palier juste au-dessus du nôtre avant notre propre emménagement. Et après notre départ en 1969, l’appartement a été loué par deux autres membres de ma fratrie, Yves et Elisabeth pendant encore au moins sept ans. Aucun d’entre nous quatre n’a jamais montré le moindre intérêt pour les allusions feutrées qui faisaient baisser la voix de nos interlocuteurs lorsque nous déclinions notre adresse. D’où provenait ce déni ? Est-ce seulement parce que l’événement survenu vingt ans plus tôt était en lui-même inimaginable ? Il bouleversait tant de croyances et d’espoirs pour la toute jeune femme que j’étais alors !
Mes parents m’ont élevée, ou plutôt « coconnée » dans un pays de rêve, la Tunisie de l’époque coloniale dont le charme des paysages et la culture trimillénaire a forgé mon amour de la beauté et ma confiance dans le génie créatif de l’homme. La sagesse antique et la foi chrétienne transmises par mes parents et de nombreux adultes, professeurs, pasteurs, monitrices d’école biblique, cheftaines du scoutisme unioniste, m’ont fait goûter très tôt aux meilleurs crus de la culture et aux plus douces saveurs de la vie. En classe de cinquième, dans une rédaction sur le sujet : « Une journée de votre vie dans vingt ans », je me voyais artiste et professeur de dessin, tant j’aimais les couleurs et les formes que la nature méditerranéenne nous offrait dans un délire d’imagination proprement divin.
Pourtant quelques années plus tard, à l’âge de quatorze ans, je fis part dans mon journal intime de mon désir de devenir médecin en Afrique. Fascinée par la personnalité d’Albert Schweitzer et ses exploits dans la brousse gabonaise, je rêvais d’une vie de missionnaire, depuis qu’une jeune femme, de passage à la maison et en partance pour Lambaréné, avait partagé avec mes parents la ferveur de sa vocation. Pasteur, philosophe, musicien, cette grande figure du protestantisme s’était dirigé vers la médecine pour suivre au plus près les pas de Jésus de Nazareth, son Maître, et développer en pleine forêt vierge, son éthique du respect inconditionnel de la vie… Je brûlais d’en faire autant, de faire « fructifier mes talents » selon l’expression biblique, dans un projet de cette ampleur. Mon père, bientôt atteint par le mal qui devait l’emporter cinq ans plus tard, conforta ce rêve, malgré l’opposition de ma mère qui en discernait les illusions et les contraintes. Elle me poussait comme ma sœur aînée, à suivre ses traces de professeur de lettres – un métier tellement compatible avec la vie de famille, disait-elle… Mais mon père fit tout, ne serait-ce que par son regard admiratif et bienveillant sur mon enthousiasme, pour faciliter la bifurcation vers une section scientifique en Terminale et mon entrée à la faculté de médecine de Rouen, en 1959, à l’âge de dix sept ans... Bientôt terrassé par son cancer, il n’a pu malheureusement suivre mon parcours ni se réjouir de ma réussite.
Mes stages hospitaliers me firent découvrir très vite les combats incessants de notre métier contre les infections, le cancer, les maladies cardiovasculaires et pour la majorité des malades, contre la misère morale et physiologique qui les accompagnait. En chirurgie, je plongeai dans un univers sordide et totalement étranger au mien, celui des avortements clandestins. Traitées comme des criminelles par les « mâles » de notre profession, les femmes arrivaient dans le sang, les larmes et la honte aux urgences de nuit pour subir un curetage, après que la sonde posée par la faiseuse d’anges eut obtenu son effet. Les internes chargés de l’opération ne se donnaient même pas la peine de les anesthésier : « Cela leur apprendra à ne pas recommencer ! » Que pouvait éprouver la jeune oie blanche que j’étais alors devant le spectacle d’une sexualité porteuse de mort et de la méchanceté imbécile qui lui répondait ? Aucune réponse ne m’étant donnée, j’enfermais ces sensations dans une boulimie de savoir médical et littéraire. Mais je me tenais à l’écart de la politique - la guerre d’Algérie faisait rage – je me méfiais de l’entourage obséquieux de mes « patrons » et je m’écartais des condisciples toujours prêts à s’étourdir dans l’alcool et la fête pour éviter la confrontation directe avec la souffrance de l’autre.
Dix ans plus tard, mon diplôme de pédiatre en poche, nous décidions en couple de répondre à l’appel du Tiers monde en pleine mutation. Hubert, mon jeune époux, débutait sa carrière de formateur et de conseiller en développement économique et moi, je retournais en Afrique du Nord, sur la terre de ma jeunesse heureuse, équipée pour en soigner les jeunes pousses, avec l’espoir de permettre à leurs mères de les voir grandir. J’avais réalisé mon rêve d’adolescente mais hélas, la mort, la pire, celle des enfants, me guettait dans ces terres lointaines. Combien de fois ai-je dû lui laisser crier victoire ?
A Yad Vaschem, je pressens cependant, qu’outre les émois et les soubresauts tragiques de mon adolescence, d’autres forces obscures ont agi pour mettre ma vie sur ces rails, sur ce chemin où je n’ai cessé de me sentir impuissante, spectatrice démunie de la souffrance de parents endeuillés. J’ai « choisi » d’être médecin d’enfants - et encore, est-ce vraiment un choix ? J’ai plutôt l’impression d’avoir été poussée ou conduite vers cette profession. Mais, assurément, je n’ai pas choisi d’être confrontée à leur mort, dans tous les postes que j’ai occupés. Pourquoi n’ai-je pas exercé, comme la plupart de mes collègues, dans un cabinet privé, entourée de bébés joufflus et souriants dont les mères sont avides de conseils et d’encouragements, lorsque leur moufflet souffre de coliques ou de régurgitations ? Pourquoi n’ai-je pas soigné quotidiennement les « rhinos » et les « gastros », rituels des cabinets de pédiatrie en ville, au lieu de m’affronter à des pathologies beaucoup plus graves dont la plupart comportait un risque mortel ? Pourquoi ai-je quitté la sécurité d’un ancrage en France pour découvrir les enfants des douars algériens, ceux de la brousse ivoirienne puis des quartiers les plus pauvres de grandes villes comme Abidjan et Pointe Noire, au Congo ? Ils étaient décimés par la malnutrition, la rougeole, le paludisme et, pour combler la mesure, au cas où je n’aurais pas encore compris la leçon, atteints par le sida. Rentrée en France, au lieu de me diriger calmement vers un service de Protection Maternelle et Infantile qui me tendait les bras, pourquoi ai-je foncé, tête baissée, vers l’hôpital où étaient référés tous les enfants de la région atteints de leucémies et de cancers ?
La traversée du tunnel aux mille bougies et l’histoire de Sarah deviennent le début d’une quête à la recherche de ma propre histoire, celle que j’ai enfouie dans le brouillard de mes très jeunes années. Elle semble enterrée à jamais puisque mes parents et presque tous ceux de leur génération ne sont plus là pour m’en donner les détails. C’est le début d’une plongée, à l’aveuglette, sans bouteille d’oxygène ni tuba, comme celles qui nous enchantaient et nous effrayaient à la fois, jadis, lorsque notre père nous faisait découvrir les fonds sous-marins sur la côte du Cap Bon. La mer semblait limpide en surface tant que les rayons du soleil en faisaient chanter les bleus indigo et les verts émeraude. Mais elle s’opacifiait bien vite, dès les premiers mètres de profondeur. Un voile translucide se formait derrière lequel se devinaient les ombres mouvantes d’algues, de bancs de poissons et de nuages et d’où pouvaient émerger, qui le savait ?- des créatures hostiles, murènes ou requins, peut-être même le Léviathan qui avala Jonas, dans les temps lointains…
Je comprends très vite qu’il faut m’équiper un tant soit peu pour descendre à de telles profondeurs et m’entourer de précautions pour ne pas disparaître dans les entrailles du monstre. J’ai besoin de guides pour éviter les caprices de la mémoire et les mirages des interprétations. Mais par où commencer ?
2- Edouard et Marguerite
Me voici bientôt sur la route des Hautes Alpes. A mi chemin entre Montpellier et le Queyras que nous arpentons chaque été depuis notre mariage, je m’arrête à la ferme de ma sœur Elisabeth. Bâti à la sueur de son front et de celle de son mari, aujourd’hui décédé, ce gîte de la montagne provençale abrite toute la mémoire de notre famille. Veuve sans enfant, ayant exercé le dur métier de chevrière, elle a développé depuis quelques années un goût prononcé pour la psychogénéalogie, goût qui lui a conféré le rôle de gardienne des archives parentales à la mort de notre mère, en 2003. Avec méthode et ferveur, elle a reconstitué un gigantesque arbre illustré de visages, instantanés de vies multiples, et a déjà exploré quelques-uns des secrets de nos deux lignées qui ont, d’après elle, pesé très lourd dans sa propre trajectoire.
Cette première étape est motivée par le souvenir d’une histoire dont elle avait retrouvé les bribes et qui pouvait avoir une relation avec la tornade de Jérusalem. Un bien immobilier juif avait été acheté en janvier 43 par nos grands parents paternels, en pleine période de déportation massive. Sa restitution en 45, après le retour d’un des propriétaires, plongea leur foyer dans une situation financière et sociale périlleuse. Je n’ai pas, jusqu’alors, tenté de creuser cette affaire sans doute pour ne pas ternir l’image tutélaire que je garde de ce grand père : un homme cultivé et plein d’humour, attentif à ses petits enfants, chantant en toute occasion des cantiques de l’Armée du Salut ou des refrains du scoutisme dont il était un des membres fondateurs en France et où il comptait de nombreux amis. Grand amateur de nature, il habitait en lisière du bois de Vincennes et possédait des ruches dans son jardin. Il nous impressionnait dans son costume d’apiculteur, lorsqu’il allait parler à ses abeilles pour récolter un miel de marronniers dont je n’ai jamais oublié le goût. Je ne voulais pas connaître non plus, les ombres de cette grand-mère, haute en formes et en couleurs, dont je goûtais fort la tendresse lorsqu’elle nous prenait sur ses genoux pour nous consoler d’une chute ou d’une contrariété. J’aimais la pétulance de ses propos, la vivacité de ses répliques et l’audace qu’elle montrait à s’adresser sans complexe aux humbles comme aux puissants, contrastant avec le calme imperturbable de mon père et surtout la réserve timide de ma mère.
Malgré cette lamentable affaire, je ne peux toujours pas imaginer mes grands-parents comme des affreux « collabos » ou même simplement comme des égoïstes qu’indiffère le malheur des autres. Ce que je sais d’eux me montre qu’ils n’étaient ni l’un ni l’autre, possédant tous deux des valeurs humanistes ancrées dans la foi protestante réformée, même s’ils avaient fini à force d’ambition, par épouser les codes de la moyenne bourgeoisie parisienne. Mon grand-père était issu d’une famille rurale immigrée, venue de Suisse tenter sa chance à Paris. Ma grand-mère faisait partie d’une fratrie de dix enfants dont le patriarche exerçait le beau et difficile métier de pasteur, grand prédicateur devant l’Eternel, fondateur d’œuvres sociales à Courbevoie et à Auteuil, banlieues parisiennes qui abritaient au début du siècle des familles ouvrières : société de tempérance antialcoolique, accueil d’orphelins et enfants maltraités. Ils ne roulaient pas sur l’or au début de leur mariage en 1909. Et pourtant, la vague naissante des mouvements de jeunesse français, scoutisme et union chrétienne de jeunes gens, avait permis à mon grand père de monter une entreprise coopérative de matériel de camping et de sport, puis de créer une fonderie, devenant fabriquant de moteurs électriques et de constructions métalliques. Signe visible de cette ascension sociale inespérée, il avait pu offrir à sa famille dès les années 20, un petit château dans la campagne normande, qu’il avait dû revendre ou plus probablement brader peu avant la deuxième guerre mondiale. Car, avant la grande crise de 1929, son idéalisme combiné à la malveillance d’un de ses associés à qui il semblait avoir rendu de grands services, le contraignit à déposer le bilan de sa société. Il devint alors salarié d’une banque protestante, durant quelques années. Mais, rattrapé par certains de ses créanciers, il fit seize mois de prison dont il fut libéré au début 1937.
Elisabeth me met entre les mains des lettres étonnantes qu’il écrivait du fond de sa geôle à l’une de ses nièces, avec laquelle il entretenait des relations affectueuses. Il échangeait des impressions pleines de finesse sur les nombreux ouvrages que sa solitude lui permettait de lire et relire, donnant ça et là des conseils à sa correspondante, jeune professeur de littérature « afin de contribuer très modestement au développement culturel de notre éminente et distinguée membre de l’enseignement ! » Il lui confiait ses doutes et ses espoirs, méditait sur ses convictions religieuses et ses opinions politiques, étonnamment pacifistes et universalistes, préfigurant la mondialisation des idées et des combats non violents de la fin du XXème siècle. Il commentait en particulier, les écrits d’un groupe de jeunes intellectuels dits « non-conformistes des années 30 ». Réunissant des écrivains comme Robert Aron, Claude Chevalley, Arnaud Dandieu, Daniel-Rops, Jean Jardin, Alexandre Marc et Denis de Rougemont, ce mouvement s’inspirait notamment de Kierkegaard, Proudhon, Nietzsche, Péguy, et se caractérisait par une orientation personnaliste sur le plan philosophique, et fédéraliste sur le plan social et politique. Edouard avait l’impression qu’ils échafaudaient des théories abstraites, éloignées des réalités actuelles. Celles-ci « ne sont émises qu’en vue d’une transformation sociale, matérielle, égoïste, étroite et qui, par la création de cellules corporatives, ne peut qu’engendrer la lutte et l’envie ». « Nous sommes, affirme-t-il, plus que jamais et demain encore plus, tributaires les uns des autres. L’avenir n’est pas dans un rétrécissement des cellules d’invention humaine, mais au contraire dans leur élargissement… » « Nous sommes toi et moi dans la vérité », s’adressait-il à sa nièce, « en déclarant que seule la transformation des cœurs humains permettra la réalisation du royaume de Dieu sur la terre. Seule cette transformation fabriquera les hommes de bonne volonté nécessaires mais en attendant, sur le plan humain, seules l’application de théories larges, aérées, préconisant l’abolition des frontières humaines et la fraternisation des peuples peut avoir une chance de faire son chemin dans la réalisation du plan du Bonheur humain voulu par Dieu. Les conceptions étriquées qui nous ramènent aux luttes du Moyen Âge sont irréalisables et les applications humaines qui en ont été réalisées en Italie ou en Allemagne sont vouées à des catastrophes ! »
On ne pouvait être plus clair sur le refus par mon grand père, de tous les nationalismes, les fascismes et les pestes noires, rouges ou brunes qui s’abattaient sur l’Europe en ces années d’entre deux guerres… De même, la lecture d’un reportage intitulé « Indochine SOS » et le courage de la journaliste Andrée Viollis dénonçant les exactions des forces coloniales en Asie du Sud Est, le soulevaient d’enthousiasme : « Extrêmement intéressant, passionnant, qu’il faut que toi, ton frère et ta mère le lisent à tout prix. Vous me remercierez de vous l’avoir fait connaître et le ferez connaître autour de vous ». Deux ans plus tard, en 1938, son fils aîné Roger, qui sera bientôt mon père, était nommé comme fonctionnaire des finances en Tunisie… Avait-il eu l’assentiment d’Edouard pour tenter ainsi l’aventure coloniale en Afrique du Nord ?
Par ailleurs, en pleine ascension du Front populaire, il ne craignait pas de faire l’éloge des socialistes les félicitant d’avoir pris des mesures favorables aux plus démunis parmi les Français. Il citait ces lois et décrets de mémoire, ce qui prouve qu’il avait une connaissance approfondie des avancées du droit du travail, bien avant son incarcération ! Il évoquait l’adoption en 1892 de la réglementation du travail des enfants, des jeunes filles et des femmes, la suppression en 1900 des équipes alternantes qui empêchaient les membres d’une même famille de se rencontrer, les premières mesures d’hygiène dans les usines et ateliers édictées en 1893, l’institution du repos hebdomadaire et des huit heures de travail journalier en 1906, etc. Après cette énumération très précise, il concluait : « Toutes ces mesures furent l’initiative des socialistes et jamais celle des Bourgeois, des capitalistes et de l’Eglise. Catholiques ou protestants ne faisaient que regretter l’état de choses antérieur. Ils assuraient aux victimes que de grandes félicités seraient leur partage après leur mort mais qu’en attendant, il fallait se résigner à souffrir et continuer à travailler dans de mauvaises conditions pour permettre à la Bourgeoisie de continuer à s’enrichir ! »
Ainsi se préoccupait-il de la marche du monde, tout en restant discret sur les événements politiques récents : les lettres étaient systématiquement ouvertes, puisqu’un tampon officiel : « les timbres-poste et les billets de banque sont rigoureusement refusés » barre chacune des pages. Mais à l’occasion d’un commentaire littéraire sur Henri de Monfreid, il faisait allusion à la montée des fascismes en Italie et en Espagne. Plus loin, les lettres de Mai, Juin, Juillet 1936 ne parlent pas directement du Front Populaire, des soubresauts de la grande grève ni de la nomination de Léon Blum. Mais ce sont dans ces lettres-là où il exposait le mieux son inclination socialiste et universaliste. Le 4 mai 1936, le lendemain de la victoire des forces de gauche, il commentait le livre de Robert Aron, auteur de « Dictature de la Liberté » : « Malgré ma meilleure volonté, je crains bien qu’il me soit impossible de faire miennes leurs conceptions de redressement toujours construites sur l’existence des patries actuelles. Tant qu’il y aura solution de continuité entre les villages, les provinces et le monde, par l’existence d’un ensemble de peuples se réclamant d’intérêts propres, contraires à ceux du voisin, toutes conceptions pour l’établissement de la paix et du bonheur humain ici-bas seront vaines. Les guerres et les maux actuels continueront. »
Et, oh, surprise pour moi, sa petite-fille qui ai toujours lutté contre les inégalités de genre et les violences intrafamiliales, il défendait des positions très féministes pour l’époque, que je n’avais pourtant jamais entendu professer clairement dans ma famille ! A l’occasion d’un exposé que sa nièce devait faire sur les femmes et le travail, il consacrait deux longues lettres à la condition féminine dont il déplorait les injustices criantes. Il lui conseillait la lecture de nombreux articles et livres : entres autres, un cours d’un certain Barthelemy, professeur à l’école des Hautes Etudes sociales, des études « remarquables » de Suzanne Grimberg sur la constitution, le tome X de la Nouvelle encyclopédie Française de A. Monzie qui contient « un magistral exposé de la duchesse de Rochefoucauld sur le vote des femmes », le numéro spécial de la revue Esprit du 1er juin 1936 dont un article s’intitule « La femme aussi est une personne ». Il recommandait aussi « certains romans tels ceux de Jacques Bridel, lauréat du prix interallié pour « Les jeunes ménages », etc… » Il encourageait sa nièce à visiter le fond documentaire du Musée Social de la rue Las Casas ainsi qu’à prendre contact avec les grandes associations féministes : l’Union pour le vote des femmes, fondée par Mme Chotard, association dont il avait fréquenté la bibliothèque mais dont il critiquait la ligne nettement « réactionnaire, opinion que je me suis faite par l’examen de ses doctrines ». Il lui préférait « l’association dirigée par Mme Brunschwig, l’Union Française pour le Suffrage des Femmes, d’un caractère nettement politique radical-socialiste ». Il déclarait posséder dans la bibliothèque familiale le compte rendu d’un congrès de l’alliance internationale des femmes, tenu en 29 ou 30 sur la question de l’entrée des femmes dans les carrières juridiques… Enfin, il rappelait la mémoire des pionnières comme Maria Vérone ou Louise Weiss et sa revue « La femme nouvelle ». Il conseillait à sa correspondante de pas oublier dans son exposé de rappeler les « précurseures » du mouvement féministe en France « Eugénie Neboyet qui dès 1848 dirigeait en France le Club des Femmes, Maria Desraimes en 1868-72, et la grande Louise Michel, etc. » et de rendre « un hommage aux vivantes : Yvonne Netter, Mme Duclos catholique féministe… » Quelle culture, quelle ouverture d’esprit, quelle liberté de jugement pour un homme de cette époque, participant de ce milieu bourgeois et protestant, dont il connaissait de l’intérieur les défauts et les qualités… et qu’il rendait responsable de sa propre déréliction !
Car, lorsqu’il abordait avec beaucoup de pudeur, l’affaire qui l’avait conduit à ce séjour à la prison de la Santé, il se décrivait comme un « homme vilipendé par des jaloux et des hypocrites » auréolés d’honorabilité et de pratique religieuse, tandis qu’ils répandaient autour d’eux calomnies et mensonges. Mais il ne s’attardait jamais sur ses détracteurs qu’il décrivait comme des malheureux, détruits par leur propre haine, « dont les mobiles ne peuvent être recherchés que dans les obligations dont ils (lui) sont tous redevables ». Sa plus grande déception venait du fait que ses accusateurs faisaient partie de ce milieu réformé, de l’Eglise dont il était lui-même un membre très engagé « milieu où plus que partout ailleurs, l’homme se montre double et où tout est prétexte à justifier le pharisaïsme colossal de l’époque, cependant riche en idéologies et en enseignements généreux (Eclaireurs, UCJG) mais combien pauvre en amour effectif et vivant de l’homme pour l’homme. » « Malgré toutes ces tristes expériences, écrivait-il plus loin, je reste quand même attaché à cette caricature d’Eglise mais dans le passé comme dans le présent et plus certainement dans l’avenir, je reste en communion d’impatience avec tous les révoltés, tous les déçus, tous les inexaucés, tous les vaincus et les damnés de ce monde, car en toute justice, ceux-ci sont plus près du Royaume de Dieu que tous ces sépulcres blanchis qui chaque dimanche font monter à Dieu dans nos temples des louanges hypocrites ! »
De ses conditions de détention, il ne livrait pas grands détails, se plaignant seulement du froid qui régnait derrière ses murs. « Il me faut bien trouver sinon le bonheur, mais tout au moins accepter avec reconnaissance les avantages et les faveurs qui sont mon lot dans la situation particulière où je me trouve. Entouré comme je le suis de votre affection à tous, tenu au courant des événements familiaux et généraux, habitué que j’étais déjà de part ma surdité à vivre en moi-même, (effectivement il souffrait depuis l’enfance d’une otospongiose, maladie des osselets de l’oreille interne qui ne bénéficiait pas encore de traitement efficace) je suis plus à même que beaucoup d’accepter la vie qui m’est imposée. Je n’ai jamais su m’ennuyer. Je trouve toujours une occupation, gymnastique en tout genre, chants et cantiques populaires, correspondance, lecture, visites de Margot (son épouse) et des enfants, des avocats et des liquidateurs, réception des mandats qui ont l’avantage de me faire sortir une demie heure chaque fois, etc. font que la journée passe et je suis moi-même surpris de la rapidité d’écoulement des heures, quoique n’ayant pas de montre. Si j’ai froid, je me réchauffe en faisant briller mon parquet (Détail surprenant pour un homme habitué à être servi par sa très fidèle employée de maison, répondant au fier prénom de Victoire !) et le soir, de par ma volonté, je chasse les papillons noirs qui viennent m’assaillir et je m’endors en pensant à vous tous… ». Il comparait son existence actuelle à celle des Chartreux d’un couvent qu’il avait visité quelques mois auparavant avec son fils André : « A part les offices, je suis dans leur cas. Réveil à 6 heures, promenade, déjeuner, etc, etc. Je pense souvent à eux. Mon imagination travaillant, je me représente vêtu de blanc et chantant les matines ou les vêpres, comme les moines de Briqueluc… »
Il restera dix-huit mois enfermé entre ces murs inhospitaliers, mais gardant en permanence l’esprit ouvert sur les soucis de sa famille – dont les plus grands étaient l’ostracisme et le rejet que pouvaient subir ses enfants à l’école ou dans la paroisse du fait de sa situation.
Sa dernière lettre date du 24 janvier 1937. J’ignore le moment exact où il a enfin été libéré, jour vers lequel convergeaient toutes ses espérances : « Ah combien la liberté me semblera bonne, lorsqu’elle sera recouvrée ! Il faut passer par l’épreuve actuelle pour apprécier le soleil, le printemps les arbres et les fleurs. L’espoir de revoir toutes ces belles choses atténue la laideur de celles du temps présent… » Gardant son optimisme jusqu’au bout, le jour de son anniversaire, après un an de détention, Edouard pouvait écrire : « Oui ma chère Germaine, nous nous réunirons à nouveau le 12 novembre autour de la table de famille mais n’y seront conviés que les fidèles. Les mêmes joies nous seront accordées et plus fort que jamais. Nous chanterons le passé, le présent et l’espérance du futur… »





























