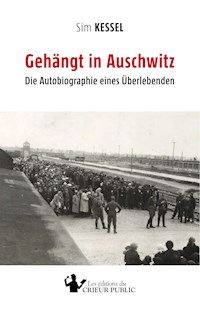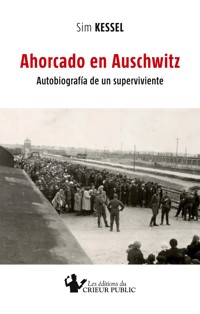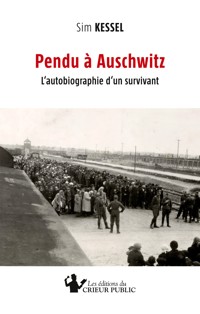
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Les Éditions du Crieur Public
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Sim Kessel, jeune Français, juif et boxeur professionnel, a écrit en 1969 son autobiographie sur les années 1940-45, décrivant comment il a survécu contre toute probabilité à Auschwitz et à d'autres camps de concentration et d'extermination du régime nazi. En 1940, immédiatement après sa démobilisation, il a rejoint en tant que soldat le mouvement de résistance français contre l'occupation allemande de la France, la Résistance. Deux ans plus tard, il fut arrêté par la Gestapo. Malgré la torture, il n'avoua rien de ses activités clandestines. En tant que juif, il fut transféré à Drancy, près de Paris, où il fut emprisonné et déporté par la suite au camp de concentration d'Auschwitz. Dans les conditions épouvantables des camps d'extermination nazis, sous le numéro 130 665, il déchargeait des matériaux de construction à Birkenau et travaillait dans les mines de Jawarzno. Complètement épuisé et malade, une simple erreur bureaucratique le sauva une première fois de la chambre à gaz. En 1943, la Gestapo du camp a de nouveau tenté de lui extorquer des aveux sur ses activités de résistance. Il a été torturé, on lui a arraché un doigt. Il fut sauvé une deuxième fois de la chambre à gaz, cette fois par un SS qui était également boxeur. Paris était libéré depuis trois mois lorsqu'il tenta de s'échapper. L'évasion échoua, il fut pendu devant 25.000 déportés. La corde s'est rompue. Cela signifiait l'assassinat par balle dans la nuque. Mais le bourreau qui devait l'abattre était également un boxeur et l'a sauvé in extremis. Le 18 janvier 1945, Auschwitz a été évacué. S'ensuivit la marche de la mort, par étapes quotidiennes de trente à quarante kilomètres, pendant treize jours, vers le camp de concentration de Mauthausen, puis vers le camp de Gusen 2. Au matin du 7 mai 1945, les déportés se retrouvèrent soudain seuls dans le camp abandonné, les Allemands ayant fui devant l'armée américaine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Avant-Propos
Chapitre I. Arrestation
Chapitre II. Le temps des supplices
Chapitre III. Drancy
Chapitre IV. Au bout de la nuit
Chapitre V.
Nacht und nebel
Chapitre VI.
Arbeit macht frei
Chapitre VII. Mineur à Jaworzno
Chapitre VIII. Auschwitz
Chapitre IX.
Politische abteilung
Chapitre X. Évasion
Chapitre XI. Sous la potence
Chapitre XII. Bagnard clandestin
Chapitre XIII. Exode
Chapitre XIV. Mauthausen
Chapitre XV. Gusen II
Chapitre XVI. Libération
AVANT-PROPOS
En décembre 1944, j’ai été pendu à Auschwitz.
Le concours de circonstances qui m’a sauvé la vie est exceptionnel, peut-être même unique. Car s’il est arrivé parfois que la corde ait cassé ou se soit dénouée, le sursis accordé au condamné n’a jamais été que de quelques heures. Les S.S. ne pardonnaient pas.
Quiconque a porté le hayon rayé des bagnards d’Auschwitz, était un condamné à mort. Chaque rescapé est un miraculé. Tout au plus peut-on dire que les derniers venus ont surmonté plus aisément l’épreuve, dès lors que la durée de leur séjour n’a pas excédé leur capacité de résistance. C’était pour eux une chance insigne que d’avoir été pris dans les derniers mois de la guerre. Mais ceux qui ont totalisé comme moi vingt-trois mois de bagne sans compter les prisons antérieures, sont extrêmement rares.
La durée moyenne du séjour à Auschwitz ou dans les camps annexes ne dépassait pas trois mois. Auschwitz n’a pas été le seul instrument du génocide. Les autres camps y ont contribué. Toutefois, aucun n’a une telle cadence.
Au-delà de cette période moyenne de trois mois, suffisante pour vider un homme de toutes ses réserves, la survie n’était plus qu’un hasard. Elle résultait d’une succession de coups de dés favorables, chacun assurant un répit de quelques jours ou de quelques semaines.
J’ai été sauvé ainsi cent fois, tantôt échappant à un coup mortel, tantôt bénéficiant d’un secours inespéré. Rayés du monde, nous ne pouvions compter sur aucune des sécurités que crée la loi ou l’industrie des hommes.
C’est pourquoi on ne saurait tirer vanité d’être sorti vivant d’Auschwitz. Il n’y a pas eu, dans cet enfer, survie des meilleurs. L’intelligence, le courage, le savoir, la vitalité ou la passion de vivre ne pouvaient rien changer. À peine peut-on soutenir que les plus habiles ou les moins scrupuleux arrivaient quelquefois à exploiter la conjoncture. La misère commune nivelait tout, effaçait les valeurs, brisait les volontés. Même pour ceux qui bénéficiaient de « planques », obtenues le plus souvent par rencontre et presque toujours temporaires, le destin restait suspendu à la mauvaise humeur d’un soldat ou à la folie meurtrière d’un Kapo.
Je n’ai pas écrit le récit de mon aventure concentrationnaire pour en tirer avantage. Si j’avais l’ambition de me mettre en valeur, j’évoquerais plus volontiers – et plus valablement – les deux années passées avant mon arrestation, dans la résistance parisienne. Ces deux années sont pourtant celles que ma mémoire retrouve avec le plus de complaisance. Elles suffisent à justifier une vie d’homme.
Les camps étaient soumis à une réglementation commune et ce qui se passait dans chacun se répétait dans tous les autres. Seule, variait l’ampleur de la destruction.
Cependant, je crois utile de témoigner. Vingt-cinq ans après la libération des bagnards d’Auschwitz, le procès de leurs bourreaux n’est pas terminé. On a vu, ces temps derniers encore, des juges en acquitter quelques-uns, en condamner quelques autres avec mansuétude. L’enquête, sur chacun d’eux, avait demandé des années.
On avait rassemblé méthodiquement les preuves de leurs crimes. Tous les survivants d’Auschwitz savent qu’il ne saurait y avoir, pour les S.S. qui les gardaient, ni exception dans la culpabilité, ni degré dans l’infamie, quand même on accepterait sans réserve l’excuse, constamment invoquée, de l’obligation d’obéir aux ordres.
Je crois utile que cela soit dit, comme je crois utile que le souvenir des martyrs soit évoqué. Ce souvenir est en voie de s’éteindre. Vingt-cinq ans après, je découvre que des jeunes n’ont jamais entendu parler des camps. Je découvre aussi que beaucoup n’y croient pas. On prétend volontiers que les faits ont été grossis, que c’est un travers commun à tous les prisonniers que d’exagérer les souffrances qu’ils ont endurées, qu’au surplus les S.S. n’ont fait qu’appliquer les lois de la guerre, et que ce qui s’est vu en Allemagne s’est vu partout et de tout temps.
Ces propos, que d’autres déportés ont entendus comme moi ou qu’ils ont lus dans certaines publications, ont de quoi les rendre enragés. Pourtant ces survivants, qui pourraient protester, ne protestent guère. Loin de montrer la trace de leurs plaies, ils n’ont que le souci de n’en plus souffrir.
Encore, les ignorants et les sceptiques ne sont-ils pas les plus révoltants. Il y a ceux qui prêchent le silence volontaire, ceux qui protestent, se plaignent qu’on trouble leur repos, qu’on leur fait respirer l’odeur de la mort, ceux qui expliquent gravement qu’il ne convient pas de remuer un passé assurément déplorable, mais définitivement enterré, ceux qui démontrent que cette exhumation est à la fois funeste et déplacée. Funeste, parce que l’humanité ne gagne rien à ranimer les rancunes et les haines. Déplacée, parce que les Allemands ont fait preuve de leur repentir, et qu’ils se sont engagés dans la voie de la réconciliation.
Je n’ai jamais confondu l’Allemagne avec le nazisme, ni admis que le peuple allemand fût criminel par essence. Dès lors que je condamne le racisme, je serais mal venu de prétendre que les Allemands sont une race à part. Du moment que je refuse le principe barbare de la responsabilité collective, je m’interdis de faire porter à tous le crime de quelques-uns. J’ai connu des Allemands qui étaient bons et humains et j’ai connu des Français qui étaient des tueurs. Il n’y a pas de races ni de nations qui soient spécifiquement perverses. Il y a seulement des hommes qui font de la barbarie un idéal, et de la violence une vertu. Que ces hommes aient régné en Allemagne plutôt qu’ailleurs n’est qu’un des hasards de l’Histoire. Il y a dans d’autres pays des tentatives du même ordre, rien ne démontre ou ne garantit qu’elles ne se renouvelleront pas.
Pour tout homme normalement informé et de bonne foi, il est évident que le principe de la discrimination raciale est scientifiquement absurde ; que la croyance à la hiérarchie des races est insoutenable ; que la destruction systématique de millions de gens réputés inférieurs ; Juifs, Russes, Polonais ou Tziganes, est un crime monstrueux. Ce crime a pourtant pu s’accomplir au vingtième siècle. Cette philosophie insensée a fait des adeptes même parmi les hommes de science. Ce plan d’extermination méthodique a été conçu et appliqué par des hommes civilisés. Rien ne permet d’affirmer que cette idéologie a disparu, ni même qu’elle est en voie de disparaître. Bien au contraire, l’hitlérisme a laissé sa marque dans le monde. Il continue à imprégner les consciences qu’il a contaminées. Pour que le poison s’élimine, il faudra du temps et des efforts.
Les années ont passé sans que je trouve l’occasion et la force de rassembler mes souvenirs. Il m’a fallu d’abord me réadapter à la vie. Trois années de torture quotidienne ne laissent pas seulement des traces physiques. Il faut attendre que la paix de l’esprit se retrouve, que le jugement s’éclaire, et que la volonté se reprenne. Longtemps j’ai fait comme tous les rescapés, j’ai lutté contre l’obsession du souvenir. Je sais par expérience que cette obsession est insupportable. Elle interdit le repos, elle peuple les nuits de cauchemars. Lorsque deux anciens déportés se rencontrent, ils évitent d’un commun accord, de remuer le passé.
Une autre difficulté qui m’a longtemps arrêté, c’est que, pour un tel récit, on ne peut compter que sur sa mémoire. Aucun déporté d’Auschwitz n’a pu prendre et conserver des notes. Il était interdit d’écrire. Du reste, à supposer qu’on en ait eu les moyens, on n’en avait ni le temps, ni le goût. J’ai donc reconstitué, daté et objectivé des événements que j’ai vécus, mais que je n’avais pas alors le loisir de penser.
On ne pourra me reprocher de ne pas être véridique. Ou de ne pas être sincère. Mais j’aurais voulu, sur de nombreux points, être plus précis. Je l’ai été autant que possible. J’ai consulté d’autres déportés. J’ai recensé laborieusement ces survivants épars dans Paris et ailleurs, pour leur demander de confirmer une date ou un fait. Tant on doute, à la longue, de soi-même et tant l’événement lui-même est incroyable !
Il faut comprendre ce scrupule. Sous la défroque du déporté, je n’étais pas le témoin, attentif à tout voir, à tout recueillir et à tout retenir. J’étais une bête traquée, cherchant à sauver sa peau, et cette perpétuelle défense contre les coups, la faim, le froid, la maladie, la vermine, ne me laissait pas le loisir d’observer et de réfléchir. J’ai enregistré passivement, sans essayer de donner un sens à ce qui m’apparaissait jour après jour. C’était beaucoup que d’avoir seulement le minimum d’énergie pour tenir et pour espérer. Ceux qui n’ont pas eu cette force et qui ont sombré dans l’apathie sont morts, par simple refus de vivre, avant même d’avoir atteint le degré de délabrement physique qui les conduisait à la chambre à gaz.
Beaucoup, parmi ces morts, ont été mes Amis. Quelquesuns se sont éteints dans mes bras. – C’est à leur mémoire que je dédie ces pages.
CHAPITRE I
ARRESTATION
J’ai été arrêté le 14 juillet 1942 à Dijon. J’avais, à quelques jours près, vingt-trois ans. C’était mon premier contact avec la Gestapo.
J’aurais pu être pris dans une rafle ou être simplement cueilli chez moi. En fait, j’appartenais à un réseau parisien, et c’est au retour d’une mission de ravitaillement en armes que les policiers m’ont appréhendé.
J’étais entré dans la Résistance le 20 décembre 1940. La rencontre d’un ami d’enfance dans une rue de Paris où je traînais mon désœuvrement, en avait décidé ainsi. Démobilisé depuis quelques jours, je ne savais que faire. Je n’avais connu de la guerre que la longue immobilité de la garde aux frontières suivie de la débandade. Comme des centaines de milliers d’autres soldats, je n’avais pratiquement pas eu l’occasion de me battre. J’en souffrais. Avec l’ardeur et l’inconscience de la jeunesse, je voulais continuer la lutte. Je ne comprenais pas le danger de l’entreprise. Je savais que les hommes de ma race étaient particulièrement visés. Les occupants n’en faisaient pas mystère. Mais je n’ai, à aucun moment, cherché à fuir, ni tenté de mettre ma famille à l’abri. Dès que je vis circuler les premiers tracts et que j’entendis la radio de Londres, je décidai de m’associer à la guerre secrète. J’étais un enfant de Paris. Grandi sur le pavé de la capitale, je ne concevais pas un autre terrain de combat.
Lorsque l’occasion me fut donnée de m’intégrer à un groupe de résistance, j’acceptai d’emblée.
Pendant près de deux ans, je connus la vie périlleuse des combattants clandestins. Je ne raconterai pas ici mes exploits, pas même l’ahurissante tentative qui me conduisit dans les locaux de la Kommandantur, place de l’Opéra, avec une bombe dans ma serviette. Une bombe qui d’ailleurs n’explosa pas. Lorsque je me remémore cette équipée, je me demande si mes camarades et moi n’étions pas poussés par une sorte de démence. Une exécution d’otages nous avait inspiré ce projet. Nous étions tout neufs, non encore sensibilisés aux coups durs, soucieux de ne pas passer pour des lâches, soutenus par le vague et absurde espoir que l’ennemi lui-même, s’il nous capturait, tiendrait compte de notre courage.
Lorsque je fus arrêté le 14 juillet 1942, je venais de franchir la ligne de démarcation, porteur d’une valise chargée de pistolets-mitrailleurs. Ces armes provenaient d’un stock secret que mon bataillon avait enterré lors de l’armistice, pour ne pas avoir à le livrer à l’ennemi. J’en connaissais l’emplacement exact. C’était la deuxième fois que je réussissais le double franchissement de la ligne de démarcation, le dépôt se situant au sud de cette ligne, à Neuville-sur-Ain. Un complice, posté au point de passage, m’avait à chaque fois facilité l’opération, en pleine nuit.
Le 12 juillet au matin, j’étais arrivé à Chalon-sur-Saône, avec l’intention d’y prendre mon billet pour Paris. J’avais l’allure aisée et tranquille de quelqu’un qui revient de la campagne par les « trains de beurre », avec du ravitaillement. La valise pleine d’armes pesait à mon bras, mon cœur battait. À peine avais-je pris mon billet des mains d’un employé indifférent que j’aperçus à travers la vitre du guichet de passage sur le quai, le contrôleur de la gendarmerie allemande, reconnaissable à sa plaque sur la poitrine, flanqué de deux civils qui appartenaient à la Gestapo. Il m’était impossible de m’y tromper. J’avais assez d’expérience pour savoir le danger que représentait un contrôle dans les trains. Je ne pouvais faire demi-tour sans me désigner à l’attention des policiers. Je passai sur le quai n’ayant en tête que le souci d’abandonner mon chargement. Je cherchai la consigne, tendis ma valise à un employé qui parut la soupeser à plusieurs reprises, mais ne dit rien. Je reçus un billet de consigne que je mis dans ma poche et m’éloignai.
Je n’osai pas sortir de la gare par le même chemin. Je me dirigeai vers le buffet, m’y assis. Les uniformes vert-de-gris, postés un peu partout, m’ôtaient le désir de chercher une issue ; la peur subitement me prit. Mes jambes ne me portaient plus. Je commençai à boire un café, du moins l’infusion d’orge grillée qui en tenait lieu.
Un cheminot, assis à une autre table, buvait aussi un café et m’observait. Je revois son visage noirci et ses yeux attentifs. Il avait compris que j’étais traqué, angoissé et, de plus, pas assez aguerri pour dominer entièrement mon désarroi. Dehors, sur le quai, une agitation inquiétante se manifestait. Des soldats couraient le long des trains.
Le cheminot s’approcha de moi, une lueur d’amitié dans les yeux. La même intuition qui lui permettait de deviner la terreur de l’homme poursuivi me faisait comprendre son initiative de sauveteur. Peut-être eut-il hésité s’il avait soupçonné ma qualité de « terroriste ». Il devait me prendre pour un fuyard cherchant à passer la ligne. En tout cas, sans hésiter, il acceptait le risque de me faire sortir de la gare sous l’apparence d’un ouvrier. Presque sans nous parler, nous étions d’accord pour nous en aller côte à côte, moi portant sa boîte à outils et coiffé de sa casquette, comme deux travailleurs qui ont terminé leur besogne.
— Surtout ne cours pas, nous allons sortir plus loin.
Nous voilà marchant le long des voies d’un pas tranquille. En arrivant devant une sentinelle, il devina mon sursaut, me prit par le bras. Je n’étais pas remis de ma frayeur.
— Ne t’inquiète pas.
Effectivement, la sentinelle ne prit pas garde à nous. Il me conduisit à travers les aiguillages jusqu’à la gare de marchandises. Je sortis de la gare, toujours à sa suite, arrivai bientôt dans un quartier tranquille avec des maisonnettes alignées et des jardinets. Il me montra un pavillon à quelque distance.
J’habite là. Mais je ne peux pas te garder chez moi. Quand les Allemands contrôlent les trains, ils viennent fouiller les maisons des cheminots. File par-là, tu as la campagne à trois cents mètres.
Je me crus sauvé. Naïvement rassuré, parce que j’avais mis quelque distance entre les Allemands et moi, je lui serrai la main et partis non vers la campagne, mais vers la ville, songeant déjà dans ma simplicité à passer de nouveau la ligne de démarcation pour aller chercher un autre chargement d’armes. Je ne mesurais pas l’importance du danger, faute d’avoir une idée des possibilités de la police. En arrivant à la gare routière, je compris vite. Les cars en partance étaient contrôlés aussi sévèrement que les trains. À travers la vitre du café où j’étais entré, je vis des voitures allemandes arriver en trombe et des gendarmes monter dans les cars pour examiner les papiers des voyageurs. Il ne me restait plus qu’à filer de nouveau, saisi d’angoisse. Je compris que la valise aux pistolets avait été découverte et que la police était en possession de mon signalement. La suite des événements devait me le confirmer.
J’ignorerai toujours si le préposé à la consigne m’a dénoncé en signalant le dépôt anormalement lourd ou s’il s’est contenté, une fois la valise découverte, de fournir mon signalement. J’étais assez facile à reconnaître : cheveux blonds, yeux bleus, nez cassé de boxeur.
Il fallait fuir, ce que je fis en évitant les rues principales. Le hasard ou l’instinct me conduisit vers le quartier proche de la gare que j’avais quitté moins d’une heure auparavant. J’espérais y retrouver le mécanicien qui m’avait sauvé. Je ne connaissais personne d’autre à Chalon-sur-Saône. Je me sentais pris au piège, enfermé dans une ville hostile où j’étais incapable de m’orienter, les voies de départ, trains et cars, interdites, les routes ouvrant sur la campagne, probablement coupées par des barrages. Il me restait l’option de demeurer caché sur place en attendant que la surveillance se relâchât.
J’eus la chance de revoir mon cheminot qui rentrait chez lui sa matinée terminée. Je venais de passer deux interminables heures dans un jardinet encombré de broussailles et j’en étais sorti à bout de patience, prêt à tenter n’importe quoi. Mon abri, déjà précaire alors que l’avenue était déserte, devenait dérisoire à mesure que les gens sortant du travail y circulaient. Je vis l’homme sortir sa clef, ouvrir sa porte. Il l’avait à peine refermée que je sonnai. Il m’ouvrit.
J’étais décidé à jouer le tout pour le tout. Je n’avais d’ailleurs pas d’autre ressource. La nécessité de me cacher primait sur toute autre considération. Dans la petite salle à manger où j’étais assis face à mon hôte, je me confiai à lui, lui racontai mon histoire, lui parlai de la Résistance. Je me fis persuasif, j’essayai d’être émouvant. Il m’écoutait, ses yeux clairs fixés sur moi. Je n’avais pas achevé que sa femme arrivait à son tour, rentrant aussi du travail. Il me fallait la convaincre car elle allait disposer de mon destin. Elle ne souleva pas d’objections, mais fit remarquer que c’était très risqué. Plus d’une fois les Allemands avaient fouillé la maison. Le couple avait un fils prisonnier dans un Stalag, une fille mariée à Lyon. Tous deux savaient ce qu’était la Résistance, écoutaient la radio de Londres. Dans le monde courageux et dur des cheminots, l’action clandestine éveillait des sympathies, suscitait des complicités et des dévouements. J’eus droit à une petite chambre dans la maison. J’y passai la journée, puis la nuit, puis la journée du lendemain.
À midi, mon hôte m’avertit que l’enquête se poursuivait. On avait interrogé tous les cheminots. On pouvait venir fouiller les pavillons. J’avais intérêt à filer dans la nuit.
Je me rendais compte du risque que je faisais courir à mes hôtes. Avais-je le droit d’exposer la vie ou la liberté d’autrui ?
Au soir du 13 juillet, vers dix heures, je me trouvai sur une route hors de la ville, l’une des moins fréquentées. Le cheminot m’y avait conduit lui-même, ayant constaté d’abord que le passage était libre. Je lui serrai la main. J’avais les larmes aux yeux et je crois bien qu’il pleurait aussi. Il me souhaita bonne chance et disparut.
Je marchai plusieurs heures dans la nuit. Un camion survint, roulant très lentement dans la même direction que moi. Sa lenteur me rassura, il ne pouvait s’agir que d’un véhicule civil marchant avec les moyens du temps. Je l’arrêtai. Un chauffeur, dont je n’arrive plus guère à me remémorer le visage, d’ailleurs peu visible dans l’ombre de la cabine, me fit asseoir près de lui et me conduisit à Dijon. Il n’allait pas plus loin. Je ne sais plus quels propos nous échangeâmes. L’homme ne semblait pas surpris de rencontrer sur la route un gaillard qui faisait du stop à une heure du matin. Du reste, il parlait peu. Il me déposa à l’entrée de la ville, alors que le jour se levait à peine et s’en alla.
Je commençai par me réfugier dans un de ces cafés, ouverts très tôt, où les travailleurs de l’aube se retrouvent. J’y attendis l’ouverture des magasins puis me mis à traîner par les rues. Je vis un coiffeur qui relevait son rideau de fer, m’installai chez lui, me fis raser, couper les cheveux. Je me souviens du sentiment de sécurité que j’éprouvai pendant que le coiffeur s’occupait de moi. Le danger semblait passé. Mon naturel expansif et gai reprit le dessus. Je bavardai joyeusement avec le coiffeur. Après ces journées anxieuses et ces nuits d’insomnie, je croyais avoir retrouvé une vie normale.
Lorsque je quittai la boutique, je ne savais pas ce que j’allais faire. Il importait de regagner Paris au plus vite, mais par quel moyen ? Au premier carrefour, je me vis brusquement entouré par trois hommes en civil.
— Vos papiers !
Aucun moyen de leur fausser compagnie. Je dus pâlir. Je sortis mon portefeuille d’une main hésitante. Mes papiers étaient mes vrais papiers. Je n’avais pas songé à me procurer une fausse identité. À quoi bon ?
— Vous êtes de Paris ? Qu’est-ce que vous faites à Dijon ?
L’accent rugueux de l’homme ne me laissait aucun doute. J’essayai d’expliquer je ne sais quoi, en bredouillant. Ils ne m’en laissèrent pas le temps.
— Suivez-nous !
Je protestai sans conviction. Ils m’entraînèrent. Sous le veston de l’homme qui m’avait interrogé apparaissait la crosse d’un pistolet. Une voiture attendait à cinquante mètres. Ils avaient dû en descendre en m’apercevant. J’y montai, un peu poussé et bousculé parce que je tentais de résister. La voiture démarra. Je ne sais plus combien de temps elle roula ni devant quel immeuble elle s’arrêta. J’essayais d’élaborer un système de défense. On me fit monter un escalier, longer un couloir et on me fourra dans une cellule.
J’entendis la clef tourner dans la serrure. On me laissa là, sans manger ni boire, toute la journée et toute la nuit.
CHAPITRE II
LE TEMPS DES SUPPLICES
Ce que furent mes interrogatoires, tous les résistants capturés le savaient. La Gestapo n’a certes pas inventé la « question ». Elle ne l’a pas perfectionnée. Mais elle a donné à la torture un style spécial. Le tortionnaire allemand était, dans la plupart des cas, un sadique, choisi comme tel ou entraîné à le devenir. Quiconque a eu affaire aux policiers de la Gestapo ou aux S.S. s’en est rendu compte. Ils frappaient pour obtenir des aveux, n’y parvenaient ni mieux, ni plus mal qu’aucune autre police, mais ils frappaient, surtout et davantage, pour la joie de frapper. Je n’ai jamais vu chez eux le moindre mouvement de pitié, ni l’ombre d’un scrupule. Ils se délectaient de la souffrance de leur victime, s’ingéniaient à l’humilier et à l’avilir, se tordaient de rire quand ils avaient brisé à coups de poing la dignité d’un homme, quand ils l’avaient contraint à ramper et à pleurer. L’Allemagne de Hitler avait formé des milliers de ces tueurs, méthodiquement déshumanisés. On imagine ce qu’elle eût fait de cette armée, dans un monde asservi…
Dès le lendemain de ma capture, on me transféra à Chalon-sur-Saône, c’est-à-dire sur le théâtre de mes exploits présumés. En effet, si la Gestapo était convaincue que j’étais bien le « terroriste » à la valise, elle n’en avait pas la preuve. Je soutins hardiment la thèse que j’étais un Juif fuyant vers la zone libre et que j’étais descendu à Dijon, venant directement de Paris, pour trouver un passeur. On m’avait soumis à la fouille, sans résultat. J’avais pris soin de faire disparaître le billet pris en gare de Chalon et le ticket de consigne. Les sommes relativement importantes trouvées sur moi pouvaient accréditer la thèse d’un exil volontaire : il fallait de l’argent pour passer la ligne.
On refusa de me croire. Trop d’indices m’accusaient et la police entendait bien exploiter la capture et me faire parler. Je ne transportais pas des pistolets pour mon seul usage ; je devais appartenir à une équipe. L’intérêt principal était donc d’obtenir de moi des noms et des adresses, pour ouvrir la série des dénonciations en chaîne. Il n’en fallait pas davantage pour détruire entièrement un réseau.
Nous savions ce que pouvait être la torture et les risques que représentait, pour l’ensemble des affiliés, la capture de l’un d’eux. Les pertes déjà subies étaient lourdes. Nous avions donc depuis longtemps essayé de les limiter en réduisant au minimum les points de contact entre nous. Je ne connaissais qu’un petit nombre de camarades. En outre, à chaque mission périlleuse de l’un de nous, il était convenu que, passé un certain délai, les autres devaient obligatoirement changer de résidence et d’identité. Avant mon départ pour Neuville-sur-Ain, nous avions fixé à trois jours le délai de sécurité. Ce délai étant dépassé, j’avais quelques raisons de penser que mes camarades s’étaient cachés.
Je décidai de bien me conduire et j’y parvins. Mais, de tout cœur, je comprends et j’excuse les malheureux qui n’ont pas résisté à la souffrance. J’ai subi sept ou huit interrogatoires pendant la première quinzaine de mon séjour à Chalon-sur-Saône. Il me reste le souvenir abominable d’une grêle de coups de poing, de coups de pied, de coups assenés avec une matraque de caoutchouc et une règle de fer, le tout accompagné de hurlements, d’injures ordurières, de rires hystériques, de commentaires sur l’action et les buts de guerre de l’Allemagne. Si j’ai réussi à ne pas parler, m’en tenant strictement à mon système de défense, je le dois peut-être à ma formation de boxeur professionnel, à l’utilisation automatique des réflexes par lesquels on pare, on esquive ou on amortit, à l’accoutumance à la douleur acquise sur les rings de combat, peut-être aussi à la réaction du boxeur qui n’est un vrai boxeur que s’il s’obstine, persévère dans sa résistance, refuse jusqu’au bout de s’admettre vaincu. Mes bourreaux connaissaient mon passé de pugiliste par mes déclarations et par quelques documents trouvés dans mon portefeuille. Ils en parurent enchantés. Au plaisir sadique de frapper, ils ajoutèrent l’agrément du sport. Ils s’essayaient au crochet et à l’uppercut, prenaient leur élan, visaient à la mâchoire et à l’estomac, se donnant à peu de frais des illusions sportives, sans aller, jusqu’à m’autoriser à me défendre !
Ils ne m’assommèrent pas dès le premier jour, mais jugèrent bon d’observer une progression méthodique dans la torture.
Le premier interrogatoire se passa à peu près sans dommage. Il s’agissait d’établir mon identité et de préciser les raisons qui m’avaient conduit à Dijon. Je déclarai calmement que je cherchais à franchir la ligne de démarcation pour me réfugier en zone libre. Je répondis aux questions sur ma famille, mon passé militaire, mes occupations professionnelles. Je niai formellement avoir la moindre accointance avec la Résistance, et déclarai que je n’avais jamais mis les pieds à Chalon. Je reçus quelques gifles assenées par le gardien qui me conduisait, mais le policier qui m’interrogeait n’insista pas. Je fus très surpris de n’être pas confronté avec des gens qui avaient pu m’apercevoir à la gare. On supposait, apparemment, qu’il n’y avait pas lieu de perdre du temps à des formalités de ce genre et que quelques brutalités suffiraient à obtenir des aveux et des dénonciations.
Je fus conduit en cellule où je passai une nuit difficile malgré l’immense besoin de sommeil qui m’écrasait. J’avais, pour longtemps, perdu le pouvoir de dormir paisiblement, comme on dort à vingt-trois ans.
Le lendemain, en début d’après-midi, retour au bâtiment où siégeait la Gestapo.
Le policier n’était plus seul. Deux autres l’assistaient. Ils examinaient ensemble les pièces d’un dossier et longtemps, ils me laissèrent debout devant eux, comme si je n’existais pas. De temps en temps, ils échangeaient en allemand quelques propos que je comprenais très mal, malgré ma connaissance relative de la langue. Cette longue attente ne pouvait manquer d’ébranler ma résistance en faisant grandir en moi une anxiété de plus en plus insupportable. Enfin, celui qui m’avait interrogé la veille leva les yeux sur moi. Une tête massive d’homme bien nourri, des cheveux taillés en brosse, un regard lourd. Il parlait un français assez correct, mais avec un accent si prononcé que certains mots en étaient déformés et qu’il me fallait deviner leur sens.
Il commença par un discours mesuré de ton, m’expliqua que les francs-tireurs se mettaient en marge des lois de la guerre et que les forces armées allemandes se devaient de les pourchasser avec la plus grande rigueur. Leur action était d’ailleurs vaine et sans espoir, la victoire du Reich ne faisant de doute pour personne ; j’avais tort de nier une action terroriste que j’avais bel et bien accomplie, en dépit de mes mensonges, et qu’il tenait là – il frappait du plat de la main sur le dossier - toutes les preuves de ma culpabilité. Je devais donc normalement être fusillé, mais il m’assurait, lui, la vie sauve, si je dénonçais mes complices.
Il m’affirma que le Reich allemand tenait le plus grand compte de la bonne volonté des patriotes français, s’ils consentaient à soutenir l’effort de guerre plutôt qu’à le contrecarrer. Il parla ainsi assez longtemps. À plusieurs reprises, je tentai de l’interrompre pour protester de mon innocence, mais il m’imposa silence d’un air mécontent. J’eus l’impression qu’il était très fier de s’exprimer avec aisance en langue française, et qu’il cherchait à briller devant ses collègues.
Je niai. Je repris mes explications de la veille qui se perdirent dans le vide. Ils recommencèrent à converser en allemand. Finalement, ils s’approchèrent nonchalamment de moi.
— Alors tu ne veux pas parler ?
La même question me fut répétée plusieurs fois et puis, brusquement, les poings partirent en direction de ma tête. Les premiers coups résonnèrent prodigieusement dans mon crâne et j’essayai instinctivement de me défendre, mais j’avais les menottes aux poignets.
Du reste, les trois hommes se relayaient, chacun visant le point que je découvrais pour faire face à l’autre. J’étais devenu un pantin qu’ils se lançaient de l’un à l’autre et ils riaient joyeusement en frappant.
La première séance ne dura guère. Les bourreaux m’accordaient d’ailleurs des pauses, échangeaient quelques phrases, puis me reposaient la même question.
— Tu ne veux pas parler ?
Et la grêle de coups de poing reprenait, au visage, à l’estomac, dans les côtes, agrémentée de coups de botte lancés à toute volée. Lorsque ces brutes me lâchèrent, j’avais la figure ravagée, les arcades éclatées et saignantes, la lèvre coupée, et les reins brisés. Je pouvais difficilement marcher. On me reconduisit en cellule.
Le lendemain, à la même heure, le policier reprit son discours à peu près dans les mêmes termes. Il conclut que la nuit avait sûrement porté conseil, et qu’il se préparait à enregistrer mes aveux.
Il savait bien ce qu’il disait. Ce n’est pas tellement sur l’instant que les coups font mal. C’est après. À mesure que les heures passent, le corps meurtri se raidit, s’ankylose, cherche en vain une position de repos et se torture à la chercher, car le moindre mouvement arrache un cri. Dans la longue nuit coupée de brefs instants de sommeil, l’angoisse grandit à la pensée du lendemain qui se prépare. Ce n’est pas la mort que l’on redoute, c’est la souffrance que l’on prévoit pire que celle qu’on éprouve, avec, en plus, des mutilations, des dégâts organiques irréparables. En outre, l’impression effroyable d’être seul, perdu, abandonné, misérable, sans la plus petite espérance de secours ou d’évasion. Étendu sur la planche de la cellule, comme une bête blessée et sacrifiée qu’on laisse mourir là, c’est à ce moment que s’insinue dans la conscience, revenant avec obstination, la tentation de parler, de dire un nom, un seul, de dénoncer le camarade le plus insignifiant ou le moins estimé. Tentation sournoise et raisonneuse, qui accumule des arguments, s’alimente de l’inévitable apitoiement sur soi-même, lorsque les larmes viennent aux yeux et qu’on pense à l’immensité du sacrifice consenti.
La résistance morale des prisonniers soumis à la torture, même chez les plus forts, descend par moments à zéro, quand on songe à la sécurité perdue, au foyer, à la mère, à la femme aimée, à la douceur de vivre et qu’on envisage la possibilité de tout retrouver. Les bourreaux m’auraient peut-être arraché des aveux s’ils avaient eu l’astuce de revenir la nuit et de profiter d’un de ces moments d’abandon où je pleurais sur moi-même.