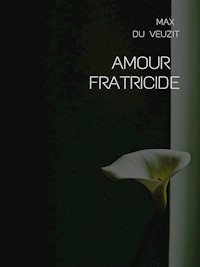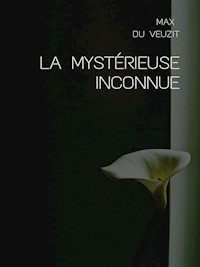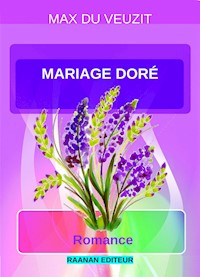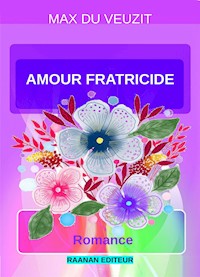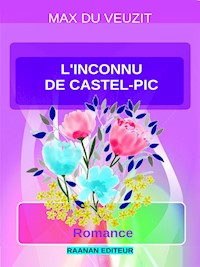2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Au bord de la ruine, Mme d'Armons presse son fils Philippe d'épouser une riche héritière, Myette Darteuil, qui vit chez sa belle-mère depuis la mort de ses parents. Elle y mène une existence misérable qui a profondément altéré sa santé et ses facultés morales. Enlevée de nuit grâce à son tuteur, elle est mariée peu après à Philippe qui n'a pas le courage de vivre avec elle et part pour l'étranger. Quant à Myette, délaissée et humiliée, elle se rend en Suisse avec Martine, la vieille nourrice de Philippe. En quelques mois, c'est la métamorphose complète de celle que son mari considère comme une étrangère. Théâtre, bals, réunions mondaines, voyages en Italie, au Maroc, en Tunisie où l'accompagnent un de ses admirateurs, Robert Montavel et la grand-mère de ce dernier. Trois années passent sans que les époux se soient rencontrés de nouveau, jusqu'au jour où le décès de Mme d'Armons les remet en présence. Et dans la splendide jeune femme qu'est devenue Myette, Philippe ne reconnaît pas... sa femme ! Quand il apprendra la vérité...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Petite Comtesse
Max du VeuzitPremière partieIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXIX - 1XXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIDeuxième partieI - 1II - 1III - 1IV - 1V - 1VI - 1VII - 1VIII - 1IX - 2X - 1XIXII - 1XIII - 1XIV - 1Troisième partieI - 2II - 2III - 2IV - 2V - 2VI - 2VII - 2Page de copyrightPetite comtesse
Max du Veuzit
Max du Veuzit est le nom de plume de Alphonsine Zéphirine Vavasseur, née au Petit-Quevilly le 29 octobre 1876 et morte à Bois-Colombes le 15 avril 1952. Elle est un écrivain de langue française, auteur de nombreux romans sentimentaux à grand succès.
Première partie
I
– Philippe, mon enfant, veux-tu, oui ou non, examiner sérieusement ma proposition ? Ton entêtement causera une catastrophe !
La voix suppliante de la vieille dame fit tressaillir le comte.
Il redressa sa haute taille qu’une longue méditation, après dîner, avait courbée vers les tisons de la grande cheminée.
– Je n’arrive pas à vous suivre sur ce terrain, ma mère ! D’ailleurs, comment croire à la réalité d’une pareille proposition ?
– Je t’ai expliqué que Me Garnier, qui nous est tout dévoué, est certain des avantages énoncés. Il a dit douze millions !
– Cette histoire est fantastique !
– Si tu en doutes, consulte-le ; en même temps, il te confirmera que nous sommes au bord du gouffre.
– Je ne l’ignore pas.
– Oui, mais il te dira aussi que ton pauvre frère ne sait plus de quel côté se tourner... cette affaire de pétrole lui a tout mangé... la dot de sa femme y a passé, tout est englouti et cependant Charles me disait encore la semaine dernière que, s’il avait des fonds, il continuerait ses recherches : il est sûr qu’il y a du pétrole aux Chaumes-Rouges. Il en a trouvé.
– Insuffisamment.
– Parce que ses moyens sont limités. Il lui faudrait un commanditaire.
Philippe d’Armons eut un geste d’indignation.
– Après avoir englouti tout ce qu’il possédait, il risquerait l’argent des autres. C’est insensé !
Mais la mère prit chaleureusement la défense de l’absent. Et sa voix douce observa avec une profonde conviction :
– Charles est un honnête homme. S’il dit qu’il y a du pétrole, c’est qu’il y en a. Et c’est désastreux pour lui, et pour nous tous, qu’il ne puisse continuer ses recherches.
– Alors, c’est pour lui permettre de nourrir sa marotte que vous me dites : « Marie-toi. »
– Non, Philippe, ce n’est pas pour que ton frère en retire avantage que je te propose cette nouvelle union. C’est surtout dans l’intérêt de ton nom et de ton avenir.
– Bah ! Il me faut si peu pour vivre : je bazarderai Orfay si c’est nécessaire !
La vieille dame regarda son fils avec tristesse, l’insouciance de ce grand jeune homme qui ne savait pas lutter contre les difficultés de la vie lui était pénible.
Il tenait de son père, évidemment.
Le comte avait été, toute sa vie, un homme léger et égoïste, ne sachant s’astreindre ni se restreindre, si bien qu’il avait connu très vite les embarras d’argent.
Il avait élevé ses fils avec la même légèreté et ce n’était pas tout à fait leur faute si, doués tous deux d’un beau nom et d’une assez belle instruction, ils ne savaient pas en tirer parti et réussir là où d’autres, moins avantagés, arrivaient sans difficulté, parce que plus énergiques.
Cependant, le cerveau de la mère avait enregistré la dernière boutade :
– Bazarder Orfay, protesta-t-elle, et quand tu auras payé ce que tu dois à droite et à gauche, te restera-t-il assez pour végéter seulement dans la baraque des Saules, où tu loges ton garde-chasse ? Raisonne un peu avant de dire des bêtises.
– Mon rêve serait de partir, de m’expatrier. Je voudrais visiter l’Inde, la Chine.
– Pour être explorateur et archéologue, – ce qui est ta passion, – il faut de l’argent. Tu n’en as pas et je t’en offre.
Philippe haussa les épaules avec lassitude.
– Il faut le prendre, cet argent, et votre moyen me répugne, observa-t-il amèrement. Me marier dans ces conditions est dégoûtant ! Je ne comprends pas comment vous pouvez m’y encourager !
D’un geste de la main, la mère parut vouloir arrêter sur les lèvres de son fils les reproches irrespectueux.
– Avant de me juger, Philippe, as-tu réfléchi que pour te conserver une jeunesse honorable, que pour maintenir à notre nom – au tien – un peu de l’éclat dont il a toujours été entouré, j’ai sacrifié toute ma fortune personnelle, tous mes bijoux, tous mes bibelots ! Votre père m’a laissé des affaires bien embrouillées. Je me suis débattue au milieu de mille difficultés. Vous étiez jeunes... toi surtout ! Il fallait vous élever et vous faire instruire ! Je n’ai pas contrarié vos vocations ; tu voulais l’école des Chartes, tu en as suivi les cours. Maintenant, je suis à bout de ressources : nos terres sont hypothéquées au-delà de leur valeur et les créanciers me harcèlent au point que nos serviteurs n’ignorent plus rien de notre réelle situation.
– Si mon frère n’avait pas entrepris ces fouilles dérisoires et coûteuses, il eût pu un peu alléger votre fardeau.
– Ton frère a une femme toujours malade et trois fillettes à élever. Il a été sublime vis-à-vis de moi et c’est grâce à lui si j’ai pu tenir aussi longtemps. Je ne veux pas te faire de reproches, mon petit Philippe, mais, sans t’en rendre compte, tu as vécu jusqu’ici comme un grand enfant, sans regarder en face les exigences de la vie.
Le comte eut un geste de protestation.
– J’ai désiré, souvent, vous être utile, ma mère, mais à ma majorité, j’ai trouvé Orfay fortement hypothéqué déjà... depuis, je n’ai pu que renouveler ces maudits papiers.
– Tu as trouvé Orfay comme ton père te l’avait laissé.
– Je sais, je sais. Quand je me suis marié...
– Ton mariage fut une grosse bêtise, mon pauvre petit !
– Je vous en prie, ma mère, pria-t-il, le visage soudain douloureux.
Elle hocha tristement la tête.
– Jacqueline était une brave petite fille que j’ai aimée sincèrement, acquiesça-t-elle. Enfin, mon pauvre enfant, il faut bien que tout cela soit dit. Avant ton mariage, je t’ai supplié de conclure une union avantageuse qui eût permis de remettre à flot la barque désemparée des Armons. Tu t’es obstiné... Tu aimais Jacqueline, on pouvait espérer que son oncle, le commandant de Sorelle, ne l’oublierait pas dans son testament.
– Il l’eût fait si elle avait vécu.
– Bref, tu as tenu bon. Vous étiez deux enfants, je ne voulais pas ce déraisonnable mariage... tu m’as menacée de me forcer la main... j’ai dû céder en faisant pour vous les pires sacrifices afin que vous ne connussiez pas, tout de suite, la misère... depuis, j ‘en suis réduite aux expédients pour vivre.
– Ma pauvre maman, je sais combien vous avez été bonne pour nous.
– C’est tout naturel de la part d’une mère... Seulement, Philippe, comprends-moi, c’est tellement pénible de demander pour soi... Je suis à bout de ressources, j’ai peur de demain non seulement pour moi, mais aussi pour toi et ton frère. Me Granier a eu une idée de génie avec ce mariage qui sauve la situation et te fait riche... si riche !... puisque le malheur a voulu que tu perdes ta femme quelques mois après ton mariage.
– Ma pauvre Jacqueline ! gémit le comte dans un sanglot.
– Tu as trente ans à peine. Ce que l’amour t’a empêché de faire la première fois, la raison t’en convaincra, maintenant.
– Mais je n’ai jamais pensé un instant que je pourrais me remarier ! cria-t-il avec une instinctive horreur. Songez donc, les cendres de ma chère femme sont à peine refroidies et je pourrais...
– Pauvre enfant ! fit la mère, apitoyée. Je te torture et réveille en toi de cruels souvenirs... j’aurais voulu t’épargner cette explication... et cependant, il le faut. C’est un mal nécessaire. Plus tard, tu me remercieras d’avoir fait ton bonheur.
– Oh ! mon bonheur ! Désormais, il ne peut plus en être question.
– Alors, pour le moment, disons de ta tranquillité.
– Ma tranquillité matérielle tout au plus, ma mère ! Car vous faites bon marché de mes sentiments et de mes goûts. Il n’y a pas six mois qu’une affreuse fièvre typhoïde a enlevé ma femme à mon affection, et vous venez me parler d’un nouveau mariage.
– L’occasion s’en présente, je ne l’ai pas cherchée.
– Une remplaçante à Jacqueline !
– Non, pas une remplaçante, je n’ai pas cette illusion ! La pauvre enfant, dont on te propose la main, sera une intruse dans ton cœur... mais elle sera le sauveur de ton nom, de ta race et de ta vie, puisqu’elle te permettra de tenir ton rang et de vivre honorablement au milieu des tiens.
– Il faudra qu’elle partage mon existence, et c’est de cela que je n’ai pas le courage.
– Un honnête homme doit avoir le courage de faire son devoir.
– Mon devoir ! Amère dérision ! Épouser une femme parce qu’elle est riche et avec la certitude de la rendre malheureuse ?
– Pourquoi la rendrais-tu malheureuse ? Je te crois incapable de cette malpropreté-là. Ne peut-on avoir des égards et des prévenances pour une femme que l’on estime et qui vous apporte l’aisance, la vie largement assurée, sans soucis, sans tracas ?
– Une femme avec qui il faut passer ses jours ! Elle devrait vivre à mes côtés, respirer l’air d’Orfay, se mouvoir dans la même ambiance que ma morte bien-aimée, au milieu de tout ce qui me l’évoque !
– Il faudra bien qu’un jour ou l’autre tu arrives à te remarier... Tu ne peux vivre sans descendance. Notre nom ne doit pas périr et puisque ton frère n’a que des filles et que sa femme est privée désormais de l’espoir d’une autre maternité, il faut bien que ce soit toi qui assumes le devoir de la survivance de notre nom.
– Le devoir, dites-vous. Où est-il, le devoir ? Un nom, c’est affaire de préjugés...
– Ne blasphème pas !
– ... Mais n’est-ce pas un devoir aussi de conserver intact le souvenir des disparus ? Le culte des morts est la chose la plus sacrée qui soit au monde et tous les peuples s’en font une loi. J’ai juré fidélité à Jacqueline. Pendant toute ma vie, je dois lui garder sa place et non pas donner à une autre le nom et les droits qui lui reviennent à elle seule.
– Tais-toi, tu divagues ! fit la vieille dame avec commisération. Avant le devoir envers les morts, il y a le devoir envers les vivants, envers ta race, envers tous tes ascendants. Tu parles des droits d’une morte ? Alors, évoque les droits de toute la longue lignée de tes ancêtres... Parle avec ta conscience et non pas avec ton cœur.
Elle se dressa et montrant du doigt une douzaine de tableaux, accrochés au mur, elle acheva, toute frémissante d’ardeur :
– Interroge-les, demande-leur conseil ! Leur nom doit-il périr parce que tu n’as plus le courage d’être époux et de créer une famille ? La maison doit-elle sombrer dans la honte des procès et le hurlement des créanciers impayés alors que l’on t’offre une planche de salut et qu’il te suffit d’immoler tes goûts personnels au bien de tous ?
Dans son exaltation, la mère était belle et comme transfigurée. Philippe la regardait, bouleversé par ses paroles qui semblaient s’adresser à des personnages réellement vivants.
– Mon fils est faible, continuait-elle, parce que le chagrin a ployé son jeune être, mais vous, preux chevaliers qui connaissez maintenant le néant des passions humaines, ne l’aiderez-vous pas du souvenir de vos vaillances guerrières et de vos vertus familiales ? La maison va sombrer, aidez-le à la sauver.
Elle joignit les mains, suppliante, avec une foi réelle dans l’efficacité de cette prière adressée à des mânes séculaires.
– Calmez-vous, ma mère, je vous en prie, fit le comte en venant l’entourer de ses bras. La maison va périr, dites-vous, et je puis la sauver. Qu’il soit fait selon votre désir. J’immolerai mon cœur et mes aspirations pour vous donner satisfaction et assurer le calme de vos vieux jours...
– Ah ! mon Philippe, je savais bien que je ne m’adresserais pas en vain à ta raison.
Il eut un triste sourire.
– Vous êtes, ma mère, tout ce qui me rattache à l’existence... sans vous, je crois bien que j’aurais suivi ma chère Jacqueline !
– Oh ! mon enfant, ne pense jamais à une chose pareille.
– J’ai eu souvent, ces derniers mois, la hantise de la mort. Pour vous, ma mère, j’ai résisté. Aujourd’hui, je veux faire violence à mes désirs personnels ; je prendrai femme comme vous le souhaitez.
– Merci, mon Philippe. Tu verras, nous serons heureux.
– Ne vous réjouissez pas trop tôt, ma mère. Je ne suis pas un héros et, quand je connaîtrai mieux votre projet, il est probable que j’y mettrai certaines conditions.
– Ne les exprime pas avant d’être au courant. Me Garnier viendra ce soir passer la soirée avec nous, il te dira lui-même de quoi il s’agit.
Il eut un pauvre sourire.
– Quand vous m’avez envoyé à Orfay ce télégramme de venir tout de suite vous voir, vous étiez donc si certaine de me décider, que Me Garnier était également convoqué ?
– Je savais que nous étions acculés, il fallait agir ou sauter et j’avais l’espoir que tu préférerais nous sauver.
– C’est la carte forcée, alors !
– Tu en jugeras.
Ils ne parlèrent plus. La mère reprit un travail de tapisserie qu’elle avait négligé depuis l’arrivée de son fils, deux heures auparavant, et Philippe enfouissant sa tête dans ses mains, se mit à songer douloureusement au poids écrasant qui pesait soudain sur ses épaules déjà si fortement ployées par son cruel deuil.
II
Il était neuf heures du matin.
Un pâle soleil d’automne fardait de clarté les murs blancs de la Blanquette, vaste château moderne aux multiples bow-windows, à la longue terrasse, au perron monumental, aux vitraux éclatants.
Avant de poursuivre sa route, le visiteur matinal que le rapide de Paris venait de débarquer à la station voisine, s’arrêta et regarda longuement la riche demeure vers laquelle il s’acheminait.
– Darteuil avait du goût. Sapristi !... quelle belle propriété ! Il doit faire bon demeurer ici...
Mais il hocha la tête.
– Et pourtant !... Quel drame vais-je trouver ! À moins que ce ne soit une atroce comédie.
Il arrivait à peine sur l’imposant perron qu’un domestique stylé s’élançait vers lui.
– Maître Savitri, sans doute ? Mme Darteuil attend Monsieur.
Et, tout en introduisant le visiteur, l’homme expliqua :
– Madame n’a pu aller au-devant de Monsieur, à cause de Mlle Darteuil... une crise... la pauvre fille, véritablement, perd complètement la tête. Le docteur dit qu’on aurait dû l’interner depuis longtemps.
Le visiteur ne répondit pas. Il examinait avec une certaine méfiance celui qui se permettait d’exprimer si familièrement son avis sur la fille de Darteuil.
Devant le silence prudent du nouveau venu, le serviteur ajouta lourdement :
– Mme Darteuil le dira elle-même à Monsieur : la vie n’est plus tenable auprès de la pauvre fille... sans compter que voici sa majorité qui approche et que ce serait un véritable malheur, pour tous, s’il fallait lui donner la clé des champs.
– Ah ! fit-il, Mme Darteuil dit que ce serait un désastre.
– C’est quasiment l’avis de tous les amis de Mme Darteuil et de Mlle Edmée, insista l’homme en fixant étrangement le visiteur.
– Un désastre ? répéta Savitri à mi-voix.
– Dame ! douze ou quinze millions... dans les mains de... de... d’une pauvre folle, tandis que... ça serait si bien placé chez... d’autres, évidemment.
– Évidemment, balbutia Savitri dont les yeux se posèrent, inquisiteurs, sur ceux du serviteur.
– Ça ne fait pas de doute, insista encore lourdement ou maladroitement ce dernier.
– Ah ! ah ! c’est possible ! murmura entre ses dents le visiteur.
Une lueur de satisfaction illumina le regard du domestique.
– Le ciel a donné à chacun des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, fit-il sentencieusement.
Mais éteignant la flamme de son regard et reprenant son allure obséquieuse :
– Je vais avoir l’honneur d’aller annoncer à Mme Darteuil l’arrivée de Monsieur. Elle sera bien contente que Monsieur se rende compte et décide lui-même...
Il allait s’éloigner, mais Savitri, d’un geste, le retint :
– Je crois que vous êtes tout dévoué à votre maîtresse, l’ami... j’aime les serviteurs dévoués.
– Je donnerais ma vie pour ma maîtresse, répondit l’homme gravement.
– Laquelle des trois ? fit brusquement Savitri en tendant le cou.
De l’affolement passa dans les yeux de l’autre. L’éclair d’une seconde, il parut à l’homme d’affaires qu’il avait devant lui une bête traquée, impuissante à se sauver.
– Laquelle ? répéta-t-il.
Mais un bruit de pas, un frôlement plutôt, se devinait derrière la porte.
– Mme Darteuil est la meilleure des patronnes, prononça le domestique à voix haute. Ses gens l’adorent et je lui suis tout dévoué.
Il parlait fermement, avec chaleur, mais ses yeux suppliants, rivés à ceux du visiteur, semblaient crier éperdument quelque chose que la bouche ne disait pas.
La porte s’ouvrit, empêchant Savitri de formuler toute autre question.
Une femme entra.
Elle pouvait avoir une cinquante d’années. Assez grande, de forte corpulence, les traits empâtés, mais qui avaient dû être beaux, elle donnait une impression de force et d’énergie, assez rare chez une femme de sa condition.
Me Savitri s’inclina galamment devant la châtelaine pendant que le domestique s’esquivait sur un coup d’œil d’intelligence de sa maîtresse.
– Votre lettre m’a donné du remords.
– Comment cela ?
– Voici des mois... deux ans même, que je ne suis venu à la Blanquette et je m’en veux d’avoir délaissé si longtemps ma pupille.
– Bah ! si cela peut adoucir vos scrupules, dites-vous que la pauvre fille ne vous eût pas reconnu... Elle est complètement inconsciente à présent.
– À tel point ?
– Folle à lier, cher monsieur. Et qui pis est, dangereuse. Gorse me disait qu’il aurait dû signer, depuis des mois déjà, son billet d’internement.
– Ce que vous me dites là me peine beaucoup. Quelle punition pour mon pauvre ami, si, de là-haut, il voit sa fille en cet état !
– Hélas ! larmoya Mme Darteuil, mon pauvre mari me disait quelquefois que Myette l’inquiétait... sa mère était neurasthénique... il craignait beaucoup cet antécédent maternel.
– Comment, Darteuil craignait de ce côté ? fit Savitri, sincèrement surpris.
– Hélas ! répéta la veuve sur le même ton. C’était son plus cruel souci.
Savitri ne répondit pas. Il regardait en dedans de lui-même et revoyait huit ans auparavant son ami, Jean Darteuil, sur son lit de mort.
La belle tête du moribond se détachait, dans sa mémoire, brillante d’intelligence malgré l’imminent dénouement, sur le fond blanc des draps immaculés. Et il croyait entendre encore la voix faible commander :
– Je te confie Myette. Ma femme l’élèvera, mais c’est à toi que je la recommande, c’est sur toi que je compte pour veiller sur elle...
Et les années ont passé.
La veuve qui, d’abord, habitait Paris la majeure partie de l’année, est venue se fixer définitivement à la Blanquette, au fond de ces Ardennes à la fois si belles et si sauvages.
Depuis cinq ans, Savitri ne voit presque plus Myette... Parfois, une lettre de la veuve vient lui donner des nouvelles. Depuis deux ans, même, Savitri n’a pas fait le voyage pour venir voir la fille de son ami. Et voici que, dans sa conscience, un doute affreux se lève.
A-t-il suffisamment veillé sur l’enfant que Jean Darteuil lui avait confiée ? Peut-il affirmer que cette femme a été bonne mère vis-à-vis de l’orpheline ?
Question angoissante ! car cette femme est mère aussi d’une fille de quelques années plus âgée que Myette... d’une fille à établir, maintenant !
– Edmée Périer, pense-t-il, est née d’un premier mariage contracté par la veuve... Jean Darteuil n’était que le second mari... L’autre était un pauvre diable de journaliste, mort sans fortune. Darteuil, au contraire, était fort riche...
Edmée Périer ne devait rien posséder, tandis que Myette, riche déjà des biens de sa mère, décédée en la mettant au monde, avait vu sa fortune tripler lors du décès de son père.
Toutes ces choses se levaient en foule dans l’esprit de Savitri.
Et était-ce hallucination ou son moi subconscient éclairait-il son intellect d’une prescience inattendue, voilà que la voix de la veuve résonnait faussement à ses oreilles ! voilà que toutes les lettres reçues ces dernières années, au sujet de Myette, lui apparaissaient perfides et sujettes à caution ! Voilà même que le murmure du domestique, tout à l’heure « Dieu a donné des oreilles et des yeux pour entendre et regarder », lui semblait lumineusement clair ! Voilà, enfin, que, malgré ce soleil radieux, cette maison cossue, cette pièce coquette, cette femme souriante, un voile sombre jetait un nuage autour de lui.
Il sentait, sans comprendre pourquoi, les ténèbres l’environner : dans l’ambiance, il flairait du drame ; sous les sourires, il redoutait la haine.
Et l’instinct obscur qui régit nos actes, presque malgré nous, lui fit se composer un visage, prendre une attitude et commander sa voix.
Voilà que les mots jaillirent de ses lèvres sans qu’il se rendît compte de la comédie qu’il devait jouer et qu’il jouait effectivement.
– Je suis navré de ce que vous m’apprenez, fit-il enfin d’un air désolé. J’espérais que votre lettre, écrite dans un moment d’affolement maternel, exagérait la vérité... Cette pauvre petite Myette, folle à vingt ans, c’est épouvantable ! S’il faut l’interner, nous aviserons, mais savez-vous que ce sera extrêmement pénible d’en arriver là !
– Hélas !
– Enfin, espérons que, placée dans une bonne maison... avec des soins spéciaux... l’aliénation peut guérir.
– Oh ! je doute...
– Vraiment ! vous croyez ?
– Gorse dit que, cet état ayant coïncidé avec l’âge de la puberté, il est à craindre que la guérison soit impossible... à moins que, vers cinquante ans...
– C’est effarant ! Et Gorse ne se trompe probablement pas, approuva Savitri de son même air éploré, mais banal.
Un éclair de joie avait brillé dans les yeux de la veuve.
– Gorse ne se trompe pas, affirma-t-elle. Je me suis renseignée : ils disent tous que c’est incurable.
– Je vous plains ! Cette perspective d’internement doit être atroce pour vous qui avez élevé Myette.
– Oui, j’ai déjà versé bien des larmes.
– Et plus cruel reste à faire ! Il va falloir que je trouve une bonne maison de santé. Il y en a beaucoup autour de Paris...
– Oh ! interrompit-elle, Gorse croit qu’un changement d’air ne lui vaudrait rien du tout. Il connaît un excellent établissement...
– Ah ! si cette question a déjà été débattue...
– C’est-à-dire, qu’il a envisagé la possibilité de lui continuer ses soins. Enfin, elle jouirait d’un régime de faveur... d’une surveillance plus familiale.
– En effet, tout serait pour le mieux.
Il paraissait enchanté de n’avoir pas à s’occuper de cette affaire.
Et cependant, quelqu’un qui l’eût intimement connu se serait inquiété de la petite lueur singulière qui brillait au fond de ses yeux.
– Et maintenant que nous sommes d’accord, reprit-il, toujours conciliant, montrez-moi un peu cette pauvre fille.
– Vous tenez à la voir ?
– Mon Dieu, puisque je suis venu jusqu’ici, autant en profiter.
– Auparavant, je tiens à vous mettre en garde contre la triste impression qu’elle peut vous causer.
– Réellement, son état mental est visible ?
– Dites que ça crève les yeux !
– Tant que ça ?
– Cette malheureuse refuse tous soins de propreté et ne supporte sur elle aucun vêtement. Elle réduit en lambeaux tous ceux que l’on veut l’obliger à porter.
– Étrange lubie !
– Il faut aussi vous attendre à ses colères ou à ses gémissements. Avec elle, il y a toujours de l’inattendu... et je me demande comment elle va vous accueillir, vous, un inconnu ?
– Peut-être, au contraire, me reconnaîtra-t-elle, observa-t-il tranquillement.
– Ce serait trop beau !...
Elle hésita, puis, regardant l’heure au splendide cadran de la cheminée :
– Vous tenez toujours à la voir ?
– Oui, évidemment !
– Eh bien ! venez, monsieur ; nous avons le temps avant de nous mettre à table.
Elle le conduisit par de larges escaliers et de vastes couloirs jusqu’au troisième étage de la grande demeure.
– Nous sommes ici sous les combles, expliqua-t-elle. J’ai dû la loger dans l’aile droite du château qui est inhabitée pour que ses cris n’impressionnent pas mes gens. Ici, elle est loin de chacun. Savez-vous que, par ce temps de crise de domestiques, il est extrêmement difficile de se faire servir lorsqu’il y a une folle à la maison.
– En effet, fit-il. Ce ne doit pas être toujours amusant.
Il la suivait avec insouciance, semblait-il ; cependant, ses yeux observaient autour de lui et retenaient les moindres détails.
Il remarqua qu’une porte avait été posée récemment à l’une des extrémités du couloir...
La châtelaine la lui désigna d’ailleurs :
– J’ai dû ajouter cette barrière pour l’isoler davantage.
– Elle cherchait à fuir ?
– Oh non, c’est impossible ! Elle est bien gardée. Mais j’avais peur que mes gens ne vinssent la tourmenter ou rire de ses extravagances.
La porte franchie, le reste du couloir formait vestibule, donnant accès, au fond, à une chambre sommairement meublée.
– C’est ici que couche Léonard, le domestique qui vous a introduit. C’est lui qui soigne la malade. Il nous est très dévoué... Il a connu Darteuil... C’est un vieux serviteur sur qui on peut compter.
– Il en reste encore quelques-uns, heureusement !
Le regard de Savitri rencontra une cravache pendue au mur. En éclair, l’attitude bizarre du domestique lui réapparut. Il pensa à nouveau :
« Dévoué à qui ?... Est-ce un bourreau ou un serviteur apitoyé ? »
Et, se rappelant la carrure herculéenne de l’homme, Savitri frissonna.
« Pauvre petite Myette ! Qui dira jamais quels traitements vous avez subis... »
La veuve s’était arrêtée.
– Léonard doit être auprès de Myette. Il ne faut pas pénétrer dans la chambre de cette enfant sans être certains qu’il est là, car elle n’accepte pas d’autres soins que les siens.
– Il faut donc chercher ce domestique.
– Je vais l’appeler.
Et d’un sifflet d’argent pendu à une chaînette dans son corsage, elle tira un long son aigu.
Une porte dissimulée sous une tenture s’ouvrit aussitôt.
– Nous venons voir Myette. Est-elle calme en ce moment ?
– Oui, elle s’amuse très doucement avec des chiffons qu’elle déchire.
– Une robe en lambeaux, probablement.
– Hélas ! Toujours la même.
L’homme parlait à Mme Darteuil sans paraître remarquer la présence de M. Savitri. Pas une seule fois, depuis qu’il était là, son regard ne s’était tourné vers celui-ci.
– Eh bien ! entrons, fit le visiteur que toutes ces précautions oratoires commençaient à agacer.
Le domestique, ouvrant la porte, s’effaça pour laisser passer le nouveau venu.
Et Savitri entra dans la chambre de la démente.
Il s’arrêta aussitôt, presque frappé de stupeur.
Dans la pièce, un désordre inextricable régnait. Sur le plancher, des monceaux de chiffons, de papiers et de cartons, paraissant provenir de livres déchirés.
Dans un coin, un matelas... par terre, à même le parquet !... et dans un angle, un pauvre être accroupi : deux grands yeux caves, dans un visage blanc... si blanc sous l’abondante tignasse brune qui l’encadrait fantastiquement !
Être de cauchemar, vêtu d’une blouse en lambeaux – blouse étriquée aux épaules et si écourtée par le bas ! Être famélique dont les joues creuses, les bras maigres, les mains longues aux doigts décharnés semblaient accuser un jeûne perpétuel... être humain pourtant, car les grands yeux hallucinants rivés sur ceux de Savitri paraissaient crier un appel au secours éperdu ; c’était comme une plainte infinie, incapable de s’exprimer par des mots, mais implorant tragiquement la pitié mieux que ne le feraient des paroles.
Et Savitri, horrifié, tendait le visage vers l’être fantastique qu’il ne s’attendait pas à voir tel.
– Myette, bégaya-t-il. Ce n’est pas possible... elle ! non ! ah ! ma petite Myette !
Un éclat de rire railleur troubla le tragique de la scène.
– Je vous avais prévenu, mon cher maître, disait Mme Darteuil. Vous doutiez, je crois !... Me croyez-vous, maintenant ?
Savitri n’eut pas le temps de répondre.
À la voix de la femme, à son rire insultant, l’être accroupi s’était dressé : corps de quinze ans, arrêté dans son développement, peut-être par une trop grande misère, mais corps souple, nerveux, onduleux, malgré la minceur exagérée.
Et, poings en avant, d’un bond, le petit être avait franchi l’espace le séparant de la châtelaine ; et, lui saisissant les cheveux, se cramponnant à son corsage, essayait de griffer, de mordre, toute sa force tendue à faire souffrir, à déchirer, à réduire, à se venger sûrement.
De rire de Mme Darteuil s’était changé en grimace horrifiée.
Elle poussait des cris aigus, hurlait, s’affolait ; n’arrivant pas même à secouer l’étreinte nerveuse qui la pinçait, l’égratignait sans merci, qui tenait à elle comme les griffes acérées d’un tigre sur sa proie.
Aux cris de Mme Darteuil, Léonard s’était précipité, ainsi que Savitri.
Tous deux essayèrent de faire lâcher prise à la jeune fille ; mais, tandis que le visiteur mettait toute sa bonne volonté à cet effet, il lui parut que son compagnon, tout en faisant de grands gestes empressés et en couvrant l’assaillante d’invectives, n’apportait pas la même précipitation utile à défendre la femme attaquée.
Illusion, peut-être, encore, mais lorsque ses grosses pattes velues effleuraient les frêles poignets de l’enfant tragique, c’était à peine s’il osait les encercler, les arracher de leur proie palpitante.
Et Savitri, levant les yeux vers Léonard, retrouva dans celui-ci le regard appuyé, profond, éloquent, d’une inexprimable volonté.
Un coin de voile se soulevait en la pensée du visiteur : ce n’était qu’une lueur, mais elle était intense.
– À laquelle des trois femmes l’homme est-il dévoué ? s’était-il demandé quelques heures plus tôt.
À présent, Savitri pouvait se répondre à lui-même.
– Pas à Mme Darteuil, sûrement !
Et cette certitude lui fut douce et éloigna un peu de lui l’atroce sensation d’horreur qu’il éprouvait depuis son entrée dans cette chambre repoussante.
Ils avaient enfin dégagé la châtelaine et rejeté l’enfant à l’autre extrémité de la pièce, sur son grabat où elle tomba, tout essoufflée.
– La misérable ! elle m’aurait tuée si vous n’aviez été là, jeta, éperdue de colère, Mme Darteuil.
Elle était en mauvais état. Des joues et les mains balafrées de sanguinolentes traînées, les cheveux crêpés, le corsage déchiré, suante, gémissante, soufflante, affolée de souffrance et de dépit.
Instinctivement, elle avait quitté la chambre de la captive et, se précipitant dans celle du domestique, elle plongeait maintenant son visage tuméfié dans une cuvette d’eau fraîche que, respectueusement et avec un empressement obséquieux, Léonard venait de lui verser.
Savitri, tout troublé encore de l’hallucinante scène dont il venait d’être le témoin, était resté debout dans l’embrasure de la porte, suivant des yeux la victime ensanglantée de Myette.
Il sentit soudain qu’une main brûlante venait se poser sur les siennes, qu’il tenait machinalement serrées derrière son dos.
Surpris, il tourna légèrement la tête.
Myette, quittant sa couche de chiffons, s’était approchée de lui en rampant.
Et, comme il tressaillait, de répulsion peut-être, au contact de l’être famélique, l’enfant se dressa sur ses genoux et, humblement, posa ses lèvres sur les mains de l’homme d’affaires.
Le geste émut celui-ci, qui eut soudain comme des picotements à la gorge.
Mais une prudence instinctive lui fit cacher son émotion, sans qu’il se rendît compte pourquoi sa pitié, en cet instant, allait vers l’agresseur et non vers la châtelaine.
Il jeta un regard craintif dans la direction de celle-ci, comme s’il avait eu peur de paraître approuver l’attaque brutale de l’enfant en acceptant qu’elle vînt si près de lui.
Mme Darteuil, tout occupée des soins que nécessitait son état, ne songeait pas à le surveiller.
Alors, doucement, sans presque changer d’attitude, il força l’enfant à se mettre debout.
Obéissante, elle se dressa tout contre lui.
Il prit son menton, l’obligeant à lever la tête, pour mieux plonger ses yeux au fond du tragique regard.
Il vit de grosses larmes couler silencieusement sur les joues d’ivoire et son cœur s’émut de ce muet désespoir après une si violente colère.
– Pauvre petite ! balbutia-t-il, si bas qu’elle seule l’entendit.
Mais ce mot de compassion la bouleversa toute.
Comprenait-elle qu’enfin le ciel lui envoyait un ami, un défenseur, peut-être ?
Ses mains se joignirent et se tendirent, suppliantes, vers lui.
– Pitié... sauvez-moi ! C’est horrible !... fit-elle, dans un souffle.
Toute la détresse humaine passait dans ses yeux et l’homme en frissonna.
– Je m’occuperai de vous, promit-il spontanément. Je...
Mais elle lui fit signe de baisser la voix.
Et, lui désignant du doigt la chambre voisine, elle le prévint :
– Se méfier !... Si elle soupçonnait votre pitié, vous seriez perdu !
Il faillit rire de la menace dont la fillette l’enveloppait.
Qu’est-ce que Mme Darteuil pouvait contre lui ?
Mais il y avait une telle crainte dans les yeux d’enfant levés vers lui, qu’il retint sa gaieté intempestive. Au surplus, connaissait-il assez la veuve de son ami pour pouvoir affirmer qu’il n’avait rien à craindre d’elle, s’il contrariait ses intérêts ?
Alors, inquiet malgré lui, il tourna la tête à nouveau vers la châtelaine. Elle avait, de son mieux, réparé le désordre de sa chevelure et maintenant elle s’essuyait les mains, sa toilette terminée.
Sans bouger le corps, son bras alla par-derrière repousser la jeune fille. Il ne fallait pas que la femme les vit ensemble.
L’enfant bizarre glissa sur ses pieds nus et gagna à reculons son grabat sur lequel elle se jeta, pauvre loque effondrée qu’on eût cru incapable d’un effort.
Savitri avait perçu son éloignement. Quand il fut certain qu’aucun soupçon ne pouvait naître dans l’esprit de la châtelaine, il se retourna hardiment vers la petite démente.
Et, tout haut :
– La voici calme, à présent. Quelle rage lui a donc pris de se jeter sur vous ?
Mais la femme se garda bien de venir voir ou même d’élever la voix.
Elle connaissait l’effet de sa vue sur l’isolée et ne se souciait pas, pour l’instant, de ranimer sa colère.
Elle fit signe à Savitri de la suivre et elle quitta la chambre du domestique pendant que l’homme d’affaires, avant de s’éloigner, jetait un dernier regard sur le petit être accroupi.
L’enfant ne l’avait pas perdu des yeux. Elle comprit sans doute qu’il allait, car, de loin, ses mains se joignirent à nouveau dans une ardente supplication.
– Pitié ! oh ! pitié !
Et, comme il s’éloignait après un imperceptible signe de la tête, elle se rejeta sur son grabat, avec de gros hoquets convulsifs.
III
Mme Darteuil avait le visage en si mauvais état qu’elle avait préféré ne pas paraître à la salle à manger, livrée à la curiosité de ses gens qui n’eussent pas manqué de faire mille suppositions.
Elle s’en était excusée auprès de Savitri, laissant celui-ci prendre seul son repas du midi au château.
Il avait accepté simplement l’invitation, tout en comprenant la réserve de Mme Darteuil qui, après une aussi sauvage agression, était dans la nécessité de garder la chambre. Au surplus, Savitri était enchanté d’être seul. Peut-être pourrait-il plus facilement ainsi apprendre quelque chose concernant son infortunée pupille.
À la réflexion, en effet, un grand trouble l’avait envahi.
Myette était-elle folle, ou simplement victime de sa belle-mère ?
Que penser de cette crise de colère poussée au paroxysme ? Vengeance, ou démence ?
Comment concilier une agression aussi rapide, aussi brutale, avec le calme et l’humilité qu’elle avait montrés vis-à-vis de lui ?
Et si l’enfant avait sa raison, comment pouvait-elle s’être laissé séquestrer pareillement ? Sans compter qu’intelligente, elle se serait refusée à vivre presque nue ! Elle aurait surtout accepté les vêtements qu’on lui distribuait plutôt que de les réduire en lambeaux !
Il fallait donc admettre que la pauvre fillette était anormale, sujette probablement à des crises de folie contre lesquelles elle ne pouvait réagir. C’était le plus vraisemblable et le plus facile à concilier dans l’esprit de Savitri, parmi tant de contradictions.
Le repas s’était passé silencieusement pour lui. Un maître d’hôtel obséquieux s’était chargé, sans paroles, de lui présenter les meilleurs morceaux et de remplir à souhait son verre des meilleurs vins.
L’estomac satisfait, sa tasse de café à moitié vide, traînant encore un peu avant de quitter la table, Savitri savourait un gros cigare blond choisi parmi une dizaine d’autres posés devant lui en même temps que plusieurs flacons de liqueurs.
Il n’est tel qu’un bon repas pour rendre l’homme optimiste. Et le tuteur de Myette se sentait tout à coup singulièrement indulgent vis-à-vis de l’hôtesse qui l’avait si bien traité.
– Décidément, je crois que cette pauvre fille est une folle dangereuse, qui pourrait nuire en liberté. Sa belle-mère n’est peut-être pas la perle des mamans, mais ça n’a pas dû être toujours rigolo d’élever une innocente !... Ces êtres anormaux sont insupportables et donnent un tintouin de tous les diables à ceux qui vivent auprès d’eux.
Il en était là de ses réflexions, quand Léonard fit son entrée dans la salle à manger.
– Madame m’envoie voir si Monsieur a bien déjeuné et s’il ne lui manque rien.
– Le repas était exquis et vous voudrez bien transmettre à Mme Darteuil tous mes remerciements. J’espère qu’elle-même va aussi bien que possible, après la secousse de ce matin ?
– Madame s’est mise au lit. La secousse, comme dit Monsieur, a été un peu rude ! L’émotion, la peur ont brisé Madame !
– C’est qu’elle mordait et griffait, la mâtine ! Une vraie petite lionne !
– Oui, elle y allait de bon cœur... ça la soulageait !...
Un éclair de joie brillait dans le regard du domestique.
– Elle a pris un peu de forces, depuis que je la soigne, remarqua-t-il doucement.
– Ah ! Auparavant ?...
– C’était le frère de Mme Darteuil qui s’en chargeait... Ça ne réussissait pas très bien, d’ailleurs... Elle était devenue bien faible, la pauvrette !... Cet homme est mort, il y a un mois...
– Vous n’aviez jamais vu Myette, auparavant ?
– Monsieur fait erreur : c’est moi qui nettoyais sa chambre.
– Pourquoi donc ne m’avez-vous jamais écrit ? Il fallait me prévenir que cette petite était... souffrante.
Les yeux de l’homme s’immobilisèrent dans le vague.
– Sait-on jamais si, en voulant faire mieux, on ne fait pas plus mal : un accident est si vite arrivé !...
Le tuteur tressaillit :
– Un accident !... Contre qui ?...
– Oh ! une façon de parler !... Le frère de Madame était un savant homme... un énergique ! Sa mort a privé Madame d’un précieux appui... C’était un homme de décision... Lui vivant, on n’aurait pas eu besoin de déranger Monsieur pour régler le sort de sa pupille.
– On l’aurait fait interner, sans me demander conseil, probablement ?
– Monsieur doit voir juste... Une pauvre folle, n’est-ce pas, c’était l’intérêt de tous... Madame aurait continué de gérer ses biens, très maternellement, avec le même dévouement...
Il avait parlé le plus paisiblement du monde, sans faire un geste, sans même élever le ton. Et, cependant, il y avait comme du défi ou du mépris dans son attitude ou dans son ironie.
Savitri le regarda longuement.
Le domestique avait un aspect bourru et peu communicatif.
Le visage était dur, osseux, avec des lignes fortement accusées. Les yeux petits, vifs, perçants, s’abritaient sous de gros sourcils épais et longs, qui soulignaient encore la dureté du regard ; pourtant, celui-ci, parfois, sous une fugitive émotion, s’adoucissait jusqu’à la bonté.
Savitri pensa :
« La belle brute. »
Mais, tout haut, pour se le concilier en paraissant s’intéresser à lui :
– Vous n’êtes pas du pays, vous, l’ami ? Votre accent dénote un étranger.
– Oh ! l’accent ne veut rien dire. J’ai bourlingué un peu partout et je comprends à peu près toutes les langues. Il n’est pas de pays, en Europe, où je n’aie traîné ma carcasse.
– Et pourquoi avoir tant voyagé ?
– Quand j’étais jeune, j’avais le sang vif et la tête chaude, je m’imaginais toujours que je serais mieux ailleurs. Ça m’a fait voir du pays, jusqu’au jour où M. Darteuil m’a rencontré.
– Ah ! vous avez vu grandir Myette ?
– Oui.
– Et, naturellement, vous vous êtes attaché à elle ?...
– Monsieur fait des suppositions vraisemblables.
– Ah ! fit le tuteur, un peu désarçonné par une aussi subtile réponse.
« Enfin, que pensez-vous de la scène de ce matin ? insista-t-il.
– Hum ! commença l’homme. Je pense... qu’il faut croire que depuis la guerre tout est changé. Auparavant, il y aurait eu bien certainement des gens pour s’étonner, tandis qu’à présent, comme dit Monsieur, on ne s’explique pas que sa pupille proteste aussi énergiquement.
Et Savitri, à nouveau, redevint incertain :
– Je ne demande qu’à m’instruire. Renseignez-moi, vous qui la connaissez...
Mais le serviteur hocha la tête :
– Ici est dangereux, là-bas serait mieux, murmura-t-il.
Et, tout haut :
– Monsieur dînera-t-il ce soir au château et faut-il lui préparer une chambre ?
– Oh ! non ! Il faut absolument que je sois chez moi demain matin.
– Monsieur reprendra donc le train du soir ?
– À quelle heure, celui-ci ?
– Dix-neuf heures cinquante... à moins que Monsieur ne prenne celui de cinq heures du soir.
– Lequel me conseillez-vous, l’ami ?
– Le premier... à moins que Monsieur ne veuille dîner à l’auberge de la Blanquette... La cuisine y est exquise et il pourrait se faire que Monsieur retrouve là des mets savoureux oubliés depuis longtemps.
Savitri demeura perplexe. Le ton d’ironie voilée de son interlocuteur ne lui échappait pas, mais il cherchait en vain ce que signifiait le conseil déguisé de dîner à l’hôtel de la Blanquette.
– Vous croyez que cette auberge vaut la peine de manquer le premier train ?
– Ah ! çà, je le garantis à Monsieur. Je connais la cave, les vins y sont exquis, sans compter que dame Lucas réussit à merveille les tournedos. Monsieur n’a qu’à s’y présenter de ma part, il sera reçu comme un prince et il apprendra ce que c’est qu’un tournedos...
– Ah ! ah ! je saurai... ?
– Tout, monsieur, tout ! À croire que dame Lucas est un diable déguisé en cuisinière. Elle sait des choses !... des riens... et encore des choses !... que Monsieur aurait bien tort de négliger. Il n’y a rien de tel qu’un repas soigné pour y voir clair en route. Quand Monsieur reprendra le train, il comprendra qu’il n’a pas perdu son temps en mangeant à l’auberge de la Blanquette, sans compter que le train de cinq heures est un omnibus qui met treize heures pour regagner Paris, tandis que celui de dix-neuf heures est un express qui dévore les stations !...
Savitri éclata de rire :
– Voilà ce qu’il fallait me dire tout de suite, maître Léonard ! La cuisine de dame Lucas aurait pu me laisser insensible, tandis que la perspective de passer une nuit complète dans le train m’est fort désagréable. Je mangerai donc à la Blanquette.
– Monsieur n’oubliera pas les tournedos.
– Ah ! ah ! vous y tenez ?...
– Dame ! À quoi servirait de rester, si Monsieur dédaignait le plus important !... Si Monsieur craint d’oublier, il n’a qu’à penser : des tournedos... le dos tourné... ce qui se passe le dos tourné... des tournedos, quoi !
Cette fois, Savitri crut comprendre.
– J’en mangerai, mon ami, j’en mangerai, soyez-en certain. Au surplus, j’adore le bœuf à toutes les sauces : je suis d’une gourmandise notoire et je n’ai jamais raté l’occasion de faire un bon dîner !
– Alors, ce soir, à l’auberge de la Blanquette... c’est vraiment une très bonne idée que Monsieur a là, de dîner dans cet hôtel et d’exiger des tournedos. Dieu, la bonne idée ! Dame Lucas va se mettre en quatre pour Monsieur.
Abasourdi, Savitri regardait Léonard, qui riait silencieusement. Et il sentait monter en lui une irritante inquiétude.
Le colosse lui faisait peur, tout à coup.
Quelle était cette auberge où il venait de promettre d’aller à la nuit tombante ? Quel traquenard pouvait y être dressé contre lui ?
Sous les paroles du domestique, il avait cru deviner une promesse d’apprendre quelque chose mais n’y avait-il pas, sous l’ironie du rire, une menace déguisée ?
Pourtant, Savitri se ressaisit bientôt.
Sa perspicacité mise en éveil saurait reconnaître d’avance le danger, s’il y en avait sous roche. Dans sa poche de pantalon, il portait un revolver toujours chargé. Enfin, il se sentait fort, subitement, excité par la tâche romanesque qu’il se proposait, en défendant Myette, l’orpheline tragique, contre la puissante châtelaine qui la séquestrait.
Cette pensée était un merveilleux viatique. Elle le soutiendrait le soir s’il en était besoin. Maintenant, il n’hésitait plus. L’attitude du domestique était bizarre, celle de la châtelaine trop naturelle ! Quel que fût le but véritable que l’on cherchât, en l’attirant à l’hôtel de la Blanquette, il irait sans hésitation, car il était certain d’y trouver des indices pour étayer sa foi.
IV
La nuit n’était pas encore venue quand Savitri pénétra dans la salle du café.
C’était une pièce longue, un peu basse de plafond, aux murs blanchis à la chaux.
Des tables de bois blanc s’alignaient le long des murs, des tabourets de paille se rangeaient sous les tables.
Deux paysans, lourdement attablés dans un coin, achevaient de vider une canette de bière.
Savitri traversa toute la pièce assombrie par le crépuscule et gagna une salle voisine brillamment éclairée, par opposition à celle qu’il quittait.
Un panier sur ses genoux, auprès d’une longue table encombrée d’ustensiles de cuisine, une femme y écossait des petits pois.
– Madame Lucas ? interrogea-t-il.
– C’est moi, monsieur.
– Je viens pour dîner... je compte prendre le train de sept heures ; vous sera-t-il possible de me préparer un repas d’ici là ?
– Hum ! C’est un peu court ! fit la femme, après avoir consulté d’un coup d’œil une horloge à balancier, dressée contre le mur.
– Léonard, un domestique du château, m’avait fait espérer que je pourrais manger chez vous.
– Ah ! c’est maître Léonard...
– Oui... Et il m’avait parlé, même, de certain tournedos que vous préparez, paraît-il, à merveille.
– Un tournedos ! un tournedos !...