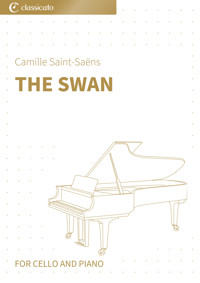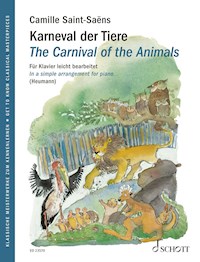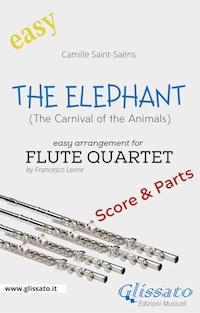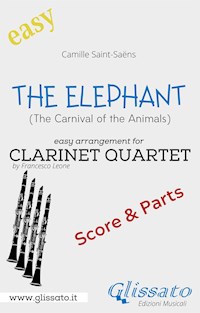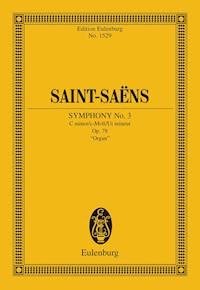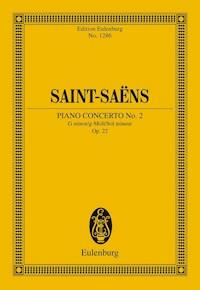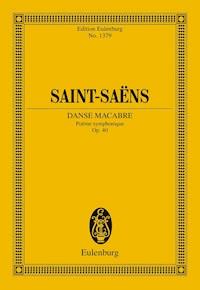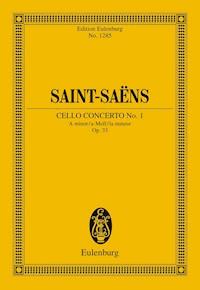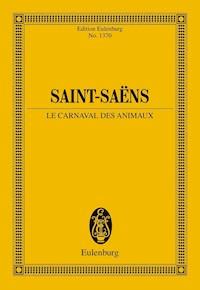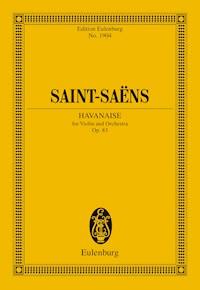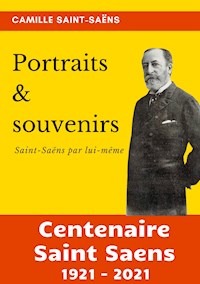
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: mémoires et écrits de compositeurs
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : Dans "Portraits et souvenirs", Camille Saint-Saëns nous ouvre une fenêtre sur son monde intérieur, révélant des anecdotes personnelles et des réflexions sur son époque. Ce recueil d'écrits, publié à l'occasion du centenaire de sa mort, offre un aperçu unique de l'esprit d'un compositeur dont l'influence s'étend bien au-delà de la musique. Saint-Saëns, connu pour ses contributions à la musique classique, partage ici des souvenirs qui vont des rencontres avec d'autres figures artistiques de son temps à des observations sur les évolutions culturelles et sociales. Le lecteur est invité à découvrir une facette plus intime de l'homme derrière les compositions, un homme curieux, érudit et souvent en avance sur son temps. Le texte, riche en détails historiques et personnels, est une invitation à explorer les pensées et les expériences qui ont façonné l'oeuvre d'un des plus grands compositeurs français. À travers ces pages, Saint-Saëns se dévoile non seulement comme un musicien, mais aussi comme un témoin de son siècle, offrant des réflexions qui résonnent encore aujourd'hui. L'AUTEUR : Camille Saint-Saëns est un compositeur et pianiste français né en 1835 à Paris. Enfant prodige, il commence à composer dès l'âge de trois ans et donne son premier concert à l'âge de dix ans. Il étudie au Conservatoire de Paris, où il se distingue rapidement par son talent exceptionnel. Au fil de sa carrière, Saint-Saëns compose de nombreuses oeuvres, allant de la musique symphonique à l'opéra, en passant par la musique de chambre. Parmi ses oeuvres les plus célèbres figurent "Le Carnaval des animaux", "Samson et Dalila" et "La Danse macabre". En plus de sa carrière musicale, Saint-Saëns est un intellectuel passionné, s'intéressant à l'astronomie, à l'archéologie et à la littérature. Il est également un fervent défenseur de la musique française et joue un rôle clé dans la fondation de la Société nationale de musique. Sa vie est marquée par une curiosité insatiable et une volonté de repousser les limites artistiques de son temps. Saint-Saëns s'éteint en 1921 à Alger, laissant derrière lui un héritage musical qui continue d'inspirer les générations.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
AVANT-PROPOS
PORTRAITS
HECTOR BERLIOZ
FRANZ LISZT
CHARLES GOUNOD
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
VICTOR MASSÉ
ANTOINE RUBINSTEIN
SOUVENIRS
UNE TRAVERSÉE EN BRETAGNE
UN ENGAGEMENT D'ARTISTE
GEORGES BIZET
LOUIS GALLET
DOCTEUR A CAMBRIDGE
Chaptire I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
ORPHÉE
DON GIOVANNI
VARIÉTÉS
LA DÉFENSE DE L'OPÉRA-COMIQUE
DRAME LYRIQUE ET DRAME MUSICAL
LE THÉÂTRE AU CONCERT
L'ILLUSION WAGNÉRIENNE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
LE MOUVEMENT MUSICAL
LETTRE DE LAS PALMAS
AVANT-PROPOS
On dirait qu'il s'est écoulé un siècle depuis le temps où j'écrivais Harmonie et Mélodie, «Harmonie,» alors, signifiait science; «Mélodie,» inspiration. La situation s'est retournée; les amateurs qui refusaient de tenter le moindre effort pour comprendre la musique se sont pris de passion pour l'obscur et l'incompréhensible; «quand je comprends,» disent les purs, «c'est que cela est mauvais; quand je ne comprends pas, c'est que cela est bon». Ils sont irrités ou dédaigneux si les instruments de l'orchestre ne courent pas de tous côtés comme des rats empoisonnés; un accompagnement simple et naturel leur fait hausser les épaules.
La Mélodie, naguère objet d'une redoutable idolâtrie, est vilipendée; un simple chant, accompagné naturellement, semble méprisable, et dans les compositions dépourvues de cet élément, on prétend que la mélodie est «partout». Quelle plaisanterie! Nous connaissions cela, à l'école, quand on nous apprenait à écrire des fugues où les diverses parties doivent être chantantes et vivre d'une vie propre, tout en concourant à l'ensemble; c'est ce qui constitue le style horizontal en opposition avec le style vertical en accords plaqués. Ce n'est pas là de la mélodie.
Le gros public, heureusement, est resté naïf, et peu lui importent les systèmes, pourvu qu'on réussisse à l'intéresser.
On trouvera un peu de tout dans ce volume et beaucoup moins de polémique ici que dans Harmonie et Mélodie. Des anecdotes, des souvenirs sur quelques grands musiciens que j'ai connus, un peu de critique générale. Quant à de véritables mémoires, je n'en écrirai jamais.
PORTRAITS
HECTOR BERLIOZ
Un paradoxe fait homme, tel fut Berlioz.
S'il est une qualité qu'on ne peut refuser à ses œuvres, que ses adversaires les plus acharnés ne lui ont jamais contestée, c'est l'éclat, le coloris prodigieux de l'instrumentation. Quand on l'étudie en cherchant à se rendre compte des procédés de l'auteur, on marche d'étonnements en étonnements. Celui qui lit ses partitions sans les avoir entendues ne peut s'en faire aucune idée; les instruments paraissent disposés en dépit du sens commun; il semblerait, pour employer l'argot du métier, que cela ne dût pas sonner; et cela sonne merveilleusement. S'il y a peut-être, çà et là, des obscurités dans le style, il n'y en a pas dans l'orchestre; la lumière l'inonde et s'y joue comme dans les facettes d'un diamant.
En cela, Berlioz était guidé par un instinct mystérieux, et ses procédés échappent à l'analyse, par la raison qu'il n'en avait pas. Il l'avoue lui-même dans son Traité d'instrumentation, quand, après avoir décrit en détail tous les instruments, énuméré leurs ressources et leurs propriétés, il déclare que leur groupement est le secret du génie et qu'il est impossible de l'enseigner. Il allait trop loin; le monde est plein de musiciens qui sans le moindre génie, par des procédés sûrs et commodes, écrivent fort bien pour l'orchestre. Ce Traité d'instrumentation est lui-même une œuvre hautement paradoxale. Il débute par un avant-propos de quelques lignes, sans rapport avec le sujet, où l'auteur s'élève contre les musiciens qui abusent des modulations et ont du goût pour les dissonances, comme certains animaux en ont pour les plantes piquantes, les arbustes épineux (que dirait-il donc aujourd'hui!). Puis il aborde l'étude des instruments de l'orchestre et mêle aux vérités les plus solides, aux conseils les plus précieux, des assertions étranges, celle-ci entre autres: «La clarinette, dit-il, est peu propre à l'idylle.» Il ne voulait voir en elle qu'une voix propre à l'expression des sentiments héroïques. Mais la clarinette, très héroïque en effet, est aussi très bucolique; il n'y a qu'à se rappeler le parti qu'en a tiré Beethoven dans la Symphonie pastorale, pour en être convaincu. Le joli début agreste du Prophète, qui n'était pas encore né quand Berlioz écrivit son traité, est encore venu lui donner un démenti.
Les grandes œuvres de Berlioz, à l'époque où parut l'ouvrage dont nous parlons, étaient pour la plupart inédites; on ne les exécutait nulle part. Ne s'avisa-t-il pas de citer comme exemples, pour ainsi dire à chaque page, des fragments de ces mêmes œuvres! Que pouvaient-ils apprendre à des élèves qui n'avaient jamais l'occasion de les entendre?
Eh bien! il en est de ce traité de Berlioz comme de son instrumentation: avec toutes ces bizarreries, il est merveilleux. C'est grâce à lui que toute ma génération s'est formée, et j'ose dire qu'elle a été bien formée. Il avait cette qualité inestimable d'enflammer l'imagination, de faire aimer l'art qu'il enseignait. Ce qu'il ne vous apprenait pas, il vous donnait la soif de l'apprendre, et l'on ne sait bien que ce qu'on a appris soi-même. Ces citations, en apparence inutiles, faisaient rêver; c'était une porte ouverte sur un monde nouveau, la vue lointaine et captivante de l'avenir, de la terre promise. Une nomenclature plus exacte, avec des exemples sagement choisis, mais sèche et sans vie, eût-elle produit de meilleurs résultats? Je ne le crois pas. On n'apprend pas l'art comme les mathématiques.
Le paradoxe et le génie éclatent à la fois dans Roméo et Juliette. Le plan est inouï; jamais rien de semblable n'avait été imaginé. Le prologue (retranché malheureusement trop souvent) et la dernière partie sont lyriques; celle-ci même est dramatique, traitée en forme de finale d'opéra; le reste est symphonique, avec de rares apparitions chorales reliant par un fil ténu la première partie à la dernière et donnant de l'unité à l'ensemble. Ni lyrique, ni dramatique, ni symphonique, un peu de tout cela: construction hétéroclite où la symphonie prédomine, tel est l'ouvrage. A un pareil défi au sens commun il ne pouvait y avoir qu'une excuse: faire un chef-d'œuvre, et Berlioz n'y a pas manqué. Tout y est neuf, personnel, de cette originalité profonde qui décourage l'imitation. Le fameux Scherzo, «la Reine Mab», vaut encore mieux que sa réputation; c'est le miracle du fantastique léger et gracieux. Auprès de telles délicatesses, de telles transparences, les finesses de Mendelssohn dans le Songe d'une nuit d'été semblent épaisses. Cela tient à ce que l'insaisissable, l'impalpable ne sont pas seulement dans la sonorité, mais dans le style. Sous ce rapport, je ne vois que le chœur des génies d'Obéron qui puisse soutenir la comparaison.
Roméo et Juliette me semble être l'œuvre la plus caractéristique de Berlioz, celle qui a le plus de droits à la faveur du public. Jusqu'ici, le succès populaire, non seulement en France, mais dans le monde entier, est allé à la Damnation de Faust; et il ne faut pas désespérer néanmoins de voir un jour Roméo et Juliette prendre la place victorieuse qui lui est due.
L'esprit paradoxal se retrouve dans le critique. Berlioz a été, sans conteste possible, le premier critique musical de son époque, en dépit de la singularité parfois inexplicable de ses jugements; et pourtant la base même de la critique, l'érudition, la connaissance de l'histoire de l'art lui manquait. Bien des gens prétendent qu'en art il ne faut pas raisonner ses impression. C'est très possible, mais alors il faut se borner à prendre son plaisir où on le trouve et renoncer à juger quoi que ce soit. Un critique doit procéder autrement, faire la part du fort et du faible, ne pas exiger de Raphaël la palette de Rembrandt, des anciens peintres qui peignaient à l'œuf et à la détrempe les effets de la peinture à l'huile. Berlioz ne faisait la part de rien, que de la satisfaction ou de l'ennui qu'il avait éprouvé dans l'audition d'un ouvrage. Le passé n'existait pas pour lui; il ne comprenait pas les Maîtres anciens qu'il n'avait pas pu connaître que par la lecture. S'il a tant admiré Gluck et Spontini, c'est que dans sa jeunesse il avait vu représenter leurs œuvres à l'Opéra, interprétées par Mme Branchu, la dernière qui en ait conservé les traditions. Il disait pis que prendre de Lully, de la Servante maîtresse de Pergolèse: «Voir reprendre cet ouvrage, a-t-il dit ironiquement, assister à sa première représentation, serait un plaisir digne de l'Olympe!».
J'ai toujours présents à la mémoire son étonnement et son ravissement à l'audition d'un chœur de Sébastien Bach, que je lui fis connaître un jour; il n'en revenait pas que le grand Sébastien eût écrit des choses pareilles; et il m'avoua qu'il l'avait toujours pris pour une sorte de colossal fort-en-thème, fabricant de fugues très savantes, mais dénué de charme et de poésie. A vrai dire, il ne le connaissait pas.
Et cependant, malgré tout cela et bien d'autres choses encore, il a été un critique de premier ordre, parce qu'il a montré ce phénomène unique au monde d'un homme de génie, à l'esprit délicat et pénétrant, aux sens extraordinairement raffinés, racontant sincèrement des impressions qui n'étaient altérées par aucune préoccupation extérieure. Les pages qu'il a écrites sur les symphonies de Beethoven, sur les opéras de Gluck, sont incomparables; il faut toujours y revenir quand on veut rafraîchir son imagination, épurer son goût, se laver de toute cette poussière que l'ordinaire de la vie et de la musique met sur nos âmes d'artistes, qui ont tant à souffrir dans ce monde.
On lui a reproché sa causticité. Ce n'était pas chez lui méchanceté, mais plutôt une sorte de gaminerie, une verve comique intarissable qu'il portait dans la conversation et ne pouvait maîtriser. Je ne vois guère que Duprez sur qui cette verve se soit exercée avec quelque persistance dans des articles facétieux; et franchement le grand ténor avait bien mérité d'être un peu criblé de flèches. N'a-t-il pas narré lui-même, dans ses Mémoires, comment il avait étranglé Benvenuto Cellini, et l'auteur pouvait-il lui en être bien reconnaissant? Peut-être eût-il mieux soutenu l'ouvrage, si Berlioz eut employé pour l'y engager les arguments sonnant dont se servit Meyerbeer pour l'encourager à prolonger les représentations des Huguenots, comme le grand chanteur le raconte aussi dans le même livre, avec une inconscience et une candeur qui désarmeraient des tigres. On pourrait penser, d'après cela, que les Huguenots ne voguaient pas alors à pleines voiles et n'étaient pas portés par un courant, comme de nos jours. Le public s'étonne parfois que les œuvres modernes s'installent si difficilement au répertoire de notre Opéra: cela tient peut-être à ce que tous les compositeurs n'ont pas cent mille livres de rente. J'ai dit peut-être, je n'affirme rien.
Berlioz a été malheureux par suite de son ingéniosité à se faire souffrir lui-même, à chercher l'impossible et à le vouloir malgré tout. Il avait cette idée très fausse, et malheureusement, grâce à lui, très répandue dans le monde, que la volonté du compositeur ne doit pas compter avec les obstacles matériels. Il voulait ignorer qu'il n'en est pas du musicien comme du peintre, lequel triture sur la toile, à son gré, des matières inertes, et que le musicien doit tenir compte de la fatigue des exécutants, de leur habileté plus ou moins grande; et il demandait, dans sa jeunesse, à des orchestres bien inférieurs à ceux d'aujourd'hui, des efforts véritablement surhumains. S'il y a, dans toute musique neuve et originale, des difficultés impossibles à éviter, il en est d'autres qu'on peut épargner aux exécutants, sans dommage pour l'œuvre; mais Berlioz n'entrait pas dans ces détails. Je lui ai vu faire vingt, trente répétitions pour une seule œuvre, s'arrachant les cheveux, brisant les bâtons et les pupitres, sans obtenir le résultat désiré. Les pauvres musiciens faisaient pourtant ce qu'ils pouvaient; mais la tâche était au-dessus de leurs forces. Il a fallu qu'avec le temps nos orchestres devinssent plus habiles pour que cette musique arrivât enfin à l'oreille du public.
Deux choses avaient affligé sérieusement Berlioz: l'hostilité de l'Opéra, préférant aux Troyens le Roméo de Bellini, qui tomba à plat; la froideur de la Société des concerts à son égard. On en connaît la cause, depuis la publication du livre de Deldevez sur l'histoire de la Société; c'est à l'influence de ses chefs qu'elle était due. Influence légitime d'ailleurs pour Deldevez, musicien sérieux et érudit, ayant tous les droits à une grande autorité. Peut-être ne comprenait-il bien que la musique classique, la seule qu'il eût profondément étudiée; peut-être son antipathie pour la musique de Berlioz était-elle purement instinctive.
C'était bien pis encore avec son prédécesseur Girard, musicien très inférieur à Deldevez, chef d'orchestre dont la direction beaucoup trop vantée avait introduit dans les exécutions une foule de mauvaises habitudes, dont la direction suivante les a heureusement débarrassées. Une petite anecdote fera juger de la nature de son esprit, de la largeur de ses vues. Il me mande, un jour, qu'il désirait mettre au programme une de mes œuvres, et me fait prier d'aller le voir. J'accours, et j'apprends, dès les premiers mots, qu'il a changé d'idée; à cela je n'avais rien à objecter, étant alors un jeune blanc-bec sans importance. Girard profita de la circonstance pour me faire un cours de morale musicale et pour me dire, entre autres choses, qu'il ne fallait pas employer les trombones dans une symphonie: «Mais, lui répondis-je timidement, il me semble que Beethoven, dans la Symphonie pastorale, dans la Symphonie en Ut mineur.....—Oui, me dit-il, c'est vrai; mais il aurait peut-être mieux fait de ne pas le faire.» On comprend, avec de tels principes, ce qu'il devait penser de la Symphonie fantastique.
On sait que cet esprit rétrograde a tout à fait disparue de la rue Bergère, où Berlioz est maintenant en grand honneur, et que l'illustre Société a sur entrer dans le courant moderne sans rien perdre de ses rares qualités.
La faveur du public commençait à venir à Berlioz dans les dernières années de sa vie, et l'Enfance du Christ, par sa simplicité et sa suavité, avait combattu victorieusement le préjugé qui ne voulait voir en lui qu'un faiseur de bruit, un organisateur de charivaris. Il n'est pas mort, comme on l'a dit, de l'injustice des hommes, mais d'une gastralgie causée par son obstination à ne suivre en rien les conseils des médecins, les règles d'une hygiène bien entendue. Je vis cela clairement, sans pouvoir y remédier, dans un voyage artistique que j'eus l'honneur de faire avec lui. «Il m'arrive une chose extraordinaire, me dit-il un matin: Je ne souffre pas!» Et il me conte ses douleurs, des crampes d'estomac continuelles, et la défense qui lui est faire de prendre aucun excitant, de s'écarter d'un régime prescrit, sous peine de souffrances atroces qui iraient toujours en s'aggravant. Or il ne suivait aucune régime et prenait tout ce qui lui plaisait, sans s'inquiéter du lendemain. Le soir de ce jour, nous assistions à un banquer. Placé près de lui, je fis tout mon possible pour m'opposer au café, au champagne, aux cigares de la Havane, ce fut en vain, et le lendemain le pauvre grand homme se tordait dans ses souffrances accoutumées.
En outre de ma complète admiration, j'avais pour lui une vive affection née de la bienveillance qu'il m'avait montrée et dont j'étais fier à juste titre, ainsi que des qualités privées que je lui avais découvertes, en opposition si parfaite avec la réputation qu'il avait dans le monde, où il passait pour orgueilleux, haineux et méchant. Il était bon, au contraire, bon jusqu'à la faiblesse, reconnaissant des moindres marques d'intérêt qu'on lui témoignait, et d'une simplicité admirable qui donnait encore plus de prix à son esprit mordant et à ses saillies, parce qu'on n'y sentait jamais cette recherche de l'effet, se désir d'éblouir les gens qui gâte souvent tant de bonnes choses.
On sera sans doute étonné d'apprendre d'où était venue, à l'origine, la réputation de méchanceté de Berlioz. On l'a poursuivi, dans un certain monde, d'une haine implacable, à cause d'un article sur Hérold, non signé, dont la paternité lui avait été attribuée.
Or, voici comment se terminait le feuilleton du Journal des Débats, le 15 mars 1869, au lendemain de la mort de Berlioz:
«.....Il faut pourtant que je vous dise..... que c'est à tort si certains critiques ont reproché à Berlioz d'avoir mal parlé d'Hérold et duPré aux Clercs. Ce n'est pas Berlioz, c'est un autre, un jeune homme ignorant et qui ne doutait de rien en ce temps-là, qui, dans un feuilleton misérable, a maltraité le chef-d'œuvre d'Hérold. Il s'en repentira toute sa vie. Or cet ignorant s'appelait (j'en ai honte!), il faut bien en convenir..... monsieur
Jules JANIN.»
Ainsi, Janin, qui vivait pour ainsi dire côte à côte avec Berlioz, car ils écrivaient chaque semaine dans le même journal, a attendu qu'il fût mort pour le disculper d'un méfait qui a pesé sur toute sa vie, et dont lui, Janin, était l'auteur! Que dites-vous du procédé? N'est-cepas charmant, et Janin ne méritait-il pas sa réputation d'excellent homme? Que voulez-vous? Janin était gras et Berlioz était maigre; il n'en fallait pas davantage pour que le premier passât pour de bon et le second pour méchant. A quel sentiment le célèbre critique a-t-il obéi en publiant cette révélation tardive? A un remord de conscience? à un besoin d'étaler son crime au grand jour, pour en mieux jouir?...
On a reproché à Berlioz son peu d'amour pour les hommes, avoué par lui-même dans ses Mémoires; il est en cela de la famille d'Horace qui a dit: Odi profanum vulgus; de La Fontaine qui a écrit:
«Que j'ai toujours haï les pensers du vulgaire!»
Avec sa nature supérieure, il ne pouvait aimer la vulgarité, la grossièreté, la férocité, l'égoïsme qui jouent un rôle si considérable dans le monde et dont il avait été si souvent victime. On doit aimer l'humanité dont on fait partie, travailler si l'on peut à son amélioration, aider au progrès; c'est ce que Berlioz, dans sa sphère d'activité, a fait autant que personne en ouvrant à l'art des voies nouvelles, en prêchant toute sa vie l'amour du beau et le culte des chefs-d'œuvre. On n'a rien de plus à lui demander; le reste n'est pas le fait d'un artiste, mais d'un saint.
FRANZ LISZT
On ne saurait croire avec quel éclat, quel prestige magique apparaissait aux jeunes musiciens des premiers temps de l'époque impériale ce nom de Liszt, étrange pour nous autres Français, aigu et sifflant comme une lame d'épée qui fouette l'air, traversé par sonz slave comme par le sillon de la foudre. L'artiste et l'homme semblaient appartenir au monde de la légende. Après avoir incarné sur le piano le panache du romantisme, laissé derrière lui la traînée étincelante d'un météore, Liszt avait disparu derrière le rideau de nuages qui cachait alors l'Allemagne, si différente de celle de nos jours, cette Allemagne composée d'un agglomérat de petits royaumes et duchés autonomes, hérissée de châteaux crénelés et conservant jusque dans son écriture gothique l'aspect du moyen âge pour toujours disparu de chez nous, malgré les efforts de restauration des poètes. La plupart des morceaux qu'il avait publiés semblaient inexécutables pour tout autre que lui et l'étaient en effet avec les procédés de la méthode ancienne prescrivant l'immobilité, les coudes au corps, une action limitée aux doigts et à l'avant-bras. On savait qu'à la cour de Weimar, dédaigneux de ses succès antérieurs, il s'occupait à des œuvres de haute composition, rêvant une rénovation de l'art sur laquelle couraient les bruits les plus inquiétants, comme sur tout ce qui marque l'intention d'explorer un monde nouveau, de rompre avec les traditions reçues. D'ailleurs, rien que dans les souvenirs laissés par Liszt à Paris, on trouvait ample matière aux suggestions de toute sorte. Le vrai, quand il s'agissait de lui, n'était plus vraisemblable. On racontait qu'un jour au concert du Conservatoire, après une exécution de la Symphonie pastorale, il avait osé, lui seul, la rejouer après le célèbre orchestre, à la stupéfaction de l'auditoire, stupéfaction bientôt remplacée par un immense enthousiasme; qu'un autre jour, lassé de la docilité du public, fatigué de voir ce lion, toujours prêt à dévorer qui l'affronte, lui lécher les pieds, il avait voulu l'irriter et s'était donné le luxe d'arriver en retard pour un concert aux Italiens, de visiter dans leur loge les belles dames de sa connaissance, causant et riant avec elles, jusqu'à ce que le lion se mît à gronder et à rugir; et lui s'étant assis enfin au piano devant le lion furieux, toute fureur s'était calmée, et l'on n'avait plus rien entendu que des rugissements de plaisir et d'amour.
On en racontait bien d'autres, qui n'entreraient pas dans le cadre de cette étude. On n'a que trop parlé, à propos de Liszt, de ses succès féminins, de son goût pour les princesses, de tout le côté en quelque sorte extérieur de sa personnalité; il est bien temps de s'occuper plus spécialement de son côté sérieux et du rôle considérable que Liszt a joué dans l'art contemporain.
L'influence de Liszt sur les destinées du piano a été immense; je ne vois à lui comparer que la révolution opérée par Victor Hugo dans le mécanisme de la Langue française. Elle est plus puissante que celle de Paganini dans le monde du violon, parce que ce dernier est resté confiné dans la région de l'inaccessible où lui seul pouvait vivre, tandis que Liszt, parti du même point, a daigné descendre dans les chemins praticables où peut le suivre quiconque veut prendre la peine de travailler sérieusement. Reproduire son jeu sur le piano serait impossible; comme l'a dit dans son livre étrange l'étonnante Olga Janina, ses doigts n'étaient pas des doigts humains; mais rien n'est plus facile que de marcher dans la voie qu'il a tracée, et, de fait, tout le monde y marche, qu'on en ait conscience ou non. Le grand développement de la sonorité et les moyens employés pour l'obtenir, qu'il a inventés, sont devenus une condition indispensable et la base même de l'exécution moderne. Ces moyens sont de deux sortes: les uns ayant trait aux procédés matériels de l'exécutant, à une gymnastique spéciale; les autres, à la façon d'écrire pour le piano que Liszt a complètement transformée. A l'encontre de Beethoven méprisant les fatalités de la physiologie et imposant aux doigts contrariés et surmenés sa volonté tyrannique, Liszt les prend et les exerce dans leur nature de manière à en obtenir, sans les violenter, le maximum d'effet qu'ils sont susceptibles de produire; aussi sa musique, si effrayante à première vue pour les timides, est-elle en réalité moins difficile qu'elle ne paraît, amenant par le travail un véritable entraînement de l'organisme et le rapide développement du talent. On lui doit encore l'invention de l'écriture musicale pittoresque, grâce à laquelle, par des dispositions ingénieuses et infiniment variées, l'auteur parvient à indiquer le caractère d'un passage et la façon même dont on doit s'y prendre pour l'exécuter; ces élégants procédés sont aujourd'hui d'un emploi usuel et général.
On lui doit surtout l'introduction aussi complète que possible, dans le domaine du piano, des sonorités et combinaisons orchestrales; son procédé pour atteindre ce but,—procédé qui n'est pas à la portée de tout le monde,—consiste à substituer, dans la transcription, la traduction libre à la traduction littérale. Ainsi comprise et pratiquée, la transcription devient hautement artistique; l'adaptation au piano, par Liszt, des Symphonies de Beethoven— par-dessus tout l'adaptation, pour deux pianos, de la neuvième— peut être regardée comme le chef-d'œuvre du genre. Pour être juste et rendre à chacun ce qui lui appartient, il faut reconnaître que la traduction pour piano des Neuf Symphonies avait été antérieurement tentée par Kalkbrenner, à qui elle fait un grand honneur, mais dont elle dépassait les forces; ce premier essait a très probablement donné naissance au travail colossal de Liszt.
Incarnation incontestée du piano moderne, Liszt a vu, à cause de cela, jeter le discrédit sur sa musique, dédaigneusement traitée de «musique de pianiste». La même injurieuse qualification pourrait être appliquée à l'œuvre de Robert Schumann, dont le piano est l'âme; s'il n'a pas été qualifié ainsi, c'est que Schumann,—bien malgré lui,—n'a jamais été un brillant exécutant; c'est qu'il n'a jamais déserté les hauteurs de l'art «respectable» pour s'amuser à des illustrations pittoresques sur les opéras de tous les pays, alors que Liszt, sans souci du qu'en-dira-t-on, semait à l'aventure, en prodigue, les perles et les diamants de sa débordante imagination. Il y a bien du pédantisme et du préjugé, soit dit en passant, dans le mépris qu'on affecte souvent pour des œuvres telles que la «Fantaisie sur Don Juan» ou le «Caprice sur la Valse de Faust»; car il y a là plus de talent et de véritable inspiration que dans beaucoup de productions d'apparence sérieuse et prétentieuse nullité, comme on en voit paraître tous les jours. A-t-on réfléchi que la plupart des ouvertures célèbres, par exemple celles de Zampa, d'Euryanthe, de Tannhäuser, ne sont au fond que des fantaisies sur les motifs des opéras qu'elles précèdent? Si l'on prend la peine d'étudier les Fantaisies de Liszt, on verra à quel point elles diffèrent d'un potpourri quelconque, des morceaux où les motifs d'opéra pris au hasard ne sont là que pour servir de canevas à des arabesques, festons et astragales; on verra comment l'auteur a sur, de n'importe quel os, tirer la moelle, comment son esprit pénétrant a découvert pour le féconder, parmi les vulgarités et les platitudes, le germe artistique le plus caché; comment, s'il s'attaque à une œuvre supérieure, comme Don Juan, il en éclaire les beautés principales et en donne un commentaire qui aide à les comprendre, à en apprécier pleinement la perfection suprême et l'immortelle modernité. Quand à l'ingéniosité de ses combinaisons pianistiques, elle est prodigieuse et l'admiration de tous ceux qui cultivent le piano lui est acquise; mais on n'a peut-être pas assez remarqué, à mon sens, que dans le moindre de ses arrangements la main du compositeur se fait sentir; le «bout de l'oreille» du grand musicien y apparaît toujours, ne fûtce qu'un moment.
Pour un tel pianiste, évoquant par le piano l'âme de la musique, la qualification de «pianiste» cesse d'être une injure, et «musique de pianiste» devient synonyme de «musique de musicien». Qui donc, d'ailleurs, à notre époque, n'a pas subi la puissante influence du piano? Cette influence a commencé avant le piano lui-même, avec le «Clavecin bien tempéré» de Sébastien Bach. Du jour où le tempérament de l'accord eut amené la synonymie des dièses et des bémols et permis de pratiquer toutes les tonalités, l'esprit du clavier entra dans le monde (l'invention du mécanisme à marteaux, secondaire au point de vue de l'art, n'ayant produit que le développement progressif d'une sonorité inconnue au clavecin et d'immenses ressources matérielles); cet esprit est devenu le tyran dévastateur de la musique par la propagation sans limites de l'hérétique en harmonie. De cette hérésie est sorti presque tout l'art moderne: elle a été trop féconde pour qu'il soit permis de la déplorer; mais ce n'en est pas moins une hérésie destinée à disparaître en un jour probablement fort éloigné, mais fatal, par suite de l'évolution même qui lui a donné naissance. Que restera-t-il alors de l'art actuel? Peut-être le seul Berlioz, qui n'ayant pas pratiqué le piano avait un éloignement instinctif pour l'enharmonie; il est en cela l'antipode de Richard Wagner, l'enharmonie faite homme, celui qui a tiré de ce principe les plus extrêmes conséquences. Les critiques, et, à leur suite, le public, n'en mettent pas moins les têtes de Wagner et de Berlioz dans le même bonnet; cette promiscuité forcée sera l'étonnement des âges futurs.
Sans vouloir s'arrêter trop longtemps aux Fantaisies que Liszt a écrites sur des motifs d'opéras (il y en a toute une bibliothèque), il convient de ne pas passer indifférent devant ses «Illustrations du Prophète», que domine une cime aussi éblouissante qu'inattendue, la «Fantaisie et Fugue pour orgue», sur le choral Ad nos, ad salutarem undam, transition entre les arrangements plus ou moins libres de l'auteur et ses œuvres originales. Cette composition gigantesque, dont l'exécution ne dure pas moins de quarante minutes, a cette originalité que le thème sur lequel elle est construite n'y apparaît pas une seule fois dans son intégrité; il y circule d'une façon latente, comme la sève dans l'arbre. L'orgue est traité d'une façon inusitée qui augmente singulièrement ses ressources, et l'auteur semble avoir prévu par intuition les récents perfectionnements de l'instrument, comme Mozart dans sa Fantaisie et Sonate en Ut mineur avait deviné le piano moderne. Un orgue colossal, d'un maniement facile, un exécutant rompu à la fois au mécanisme de l'orgue et du piano, sont indispensable à l'exécution de cette œuvre; ce qui revient à dire que les occasions de l'entendre dans de bonnes conditions sont assez rares.
Les Soirées de Vienne les Rapsodies Hongroises, bien que formées de motifs empruntés, sont de véritables créations où se manifeste le talent le plus raffiné; les Rapsodies peuvent être considérées comme les illustrations du livre si curieux écrit par Liszt sur la musique des Bohémiens. C'est bien à tort qu'on y verrait seulement des morceaux brillants; il y a là toute une reconstitution et, si l'on peut dire, une «civilisation» de la musique d'un peuple, du plus haut intérêt artistique. L'auteur n'y a pas visé la difficulté, qui n'existait pas pour lui, mais l'effet pittoresque et la reproduction imagée du bizarre orchestre des Tziganes. Dans ses œuvres pour piano, d'ailleurs, la virtuosité n'est jamais un but, mais un moyen. Faute de se placer à ce point de vue, on prend sa musique au rebours du sens et on la rend méconnaissable.
Chose étrange! Si l'on met à part la magnifique Sonate, audacieuse et puissante, ce n'est pas dans ses œuvres originales pour le piano que ce grand artiste et ce grand pianiste a mis son génie. Schumann, Chopin le battent aisément sur ce terrain. Les Méditations religieuses, les Années de Pèlerinage