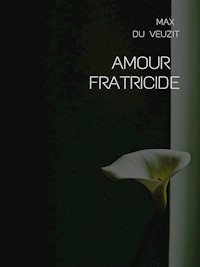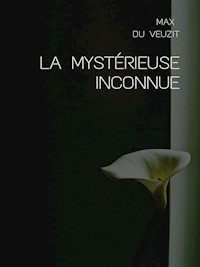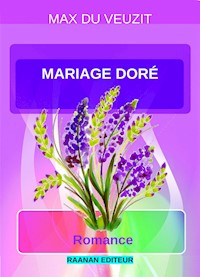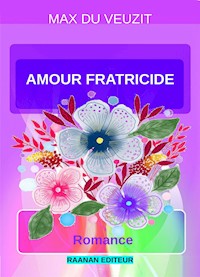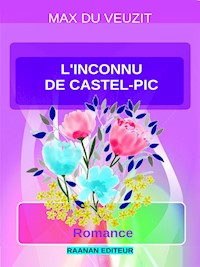1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosine Reynaert
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Aînée de cinq frères et soeurs, Christiane Chambreuil, après la mort de son père, doit subvenir aux besoins des siens ; elle accepte l'emploi de "maîtresse de maison" dans une famille écossaise. Elle signe les documents d'engagement sans même les lire et, à sa stupéfaction, apprend quelque temps après son arrivée à Uam-Var qu'elle est officiellement mariée à Edward Duncan, un des deux fils de Sir Archibald Duncan. Christiane proteste, tempête... C'est trop tard ! Un mariage par procuration est un mariage quand même. Et "maîtresse de maison" n'est-elle pas une expression ambiguë qui sous-entend "épouse" ? A peine est-elle remise de ce choc que se présente à elle, au château, en l'absence de leurs maîtres, une femme tenant à la main un tout jeune enfant. "Je vous amène le petit Christian. La vieille Gertrude est morte et sa famille ne sait que faire de votre enfant". Un singulier mariage en vérité...|Librairie Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Épilogue
MAX DU VEUZIT
UN SINGULIER MARIAGE
Paris, Tallandier, 1950
Raanan Éditeur
Livre 1041 | édition 1
Un singulier mariage
I
Par la haute fenêtre en ogive, étroite et austère, j’aperçois la grise étendue des Highlands, cette sorte de steppe dénudée et vallonnée, noyée en ce moment par une pluie persistante et fine. Je vois s’estomper, dans le lointain, perdues dans la brume, les courbes incertaines, battues par le vent, du glen désertique.
Est-ce bien moi qui suis là, devant ce paysage sans espoir ? Est-ce bien moi, Christiane Chambreuil, qui me trouve ici, dans cette chambre glaciale, en face de cette patrie du spleen et du brouillard, entourée de murs hostiles et de gens inconnus ?
Je suis obligée de me pincer pour réaliser pleinement la réalité de ce cauchemar, pour me persuader que je ne rêve pas, pour me convaincre que c’est bien de moi qu’il s’agit, que cette demeure s’appelle Uam-Var – la Grande Caverne – et que, si j’y suis, c’est de ma propre volonté, car personne ne m’a contrainte d’y venir, ni ne m’y a traînée de force.
Je m’arrache, pour quelques instants, à cette fenêtre et à ce panorama déprimant. Mes yeux tombent sur le large miroir qui se trouve en face du haut lit à baldaquin que je viens de quitter.
Il n’y a aucun doute, il s’agit bien de moi. Cette personne qui se reflète dans cette glace dont le tain a presque noirci, sous l’outrage des années, et qu’on voit mal dans l’incertitude de cette lumière fantomatique environnante, est bien Christiane Chambreuil. Aucun doute là-dessus ! Les traits sont légèrement déformés par la surface de la glace qui n’a pas l’air d’être tout à fait plate, mais c’est néanmoins de moi qu’il s’agit.
Et c’est bien en haute Écosse que je me trouve.
La chambre que j’occupe n’est pas, comme à Paris, à deux cents mètres de la place de la République ; cette contrée pluvieuse, où l’on n’aperçoit que les bruyères et les rocs, n’a rien du paysage séquanais. Le silence impénétrable qui m’entoure ne risque pas d’être interrompu, d’une minute à l’autre, par le rire frais de mes deux petites sœurs, Madeline et Rose-Marie, ou par les appels tendres et doux de ma mère chérie.
Adieu, Paris ! Adieu, Madeline ! Adieu, Rose-Marie ! Adieu, maman ! Adieu, Jacques !
Cette fois-ci, c’est vraiment sérieux. Il n’y a absolument pas moyen de revenir en arrière. Je ne sais pas si j’ai raison ; j’ignore si je n’ai pas commis la plus grande et la plus irréparable sottise de mon existence ! Mais il y a une chose certaine et sûre : à l’heure actuelle, la route que j’ai empruntée est définitive... je ne puis revenir en arrière !
Un long frisson me parcourt l’échine ; un tremblement irrépressible me secoue de la tête aux pieds... Je fais un effort, je détache mon regard de l’image que le miroir me renvoie et je me rapproche de la fenêtre de tout à l’heure pour contempler, une nouvelle fois, le panorama de la lande noyée de pluie qui s’estompe dans le brouillard.
Il est sept heures du matin. À regarder la lumière qui règne sur cette région désolée, il pourrait tout aussi bien être six heures du soir. On a l’impression d’être réellement aux confins du monde, et que jamais, au grand jamais, ni une fleur, ni une éclaircie, ni un rayon de soleil, ne viennent rompre la monotonie de ce désert brumeux, ni égayer la tristesse de ce pays perdu.
Toutes les lectures de ma jeunesse sur l’Écosse reviennent à ma mémoire. La grouse et la lande, les rivalités des clans et les chevaliers de sir Walter Scott, Ivanhoe et les fantômes des lochs, tout cet ensemble de légendes moyenâgeuses et de chants gaéliques d’Ossian m’entoure de présences invisibles, insinuantes, pesantes. Je n’arrive pas à me reprendre.
Mon regard se dirige encore une fois autour de ma chambre. Celle-ci tient plus du chœur monastique que de la chambre à coucher. Les hautes parois boisées, la cheminée immense, les meubles austères, le haut lit à baldaquin, tout cela, de dimensions énormes, donne une impression de grandeur et de froideur d’où toute intimité est bannie. Et dire qu’il va falloir vivre là dorénavant !
Christiane, il faut te secouer, que diable ! Pourquoi te laisser aller à tant de tristesse et à tant de découragement ? Pas de visions déprimantes, ma fille. Il ne faut pas permettre à cette ambiance délétère de déteindre sur toi.
Il s’agit de réagir, de considérer la situation bien en face et de ne pas se laisser aller au désespoir. Cessons de nous promener de long en large, asseyons-nous ici, tranquillement, en cherchant à mettre un peu d’ordre dans ce tournoiement de sensations et dans ce chassé-croisé de cauchemars qui me hantent. Tâchons, une fois pour toutes, d’y voir clair.
Faisons, comme me le suggérait le Père Guérand, mon bon ami et conseiller de toujours, faisons un examen de conscience.
Je suis Française, d’un naturel gai, sain, raisonnable. Je n’accepterai pas de perdre un seul instant aucune de ces qualités. Les moineaux parisiens sont connus pour ces deux caractéristiques qui les rendent légendaires par le monde entier : ils sont optimistes et débrouillards...
Admettons que je suis un moineau parisien en exil et agissons comme il le ferait !
――
Uam-Var, comme la plupart des autres résidences des hauts plateaux que j’ai aperçues jusqu’ici, est une grande maison qui tient à la fois du château fort et de la grosse ferme. Les bâtiments, accolés les uns aux autres, ont l’air de gros rochers frileux. Les fenêtres, étroites et minces, s’y ouvrent, petites et rares.
Les résidences de la haute Écosse ont manifestement été de tout temps les témoins de l’histoire de ce pays : la guerre et la pauvreté.
Il n’y a pas ici de pelouses fleuries comme dans le Sussex ; pas de grands arbres et si peu de buissons ! Les cours d’Uam-Var sont pavées de grosses dalles et cernées par des bâtiments de pierre presque noire. Cette teinte est la couleur immuable de tous les bâtiments que j’ai vus dans ce coin-ci.
Quand on ferme la grande porte cochère, le soir venu, on a l’impression qu’une porte de prison vient de se refermer sur soi.
Je souris, malgré moi, à la glace qui me renvoie mon image.
Bonté divine ! Je ne dois cependant pas être la première femme à vivre dans ce vieux manoir ! Il a dû y en avoir d’autres, qui sont nées, qui ont grandi, qui ont vécu, qui ont été heureuses ici. Ces femmes ont certainement été jeunes. Elles ont aimé le soleil, le sourire du printemps, la joie des êtres, et tout ce qui rend le cœur content...
N’ont-elles donc pas désiré voir des fleurs, puisqu’il n’y en a nulle part ?
Ou bien ces femmes n’ont-elles jamais été heureuses ?
Peut-être le bonheur ne les a-t-il jamais effleurées de son aile ?... Peut-être n’ont-elles jamais souri et ont-elles, toujours et inlassablement, été tristes ?
Mais une autre supposition se présente à moi.
Peut-être, dans ce coin sauvage et aride, était-il plus prudent, à travers les siècles écoulés, d’ériger des murs épais, de les barder de fer, de creuser des fossés, que de songer à perdre du terrain et du temps à cultiver des plantes dites d’agrément ?
J’ai vraiment du mal à admettre que c’est bien moi qui suis venue en Écosse, pays qui ne me semblait, sur la carte, après tout, pas si loin que cela, mais qui me paraît, maintenant, le bout du monde.
Je commence sérieusement à me demander si j’avais tout mon bon sens – ce solide bon sens qui fait la force principale du peuple français – le jour où j’ai accepté ce singulier marché... Car, il est vain de se le dissimuler : c’est bien d’un marché – pour tout dire, d’un étrange marché – qu’il s’agit.
Encore une fois, j’essaye de calmer mes appréhensions, de modérer les battements de mon cœur, de mettre un frein à la fantasmagorie d’idées et d’images qui a pris possession de mon cerveau... Il faut que je réfléchisse, que j’ordonne mes pensées et mes souvenirs.
Il faut que je me reprenne en main, comme nous le conseillait notre professeur de philosophie, chaque fois que quelque chose n’allait pas. Une analyse sévère – mais juste – des circonstances s’impose, si je ne veux pas perdre complètement le contrôle de moi-même et de mes réflexes.
Sinon, je sens que le regret va venir et que je vais sombrer dans le désespoir...
Posément, calmement, les yeux secs et l’esprit clair, il s’agit de revivre, sans passion, les événements.
II
C’est au Tonkin que je suis née, au confluent de deux fleuves.
Une vieille coutume hindoue affirme qu’il est indispensable d’ensevelir, à la confluence de deux fleuves, les héritiers de sang royal. Ma vieille nourrice annamite affirmait que l’âme d’un prince hindou était passée, par métempsycose, dans la mienne, grâce à la particularité de ma naissance, et que je finirais sûrement dans la peau d’une reine ou quelque chose d’approchant.
C’est une histoire qui, depuis, m’a toujours fait sourire ; mais il n’en reste pas moins que, pendant toute ma petite enfance, j’y ai cru vraiment. Cela peut expliquer beaucoup de choses...
Je suis née de parents français, naturellement. Mon père, qui devait devenir par la suite officier supérieur, était au moment où je suis venue au monde, simple lieutenant. Il fut envoyé successivement à Haïphong, Hanoï et Hué, pendant son séjour en Indochine ; puis, au hasard des garnisons, il connut successivement Madagascar, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, pour être, en définitive, affecté au ministère des Colonies, à Paris, où il revint avec toute sa famille.
C’est peut-être de cette enfance, menée aux quatre coins du monde, que j’ai gardé le goût des voyages et l’attrait de l’aventure. Et, cependant, rien pour moi n’est comparable à Paris.
Paris ! c’est là que j’ai fait mes études, que j’ai grandi, que je suis devenue une jeune fille, là où mon caractère s’est formé, où ma nature, franche et exubérante, a pu se sentir à l’aise.
Tous mes beaux souvenirs me parlent de Paris... Les plus cruels aussi... Et les uns comme les autres me sont tout aussi chers.
Il est vrai que la vie est faite du meilleur comme du pire et que les événements marquent leur empreinte sur notre âme, indépendamment du fait qu’ils sont favorables ou fâcheux.
Il n’est même pas certain que les événements heureux contribuent à nous rendre cher un certain endroit ou une certaine ville plus que les événements tristes.
Je crois même que c’est le contraire.
Je sens que, jusqu’à ma mort, je serai profondément, intimement liée à Paris, parce que c’est là que j’ai connu mes premières souffrances et que mon père a cessé de vivre, l’année dernière...
Pauvre papa... Il a montré une grande force d’âme dans les derniers mois de sa vie, mais sa mort a été vraiment affreuse. Il a succombé à un cancer qui lui avait ravagé une partie du visage... Certains médecins ont soutenu qu’il traînait ce mal depuis son séjour en Indochine ; d’autres, au contraire, affirmaient que, seules, les années de captivité étaient responsables.
Quoi qu’il en soit, aucun n’a réussi à le sauver.
Cher papa... Pourquoi est-il parti ? Pourquoi nous a-t-il laissés, sans guide, sans soutien, ma mère, mes quatre frères et sœurs et moi-même ? Sans le savoir, sans nous en rendre compte, nous vivions heureux et sans souci quand, de près ou de loin, il veillait sur nous. Tant qu’il était là, nous n’avons jamais su ce qu’étaient le besoin ni la gêne.
J’étais encore bien trop jeune pour mesurer les difficultés financières de cette terrible époque ; mais j’ai bien compris depuis que, par rapport à la plupart des gens, nous étions alors des privilégiés. C’est même, je crois, cette sécurité dans laquelle j’ai toujours vécu durant mon adolescence qui a engendré cette insouciance qui devait me jouer de si vilains tours par la suite.
Puis, papa revenu de captivité et la guerre enfin terminée, la vie avait repris son cours normal et semblait devoir s’écouler, limpide et heureuse, sans heurts et sans soubresauts.
Je préparais ma licence d’anglais, afin de réaliser mon rêve de traduire en français les belles œuvres anglo-saxonnes encore peu connues. Et mon père approuvait mon projet.
L’aîné de mes frères, Jacques, préparait son bachot dans l’espoir de se présenter à Saint-Cyr et d’embrasser la carrière militaire.
Maurice, qui a toujours eu une tournure d’esprit pratique, comptait entrer à l’École Centrale et devenir ingénieur.
Avec une précocité assez étonnante, Madeline, qui s’était toujours montrée très altruiste, avait choisi d’être assistante sociale.
Quant à Rose-Marie, notre benjamine, peut-être par contraste avec l’attitude très raisonnable du reste de la famille, elle déclarait, dans un bel éclat de rire, malgré ses douze ans, qu’elle voulait être artiste de cinéma, actrice ou écuyère de cirque.
Tout ce qui est brillant et extraordinaire l’attirait. Nous étions un peu sidérés par ces tendances assez insolites au sein d’une famille, en somme, éminemment conformiste ; mais il était sans doute nécessaire, dans l’intérêt même d’un équilibre bien compris, qu’un grain de folie et un soupçon d’anarchie vinssent, comme une sorte de levain, travailler la pâte de notre philosophie trop raisonnable.
Toutefois, au fond de nous-mêmes, nous sentions qu’avec les années Rose-Marie finirait par s’assagir et par changer d’idée.
Tous ces mirobolants projets se sont anéantis quelques mois après la mort de mon père.
Comment la débâcle est-elle venue ?... Comment tout ce qui faisait notre vie, nos espoirs, notre avenir, s’est effondré à la façon d’une digue s’écroulant sous la poussée des eaux, fracassant et broyant tout sur leur passage ?
Il est difficile d’expliquer un cataclysme qui bouleverse un foyer de six existences, sans qu’on ait su prévoir les mauvais coups du sort. L’orage qui s’est abattu sur la maison des Chambreuil ne laissait rien d’intact derrière lui.
Il en est ainsi, la plupart du temps, lorsqu’on est en pleine tourmente. Le manque de recul empêche de se rendre compte des dégâts. On se laisse porter par le cyclone.
On cite le cas d’un dirigeable pris dans un ouragan, ayant franchi trois cents kilomètres, pendant que ses occupants avaient l’illusion de l’immobilité.
L’aventure qui m’est arrivée est en tout point semblable ; ce n’est qu’en fin de course que je me suis aperçue du chemin parcouru et de l’abîme où nous dégringolions.
Maman était tombée malade après la mort de papa. Elle a toujours été assez fragile et son pauvre cœur n’a pu résister à l’atroce séparation... cette séparation qui, cette fois-ci, était, hélas ! définitive.
Mes parents avaient toujours formé un couple uni, sans une fêlure et sans un désaccord.
Après les funérailles, ma mère avait dû s’aliter.
C’est de la maladie de maman que tout le reste a découlé.
Les docteurs, appelés en hâte, ont été formels : il fallait absolument éviter à notre malade toute fatigue et tout souci.
Son état inspirant les plus vives inquiétudes, ce n’est qu’avec des soins attentifs et une attention extrême qu’on pouvait espérer la sauver.
Les médecins sont des gens extraordinaires. Lorsqu’ils décrètent : « Vous devriez aller trois mois à la montagne », ils ne se préoccupent nullement de savoir si vous avez seulement les moyens d’aller passer un week-end à Compiègne. Ils décident dans l’absolu, sans se soucier de vaines contingences. Pas de soucis comme si c’était au pouvoir de l’homme de n’en point avoir !
On devine combien pareil diagnostic alarma nos jeunes âmes, complètement désemparées déjà par la mort de papa. Il ne nous restait plus que notre mère. Que ce fût ou non possible, que ce fût ou non réalisable, il fallait à tout prix la sauver, se conformer aux ukases de la Faculté.
Toute notre bonne volonté, jointe à notre profonde affection, allait s’efforcer, par tous les moyens, de suivre à la lettre les prescriptions des spécialistes consultés à grand frais.
J’étais l’aînée. Dans les circonstances que nous traversions, c’était donc moi qui devenais pratiquement et j’espérais, provisoirement, le chef de famille.
Quoi qu’il en soit, il n’y avait pas lieu d’ergoter, il fallait bien en passer par là. C’était une de ces situations impératives devant lesquelles le destin vous place et à quoi il n’est pas possible de se dérober, que l’on soit ou non prêt à y faire.
La vie est autrement exigeante qu’un examen ou qu’un professeur. Il n’y a pas de repêchage. L’épreuve ratée en juillet ne peut se remettre en octobre.
Si vous êtes sur le carreau, vous y restez définitivement.
Pour commencer, je suspendis mes études. Il fallait diriger la maison et remplacer, dans la mesure de mes forces, la chère malade qui, momentanément, était dans l’impossibilité de continuer, même partiellement, sa tâche.
Je puis juger, aujourd’hui, à quel point j’étais inexpérimentée et inconsciente. Mais, à ce mo-ment-là, je me berçais de l’illusion d’une compétence que j’étais seule à imaginer, et j’allais jusqu’à m’étonner de la facilité relative que comportait la prise en charge d’une maisonnée.
Par instants, seulement, la prescience du danger me donnait un avertissement que j’aurais dû considérer comme salutaire, mais, régulièrement, je rejetais ces craintes d’un haussement d’épaules, en les recouvrant du manteau de mon insouciance.
La vérité est que j’étais sans expérience aucune. Cinq enfants à nourrir, à vêtir, représentaient un fardeau moral et matériel écrasant pour l’insouciante fillette que j’avais été jusque-là.
Cinq grands enfants ont les dents longues et réclament à chaque repas des plats copieux et substantiels. De plus, dans les autres manifestations de l’existence, ils ont besoin d’être tenus, refrénés, surveillés.
Germoise, la cuisinière, qui était à notre service depuis de nombreuses années, me secondait de son mieux, en cette circonstance. Malheureusement, elle n’avait aucun principe d’économie et, quant à moi, j’avoue avoir été toujours d’une incompétence notoire pour tout ce qui a trait aux chiffres et à l’administration.
Ma mère avait une telle habitude de régenter Germoise à propos des dépenses de la maison, que la vieille femme n’avait, depuis des années, qu’à se conformer aux ordres reçus. À force d’obéir, on finit par tuer en soi tout esprit d’initiative.
Quant à moi, pourvu que la table fût abondamment servie et que mes frères n’eussent pas à se plaindre, ni sous le rapport de la quantité, ni sous celui de la qualité, je ne m’inquiétais pas du prix des choses. Je ne m’apercevais même pas que l’argent filait entre mes doigts malhabiles. Et Germoise, dans sa naïve candeur, faisait tout ce qu’il fallait pour que cette hémorragie continuât de plus belle.
C’était, à vrai dire, un véritable tonneau des Danaïdes !...
Il fallait payer les docteurs, payer les médicaments, payer pour l’instruction des quatre étudiants, payer pour leurs vêtements, payer pour leurs chaussures, payer pour leurs obligations mondaines et sociales.
Les billets de mille partaient, filaient. Seule, la rupture d’une digue peut donner une idée approximative de la vitesse avec laquelle l’argent roulait.
Comment n’ai-je pas réalisé, alors, que la source de cet argent n’était pas inépuisable, qu’elle finirait par se tarir un jour ou l’autre ? Il n’est pas d’exemple d’une citerne restant pleine, quand on y puise sans cesse, si des apports constants ne l’alimentent au fur et à mesure qu’on la vide.
Je vivais dans une sorte d’état second, et encore aujourd’hui je me demande par quelle aberration je ne vis point qu’un tel mode de vie ne pouvait s’éterniser. La logique aurait dû me suggérer que, obligatoirement, je courais à la catastrophe.
Mais peut-être y a-t-il là une sorte d’accoutumance qui empêche de regarder les choses en face et d’en tirer les conséquences logiques ? Une accoutumance grâce à laquelle les faits les plus absurdes et les moins raisonnables finissent par paraître normaux.
Je suppose que les indigènes de certaines îles du Pacifique, où les tremblements de terre ont lieu en moyenne deux ou trois fois par an doivent considérer comme naturelles les éruptions volcaniques et trouver bizarres les années où leurs îles ne sont pas dévastées par un ou deux raz de marée.
Quand je n’avais plus d’argent en poche, je faisais signer un chèque à ma mère, qui était bien trop faible pour juger sainement de la situation et même établir la moindre addition.
Puis, j’allais à la banque le toucher. Quand, de nouveau, son montant était épuisé, je recommençais, et ainsi de suite.
Il ne me venait même pas à l’idée que notre compte pouvait se tarir.
Je crois bien que j’étais intimement convaincue que je pourrais ainsi puiser là-dedans jusqu’à la consommation des siècles, sans que le Pactole cessât de s’écouler.
Cependant, je ne faisais aucun débours inutile. Mais je dépensais sans compter. La vérité m’oblige à dire que je n’avais jamais su calculer. Il y a quelque temps, cette inaptitude aux chiffres me paraissait une affreuse monstruosité, quelque chose comme une verrue sur le nez ou une bosse au milieu du dos. Depuis, j’ai appris que je partageais cette particularité avec bon nombre d’humains, que c’était une maladie fort répandue, et que, si malade il y a, il serait peut-être plus juste de parler d’une véritable épidémie.
Je payais tout sans discuter. C’est là, à vrai dire, un trait de caractère qui n’est pas forcément lié aux questions d’argent. Tout payer sans discuter ne veut pas forcément signifier qu’on ne tient pas du tout à l’argent : cela revient à dire que l’on a horreur de la discussion.
En vérité, il en est ainsi : j’ai toujours eu horreur de la discussion. Non pas que je ne sois pas combative, pleine d’initiatives, capable de faire face aux situations les plus délicates (la suite de mon histoire l’a prouvé abondamment). Non, tout simplement j’ai horreur de la discussion.
Il me semble que toute discussion est oiseuse, que ce n’est qu’une perte de temps et un gaspillage d’énergie que l’on pourrait utilement employer à d’autres fins.
Quoi qu’il en soit, l’argent glissait comme une poignée de sable fin, entre mes doigts innocents, et, je dois le dire à ma très grande confusion, je n’ai pas vu le malheur venir.
Un beau matin... – elle est étonnante, cette formule consacrée de commencer un récit, même si ce matin-là se trouve être pour vous un des plus désagréables qui soient, – un beau matin, donc je me présentai à la banque avec un chèque de dix mille francs signé naturellement par maman. J’avais un besoin pressant de cet argent, car c’était la fin du mois de mars, et j’avais un certain nombre de factures à régler.
Je donnai mon chèque, avec un sourire, à l’employé du guichet, qui me connaissait – tout le monde me connaît à la banque. Je me souviens d’avoir même ponctué mon geste d’une remarque définitive et éminemment originale sur le temps qu’il faisait, – il pleuvait à verse, – pendant qu’il me remettait le petit jeton en métal où était marqué le numéro par lequel je serais appelée à la caisse.
Le moindre détail de cette matinée-là est ancré en ma mémoire. Munie de mon précieux jeton, je suis allée m’asseoir sur une banquette en face de la caisse, en attendant que l’on m’appelât. Je savais que cela demandait, en général, de cinq à dix minutes.
Mais, ce matin-là, l’attente se prolongeait. Il y avait bien un quart d’heure que j’étais assise sur ma banquette et je commençais à m’impatienter.
Soudain, une voix parvint à mon oreille :
– Mademoiselle Chambreuil !... Mademoiselle Chambreuil !...
Tournant la tête, j’aperçus alors le même employé qui, tout à l’heure, m’avait tendu le numéro d’ordre. Manifestement, il cherchait à attirer mon attention. Je mis quelques secondes à réaliser que c’était bien de moi qu’il s’agissait. En général, un des caissiers se bornait à appeler mon numéro. Je m’approchais, tendais mon jeton, on me décomptait le montant du chèque, et c’était fini. Mais, cette fois-ci, c’était bien l’employé des visas qui venait de s’adresser à moi et en m’appelant par mon nom. Bizarre !...
Je m’approchai, d’un air interrogatif.
Il avait, figé sur sa figure, un sourire stéréotypé, mais l’expression de son visage dénotait une certaine gêne.
– Vous m’avez appelée ? demandai-je, sans voir, sur le moment, la parfaite inutilité de cette question.
– Oui, mademoiselle Chambreuil.
Il se pencha vers moi par-dessus le comptoir, comme pour me confier un secret important.
– M. Bordier, notre fondé de pouvoir, désirerait vous parler, mademoiselle.
– Me parler ?
Je restai là, une seconde, bouche bée.
Je ne dis pas :
– Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?
À ce moment-là, je n’avais pas la moindre idée qu’il pût y avoir quelque anicroche.
– Monsieur Granger, enchaîna l’employé sans relever ma question, en s’adressant à l’huissier qui se tenait en permanence dans le hall, voulez-vous conduire Mademoiselle chez M. Bordier. Il l’attend.
Et, s’adressant à moi :
– Voulez-vous avoir l’obligeance de suivre l’huissier, mademoiselle Chambreuil ? Merci, mademoiselle.
Puis, comme si j’avais subitement cessé d’exister pour lui, il m’ignora et s’adressa à une autre cliente.
Il ne m’avait pas demandé mon avis, mais il était visible que, pour lui, l’affaire était réglée et que j’irais voir M. Bordier, sans autre forme de procès.
Il avait raison. Je suivis en effet l’huissier, sans protester et sans demander de plus amples détails.
Ma tranquillité était totale et mon âme parfaitement en paix. Nulle inquiétude ne m’habitait. Tout au plus, je pensais qu’il devait manquer une date, ou une signature, ou un cachet quelconque sur le chèque, et que cela s’arrangerait automatiquement, en quelques secondes. J’étais d’un optimisme inébranlable.
Je fus aussitôt introduite dans le bureau de M. Bordier, qui me reçut avec une courtoisie extrême, mais sans son sourire habituel de bienveillance. Il m’indiqua une chaise.
M. Bordier avait une moustache grisonnante et une paire de lunettes. Je crois que je ne l’oublierai jamais.
Il tenait à la main une règle en acier et mon chèque.
– Mademoiselle Chambreuil, ce chèque a été signée par Mme votre mère, n’est-ce pas ?
– Oui, monsieur.
– Il y a très longtemps que nous n’avons eu le plaisir de voir votre maman.
– Ma mère est très malade et ne peut guère quitter sa chambre.
– Je comprends, je comprends... Vous avez perdu votre père l’année dernière, je crois ?
– Oui, monsieur.
– Bien entendu, tout cela me paraît très clair. Votre maman n’est pas en état de tenir un compte très précis de la situation.
Que signifiaient toutes ces circonlocutions ? Où voulait-il en venir ? Comme je ne faisais pas un geste, ni ne disais un mot pour l’aider, – j’en étais bien incapable, étant donné que je ne comprenais pas du tout de quoi il s’agissait – il poursuivit, après s’être éclairci la voix, d’un air quelque peu embarrassé :
– Voyez-vous, mademoiselle, à notre grand regret... très grand regret, nous sommes dans l’impossibilité de payer ce chèque. Il ne reste à votre crédit que trois cent quinze francs. Avec notre meilleure volonté... Je comprends que votre maman, malade, ait pu se tromper. Il s’agit là, bien entendu, d’une erreur... Il me semble que vous pourriez utilement vous adresser à votre notaire. Peut-être a-t-il envisagé des dispositions pour que le compte courant de Mme votre mère soit réapprovisionné, ou qu’une nouvelle ouverture de crédit lui soit consentie. Quant à nous, nous n’avons malheureusement, jusqu’à ce jour, aucune instruction à ce sujet... Vous m’en voyez navré, mademoiselle.
Ce fut comme un effroyable coup de foudre. Je ne sais pas ce que j’ai répondu. Je ne sais pas ce que j’ai bredouillé. Je ne sais pas comment j’ai pris congé de M. Bordier, ni comment j’ai remis le chèque dans mon sac.
Je me suis retrouvée dehors, sous la pluie, assommée comme par un terrible coup de massue.
III
Tout d’abord, je n’avais pas du tout compris ce que l’incident de la banque signifiait.
J’étais rentrée, trempée, à la maison, et je m’étais bien gardée de souffler mot à âme qui vive des événements de la matinée. Surtout à ma mère !
Il ne fallait à aucun prix donner à cette dernière un motif d’inquiétude qui risquait de compromettre l’amélioration de son état de santé. D’autre part, je voulais me donner à moi-même le temps de réfléchir et d’envisager la situation avec calme.
À vrai dire, je n’y voyais pas très clair. Je me disais vaguement qu’il devait y avoir une erreur de chiffres, que le notaire avait négligé certainement de faire un transfert de titres ou je ne sais quoi de similaire.
Au fond, j’étais persuadée que tout finirait par s’expliquer et rentrer dans l’ordre.
J’étais vraiment la proie d’une illusion incroyable, en faisant preuve d’une confiance aussi aveugle qu’injustifiée !
Évidemment, le mieux était sans conteste d’aller voir notre notaire, ne serait-ce que pour en avoir le cœur net.
À peine le déjeuner achevé, je me décidai à cette démarche.
Je ne fis pas longtemps antichambre.
Me Ducourget me reçut presque aussitôt dans la grande pièce aux boiseries anglaises où j’étais venue déjà plusieurs fois après la mort de mon père.
Me Ducourget n’était pas un de ces notaires à bésicles et à favoris, comme on en rencontre dans les pièces du répertoire. C’était un homme d’une cinquantaine d’années, portant beau, habillé d’un complet de bonne coupe, l’air plutôt d’un gros industriel que d’un tabellion.
– Que puis-je pour vous, chère mademoiselle ? me demanda-t-il après m’avoir indiqué un fauteuil confortable, tout en arborant un sourire engageant.
Je le mis au courant de l’incident de la banque et de ma déconvenue – car, intérieurement, il ne s’agissait encore pour moi que d’une déconvenue.
Pour la première fois, en exposant les faits, je vis alors les événements sous leur vrai jour.
Plusieurs fois, j’avais entendu parler de chèques sans provision. J’avais lu, dans les journaux, qu’un tel délit conduisait parfois son auteur au Dépôt. Jusque-là, ces sortes d’actions m’étaient apparues comme des contes irréels, des choses qui se passaient dans un monde à part, absolument en dehors de celui où j’avais l’habitude de vivre.
Devant le tabellion, je fus subitement frappée par l’idée que, le matin même, que je le veuille ou non, j’avais eu à mon actif une histoire de chèque sans provision !
Aussitôt, je réalisai que le Dépôt n’était pas du tout une vue de l’esprit, mais bel et bien un immeuble destiné à recevoir ceux qui se permettaient ce genre de plaisanterie, et j’eus la sinistre vision d’amples barreaux et de solides cadenas !