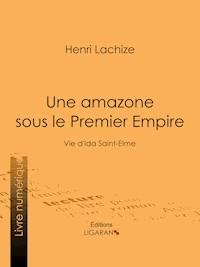
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Ida Saint-Elme naquit, le 26 septembre 1778, à Valambrose, charmante campagne des bords de l'Arno, près de Florence. Elle descendait d'une illustre famille : son père, Léopold Ferdinand de Tolstoy, né en 1749 au château de Verbown, en Hongrie, était fils de Samuel-Léopold de Tolstoy, duc de Cremnitz, et de Catherine Vevoy, comtesse de Thuroz. A la mort de ses parents, Léopold eut pour tuteur un de ses oncles maternels, au service de l'Autriche."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La femme, en particulier, est ce que la fait celui qu’elle aime ; les femmes, en général, sont ce que les fait leur temps. Elles vont, quel que soit le hasard de l’évènement, n’importe où comme au bal, avec la même passion, folles de sagesse ou de folie, et, quoi qu’il advienne, toujours suivant la mode, sous Louis XIV, où Dieu est bien en cour, allant au couvent, sous Louis XV, où florit la dépravation, allant à la galanterie, sous la Révolution, où tout s’égalise librement au nom de la fraternité, allant à l’échafaud.
Napoléon, que la marquise de Coigny admirait comme elle avait admiré Voltaire, et que Chateaubriand devait successivement comparer à Cyrus et à Néron, Napoléon ayant mis l’héroïsme à l’ordre du jour, rien de surprenant à ce que nombre de femmes, enthousiasmées, aient accompagné les armées, quelques-unes trouvant une manière de célébrité dans l’ombre même de sa gloire.
Parmi ces dernières, Ida Saint-Elme est surtout intéressante pour l’esprit que sut avoir son cœur.
Ce ne fut pas une grande et honneste dame, non. Soit. Ce fut mieux, peut-être, ce fut une femme, femme d’âme ultra-délicate, de conscience élevée, aux vues larges et justes, point morale mais point hypocrite, vertu rare, et qui, mêlée aux plus formidables évènements et parmi tant d’hommes violents ou infâmes, loyale femme galante, ne trafiqua jamais ni de l’honneur ni de la vie de personne.
Ida est une indépendante. Si l’influence de Jean-Jacques l’atteignit, comme elle atteignit tous ceux d’alors, comme elle a depuis atteint George Sand, cette autre amazone au grand cœur qui, venue plus tôt, sans doute eût suivi le grand marcheur, elle n’apprit pas les sentiments dans les livres. Elle ne fait pas d’esprit, elle en a. Beaucoup, et du meilleur, du plus fin et du plus fier.
Aussi librement témoin d’elle-même que des autres, attestant, sans souci de l’étroitesse timorée des sots, les faits les plus intimement vécus avec cette tranquillité supérieure qui est marque d’aristocratie native, de ces Mémoires, où Portraits et Caractères, traités de clairvoyante observation et de positive analyse, de pensée maîtresse évoquant parfois la souveraine magie de Saint-Simon, de ces très vivaces Mémoires, si touffus, se dégage, miracle de la sincérité, la très noble émotion des angoisses d’un cœur passionné devant la sombre tragédie de Ney, dont l’âme tumultueuse et l’image dominent les deux cents chapitres de ces huit volumes.
De haute franchise, en traits épars, inconscients, naturels, elle se peint elle-même.
« Je m’élevais parfaitement toute seule, dit-elle. À treize ans, presque une femme de taille et de figure, mais une enfant pour la raison. Un an plus tard, j’étais mariée. Il a toujours fallu pour me séduire un mérite distingué. Loin de ma mère, mon mari ne s’occupant aucunement de ma conduite, je fus tour à tour repentante et coupable. À Valmy, j’avais quitté les vêtements de mon sexe, et revêtu l’habit d’homme. Dans les salons, où l’égalité révolutionnaire étalait quelquefois le faste de l’ancien régime, les hommes se montraient brusques et sans éducation. Je n’avais pas une insatiable coquetterie d’hommages, mais j’avais ma petite vanité, qui me mettait facilement au-dessus des clabauderies et des murmures. Rencontrant les troupes françaises en 1795, mon cœur battit. J’aime cet air de conquête qui sied si bien au caractère français. »
Son mari, ayant su qu’elle l’avait trompé, philosophe, avait pardonné, pardon qu’elle ne lui pardonne pas.
« Soudain je me pris à le haïr. Oublier si promptement une faute qui eût dû lui inspirer à mon égard au moins une réserve attristée, à défaut d’une cruelle indifférence. J’étais sans doute injuste. Mais il me semblait que j’étais ainsi abaissée par lui au rang d’une maîtresse, par les témoignages d’une tendresse qui ne pouvait être basée sur l’estime. – Cette idée fermenta dans ma tête et m’envahit à ce point que je décidai de le quitter, dût cette résolution entraîner pour moi la perte des avantages de ma naissance et de ma fortune, l’indépendance de mon caractère ne me permettant pas de feindre plus longtemps par hypocrisie des sentiments qui n’étaient plus dans mon cœur, résolue à vivre libre, afin de ne plus recevoir de l’homme que j’avais cruellement offensé des preuves d’une tendresse que je ne pouvais plus partager. – Et je partis sans plus jamais regarder en arrière. »
Ce sont là, m’est avis, replis de cœur, délicatesse et hauteur de sentiments dignes en tout point des héroïnes de Racine, sentiments qui jamais ne se démentent chez Ida, laquelle d’ailleurs, aima la Tragédie avec passion, jusqu’à la jouer à la Comédie-Française, en une soirée qui fut sans lendemain.
« Beaucoup, qui n’ont pas comme moi quitté leur mari, n’en valent pas mieux », dit-elle plus loin. – Sans m’en être encore rendu compte, je me trouvais déjà enchaînée au sort de Moreau. Je n’avais pas su résister. – Arrivant ensemble en Italie, il me prévint qu’à partir de ce jour, je serais pour tout le monde Madame Moreau. Ces mots produisirent sur moi une impression pénible. Il me semblait qu’en prenant désormais le nom du général, j’allais renoncer une seconde fois à celui qu’une union légitime m’avait donné le droit de porter. Je craignais de faire ainsi publiquement outrage à mon mari, que j’avais si cruellement offensé. »
Ce mari meurt, en Guyane Hollandaise, laissant en faveur de sa veuve des dispositions testamentaires avantageusement importantes.
« Il ne tenait qu’à moi de les faire valoir ; j’abandonnai le legs. »
Séparée de Moreau, elle s’est prise de passion pour Ney, lequel, alors, se trouve précisément sous le commandement de Moreau à l’armée du Rhin.
« Chaque jour plus exaltée, je fus au moment de convertir en or tout ce que je possédais, de prendre mes habits d’homme et de courir à l’armée ; mais la reconnaissance arrêta l’amour. Le souvenir de Moreau, de ses dernières bontés, me fit craindre de le rendre témoin de cette marque publique d’une préférence qui deviendrait pour lui une trop cruelle injure. Je restai donc. »
Mais Ney vient à Paris.
« Si Ney eût été un homme ordinaire, on eût presque trouvé sur son visage de la laideur. Mais avec sa noble taille, avec son attitude et ce regard qui était tout l’homme, on voyait tant de gloire qu’on croyait voir la beauté. Ney était libre encore. Nous fûmes entraînés au-delà de l’amitié fraternelle. »
Pour Napoléon, à qui les femmes pouvaient plaire sans l’occuper, écoutons Ida nous conter, sans plus de fausse pudeur que de sot orgueil, très naïvement, sa haute bonne fortune :
« Tout allait vite avec Napoléon. À Milan, je me trouvai dans un cabinet de vingt pieds carrés, avec le souverain pour qui le monde était trop petit. Napoléon ne ressemblait plus du tout au général Bonaparte que j’avais vu maigre et grêle. Certes, ce n’était pas un dameret. Il me traita avec plus de brusquerie que de tendresse, avec la nonchalance d’un souverain. Comme je remarquai l’étonnante blancheur de ses mains, il m’en remercia presque avec le sourire d’une jolie femme. Je puis avouer ici un changement dans mes opinions. À dater de notre entrevue, Napoléon ne s’offrit plus à ma pensée que comme le plus grand homme de son temps. En rentrant chez moi, j’étais fière et humiliée à la fois. »
Et, songeant à Ney, au Lion rouge, elle ajoute :
« Ma conscience n’était pas tranquille. »
Ney, l’homme de sa vie, elle le suivra à Eylau, où elle sera blessée ; en Russie, où, croit-elle, « le maréchal céda un peu à la tentation de la battre » ; à Waterloo, où il eut cinq chevaux tués sous lui, prenant de sa main un drapeau anglais ; et, le matin du 7 décembre, elle le verra tomber sous le plomb de la Chambre des Pairs.
C’est ici l’occasion de citer la dernière lettre écrite par celui dont l’héroïsme avait, pendant la Retraite de Russie, sauvé des milliers de Français, lettre admirable, adressée, avant d’aller mourir, à son beau-frère habitant la Malgrange, près Nancy :
Au Luxembourg, le 7 décembre 1815.
4 heures du matin.
« Mon cher Monnier, mon procès est terminé ; l’huissier de la Chambre des Pairs vient de me lire la sentence qui me condamne à la peine de mort. Ménagez cette nouvelle à mon bon père, qui est sur le bord de la tombe. Avant vingt-quatre heures je paraîtrai devant Dieu, avec des regrets amers de ne pas avoir pu être plus longtemps utile à ma patrie ; mais il saura, ainsi que je l’ai dit devant les hommes, que je me sens exempt de remords. Embrassez ma sœur ; dites mille choses pour moi à vos enfants ; ils aimeront, j’espère, malgré la terrible catastrophe qui me frappe, leurs bons petits-cousins. À Dieu pour jamais, je vous embrasse avec tous les sentiments d’un bon frère. »
Le maréchal prince de la Moskowa, NEY.
Sans insister plus que l’intéressée sur le caprice impérial, en dehors de Moreau et de Ney, passion que les circonstances réduisirent souvent à un « veuvage fraternel », Ida goûta d’autres intimités, toutes pareillement passagères, intelligentes et surtout désintéressées, cette grande amoureuse, qui ne fut jamais une courtisane, n’ayant pas été de celles qui font constater leur opprobre par acte notarié.
Nous venons d’indiquer la femme intime, présentons maintenant celle qui s’est elle-même très justement surnommée la Contemporaine.
Après le côté du cœur, le côté de l’esprit.
Mêlée à l’action des vingt-trois années qui ont vu les hauts faits de la République et de l’Empire, Ida, à qui, le plus souvent, sa situation a interdit de se peindre autrement qu’en buste, va nous montrer les autres en pied.
Ne fût-ce que d’un trait, elle va tracer la silhouette, esquisser le portrait, éclairer le caractère de tous ceux qui l’ont approchée ici et là à travers l’Europe, soldats, diplomates, ministres, savants, écrivains, comédiens, banquiers, gens d’affaires, hommes et femmes, tout le bourdonnement de la ruche humaine, récit du plus vivant intérêt, roman qui est de l’histoire, – histoire prodigieuse, invraisemblable, d’un temps héroïque qu’il ne sied pas de juger à l’étroite mesure des sentiments actuels, rapetissés, diminués, sinon avilis, par de tristes faits nouveaux.
Femme, elle n’est pas la seule à chevaucher sur les routes, entraînée par un noble élan dans le sillon de gloire, suivant le petit chapeau, conquise par le conquérant.
Tenez, voici Catherine Pochta, dès le 6 septembre 1792, an IV, canonnière au bataillon des Enfants-Rouges ; tenez, voici Virginie Ghesquière, dite Joli-Sergent, Marie Schellinck et Joséphine Trinquart toutes trois décorées comme soldats en 1806, six ans après la fondation de l’Ordre, et la veuve Perrot, cantinière, ainsi que la veuve Brulon, sous-lieutenant d’infanterie, décorées le 15 août 1815 ; tenez, voici la veuve Futerre, ex-dragon ; tenez, voici les sœurs Fernig ; tenez, voici Rose Barreau ; tenez, voici Thérèse Fégure, Thérèse Fégure, dite Sans-Gêne, à dix-neuf ans engagée volontaire, le 20 messidor an Ier (9 juillet 1793), dans la Légion Allobroge, ensuite incorporée au 15e, puis au 9e dragon, blessée d’une balle au sein gauche au siège de Toulon, Batterie des Hommes-Sans-Peur, blessée de quatre coups de sabre, le 3 brumaire an VIII, à la bataille de Savigliano sur la Macra, ayant eu trois chevaux tués sous elle, deux fois prisonnière, ayant fait la campagne d’Italie, où Bonaparte l’appelait Monsieur Sans-Gêne, ayant été à Ulm, à Austerlitz, à Vienne, à Iéna, à Burgos, ayant été emmenée de Lisbonne à Portsmouth en captivité, et, sous l’uniforme de chasseur à cheval, ayant revu son Empereur à Paris, en une grande revue passée au retour de l’île d’Elbe !
Temps évanouis, époque géante, atmosphère surchauffée, milieu extraordinaire expliquant du reste l’existence d’Ida et sa conduite, qui n’aurait besoin d’être excusée qu’auprès des sots – et, de ceux-là, nous ne nous occupons, sachant que rien, rien ne guérit les sots de leur sottise.
Ce qu’il importe de recueillir en ces pages émouvantes, c’est l’impression des mœurs et des idées, des façons d’agir et de sentir d’une époque intéressante entre toutes, de Valmy à Waterloo, de l’aurore au couchant.
Si « arrangés » qu’ils puissent être, les Mémoires ont parfois, contre le vouloir même de leur auteur, cette qualité précieuse autant qu’amusante de nous montrer en chemise des personnages que la sévère Histoire se croit tenue de ne nous présenter qu’en péplum.
En analysant les Mémoires d’une Contemporaine, publiées en 1827, et dont la malveillante chronique scandaleuse a dit
en réduisant leurs trois mille pages à deux cents, et leurs deux cent dix-neuf chapitres à quatorze, M. Henry Lachize ajoute à propos un feuillet au dossier de l’Histoire, à l’heure précise où tout ce qui touche à l’Épopée, aux personnages de la République, du Consulat et de l’Empire, continue de captiver le monde et il faut savoir gré au tact de l’éditeur, M. Carrington, qui a pris souci de donner à l’amazone une monture de race, c’est-à-dire un volume d’impeccable beauté typographique, dont les élégantes gravures, dues à M. Ch. Thévenin, sont, en leur finesse, de parfaite exécution, véritables petits tableaux complétant à souhait ce livre. Les bibliophiles sauront gré à l’éditeur du choix qu’il a fait de cet artiste.
Et, puisque nous parlons de gravures, l’iconographie de « la Contemporaine » est pour intéresser les chercheurs.
Voici donc ce qu’on en sait.
Tout d’abord, c’est la Statue de la femme couchée, où la belle Ida est représentée dans le plus galant équipage, en costume qui n’en est pas un, le plus beau des costumes, rien n’habillant mieux que le nu, nu souligné par une suggestive draperie qui semble un baiser, volupté de plus.
De quoi l’on ne saurait ni ne doit faire au modèle aucun reproche.
En effet, Pauline, la sœur même de Bonaparte, Paulette, comme on la nommait en famille, après avoir soupiré pour Fréron, après avoir épousé le général Leclerc, puis le prince Borghèse, se fit-elle pas représenter en Vénus victrix par le grand sculpteur pour qui elle était plus qu’un modèle ?
Cette Femme couchée, dont une réduction fut offerte par Ida à Talleyrand, sculptée en 1802, à Chaillot, dans la maison même de Moreau, est marbre dû au ciseau de François-Frédéric Lemot, né à Lyon, le 4 novembre 1772, et mort à Paris, le 6 mai 1827. Élève de Dejoux, premier prix de l’Académie, soldat sous Pichegru, de retour à Paris en 1795, Dejoux y exécuta un Numa Pompilius pour la salle du Conseil des Cinq-Cents, un Cicéron pour la salle du Tribunat, un Léonidas pour le Sénat, un Brutus et un Lycurgue pour le Corps législatif. Au Salon de 1801, une Bacchante de lui fut acquise par le Premier Consul. Le char et les figures de la Victoire et de la Paix de l’Arc de triomphe du Carrousel sont de lui ainsi que le grand bas-relief de Minerve consacrant le buste de Louis XIV, qui décore le fronton de la Colonnade du Louvre, composition exécutée en 1810, et, pour sa froideur même, trouvée digne du prix décennal. De lui encore la statue d’Henri IV, depuis 1818 sur le Pont-Neuf. En 1817, Lemot a publié une intéressante Notice historique sur le château de Clisson. Enfin il a eu Pradier pour élève.
En 1816, un savant dessinateur, qu’Ida ne nomme pas, accompagnant le duc de Kent à Waterloo, la crayonna, les rubans de son chapeau passés au bras, les cheveux en désordre autour de la tête et les vêtements, non serrés au cou, en forme de robe de religieuse.
En 1820, elle fut lithographiée par Henri Grévedon, né à Paris où il mourut en 1860, et dont la fille avait épousé Régnier, de la Comédie-Française.
En 1828, elle fut de nouveau lithographiée, coiffée d’un large chapeau garni d’un immense voile, en manteau à collet et robe à carreaux, par Achille Devéria, lithographie gravée par J.-M. Fontaine, et, en 1833, par le même artiste, vue de face et mains croisées, avec cette légende : Comme nous passons, et comme je suis passée !
Quant au Portrait pour lequel Ida posa en 1790 « devant un peintre », c’est très probablement la miniature d’Isabey, que Moreau voulut conserver en quittant sa maîtresse.
Ajoutons qu’en 1806, pendant la campagne de Prusse, il fut fait d’elle un Portrait en costume d’homme, avec les cheveux coupés à la Titus, mais cette esquisse est sans signature.
Et maintenant, pour conclure, quoi qu’on puisse penser de « la Contemporaine, » disons qu’il faut tout lui pardonner parce qu’elle a ardemment aimé.
JULES DE MARTHOLD.
Ida Saint-Elme naquit, le 26 septembre 1778, à Valambrose, charmante campagne des bords de l’Arno, près de Florence.
Elle descendait d’une illustre famille : son père, Léopold Ferdinand de Tolstoy, né en 1749 au château de Verbown, en Hongrie, était fils de Samuel-Léopold de Tolstoy, duc de Cremnitz, et de Catherine Vevoy, comtesse de Thuroz. À la mort de ses parents, Léopold eut pour tuteur un de ses oncles maternels, au service de l’Autriche. Celui-ci, qui ne cherchait qu’à spolier son pupille, le dépouilla tout d’abord d’une immense terre qu’il possédait dans le comté de Nitria.
À dix-neuf ans, le jeune Léopold parcourait déjà les champs de bataille, aux côtés de son grand-oncle maternel Béniowski, qui s’était attaché à la fortune de Charles de Lorraine.
Poussé par Béniowski, Léopold résolut de se faire rendre justice. Il rassemble les anciens vassaux de son père, les harangue, attaque, à leur tête, le château usurpé par son tuteur, et rentre de vive force dans le domaine de ses aïeux. Son triomphe fut de courte durée. Accusé d’avoir soulevé ses vassaux contre la puissance impériale, il fut condamné au bannissement. Il avait alors vingt et un ans. Voulant se venger de son persécuteur, il parvint à le provoquer en duel. Le résultat de cette rencontre fut heureux pour lui ; mais, trop empressé à porter secours à son ennemi blessé, il fut arrêté sur le terrain même du combat et conduit à la citadelle de Presbourg. Il n’y resta pas longtemps, car la nièce du gouverneur de la citadelle, Ida Kormwitz, s’éprit follement du beau prisonnier. Elle réussit à le faire évader et ils s’enfuirent jusqu’aux frontières de l’empire russe.
Ida Kormwitz ne voulut point accepter le nom que lui offrait Léopold en reconnaissance de ses services, et se retira à l’Abbaye de Novitorg.
Refusant une riche alliance proposée par Béniowski, Léopold quitta Saint-Pétersbourg, où il avait rejoint son grand-oncle et se rendit à Dantzig, d’où il s’embarqua pour Hambourg. De cette ville, il vint à Amsterdam et arriva enfin à La Haye en 1774.
Là il épousa Mlle Van-Aylde et quitta le nom de sa famille pour prendre celui de sa femme.
Celle-ci eut deux fils qui moururent en bas âge. Elle était de santé délicate, et son état s’aggravant, ils partirent tous deux pour l’Italie, où Elzélina vint au monde.
Ses premières années offrent peu d’intérêt.
« Dès le berceau, dit-elle mon oreille n’entendit que des chants mélodieux » ; dès le berceau, en effet, elle fut charmée par l’harmonie des strophes du Tasse. « Quand mon intelligence commença à se développer, les fictions de l’Arioste vinrent étonner ma jeune imagination. La lecture de ce poète était la récompense qu’on m’accordait dans les heures de récréation qui interrompaient mes faciles études : je n’avais pas d’autres maîtres que mes parents. »
Son éducation physique n’était pas moins soignée. Habile à tous les exercices du corps, son père avait fait établir dans sa villa un manège, une salle d’escrime, un jeu de paume et un billard.
Dès son plus jeune âge, Elzélina faisait de longues promenades à cheval, accompagnée de ses parents.
Un naturel masculin semblait la dominer toujours, ce qui n’était pas sans contrarier sa mère.
« Je n’avais pas encore six ans que déjà je galopais avec intrépidité sur mon petit cheval hongrois, placée entre mon père et ma mère, qui surveillaient de l’œil tous mes mouvements.
Malgré les douces remontrances de ma mère, qui craignait toujours que je ne finisse par contracter des habitudes trop mâles, mon père me faisait prendre part à ses exercices les plus favoris, il me donnait des leçons d’escrime. J’étais heureuse des petits succès que mon adresse me faisait quelquefois obtenir.
Un jour entre autres, ma joie alla jusqu’au délire ; ce fut le jour où mon père me reçut élève, aux acclamations et aux applaudissements de ses hôtes et de ses amis rassemblés pour cette fête : déjà armée de mon plastron, les mains couvertes de mes gantelets, et brandissant mon fleuret, je m’élançais vers ma mère pour qu’elle m’attachât mon masque. En relevant les longues boucles de mes cheveux blonds, et les réunissant sous le ruban qui devait les retenir, elle laissa tomber une larme de ses yeux. Était-ce une larme de joie, ou bien ma bonne mère devinait-elle par une prescience secrète, à quels malheurs m’exposerait un jour la facilité de mon âme à passer subitement du calme le plus profond en apparence au plus fol enthousiasme ? »
Ce fut un heureux séjour sous le beau ciel d’Italie, mais ce bonheur ne devait pas durer : Le temps n’avait pas apaisé la haine des ennemis de Léopold de Tolstoy ; ses jours étant menacés en Italie, il résolut de retourner en Hollande.
Le 2 novembre 1787, ils se mirent en route. Ce voyage se termina par une tragique aventure : à Rotterdam, le 27 décembre de la même année, Léopold de Tolstoy mourut des suites d’une maladie contractée en voulant sauver un vieux serviteur qui se noyait dans le Waal. Sa malheureuse femme ne voulut pas abandonner ces lieux qui lui rappelaient un si cruel souvenir et s’établit dans le petit village où était mort son mari.
Deux ans s’écoulèrent. Elzélina grandissait ; son imagination ardente, lasse de son oisiveté, s’élançait chaque jour vers de nouvelles sensations. Cet ennui devait fatalement la conduire à un résultat : ce fut son mariage.
Pendant une belle matinée du mois de mai, elle parcourait seule, à cheval, un grand parc dont le propriétaire lui était inconnu, lorsqu’au détour d’une allée, apparut un jeune homme d’une figure charmante, dont l’expression était pleine de grâce et de bonté. On rougit un peu de part et d’autre, on se salue avec courtoisie, et la conversation s’engage. Elzélina apprend que le bel adolescent est fils unique de M. Van-M*** d’Amsterdam, propriétaire de ce superbe domaine ; elle ne fait pas non plus mystère de son nom et de sa demeure. Quand on eut bien trotté, bien galopé de conserve, causé aimablement côte à côte, force fut de se séparer, après, toutefois, avoir échangé la promesse de se retrouver le lendemain à un endroit désigné, pour entreprendre une plus longue promenade.
De ce jour, la vie d’Elzélina prit une direction toute nouvelle. Elle dit dans ses Mémoires que ce qu’elle éprouvait « n’était pas tout à fait de l’amour », ce qui est fort possible, parce qu’à onze ans, quelque heureusement née et précoce que soit une jeune fille, elle n’a pas encore d’idées bien arrêtées sur les mérites d’un homme. Elzélina parut donc s’abandonner à un sentiment instinctif qui, depuis ce jour, se développa et s’accrut merveilleusement. Cependant, un obstacle imprévu vint déranger tous les projets qu’elle avait formés pour ce premier rendez-vous, mais elle trouva d’elle-même le remède à la contrariété qu’elle en éprouva.
À peine le soleil était-il levé que le beau jeune homme reçut ce joli petit billet :
« Je sais que je fais mal de vous écrire, car je me cache de maman, et je trompe un domestique qui aura le droit de me mépriser. Mais je vous ai promis d’aller me promener avec vous, et il faut bien que vous sachiez que je ne puis pas tenir ma promesse ; vous avez l’air si bon, si doux et si gai ; la douleur de maman rend notre vie si triste, que je n’avais pas cru mal faire en acceptant l’offre que vous me faisiez d’entreprendre avec moi une longue course. Wilhelm m’a fait voir que j’avais eu tort, et j’aime trop maman pour vouloir jamais ajouter à ses peines. Cependant, je voudrais bien goûter avec vous le plaisir de la promenade ; ce désir n’a certainement rien de répréhensible. Au lieu de courir les grands chemins, venez voir mes parterres, mes viviers, ma volière ; je m’ennuyais de tout cela, mais je crois qu’avec vous, je pourrai m’en amuser encore. Tous les matins, je dessine pendant une heure dans le petit pavillon qui est à l’entrée de la grande prairie ; j’étudie ensuite un peu ou je fais de la musique ; ensuite, je déjeune avec maman, et je ne la revois plus depuis dix heures jusqu’à trois. Si vous voulez venir demain à la petite porte des marais, je peux l’ouvrir et nous nous arrangerons pour nous voir tous les jours ; cela me rendra un peu de gaîté, sans inquiéter ni chagriner ma bonne mère. »
Venez voir mes parterres, mes viviers, ma volière ! Cette enfant appelait un ami pour partager ses plaisirs. Enfant, certes, qui se sent devenir femme, qui le veut, poussée par un destin aveugle qui l’entraînera jusqu’à la chute, après lui avoir fait connaître une parcelle de gloire…
Van-M*** avait vingt-trois ans ; il aimait Elzélina avec passion et n’avait qu’un but : en faire sa femme.
Tous les jours, la petite porte s’ouvrait, et l’heureux adolescent était introduit dans le pavillon. Notre ingénue lui donnait des leçons d’italien, et, lui, en donnait de hollandais ; quoi de plus innocent ? Cependant la maîtresse d’italien s’aperçut un beau jour que le maître de hollandais avait conçu pour elle une amitié qui ressemblait à ce qu’elle avait lu de l’amour dans les poèmes du Tasse et de l’Arioste. Quant à elle, cette funeste passion ne l’avait pas encore effleurée. Ce fut pourtant avec une douce émotion qu’elle écouta le jeune Van-M*** quand il lui proposa de l’épouser, et de l’enlever au préalable. Elle fut même fière en pensant à l’honneur qui lui adviendrait, d’une aventure si rare, à son âge.





























