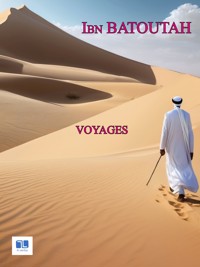
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
C'est l'histoire d'un pelerin au XIVeme siecle, erudit, qui se rend à La Mecque et rencontre des hommes de foi. Le voyage ne s'arrête pas là. Il est reconnu pour être le premier à s'être aventuré en Chine, avant Marco Polo,
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
VOYAGES
IBN BATOUTAH.
PRÉSENT FAIT AUX OBSERVATEURS, TRAITANT DES CURIOSITÉS OFFERTES PAR LES VILLES ET DES MERVEILLES RENCONTRÉES DANS LES VOYAGES.
AU NOM DU DIEU CLÉMENT ET MISÉRICORDIEUX.
Voici ce que dit le cheïkh, le jurisconsulte, le savant, le véridique, le noble, le dévot, le très-bienfaisant, l’hôte de Dieu, qui s’est acquitté de la visite des lieux saints, l’honneur de la religion, celui qui, dans le cours de ses voyages, a mis sa confiance dans le seigneur des créatures, Abou Abd Allah Mohammed, fils d’Abd Allah, fils de Moham- med, fils d’Ibrâhîm alléouâty atthandjy, connu sous le nom d’Ibn Batoutah, que Dieu lui fasse miséricorde et soit content de lui par l’effet de sa bonté et de sa générosité ! Ainsi soit-il. Louange à Dieu, qui a soumis la terre à ses serviteurs, afin qu’ils y marchassent dans des routes spacieuses (Coran, LXXI, 19), qui a placé dans cette terre et qui y fait aboutir les trois vicissitudes de leur destinée : la création, le retour dans la terre et l’extraction de ses entrailles (Coran, XX, 57). Il l’a étendue par sa puissance, et elle a été un lit pour ses serviteurs. Il l’a fixée au moyen de montagnes inébranlables et de hauteurs considérables, et a élevé au-dessus d’elle le sommet du ciel, sans aucune colonne. Il a fait paraître les astres comme un guide au milieu des ténèbres de la terre et de la mer, et a fait de la lune une lumière et du soleil un flambeau. Puis du ciel il a fait descendre de l’eau, avec laquelle il a vivifié la terre lorsqu’elle eut été desséchée. Il y a fait croître toute espèce de fruits, et a créé ses diverses régions, en leur donnant toutes sortes de plantes. Il a fait couler les deux mers : l’une d’eau douce et rafraîchissante, l’autre salée et amère (Coran, XXV, 55). Il a complété ses bienfaits envers ses créatures, en leur assujettissant les chameaux, et en leur soumettant des vaisseaux semblables aux montagnes (Coran, LV, 24), afin qu’ils leur servissent de montures au lieu de la surface du désert et du dos de la mer. Que Dieu bénisse notre seigneur et notre maître Mohammed, qui a révélé aux hommes une règle de conduite et leur a offert, pour les diriger, une lumière éclatante ! Dieu l’a envoyé par commisération pour les mortels, et l’a choisi pour être le dernier des prophètes. Il a livré à ses glaives acérés les cous des polythéistes, de sorte que les hommes sont entrés par troupes nombreuses dans la religion divine. Il l’a aidé par des miracles manifestes, et a donné la parole aux choses inanimées, pour qu’elles témoignassent de la vérité de ses discours. Grâce à ses prières, il a rendu la vie à des os cariés et a fait couler entre ses doigts une eau abondante (Coran, LXXVIII, 14).
Que Dieu soit satisfait des personnes qui ont été anoblies par leurs relations avec Mahomet, à titre de compagnons, de parents ou d’épouses ; de ceux qui ont arboré le drapeau de la religion !
Tu ne craindras pas de suivre, en les imitant, une conduite tortueuse. Ce sont eux qui ont fortifié le Prophète dans sa guerre contre les ennemis, qui l’ont aidé à faire triompher la religion brillante, qui ont satisfait à ses nobles exigences : la fuite, le secours et l’hospitalité ; qui se sont précipités pour le défendre dans le feu ardent de l’adversité, et se sont plongés dans la mer agitée du trépas. Nous prions Dieu d’accorder à notre maître le khalife, le prince des croyants, qui met sa confiance dans le sou- verain des mortels, qui combat dans la voie de Dieu et qui est fortifié par son secours, Abou Inân Faris, fils de nos seigneurs les imâms bien dirigés, les khalifes légitimes ; de lui accorder, disons- nous, une victoire qui remplisse d’al- légresse le monde et ses habitants, un bonheur qui puisse remédier aux calamités du destin ; comme il lui a donné un courage et une générosité qui ne négligent ni un oppresseur, ni un indigent. Avec son épée et ses dons, il a élargi tout ce qui était étroit (c’est-à-dire, il a surmonté les obstacles et mis fin à la pauvreté). Or les intelligences ont décidé, et les connaissances qui dépendent du raisonnement et de la tradition ont prononcé que ce règne sublime, belliqueux, pieux, farisien (c’est- à- dire, d’Abou Inân Faris), est l’ombre de Dieu même étendue sur les hommes, et sa corde à laquelle on s’attache fortement (Coran, 111, 98) ; qu’il convient d’être compris dans le nombre de ses serviteurs. C’est ce règne qui a guéri la religion dans sa maladie, qui a fait rentrer dans le fourreau l’épée de l’injustice, lorsqu’elle eut été dégaînée, qui a corrigé la fortune, lorsqu’elle eut été gàtée, et qui a bien achalandé le marché de la science, auparavant livré à la stagnation. Il a rendu manifestes les règles de la piété, lorsqu’elles eurent été oblitérées ; il a calmé les régions de la terre, lorsqu’elles étaient agitées ; il a fait revivre la tradition des actes de générosité, après sa mort ; il a fait mourir les coutumes tyranniques ; il a apaisé le feu de la discorde, au moment où il était le plus enflammé ; il a détruit les ordres de la tyrannie, au moment même où elle exerçait un pouvoir absolu ; il a élevé les édifices de l’équité sur les colonnes de la crainte de Dieu ; et s’est assuré par les liens les plus forts la possession de la confiance dans l’Éternel. Ce règne possède une gloire dont la couronne est placée sur le front d’Orion, et une illustration qui recouvre des pans de sa robe la voie lactée ; un bonheur qui a rendu au siècle une nouvelle jeunesse ; une justice qui déploie sa vaste tente sur les hommes religieux ; une libéralité semblable au nuage qui arrose à la fois les feuilles tombées des arbres et les arbres eux-mêmes ; un courage qui, de même que les nuées versent des torrents de pluie, répand des flots de sang. Ses escadrons victorieux secouent la mort. Il a pour lui l’assistance divine, du butin de laquelle font partie les empires ; une force impétueuse dont l’épée prévient les réprimandes ; une patience qui ne se fatigue pas d’espérer ; une prudence qui interdit aux ennemis l’approche des pâturages ; une résolution qui met en fuite leurs troupes, avant même que l’action soit engagée ; une douceur qui se plaît à cueillir le pardon sur l’arbre des péchés ; une bonté qui lui gagne tous les cœurs ; une science dont les lumières éclaircissent les plus ténébreuses difficultés ; une conduite conforme à la sincérité, et des actes conformes à ses intentions. Lorsque sa noble résidence fut devenue le théâtre des espérances, la prairie où paissent librement les désirs des hommes, la station des vertus, le rendez-vous du repos de l’homme craintif et du désir du mendiant, la fortune se proposa de lui rendre hommage, au moyen de présents merveilleux et de raretés élégantes. Les savants s’y rassemblèrent en nombre si considérable qu’on ne peut le décrire ; les philologues s’y rendirent à l’envi l’un de l’autre, avec un empressement qui produisit des multitudes. Les hommes instruits entreprirent le pèlerinage de son illustre sanctuaire, et les voyageurs formèrent le projet d’explorer ses qualités excellentes. Les hommes craintifs se sont réfugiés sous la protection de sa glorieuse majesté ; les rois ont cherché à obtenir du secours en rendant hommage à ses portes ; car c’est l’axe sur lequel tourne le monde. C’est, en un mot, grâce à son excellence sans pareille que les impromptus de l’ignorant et du savant ont pu se livrer combat ; c’est sur ses illustres traditions que s’appuie la véracité de tous les Moslim (nom de l’auteur d’un des deux plus célèbres recueils de traditions musulmanes), et, grâce à la perfection de ses nobles mérites, chaque professeur parle avec clarté. Au nombre de ceux qui arrivèrent à son illustre porte, et qui, après avoir traversé les étangs des autres contrées, parvinrent à cette mer immense, se trouvait le cheïkh, le jurisconsulte, le voyageur, l’homme digne de foi, sincère, qui a voyagé dans toute la terre et en a traversé les diverses régions en long et en large, Abou Abd Allah Mohammed, fils d’Abd Allah, fils de Mohammed, fils d’Ibrâhîm alléouâty atthandjy, plus connu sous le nom d’Ibn Batoutah, et désigné, dans les contrées de l’Orient, par celui de Chems ed-dîn. C’est le même qui a fait le tour du monde et a parcouru les cités en homme attentif et instruit, qui a examiné avec soin les diverses nations et a exploré les coutumes des Arabes et des Persans ; après quoi, il déposa le bâton du voyageur dans cette noble capitale, car il reconnut qu’elle avait un mérite supérieur, sans restriction et sans exception. Il parcourut donc l’Orient pour arriver au lieu où se lève cette pleine lune dans l’Occident, et il la préféra aux autres régions, de même que l’on préfère la poudre d’or à la poussière ; et cela de son propre mouvement, après avoir tâté pendant longtemps des autres pays et des autres hommes, et dans le désir de se joindre à la troupe qui ne cesse d’être occupée de Dieu. Abou Inân le combla de ses grâces magnifiques, de ses faveurs pleines de sollicitude et abondantes, au point de lui faire oublier le passé pour le présent, de le mettre en état de renoncer aux voyages lointains, de lui faire mépriser toutes les autres choses qu’il honorait, et de le confirmer dans l’idée qu’il s’était faite de la bonté du prince. Il oublia son ancienne habitude de parcourir les pays étrangers, et devint maître d’un gras pâturage, après l’avoir cherché durant longtemps. Un auguste commandement lui prescrivit de dicter à un scribe la description des villes qu’il avait vues dans son voyage, le récit des événements curieux qui étaient restés dans sa mémoire, de faire mention des personnages qu’il avait visités, comme les rois des régions étrangères, leurs savants les plus distingués et leurs saints les plus pieux. Ibn Batoutah dicta donc sur ces matières des détails capables de plaire à l’esprit, de réjouir les oreilles et les yeux, savoir toute espèce de choses étranges et merveilleuses, par l’exposition et la révélation desquelles il a été utile, et nous a gratifiés de connaissances tout à fait nouvelles.
L’ordre illustre a été transmis à l’esclave de sa noble majesté, à celui qui est entièrement dévoué à sa cour, qui est ennobli par le service de Sa Hautesse Mohammed, fils de Mohammed, fils de Djozay alkelby (que Dieu l’aide à bien servir le souverain, qu’il le pousse à lui témoigner sa reconnaissance !) ; cet ordre lui a été transmis de réunir les morceaux qu’avait dictés sur ces matières le cheikh Abou Abd Allah, dans une composition qui en renfermât tous les avantages et qui rendit parfaitement claires les idées qu’il avait en vue. Il lui fut recommandé de donner ses soins à la correction et à l’élégance du style, de s’appliquer à le rendre clair et intelligible, afin qu’on pût jouir de ces raretés, et qu’on tirât un grand profit de cette perle, lorsqu’elle aurait été extraite de sa coquille. L’esclave susmentionné se conforma promptement à ce qui lui avait été prescrit, et se plongea dans cette vaste entreprise, afin d’en sortir, avec l’assistance de Dieu, après avoir accompli les intentions du prince à cet égard. J’ai exprimé le sens des paroles du cheïkh Abou Abd Allah dans des termes qui rendent complétement les idées qu’il avait en vue, et qui montrent clairement le but qu’il s’était proposé. Souvent même j’ai transcrit ses propres paroles dans l’ordre où il les avait employées, sans y faire le moindre changement, et j’ai rapporté toutes les anecdotes et les histoires qu’il avait racontées. Mais je n’ai pas entrepris d’en examiner l’authenticité, puisqu’il a suivi la plus juste méthode, afin de l’établir par des témoignages dignes de foi, et qu’il s’est déchargé de la responsabilité des autres récits, par les termes mêmes dont il s’est servi. Afin que ce livre fût plus utile, sous le rapport de la correction et de l’exactitude de l’orthographe, j’ai fixé la lecture des noms de lieux et d’hommes qui pouvaient présenter de la difficulté, en employant les signes des voyelles et les points diacritiques. J’ai expliqué tous les mots étrangers qu’il m’a été possible d’expliquer, car ils présentent de l’obscurité pour le lecteur, à cause de leur forme barbare : et la méthode ordinaire de raisonnement, appliquée à résoudre ces énigmes, ne servirait qu’à induire en erreur.
J’espère que le travail que j’ai entrepris sera favorablement accueilli de Sa Noble Majesté (que Dieu lui soit en aide !), et que j’obtiendrai pour les défauts de l’exécution l’indulgence à laquelle j’ose prétendre ; car ses coutumes libérales sont magnifiques, et les actes de générosité par lesquels elle pardonne les fautes sont mes garants. (Que Dieu très haut la maintienne dans ses habitudes de victoire et de domination, qu’il lui fasse connaître les bienfaits de la grâce divine et lui accorde un succès éclatant !) Le cheïkh Abou AbdAllah dit ce qui suit : Je sortis de Than-djah (Tanger), lieu de ma naissance, le jeudi, 2 du mois de redjeb, le divin et l’unique, de l’année 725 (14 juin 1325 de J. C.), dans l’intention de faire le pèlerinage de la Mecque et de visiter le tombeau du Prophète. (Sur lui soient la meilleure prière et le salut !) J’étais seul, sans compagnon avec qui je pusse vivre familièrement, sans caravane dont je pusse faire partie ; mais j’étais poussé par un esprit ferme dans ses résolutions, et le désir de visiter ces illustres sanctuaires était caché dans mon sein. Je me déterminai donc à me séparer de mes amis des deux sexes, et j’abandonnai ma demeure comme les oiseaux abandonnent leur nid. Mon père et ma mère étaient encore en vie. Je me résignai douloureusement à me séparer d’eux, et ce fut pour moi comme pour eux une cause de maladie. J’étais alors âgé de vingt-deux ans. Ibn Djozay raconte ce qui suit : « Abou Abd Allah m’a dit à Grenade qu’il était né à Tanger, le lundi, 17 de redjeb de l’année 703 (24 février 1304) ». Mais revenons au récit du voyageur.
Je me mis en route sous le règne du prince des croyants, du défenseur de la religion, qui combat dans la voie de Dieu, et dont la libéralité a fourni matière à des récits transmis par une tradition non interrompue ; les monuments de sa munificence jouissent d’une célébrité qu’attestent des témoignages authentiques ; son époque est ornée de la parure de son mérite, et les hommes vivent dans l’abondance à l’ombre de sa miséricorde et de sa justice. Je veux parler du saint imâm Abou Sa’id, fils de notre seigneur, le prince des croyants et le défenseur de la foi, qui, par ses résolutions vigoureuses, a ébréché le tranchant du sabre du polythéisme ; dont les glaives acérés ont éteint le feu de l’impiété en répandant des flots de sang dont les escadrons ont détruit les adorateurs de la croix, et dont la conduite dans la guerre sainte a été digne d’honneur : le saint imâm Abou Youcef, fils d’Abd alhakk. (Que Dieu renouvelle pour eux son approbation, qu’il arrose de la pluie de ses dons leurs mausolées sanctifiés, qu’il leur accorde la plus belle des récompenses en faveur de l’islamisme et des musulmans, et qu’il conserve l’empire à leurs descendants, jusqu’au jour du jugement dernier !)
J’arrivai dans la ville de Tilimsân (Tlemcen), qui avait alors pour sultan Abou Tâchifin Abd arrahımân, fils de Moûça, fils d’Othman, fils d’Yaghmorécen, fils de Ziyân.
J’y rencontrai les deux ambassadeurs du roi de l’Afrikiyah (c’est-à-dire, de Tunis), le feu sultan Abou Yahia, savoir le kâdhi des mariages à Tunis, Abou Abd Allah Mohammed, fils d’Abou Becr, fils d’Aly, fils d’Ibrâhîm anneszâouy, et le pieux cheïkh Abou Abd Allah Mohammed, fils de Hoceïn, fils d’Abd Allah alkorachy (le koreïchite), azzobeïdy (ce dernier surnom venait de ce qu’il était originaire d’une bourgade appelée Zobeïd, et située sur la côte voisine de Mahdiyah). Azzobeïdy était un homme distingué ; il mourut en l’année 740 (1339-40) . Au moment même où j’arrivais à Tilimsân, les deux ambassadeurs susmentionnés en sortaient. Un de mes confrères me donna le conseil de les accompagner. Je consultai à ce sujet la volonté de Dieu, et, après avoir passé trois jours à Tilimsân pour me procurer ce qui m’était nécessaire, je sortis de cette ville et marchai en toute hâte sur les traces des deux ambassadeurs. Je les rejoignis dans la ville de Milianah. C’était alors la saison des premières chaleurs de l’été. Les deux fakîhs tombèrent malades, ce qui nous retint pendant dix jours, au bout desquels nous partîmes. Comme la maladie du kâdhi avait fait des progrès, nous nous arrêtâmes durant trois jours dans un endroit bien arrosé, à quatre milles de Milianah. Le matin du quatrième jour, le kadhi rendit le dernier soupir. Son fils Abou’tthayib et son compagnonAbou Abd Allah azzobeïdy retournèrent à Miliânah, et y ensevelirent son corps. Je les quittai en cet endroit et je me mis en route, en compagnie d’une caravane de marchands de Tunis, parmi lesquels se trouvaient Alhadjdj Maçoûd, fils d’Almontacir alhadjdj aladaouly, et Mohammed, fils d’Alhadjar.
Nous arrivâmes à la ville d’Aldjézâïr (Alger), et séjournâmes quelquesjours dans son voisinage, attendant le cheïkh Abou Abd Allah et le fils du kâdhi. Lorsqu’ils nous eurent rejoints, nous nous dirigeâmes tous, par la Mitidjah, vers la Montagne des chênes (Djebel azzân) ; après quoi, nous arrivâmes à la ville de Bidjaïah (Bougie). Le cheïkh Abou Abd Allah y logea dans la maison de son kadhi, Abou Abd Allah azzouaouy. Abou’tthayib, fils du kadhi, łogea dans la maison du sakîh (jurisconsulte) Abou Abd Allah almofassir.
Bougie avait alors pour émir (commandant) Abou Abd Allah Mohammed ben Seyid annâs, le chambellan (alhadjib). Or, un des marchands de Tunis en compagnie desquels j’avais voyagé depuis Milianah, le nommé Mohammed, fils d’Alhadjar, dont il a été fait mention plus haut, était mort, laissant une somme de trois mille dinars d’or, qu’il avait confiée par testament à un individu d’Alger nommé Ibn Hadidah, afin que celui-ci la remît à Tunis entre les mains de ses héritiers. Ibn Seyid annâs, ayant eu connaissance de ce fait, enleva la somme des mains du dépositaire. C’est le premier acte d’injustice dont j’aie été témoin de la part des agents et des lieutenants des Almohades (almoahhidoun ou almoahhidîn, les unitaires).
A peine étions-nous arrivés à Bougie que je fus pris de la fièvre. Abou Abd Allah azzobeïdy me conseilla de m’arrêter en cette ville jusqu’à ma guérison ; mais je refusai de suivre cet avis, et je répondis : « Si Dieu a résolu ma mort, que du moins elle arrive pendant que je serai en route pour me rendre dans le Hidjaz. Si telle est ta résolution, me dit-il alors, eh bien, vends ta monture et tes bagages les plus pesants ; je te prêterai une monture et une tente, et tu nous accompagneras peu chargé. Nous marcherons en toute hâte, de peur d’éprouver en chemin la perfidie des Arabes. » Je me conformai à ses conseils, et Abou Abd Allah me prêta les objets qu’il m’avait promis. (Puisse Dieu l’en récompenser !) Ce fut le commencement des grâces divines dont je fus l’objet pendant le cours de ce voyage au Hidjaz.
Cependant nous voyageâmes jusqu’à ce que nous fussions arrivés près de Koçanthînah (Constantine), et nous campâmes en dehors de cette ville. Mais nous fûmes surpris par une pluie abondante, qui nous contraignit à sortir de nos tentes pendant la nuit, pour nous réfugier dans des maisons voisines. Le lendemain matin, le gouverneur de la ville vint au-devant de nous. C’était un chérif très distingué que l’on appelait Abou’lhaçan. Il examina mes vêtements, que la pluie avait salis, et ordonna qu’on les lavât dans sa maison. L’ihrâm (le mizar ou almaïzar, fichu que les Arabes d’Espagne et d’Afrique roulaient autour de leur tête) était tout usé. Cet officier m’envoya, pour le remplacer, un ihrâm d’étoffe de Baalbec, dans l’un des coins duquel il avait lié deux dinars d’or. Ce fut la première aumône que je reçus pendant mon voyage. Nous partîmes de Constantine et marchâmes sans nous arrêter jusqu’à la ville de Bône (Bounah), où nous demeurâmes plusieurs jours. Nous y laissâmes les marchands de notre compagnie, à cause des dangers que présentait le chemin ; quant à nous, nous voyageâmes avec promptitude et nous marchâmes sans nous arrêter. La fièvre m’ayant repris, je m’attachai sur ma selle avec un turban, de peur de tomber, tant ma faiblesse était grande. Il ne me fut cependant pas possible de mettre pied à terre, à cause de la frayeur que je ressentais, jusqu’à ce que nous fussions arrivés à Tunis. Les habitants de cette ville sortirent à la rencontre du cheïkh Abou Abd Allah azzobeïdy et d’Abou’tthayib, fils du kâdhi Abou Abd Allah annefzâouy. Les deux troupes s’approchèrent l’une de l’autre en se saluant et en s’adressant des questions. Quant à moi, personne ne me salua, car je ne connaissais aucun de ces gens-là. Je fus saisi en moi-même d’une telle tristesse que je ne pus retenir mes sanglots, et que mes larmes coulèrent en abondance. Un des pèlerins remarqua l’état où je me trouvais, et s’avança vers moi en me donnant le salut et en me réconfortant. Il ne cessa de m’égayer par sa conversation, jusqu’à ce que je fusse entré dans la ville ; j’y logeai dans le collége des libraires.
Ibn Djozay dit ce qui suit : « Mon cheïkh (professeur), le kâdhi de la djema’ah (communion des fidèles, c’est-à- dire le kâdhi des kâdhis ou kadhi suprême), le plus éloquent des prédicateurs, Abou’lbérékât Mohammed, fils de Mohammed, fils d’Ibrâhîm asselmy, connu sous le nom d’Ibn alhadjdj albelfiky, m’a raconté qu’il lui arriva une aventure semblable à celle-là. « Je me dirigeais, dit- il, vers la ville de « Bellech (Velez) en Espagne, la nuit de la fête (de la rupture du jeûne), pour y réciter le hadith (récit traditionnel), consacré spécialement à cette fête, d’après Abou Abd Allah, fils d’Alkemmâd. Je me rendis au moçalla (lieu de la prière) avec les habitants. Lorsque la prière et le sermon furent terminés, les assistants s’abordèrent les uns les autres en se saluant ; quant à moi, je restais dans un coin et personne ne me donnait le salut. Un vieil habitant de la ville sus-mentionnée se dirigea de mon côté, et s’approcha de moi en me donnant le salut et en me réconfortant. Je t’ai aperçu, me dit-il, et j’ai vu que tu te tenais à l’écart des autres et que personne ne te saluait. J’ai compris par là que tu es étranger et je veux te tenir compagnie. (Que Dieu l’en récompense !). Mais revenons au récit de notre voyageur.
DU SULTAN DE TUNIS.
Lorsque j’entrai dans cette ville, elle avait pour sultan Abou Yahia, fils du sultan Abou Zacaria Yahia, fils du sultan Abou Ishak Ibrâhîm, fils du sultan Abou Zacaria Yahia, fils d’Abd alouâhid, fils d’Abou Hafs. Il y avait à Tunis un certain nombre de savants du premier mérite, parmi lesquels je citerai le kâdhi de la communauté Abou Abd Allah Mohammed, fils du kadhi de la communauté Abou’labbas Ahmed, fils de Mohammed, fils de Haçan, fils de Mohammed alansâry alkhazradjy, originaire de Valence, mais d’une famille établie à Tunis. C’est lui qui est connu sous le nom d’Ibn alghammâz (le fils du sycophante). Je mentionnerai encore le prédicateur Abou Ishak, fils d’Ibrâhîm, fils de Hoceïn, fils d’Aly, fils d’Abd arréfy’ arriba’y, qui fut aussi investi de la dignité de kadhi suprême sous cinq règnes ; et le jurisconsulte Abou Aly Omar, fils d’Aly, fils de Kaddah alhaouâry, qui fut aussi kadhi de Tunis. Ce dernier était au nombre des plus éminents oulémâ. Il avait coutume de s’adosser, chaque vendredi, après la prière, contre une des colonnes de la grande mosquée connue sous le nom de Djami azzeï-toûnah (mosquée de l’olivier) ; les habitants de la ville lui soumettaient leurs affaires litigieuses et lui demandaient un Setoua (décision juridique). Quand il avait fait connaître sa décision sur quarante questions, il s’en retournait. La fête de la rupture dujeûne eut lieu pendant mon séjour à Tunis. Je me rendis au moçalla, où les habitants étaient réunis en grand nombre pour assister à cette fête. Ils étaient sortis revêtus de leurs plus beaux habits et dans le plus pompeux appareil. Le sultan Abou Yahia arriva à cheval, accompagné de tous ses proches, de ses courtisans et des officiers de son empire, qui marchaient à pied dans un ordre merveilleux. La prière fut récitée, et après que le sermon fut terminé, les assistants s’en retournèrent dans leurs demeures. Au bout de quelque temps, la caravane du Hidjaz fit choix pour la conduire d’un cheïkh nommé Abou Ya’koub assoûcy, qui habitait Iklibiah, ville de l’Afrikiyah. La majeure partie des gens de la caravane étaient des Masmoudites. Ils me choisirent pour leur kadhi. Nous sortîmes de Tunis à la fin du mois de dhou’lka’deh, en suivant le chemin qui longe le rivage, et nous arrivâmes à la ville de Soûçah. C’est une place de peu d’étendue, mais jolie et construite sur le bord de la mer, à quarante milles de Tunis. De Soû- çah nous nous rendîmes à la ville de Séfâkos (Syphax), près de laquelle se trouve le tombeau de l’imâm Abou’l-haçan allakhmy łe mâlikite, auteur du traité de jurisprudence intitulé Tabsiretfi’lfikh (Éclaircissement sur le droit). Ibn Djozay dit que c’est à propos de la ville de Séfåkos que Aly, fils de Habib attonoûkhy, a composé ces vers :
Que Dieu fertilise la terre de Séfâkos ! ville riche en palais et en oratoires;
Que Koceïr, qui s’étend jusqu’au golfe, soit protégé, ainsi que sa citadelle élevée.
Lorsque vous la visitez, la ville a l’air de vous dire : soyez le bienvenu !
Et la mer, qui tantôt s’éloigne d’elle et tantôt la baigne,
Ressemble à un amant qui désire visiter son amie, mais qui se retire dès qu’il aperçoit les sentinelles.
Dans un sentiment tout à fait opposé à celui qu’expriment ces vers, le savant et l’élégant Abou Abd Allah Mohammed, fils d’Abou Témîm, qui était au nombre des littérateurs les plus laborieux et les plus féconds, a composé les vers suivants :
Que la vie des habitants de Séfákos soit troublée ! que la pluie, même tombant avec abondance, ne fertilise pas son territoire !
Ville dangereuse ! quiconque descend sur sa plage a deux ennemis à y redouter : les chrétiens et les Arabes.
Combien de gens ont erré sur le rivage, dépouillés de leurs marchandises ; combien d’autres, sur l’Océan, ont eu à pleurer leur captivité et une mort imminente.
La mer elle-même a reconnu la turpitude des habitants de Séfákos, et toutes les fois qu’elle a été sur le point de s’en approcher, elle s’est enfuie.
De Séfâkos nous arrivâmes à la ville de Kâbis (Tacapé), et nous nous logeâmes dans son enceinte. Nous y passâmes dix jours, à cause des pluies incessantes. Ibn Djozay fait observer que c’est à propos de Kâbis qu’un poëte a dit :
Hélas! que sont devenues ces nuits délicieuses passées dans la plaine, près de Kâbis ?
Lorsque je me les rappelle, mon cœur brûle, comme un charbon ardent dans les mains d’un kabis (celui qui cherche du feu).
Nous sortîmes enfin de la ville de Kabis, nous dirigeant vers Athrâbolos (Tripoli de Barbarie). Cent cavaliers, ou même davantage, nous escortèrent pendant plusieurs marches. La caravane était, en outre, accompagnée d’un détachement d’archers. Les Arabes craignirent ceux-ci et évitèrent leur rencontre. Dieu nous protégea contre leurs attaques. La fête des sacrifices (10 de dhou’lhidjdjeh) nous trouva dans une de nos étapes. Quatre jours après nous arrivions à Tripoli, où nous fîmes quelque séjour. Je m’étais marié à Séfâkos avec la fille d’un des syndics de corporation de Tunis ; ce fut à Tripoli que je consommai mon mariage. Je quittai cette ville à la fin du mois de moharrem 726 (commencement de janvier 1326), en compagnie de ma femme et d’une troupe de Masmoudites. C’était moi qui portais l’étendard et qui servais de chef à la troupe. Quant à la caravane, elle resta à Tripoli, de peur du froid et de la pluie. Nous dépassâmes Meslâtah, Mosrâtah et Koçoûr Sort. En ce dernier endroit, des tribus arabes (ou bien une troupe d’Arabes, composée de gens appelés Djammâz) voulurent nous attaquer ; mais la providence les écarta et mit obstacle au mal qu’elles prétendaient nous faire. Enfin, nous nous enfonçâmes dans une forêt, et, après l’avoir traversée, nous arrivâmes au château de Barsîs l’anachorète, puis à Kobbet Sellâm (la chapelle funéraire de Sellâm), où nous rejoignit la caravane, qui était restée à Tripoli. Il survint entre moi et mon beau-père un dissentiment qui m’obligea à me séparer de sa fille ; alors j’épousai la fille d’un talib de Fès. Je consommai mon mariage à Kasr Azza’afiah, et je le célébrai par un repas auquel je retins pendant un jour la caravane tout entière. Nous arrivâmes enfin, le premier jour de djomâda premier (5 avril 1326), à la ville d’Alexandrie. (Que Dieu veille sur elle !) C’est une place frontière bien gardée et un canton très fréquenté ; un lieu dont la condition est merveilleuse et la construction fort solide. Tu y trouveras tout ce que tu désires, tant sous le rapport de la beauté que sous celui de la force, et les monuments consacrés aux usages mondains et aux exercices du culte. Ses demeures sont considérées et ses qualités sont agréables. Ses édifices réunissent la grandeur à la solidité. Alexandrie est un joyau dont l’éclat est manifeste, et une vierge qui brille avec ses ornements ; elle illumine l’Occident par sa splendeur ; elle réunit les beautés les plus diverses, à cause de sa situation entre l’Orient et le Couchant.
Chaque merveille s’y montre à tous les yeux, et toutes les raretés y parviennent. On a déjà décrit Alexandrie de la manière la plus prolixe ; on a composé des ouvrages sur ses merveilles et l’on a excité l’admiration. Mais pour celui qui considère l’ensemble de ces objets, il suffit de ce qu’a consigné Abou Obaid (Albecry), dans son ouvrage intitulé Al-méçálic (les Chemins).
DES PORTES D’ALEXANDRIE, ET DE SON PORT.
Alexandrie possède quatre portes : la porte du Jujubier sauvage (assidrah), à laquelle aboutit le chemin du Maghreb ; la porte de Réchîd (Rosette), la porte de la Mer et la porte Verte. Cette dernière ne s’ouvre que le vendredi ; c’est par là que les habitants sortent pour aller visiter les tombeaux. Alexandrie a un port magnifique ; je n’en ai pas vu de pareil dans le reste de l’univers, si l’on en excepte les ports de Coûlem et de Kalikoûth (Calicut), dans l’Inde ; le port des infidèles (Génois) à Soûdâk, dans le pays des Turcs (Crimée), et le port de Zeïtoûn (Thse-thoung, act. Thsiouen-tcheou-fou) dans la Chine, lesquels seront décrits ci-après.
DESCRIPTION DU PHARE.
Dans ce voyage je visitai le phare, et je trouvai une de ses faces en ruines. C’est un édifice carré qui s’élance dans les airs. Sa porte est élevée au-dessus du niveau du sol, et vis-à- vis est un édifice de pareille hauteur, qui sert à supporter des planches, sur lesquelles on passe pour arriver à la porte du phare. Lorsqu’on enlève ces planches, il n’y a plus moyen de parvenir à la porte du phare. En dedans de l’entrée est un emplacement où se tient le gardien de l’édifice. A l’intérieur du phare se trouvent beaucoup d’appartements. La largeur du passage qui conduit dans l’interieur est de neuf empans, et l’épaisseur du mur d’enceinte de dix empans. Le phare a cent quarante empans sur chacune de ses quatre faces. Il est situé sur une haute colline, à une parasange de la ville, et dans une langue de terre que la mer entoure de trois côtés, de sorte qu’elle vient baigner le mur de la ville. On ne peut donc gagner le phare du côté de la terre, qu’en partant de la ville. C’est dans cette langue de terre contiguë au phare, que se trouve le cimetière d’Alexandrie. Je me dirigeai une seconde fois vers le phare, lors de mon retour au Maghreb, en l’année 750 (1349), et je trouvai que sa ruine était complète, de sorte qu’on n’y pouvait plus entrer, ni monter jusqu’à la porte. Almélic annâcir avait entrepris de construire vis-à-vis un phare tout semblable, mais la mort l’empêcha de l’achever.
DESCRIPTION DE LA COLONNE DES PILIERS.
Parmi les merveilles d’Alexandrie, se trouve l’étonnante colonne de marbre que l’on voit à l’extérieur de la ville, et qui porte le nom de Colonne des piliers. Elle est située au milieu d’une forêt de palmiers, et on la distingue de tous ces arbres à son élévation prodigieuse. Elle est d’une seule pièce, artistement taillée, et on l’a dressée sur des assises en pierres carrées qui ressemblent à d’énormes estrades. On ne sait pas comment elle a été érigée en cet endroit, et on ne connaît pas d’une manière positive par qui elle a été élevée.
Ce qui suit appartient à Ibn Djozay : « Un de mes professeurs, qui avait beaucoup voyagé, m’a raconté qu’un archer d’Alexandrie monta un jour en haut de cette colonne, avec son arc et son carquois, et qu’il s’y tint tranquillement. Le bruit de cette ascension s’étant répandu, un grand concours de peuple se réunit pour le voir, et l’étonnement qu’il causa dura longtemps. Le public ignorait de quelle manière il s’était hissé au haut de la colonne. Quant à moi, je pense qu’il était poussé par la crainte ou mû par la nécessité. Quoi qu’il en soit, son action le fit parvenir à son but, grâce à l’étrangeté de ce qu’il accomplit. Voici de quel moyen il s’avisa pour monter sur la colonne : il lança une flèche à la pointe de laquelle il avait lié une longue ficelle, dont le bout était rattaché à une corde très solide. La flèche passa au-dessus de l’extrémité supérieure de la colonne, et, la traversant obliquement, elle retomba du côté opposé à l’archer. Lorsque la ficelle eut traversé obliquement le chapiteau de la colonne, l’archer la tira à lui jusqu’à ce que la corde passât par le milieu du chapiteau, en place de la ficelle. Alors il fixa la corde dans la terre, par une de ses extrémités, et s’attachant à elle, il grimpa par l’autre bout en haut de la colonne et s’y établit, puis il retira la corde et elle fut emportée par quelqu’un dont il s’était fait accompagner. Le public n’eut pas connaissance du moyen par lequel il avait réussi dans son ascension, et fut fort étonné de cette action. » Mais revenons au récit de notre voyageur.
L’émir d’Alexandrie, au moment où j’arrivai dans cette ville, était un nommé Salah eddîn. A la même époque se trouvait à Alexandrie le sultan déchu de l’Afrikiyah (Tunis), c’est-à-dire, Zacaria Abou Yahia, fils d’Ahmed, fils d’Abou Hafs, connu sous le nom d’Allihiany (le barbu) . Almélic annâcir avait ordonné de le loger dans le palais royal d’Alexandrie, et lui avait assigné une pension de cent dirhems par jour. Zacariâ avait près de lui ses enfants Abd Alouâhid, Misry et Iskendery ; son chambellan Abou Zacariâ, fils de Ya’koûb, et son vizir Abou Abd Allah, fils d’Yacîn. Allihiany mourut à Alexandrie, ainsi que son fils Aliskendéry, et Misry demeure encore dans cette même ville. Ce qui suit est une remarque d’Ibn Djozay. Une chose étrange, c’est ce qui arriva à propos des noms des deux fils d’Allihiany : Aliskendéry et Misry ; savoir, la réalité des présages que l’on peut tirer de certains noms. Le premier est mort à Alexandrie (Iskenderiyeh), et Misry a vécu pendant longtemps dans cette ville, qui fait partie de Misr (l’Égypte). » Quant à Abd Alouâhid, il passa successivement en Espagne, dans le Maghreb et l’Afrikiyah, et mourut dans ce dernier pays, dans l’île de Djerbah (Gerbi).
DE QUELQUES SAVANTS D’ALEXANDRIE.
Parmi eux, on peut citer le kâdhi de cette ville, Imâd eddîn Alkendy, un des maîtres dans l’art de l’éloquence. II couvrait sa tête d’un turban qui dépassait par son volume tous les turbans jusqu’alors en usage. Je n’ai pas vu, soit dans l’Orient, soit dans l’Occident, un turban plus volumineux. J’aperçus un jour le kâdhi Imâd eddîn assis devant un mihrab (chœur d’une mosquée), dont son turban remplissait presque tout l’espace. Parmi les savants d’Alexandrie, on remarquait encore Fakhreddîn, fils d’Arrîghy, qui était aussi au nombre des kâdhis de cette ville. C’était un homme distingué et très savant.
ANECDOTE.
On raconte que l’aïeul du kâdhi Fakhreddîn Arrîghy appartenait à la tribu de Righah, et qu’il s’adonna à l’étude. Dans la suite il partit pour le Hidjâz, et arriva un soir près d’Alexan- drie. Comme il était dépourvu de ressources, il prit avec lui-même la résolution de ne pas entrer dans cette ville, avant d’avoir entendu quelque parole de bon augure. Il s’assit donc tout près de la porte. Cependant tous les habitants étaient rentrés successivement ; le temps de la fermeture des portes était arrivé, et il ne restait plus que lui dans cet endroit. Le concierge fut mécontent de sa lenteur, et lui dit, par manière de plaisanterie : « Entre donc, ô kadhi ! - Kadhi, s’il plaît à Dieu, se dit l’étranger. » Après quoi il entra dans une medréceh, s’appliqua à la lecture du Coran, et marcha sur les traces des hommes distingués. Sa réputation devint considérable et sa renommée se répandit. Il se fit connaître par sa piété et sa continence, et le bruit de ses vertus parvint jusqu’aux oreilles du roi d’Egypte. Sur ces entrefaites, le kâdhi d’Alexandrie vint à mourir. Il y avait alors en cette ville un grand nombre de fakîhs et de savants, qui tous ambitionnaient la place vacante. Arrighy, seul entre tous, n’y songeait pas. Le sultan lui envoya l’investiture, c’est-à -dire le diplôme de kadhi. Le courrier de la poste le lui ayant apporté, Arrighy ordonna à son domestique de proclamer dans les rues de la ville que quiconque avait un procès eût à se présenter pour le lui soumettre. Quant à lui, il s’oc- cupa sans retard de juger les contestations des habitants. Les gens de loi, etc. se réunirent chez un d’entre eux, qu’ils avaient regardé comme ne pouvant manquer d’obtenir la dignité de kâdhi. Ils parlèrent d’adresser à ce sujet une réclamation au sultan, et de lui dire que la population n’était pas satisfaite de son choix. Un astrologue, homme de beaucoup d’esprit, assistait à cette réunion ; il leur tint ce discours : « Gardez-vous de faire cela ; j’ai examiné avec soin l’astre sous lequel il a été nommé : il m’a été démontré par mes calculs que cet homme exercerait pendant quarante ans les fonctions de kadhi. » En conséquence, les fakîhs renoncèrent à leur dessein de réclamer contre sa nomination. Ce qui arriva fut conforme à ce qu’avait découvert l’astrologue, et Arrîghy fut célèbre pendant tout le cours de sa magistrature par son équité et la pureté de ses mœurs. Parmi les savants d’Alexandrie, on remarquait encore Quédjîh eddîn Assinhâdjy, un des kâdhis de cette ville, non moins connu par sa science que par sa vertu ; et Chems eddîn, fils de Bint attinnîcy, homme vertueux et bien connu. Parmi les religieux de cette ville, je citerai le cheikh Abou Abd Allah alfàcy, un des principaux saints. On raconte que, lorsque dans ses prières il prononçait les formules de salutation, il entendait une voix lui rendre le salut. Parmi les religieux d’Alexandrie, on distingue encore le savant, pieux, humble et chaste imâm Khalifah, le contemplatif (proprement, l’extatique.)
MIRACLE DE CET IMAM.
Un de ses compagnons, de la véracité duquel on est sûr, m’a fait le récit suivant : « Le cheikh Khalifah vit en songe le Prophète de Dieu, qui lui disait : « Rends-nous visite, ô Khalifah. » Le cheïkh partit aussitôt pour Médine et se rendit à l’illustre mosquée ; il y entra par la porte de la Paix, salua la mosquée et bénit le nom du Prophète ; après quoi il s’assit contre une des colonnes du temple, appuyant la tête sur ses genoux, posture qui est appelée par les soufis atterfik. Lorsqu’il releva la tête, il trouva quatre pains ronds, des vases remplis de lait et une assiette de dattes. Lui et ses compagnons en mangèrent, après quoi il s’en retourna à Alexandrie, sans faire cette année-là le pèlerinage. »
Je citerai encore, parmi les religieux d’Alexandrie, le savant imâm, le pieux, chaste et humble Borhân eddîn Al-a’radj (le boiteux), qui était au nombre des hommes les plus dévots et des serviteurs de Dieu les plus illustres. Je le vis durant mon séjour à Alexandrie, et même j’ai reçu l’hospitalité chez lui pendant trois jours.
RÉCIT D’UN MIRACLE DE CET IMAM.
J’entrai un jour dans l’appartement où il se trouvait : « Je vois, me dit- il, que tu aimes à voyager et à parcourir les contrées étrangères. » Je lui répondis : « Certes, j’aime cela. » (Cependant à ce moment-là je n’avais pas encore songé à m’enfoncer dans les pays éloignés de l’Inde et de la Chine.) Il faut absolument, reprit-il, s’il plaît à Dieu, que tu visites mon frère Férîd eddîn, dans l’Inde ; mon frère Rocn eddîn, fils de Zacariâ, dans le Sind, et mon frère Borhân eddîn, en Chine. Lorsque tu les verras, donne leur le salut de ma part. » Je fus étonné de ce discours, et le désir de me rendre dans ces pays fut jeté dans mon esprit. Je ne cessai de voyager, jusqu’à ce que je rencontrasse les trois personnages que Borhân eddîn m’avait nommés, et que je leur donnasse le salut de sa part. Lorsque je lui fis mes adieux, il me remit, comme frais de route, une somme d’argent que je gardai soigneusement ; je n’eus pas besoin dans la suite de la dépenser ; mais elle me fut enlevée sur mer, avec d’autres objets, par les idolâtres de l’Inde. Enfin, je citerai le cheikh Yakoût l’Abyssin, un des hommes les plus distingués et qui avait été disciple d’Abou’l-abbas almursy, disciple lui-même de l’ami de Dieu Abou’l-haçan achchâdhily, ce célèbre personnage qui a été l’auteur de miracles illustres et qui est parvenu dans la vie contemplative à des degrés élevés.
MIRACLE D’ABOU’LHAÇAN ACHCHADHILY.
Le cheikh Yakoût m’a fait le récit suivant, qu’il tenait de son cheikh Abou’l’abbas almursy : « Abou’lhaçan faisait chaque année le pèlerinage ; il prenait son chemin par la haute Égypte, passait à la Mecque le mois de redjeb et les suivants, jusqu’à l’accomplissement des cérémonies du pèlerinage ; puis il visitait le tombeau de Mahomet et revenait dans son pays, en faisant le grand tour (par la route de terre, en traversant le Hidjaz, le désert, etc.) Une certaine année (ce fut la dernière fois qu’il se mit en route), il dit à son serviteur : Prends une pioche, un panier, des aromates et tout ce qui sert à ensevelir les morts.
- Pourquoi cela, ô mon maître ? » lui demanda son domestique.
- « Tu le verras à Homaïthira, » lui répondit Châdhily. (Ho- maïthirâ est un endroit situé dans le Saïd (haute Égypte), au désert d’Aïdhâb. On y voit une source d’eau saumâtre, et il s’y trouve un grand nombre de hyènes).« Lorsqu’ils furent arrivés à Homaïthira, le cheïkh Abou’lhaçan fit ses ablutions et récita une prière de deux ric’ahs. A peine avait-il terminé sa dernière prosternation, que Dieu le rappela à lui. Il fut enseveli en cet endroit. » J’ai visité son tombeau, qui est recouvert d’une pierre sépulcrale, sur laquelle on lit son nom et sa généalogie, en remontant jusqu’à Haçan, fils d Aly.
DES LITANIES DE LA MER, QUE L’ON ATTRIBUE À CHADHILY.
Comme nous l’avons vu plus haut, Châdhily voyageait chaque année dans le Saïd et sur la mer de Djouddah (mer Rouge). Lorsqu’il se trouvait à bord d’un vaisseau, il récitait tous les jours la prière connue sous le nom de Litanies de la mer. Ses disciples suivent encore le même usage, une fois par jour. Les litanies de la mer sont ainsi conçues :
« Ô Dieu, ô être sublime, ô être magnifique, doux et savant, c’est toi qui es mon Seigneur ! Il me suffit de te connaître. Quel excellent maître est le mien, quel excellent lot est le mien ! Tu secours qui tu veux, tu es l’être illustre et clément. Nous implorons ta protection dans nos voyages, dans nos demeures, dans nos paroles, dans nos désirs et nos dangers ; contre les doutes, les opinions fausses et les erreurs qui empêcheraient nos cœurs de connaitre tes mystères. Les musulmans ont été éprouvés par l’affliction et violemment ébranlés. Lorsque les hypocrites et ceux dont le cœur est malade diront : Dieu et son envoyé ne nous ont fait que de fausses promesses, affermis-nous, secours-nous et calme devant nous les flots de cette mer, comme tu l’as fait pour Moïse ; comme tu as assujetti les flammes à Abraham, comme tu as soumis les montagnes et le fer à David, les vents, les démons et les génies à Salomon. Calme devant nous chaque mer qui t’appartient sur la terre et dans le ciel, dans le monde sensible et dans le monde invisible, et la mer de cette vie et celle de l’autre vie. Assujettis-nous toutes choses, ô toi qui possèdes toutes choses . C. H. Y. A. S. » (Ces lettres ou monogrammes commencent le chap. XIX du Coran, qui traite de la miséricorde de Dieu envers Zacharie, etc.) « Secours-nous, ô toi qui es le meilleur des défenseurs, et donne-nous la victoire, ô toi le meilleur des conquérants ; pardonne-nous, ô toi le meilleur de ceux qui pardonnent ; fais-nous miséricorde, ô le meilleur des êtres miséricordieux ; accorde- nous notre pain quotidien, ô le meilleur de ceux qui distribuent le pain quotidien ! Dirige-nous et délivre-nous des hommes injustes. Accorde-nous des vents favorables, ainsi que le peut ta science ; tire-les pour nous des trésors de ta clémence, et soutiens-nous généreusement par leur moyen, en nous conservant sains et saufs dans notre foi, dans ce monde et dans l’autre ; car tu peux toutes choses. O mon Dieu ! Fais réussir nos affaires, en nous accordant le repos et la santé pour nos cœurs comme pour nos personnes, en ce qui touche nos intérêts religieux et nos intérêts mondains. Sois notre compagnon de voyage, et remplace-nous au sein de notre famille. Détruis les visages de nos ennemis et fais empirer leur condition ; qu’ils ne puissent nous échapper, ni marcher contre nous. Si nous voulions, certes, nous leur ôterions la vue ; ils se précipiteraient alors vers le Si râth. » (Chemin, sentier; et pont dressé au-dessus de l’enfer, suivant les musulmans, plus fin qu’un cheveu, etc.) « Mais comment le verraient- ils ? Si nous voulions, nous les ferions changer de forme ; ils ne pourraient ni passer outre ni revenir sur leurs pas. » (Coran, XXXVI, 66, 67.) Y. S. (Ces deux lettres commencent le ch. XXXVI.) « Leurs faces seront laides ; A. M. et leurs visages seront baissés devant le vivant et l’immuable. Celui qui sera chargé d’injustices sera frustrẻ. » (Coran, XX, 110.) TH. S. H. M. A. S. K. (Les deux premieres lettres commencent le ch . XXVII, et les deux suivantes les ch. XL à XLVI inclusivement ; les trois dernières se trouvent aussi après, en tête du ch. XLII .) « Il a fait couler séparément les deux mers qui se touchent. Entre elles s’élève une barrière, et elles ne la dépassent pas. » (Coran





























