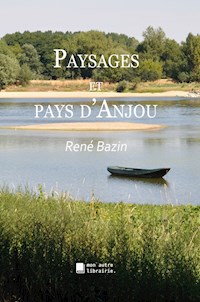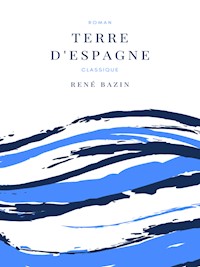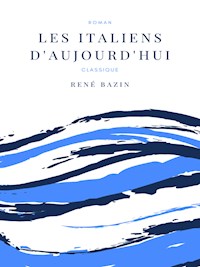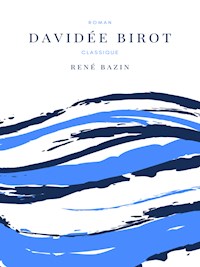Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ceci est tout sauf un livre d'aventure. C'est un livre de découverte tranquille, la rencontre curieuse et respectueuse d'un peuple aimé. L'Italie du XIXe siècle est très loin de celle d'aujourd'hui. Des problématiques qui à l'époque marquaient profondément les esprits, l'influence allemande, la Triple Alliance, l'Érythrée, sont depuis longtemps oubliées, mais elles ont laissé des traces durables dans les mémoires. Il émane de ce texte comme un extrait concentré d'Italie, qui pourrait surprendre même les connaisseurs. Ce que nous révèle ce livre en fait, c'est l'âme italienne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À l’aventure
Croquis italiens
René Bazin
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Calmann-Lévy, Paris, 1891.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-83-6
Table des matières
Avant-propos
I – Un domaine seigneurial en Piémont
II – Venise. – La note moderne. – Les réservistes. – Sensations rapides. – Une idylle
III – De Venise à Trieste la nuit. – Trieste et ses deux rivales. – La mêlée des races. – Pour une photographie. – La dernière conquête des Slaves
IV – Sur la route d’Adelsberg. – Un compartiment de troisième. – Opinions d’un musicien italien et de deux vélocipédistes hongrois. – L’irrédentisme. – La démonstration du vendredi
V – Les deux Bologne. – L’Université. – Les nations de Flandre et d’Espagne
VI – Un patriote grand seigneur. – Son opinion sur la triple alliance. – La marquise B.
VII – Le palais du marquis B. – Les partis italiens. – Mélancolie d’un jeune homme riche. – La peur de se compromettre
VIII – Florence la nuit. – Une œuvre pie : la Miséricorde. – Les pigeons du Dôme
IX – Assise
X – Observations psychologiques à propos de Massaoua
XI – La ville et le territoire de Massaoua. – Les alliés de l’Italie. – L’avenir de la colonie Érythrée
XII – La famille Tacconi. – Les ouvriers français à Rome. – La troisième visite
XIII – La combinazione. – Pourquoi les Italiens n’ont pas de romanciers
XIV – La pénétration allemande. – L’influence française
XV – L’enseignement secondaire à Rome
XVI – La loterie
XVII – Mon ami Dévastard. – Conclusion
Avant-propos
Il y autant de manières de voir et de voyager qu’il y a de fantaisies, et de projets d’étude ou de plaisir, et de souvenirs même en chacun de nous. Tout ce qui change nos âmes change aussi nos yeux. En revoyant les choses, nous ne les retrouvons plus exactement les mêmes. L’intérêt qu’elles avaient hier ne ressemble point à celui qu’elles ont aujourd’hui. On croit recommencer un voyage, mais l’illusion tombe vite : on est allé dans le même pays, et c’est tout.
J’en ai fait l’expérience. Je reviens d’Italie, ravi comme la première fois, mais pour d’autres raisons, avec une impression très vive, mais différente de l’ancienne. Tout de suite j’ai senti qu’il en serait ainsi. À peine le train qui m’emportait, au sortir du tunnel du Mont-Cenis, dévalait le long des Alpes dont des milliers de crocus violetaient les prés en pente, à peine aperçus les premiers mûriers enlacés de hautes vignes, les premières fermes ayant à leurs balcons des épis de maïs couleur d’or pendus en chapelets, les gaves à demi desséchés qui ne sont guère, même en automne, que des cascades de cailloux blancs, et le soleil clair sur les plaines vastes du Piémont, le doux et fort amour qui m’en était resté tressaillit au dedans de moi. Mais je ne lui appartenais plus tout entier, comme jadis. À la joie de retrouver cette campagne italienne, et les villes dont les toits de tuiles rougissaient par endroits l’horizon, se mêlaient à présent toutes sortes de questions et de désirs nouveaux.
Est-ce donc en pays ennemi que je suis entré ? me disais-je. Y sommes-nous détestés comme on l’affirme, et par tout le monde ? On prétend que l’état-major de Berlin donne des ordres ou, si l’on veut, des conseils à celui de Rome ; mais le peuple aime-t-il les Allemands ? Reconnaîtrait-on la pénétration tudesque dans les écoles, dans la langue, dans les habitudes de la vie ? Que sont devenues les universités ? Florissent-elles ? Sont-elles en décadence ? Quelle influence avons-nous conservée sur la littérature et l’esprit d’une nation dont il paraît que toutes les baïonnettes sont tournées contre nous ? Joue-t-on nos pièces ? Lit-on nos livres, et lesquels ? Existe-t-il un parti français, comme certains l’ont dit ? Où sont les villes qui grandissent et les villes qui meurent ? Retrouve-t-on toujours facilement le Piémontais, le Vénitien, le Toscan, le Romain, sous l’uniforme du soldat ou la tenue de l’employé d’État ? Et dans ce coin touché par un rayon d’Orient, en quoi consiste l’irrédentisme, quelle importance a-t-il ? Quels sont les poètes là-bas, et les meilleurs romanciers ?
Je n’ai pas la prétention d’avoir résolu tous ces problèmes, ni même de les avoir tous étudiés. Mais comme ils ont sans cesse habité mon esprit, il serait étonnant que je n’eusse pas rencontré, çà et là, pour quelques-uns du moins, un commencement de réponse. J’ai vu beaucoup d’hommes et de toutes conditions : avocats, ingénieurs, fonctionnaires, grands seigneurs, paysans, journalistes. J’ai causé avec chacun des sujets qu’il pouvait le mieux connaître. La plupart se sont expliqués, sur leur pays ou sur le nôtre, avec une franchise à laquelle je ne m’attendais pas ; j’ai trouvé des hommes intelligents et réfléchis, serviables, souvent instruits, qui m’ont laissé, sinon pour tous les Italiens, du moins pour une partie d’entre eux, des sentiments de sympathie qu’en toute franchise je n’avais pas portés chez eux. J’ai pu rencontrer des réticences, mais il y en a de transparentes ; des réserves aussi, mais qui pouvaient passer pour de la fierté, et n’avaient rien d’offensant.
Eh bien ! parmi les choses qui m’ont été dites ou que j’ai cru deviner, parmi celles que j’ai vues, peut-être s’en rencontrera-t-il qui ne seront pas sans quelque intérêt ou quelque nouveauté. Je le désire du moins, et c’est la raison de ces notes. Elles ont été écrites pour le Journal des Débats où, sauf la neuvième et la fin de la douzième, rédigées depuis lors, elles ont toutes paru. J’hésitais d’abord à les éditer. L’accueil qu’on leur a fait m’y détermine. Les voici donc. Je les ai groupées à ma façon, n’en ayant pas d’autre, avec le souci de ne pas désigner les personnes et d’exprimer leurs idées fidèlement. J’espère que les lecteurs français me sauront gré de cette sincérité, et que mes amis d’Italie ne s’en offenseront pas.
I – Un domaine seigneurial en Piémont
Milan, septembre 1889
J’avais exprimé à un de mes amis le désir de visiter son domaine, une des terres seigneuriales de la Haute-Italie, curieuses à tant de points de vue, que le voyageur, d’ordinaire, se contente de regarder d’un œil distrait, par la portière du wagon, entre deux villes à musées.
L’administrateur, averti par une lettre, était venu me prendre à Milan. Nous partons donc d’assez bon matin, et, au bout d’une heure, sur la route de Milan à Gènes, le train nous arrête à Vigevano, où nous attendait la voiture de l’exploitation. Vigevano est une de ces petites villes italiennes comme il y en a tant, qui ont un évêché, un reste de commerce traditionnel dont elles vivent tant bien que mal, des rues misérables et ensoleillées, et, au milieu, parmi les toits avançants, aux tuiles à demi ruinées qui se hérissent comme des paquets de plumes rouges, un groupe de monuments anciens, souvent superbes, intéressants toujours, serrés l’un contre l’autre, qui parlent des grands siècles de l’art national. En effet, tout à coup, au détour d’une rue, nous traversons une vaste place entourée d’arcades. Au fond, la cathédrale ; à gauche, le château et une tour de Bramante qu’habite aujourd’hui un régiment d’artillerie. C’est aussi beau que cent choses plus connues. Les paysans qui sont venus pour le marché, par groupes aux couleurs vives, paraissent moins soucieux de vendre leurs légumes ou leurs fruits que de jouir du soleil qui monte, rétrécissant l’ombre des portiques.
Nous passons vite. Nous sommes bientôt sur la route qui file, toute grise de poussière, entre des étendues toutes plates, vertes quand ce sont des prés, d’un blond pâle quand ce sont des rizières, découpées en tous sens par des canaux bordés de saules. Et ces couleurs de la campagne, neutres, fondues, sont étonnamment harmonieuses sous le bleu léger du ciel.
Mon compagnon est un Piémontais de quarante ans, ingénieur agronome sorti de l’Institut technique supérieur de Milan, très intelligent et très actif. Il m’explique en chemin le merveilleux système d’irrigation du pays ; comment, grâce au voile d’eau courante qui les couvre l’hiver, et les empêche de geler, les prairies arrosées, les marcite, donnent jusqu’à six et sept coupes d’herbes par an, dont deux ou trois sont mangées vertes et les autres séchées en foin. Dans ce sol fécond, en tout semblable à celui de la plaine lombarde qu’il avoisine, le maïs même donne deux récoltes. Le riz abonde ; partout autour de nous, à un demi-mètre en contre-bas, la chaussée est bordée de petits marais quadrillés où il pousse en touffes basses, très serrées, pliant sous le grain mûr.
Pendant que nous allons ainsi, causant d’économie rurale, j’aperçois à droite une villa presque entièrement close. Les clématites, les jasmins, toutes sortes de plantes grimpantes ont envahi les balcons et les persiennes baissées. Une seule porte et une seule fenêtre sont ouvertes. Le jardin, exquis d’ailleurs, abandonné à lui-même, pousse en hautes futaies ses massifs de rosiers.
Je demande à mon guide ce que c’est.
– La maison d’un officier, me dit-il, tombé à Dogali. Pauvre garçon ! À peine arrivé en Afrique depuis deux jours, et le voilà cerné, attaqué, écrasé avec d’autres braves comme lui.
Dans le ton de mon compagnon, je devinais non seulement le chagrin de la perte d’un homme qu’il avait sans doute connu, mais aussi un sentiment d’amertume, la sourde irritation d’un patriote obligé de rappeler le souvenir d’une défaite. Il ne voulut pas me laisser sous l’impression fâcheuse que ce nom pouvait éveiller en moi, et ajouta presque aussitôt :
– Nos officiers se sont battus là comme des héros.
– C’est vrai, lui dis-je, ils ont chèrement vendu leur vie.
– Vous avez vu nos régiments ? Comment vous ont-ils semblé ?
– Bien équipés et de bonne tenue.
– Nous avons une armée sérieuse, reprit-il assez vivement. Autrefois, d’une province à l’autre, nous nous connaissions à peine, et nous ne nous aimions guère : Piémontais, Vénitiens, Toscans, Romains, Siciliens. L’Italie n’était que dans la tête des étudiants, et maintenant elle est dans la tête de tous. Nous sommes un peuple. C’est l’armée qui a fait cela !
– Il n’est pas douteux, tout au moins, qu’elle y a grandement contribué. Elle est organisée tout exprès. Mais l’aimez-vous ?
– Sans doute.
– Je veux dire, l’aimez-vous passionnément ? Avez-vous dans le sang ce qui fait la bonne humeur du conscrit et la jubilation des bonnes gens assemblés sur les portes pour voir passer le régiment ?
Il réfléchit un instant, et répondit :
– Pour être franc, pas autant que vous. Chez vous, c’est du fétichisme. Vous vous mettriez à genoux devant l’armée. Vous ne savez rien de plus beau qu’un soldat. Il n’en est pas de même chez nous. Nous faisons notre temps de service parce qu’il le faut, parce que c’est la loi. Il y en a peu qui vont au delà. Ce qui n’empêche pas que nous avons une armée sérieuse, très sérieuse...
Nous continuons un peu notre route, les chevaux traversent au trot les rues d’un gros bourg, toutes peuplées d’enfants, et bientôt après nous arrivons à la ferme que nous venons visiter, la plus grande du domaine, qui en comprend neuf autres. À elle seule, elle compte six cents hectares. Il faut beaucoup de bras, surtout en Italie, pour cultiver une pareille étendue. Les constructions du podere ressemblent à un village. Plus de soixante familles occupées à l’exploitation y sont logées. Au milieu se dresse un vaste quadrilatère de briques, ancien château fort des Sforza. Les murs en sont couverts de losanges blancs et rouges. On dirait un château de cartes. La voiture, pour y pénétrer, traverse un pont jeté sur d’anciens fossés. Les traces du pont-levis féodal sont encore visibles au-dessus de la haute porte cintrée couronnée d’armoiries. À l’intérieur, une grande cour sur laquelle ouvrent des bâtiments de service et les appartements des fermiers. Car ils sont trois frères, tous trois Piémontais, locataires du podere, de vrais gentlemen comme les fermiers anglais. Ils possèdent vingt-cinq paires de bœufs, un troupeau de deux cents vaches, de race suisse, qui leur donnent de mille à quatorze cents litres de lait par jour, avec lequel ils fabriquent le parmesan et un fromage frais, vendu surtout en Angleterre et en Allemagne, le gorgonzola. En dehors des soixante familles établies sur le sol, ils emploient cinquante journaliers d’un bout de l’année à l’autre. Et même, en temps de récolte, il faut doubler le chiffre : en ce moment, ils ont cent hommes occupés à couper le riz.
Nous rencontrons l’un des fermiers dans son aire. Celui-là est avocat de l’Université de Turin. Il ressemble aux portraits de Victor-Emmanuel, grand, vigoureux, doté de moustaches et de sourcils énormes. Il s’avance vers nous, appuyé sur un bâton d’épine roussie qui m’a paru être un signe de commandement dans tout le domaine. La récolte du riz est superbe. Il en convient volontiers devant l’administrateur, avec ce sourire des paysans à ferme lorsqu’ils parlent d’une moisson abondante, bien abritée derrière un bail contre les convoitises du maître.
– Vous voyez ! dit-il en étendant la main autour de lui, d’un geste comme devait en avoir Booz, patriarche aux greniers pleins, voilà le travail de ce matin.
Partout, sur l’aire immense et cimentée – une surface de plus d’un hectare – des tas de riz attendent que le soleil soit plus haut dans le ciel ; alors on les étendra pour les faire sécher. Le grain est encore humide et enveloppé de son écorce blonde. Il sort de la batteuse hydraulique dont le ronflement ne cesse ni jour ni nuit depuis dix jours déjà. Quand il aura un peu séché, on le jettera aux pilons à décortiquer, mus par ces mêmes courants d’eau qui sont la richesse du pays, et de là dans ce grenier à deux étages, situé dans le prolongement du moulin, déjà rempli jusqu’aux solives. Et sans cesse, le long de la palissade qui limite l’aire en face de nous, passent de grands bœufs au pelage gris tendre, amenant à la batteuse de nouvelles charretées de gerbes.
Nous apercevons leurs attelages tranquilles échelonnés tout le long du chemin qui s’en va dans la plaine, parmi les saules rares. Ils viennent de loin, car toutes les rizières voisines sont coupées, et les moissonneurs travaillent là-bas, dans ces lointains gris où finit le domaine.
– Allez voir mes ouvriers, me dit l’avocat-fermier, ensuite vous me ferez l’honneur d’entrer à la maison. Je ne veux pas que vous quittiez le domaine sans avoir accepté quelque chose de moi.
Nous voici donc, l’administrateur et moi, sur l’étroite chaussée par où rentrent les chariots pleins, entre deux rizières boueuses. Le second frère nous croise : même stature, mêmes moustaches et même bâton que l’autre. Son chien de chasse le suit, et, des touffes serrées du chaume de riz, fait partir des poules d’eau et des râles.
Mon compagnon qui, depuis son entrée dans la ferme, était demeuré à peu près silencieux, me révéla enfin le fond de cette mélancolie subite, et, à peine le fermier passé, se tournant vers moi, me dit :
– Quelle récolte ! Il vendra pour plus de cent mille francs de riz cette année !
– Cent mille francs ! Cela se vend donc bien ?
– C’est la denrée la plus rémunératrice en ce pays et en ce moment-ci. Le blé, l’orge, le seigle ont bien baissé depuis la concurrence étrangère...
– Les bestiaux aussi, sans doute, depuis la rupture des traités de commerce avec la France ?
– Oui, au début, mais les cours ont remonté par suite des maladies qui ont sévi sur le bétail en Suisse et en Hongrie. Aujourd’hui – pour combien de temps, je n’en sais rien – les fermiers n’ont pas trop à se plaindre. Ce sont plutôt les propriétaires qui souffrent.
– Vous avez diminué les fermages ?
– Ils l’ont été, monsieur, d’un tiers ou d’un quart partout, mais le plus souvent d’un tiers.
Et il ajouta, avec un long soupir d’administrateur
– Ah ! si l’on m’avait cru ! Une ferme que nous louions cent dix mille francs il y a trois ans ! Quel bénéfice nous aurions eu à l’exploiter directement, avec des années de riz pareilles !
Je le laissai m’expliquer son système de culture directe, pour regarder les hommes couper le riz. Ils étaient là cinquante robustes Piémontais, tous vêtus de gris, taillant à coups de faucille dans l’épaisse toison du sol et liant les gerbes d’un tour de main. Rien qu’à les voir, on sentait une race laborieuse et rude à la fatigue. Ils ne se reposaient presque pas. Derrière eux, le chef de l’escouade, appuyé sur un bâton, comme les deux fermiers du podere, surveillait les travailleurs, et, d’un mot bref, gravement, relançait ceux qui eussent été tentés de s’écarter de la ligne ou de négliger l’ouvrage. Le soleil de midi chauffait la terre molle, où s’enfonçaient les talons de leurs bottes, et dégageait au-dessus du champ une vapeur tremblotante, qui recèle souvent la fièvre, « de petites fièvres, pas très dangereuses », m’assurait mon guide. Une seconde escouade moissonnait une autre rizière, à deux ou trois cents mètres à gauche.
Tout à coup, sortant de l’abri d’une haie de saules et d’osiers tressés, une jeune fille paraît sur la chaussée, à quelques pas de nous. Elle a les jambes nues jusqu’aux genoux, brunes de soleil, une jupe bordée de rouge, un bras appuyé à la hanche, l’autre levé pour retenir les paquets de riz qu’elle porte sur l’épaule, la tête coiffée d’un foulard rouge, inclinée, à demi cachée par la retombée des épis. Elle passe en montrant ses dents blanches. Une autre la suit, puis trois, quatre, dix, trente jeunes filles du domaine ou des villages voisins, toutes vêtues de même et presque toutes jolies, leurs têtes blondes ou brunes penchées à droite ou à gauche. Elles courent, lourdement chargées, vers la ferme. La route est si poudreuse que leurs pieds soulèvent un nuage de poussière. Une seule est restée en arrière. La corde qui liait ses gerbes s’est rompue. « Pauvre moi ! » s’écrie-t-elle avec un geste dramatique. Le désespoir n’est pas long. En un instant, son expression tragique s’efface. Elle se baisse, ramasse les paquets dispersés, renoue sa corde, et la voilà qui court pour rattraper les autres. Elles sont déjà loin sur la route amincie par la distance, et comme les champs se pressent autour d’elles, sans haies, sans différence appréciable de niveau, on dirait une bande de coquelicots qui auraient fleuri là depuis notre passage.
– Spigolatrici, me dit l’ingénieur.
– J’entends, lui dis-je, des glaneuses. Pauvres filles ! Elles en portent lourd ! Est-ce tout pour elles ?
– Non, elles partagent la glane avec le fermier. Encore n’obtiennent-elles la permission de se rendre aux champs que moyennant l’obligation de donner gratuitement leur travail, pendant plusieurs journées, au temps des foins. En dehors de ces cas exceptionnels, elles ne prennent guère part aux travaux de la culture, comme cela se voit en tant d’autres points de l’Italie. Les fermiers du domaine emploient surtout des hommes.
– Combien les paient-ils ?
– Cela dépend. Les chefs de famille habitant le domaine reçoivent d’abord le logement, un peu de bois, sept ou huit hectolitres de maïs, sans avoir égard, d’ailleurs, au nombre des enfants, deux hectolitres de riz et environ cent francs d’argent. En outre, ils ont droit à un tiers du rendement des terres ensemencées en maïs, qui sont, à cet effet, divisées entre eux.
– Et vos journaliers ?
– Cela dépend encore. Ceux qui sont engagés à long terme touchent une paye en argent, soixante-dix centimes par jour ; les autres, ceux que vous venez de voir, loués seulement pour la récolte, reçoivent un salaire en nature et à forfait : deux hectolitres de riz, quelle que soit la durée de la campagne, vingt jours, vingt-cinq jours, suivant l’abondance de la moisson et l’humeur du temps.
– Ce n’est guère payé. Vous n’avez pas de grèves ?
– Non, les grèves sont inconnues ici. D’abord, la population est excellente, très sobre, contente de peu. En outre, sans être très rémunérateur, ce salaire suffit à vivre. Il n’en est pas de même dans les provinces de Crémone, de Côme, dans les environs de Milan, où les braccianti ne reçoivent pas littéralement de quoi vivre, et sont beaucoup plus travaillés par le socialisme que nos Piémontais. C’est là que se sont produites les grèves agraires dont vous avez vu le récit dans les journaux. Et comme les causes, depuis lors, n’ont pas disparu, je serais étonné que le printemps prochain se passât sans violences nouvelles.
Nous étions, causant ainsi, revenus dans la cour du château.
L’avocat-fermier nous attendait dans son salon, une pièce assez élégamment meublée, avec fauteuils, canapé, tentures aux fenêtres, et même un portrait de famille, celui du père des trois frères, vieux paysan madré, en redingote noire. Il nous fallut boire une chope de bière de Vienne, servie dans des verres taillés de fabrication allemande, puis, nos hommages présentés à l’une des maîtresses du logis, qui travaillait à l’aiguille avec ses filles, dans la salle voisine, nous remontâmes en voiture.
Comme nous traversions de nouveau les cours peuplées d’enfants et bordées de masures qui précèdent la ferme, j’aperçus, au-dessus de la porte de l’une d’elles, évidemment déserte et offrant l’aspect lamentable que prennent les pierres mêmes de nos maisons dès que le foyer s’éteint, l’inscription : Scuola communale.
Je demandai à l’ingénieur
– Vous avez une école communale ici ?
– Nous en avions une : elle est fermée.
– Pourquoi ?
– Les enfants n’y venaient guère. L’hiver, la maîtresse en récoltait encore cinquante ou soixante, surtout les jours de pluie ; mais sitôt le printemps, dès qu’il faisait bon courir en chemise dans la campagne, allez donc tenir tous ces marmots-là ! Alors, par économie, on a supprimé l’école.
– Qu’est devenue la maîtresse ?
– Elle est allée rejoindre ses collègues du bourg. Cela fait qu’ils sont quatorze aujourd’hui, tant instituteurs qu’institutrices.
– Quatorze !
– Oui, pour une population de six mille âmes.
– Et le printemps, là-bas, doit leur être aussi funeste qu’ici ?
Mon compagnon se prit à rire.
– À peu près, dit-il, mais que voulez-vous ? Pour les garçons, au moins, il y a un remède : ils apprendront à lire au régiment.
Cela m’ouvrit un petit jour sur l’instruction obligatoire dans les campagnes d’Italie.
Et nous regagnâmes Vigevano.
II – Venise. – La note moderne. – Les réservistes. – Sensations rapides. – Une idylle
Septembre 1889
Ceux qui pleurent sur la disparition du pittoresque peuvent encore venir ici. Ils y trouveront quelque consolation. Car les gondoliers rament toujours sur leurs gondoles d’une élégance funèbre ; le palais des Doges, au-dessus de ses deux étages ajourés, déploie ses murs de marbre plein, comme un lourd tapis du Levant en équilibre sur une dentelle ; les pigeons tant célébrés de la place Saint-Marc, ni moins nombreux, ni plus farouches qu’autrefois, s’élancent et tourbillonnent en nuée grise pour une bouchée de pain que leur jette un enfant ; le pont des Soupirs continue à être une chose massive, et les palais princiers, pour être trop souvent loués à la brocante, n’en ont pas moins devant leurs portes des piliers fraîchement peints aux couleurs des vieux maîtres.
Sans doute, il y a plus d’une note toute moderne dans ce paysage romantique. Des bateaux à vapeur traversent d’un bout à l’autre le grand canal, au désespoir des gondoliers, dont l’honorable corporation est tombée de douze cents membres à huit cents ; d’autres vont à Mestre et à Chioggia ; la nuit, la flamme des becs de gaz tremblote sur les lagunes où nos pères n’avaient vu que des étoiles ; à côté du verrier de Murano, homme de tradition, anobli par François Ier et chanté par les poètes, un innovateur hardi, quelque cadet sans vergogne et sans souci de poésie a planté son enseigne de fabricants d’yeux humains ; vous pourrez vous promener longtemps et regarder les femmes du peuple et les femmes du monde sans découvrir le blond de Venise ; en revanche, vous avez chance de rencontrer un officier de la marine italienne, en uniforme chamarré d’or, qui vient d’accoster au quai des Esclavons, ou quelque bataillon de territoriaux en cours d’appel, précédés d’une musique dont la fanfare s’assourdit rapidement au détour des ruelles. Et, pour le dire en passant, ces territoriaux ont assez bonne mine, dans un costume qui m’a paru seulement un peu léger pour la saison d’automne.
Tout est en toile grise : les guêtres, le pantalon, la veste, jusqu’au chapeau, de forme melon, orné d’une plume de dinde. Il paraît que cet équipement était primitivement destiné à l’armée d’Afrique. Les essais ne furent pas heureux, et la territoriale hérita des cent mille complets gris et des cent mille plumes de dinde qu’elle porte en ce moment.
Mais ce ne sont là que des détails qui disparaissent dans l’impression d’ensemble. Et celle-ci est incomparable. Venise a gardé le charme qui l’a fait aimer à travers les âges. Je ne parle pas de l’attrait de curiosité, vite épuisé, qui pousse, quatre ou cinq jours durant, la foule banale de touristes de San Giorgio Maggiore à la Madonna dell’ Orto, mais bien d’un autre, plus pénétrant et plus intime, qui fait songer : « Comme il ferait bon vivre ici, arrêter sa course et se fixer pour six mois au bord de la Giudecca, parmi les jardins tout petits qu’ombrage un grand figuier, pour y commencer un tableau, pour y finir uu livre ! »
En vérité, nulle part ailleurs on ne saurait trouver une atmosphère mieux faite pour la pensée. Être enveloppé à la fois de silence et de mouvement, quel rêve de travailleur et de poète, qui ne peut se réaliser qu’à Venise ! Ici, la vie est partout, débordante et variée ; elle est dans les bateaux qui se croisent sur les canaux, dans le fourmillement du peuple le long des rues étroites, dans les pigeons qui volent, dans la mer qui monte et descend sur les fondations effritées des maisons : mais tout cela, les barques, les hommes, les oiseaux, la mer, glisse et ne bruit pas. Il n’y a point de foule, faute d’espace ; il n’y a point de vagues, faute de vent, et les rames sont muettes comme des ailes. L’esprit se trouve excité et non troublé. Le moindre son de cloche, perdu d’ordinaire dans la rumeur des grandes villes, prend des proportions d’événement. Quand les heures sonnent à Saint-Marc, l’eau qui les porte légèrement, comme le reste, les amène jusqu’au bout des lagunes vers le voyageur qui rentre. Dans cette paix profonde, dont l’oreille s’étonne, il semble même que les choses revêtent un aspect nouveau, des allures nouvelles. Les voiles, par exemple, qui sont jaunes, rouges, oranges, violettes, avec des lunes blanches, des croix, les trois clous de la Passion, un chiffre, un lion peints, ont une majesté sans pareille. Elles vont royalement vers le large, toutes droites sur les eaux dormantes, un reflet éclatant derrière elles. On dirait qu’elles emportent un des vieux doges de Véronèse, dont la robe de drap d’or traînerait sur la mer. Et ce ne sont que des pêcheurs qui partent ! Oh ! oui, j’ai infiniment goûté le recueillement de cette féerie incessante, et j’ai compris ce bonhomme vénitien qui, faisant route avec moi, par hasard, au retour du théâtre, me disait : « Voyez-vous, monsieur, ce n’est pas ici comme dans les autres villes où l’on entend des cris, des voitures qui roulent, des claquements de fouet ; non, nous n’avons jamais besoin d’élever le ton, nous autres, nous parlons mezza voce, doucement. Venise est toute douce : qui aime le bruit ne s’y plaira pas, mais pour qui cherche la paix, c’est la première ville du monde. »
Beaucoup de peintres ont subi cette séduction de Venise, et se sont établis là pour un an, pour deux, quelques-uns même pour toujours. Ce sont presque tous des étrangers, américains, anglais ou russes. Ils vivent entre eux, et leurs ateliers s’ouvrent difficilement aux profanes. Les Français, plus accueillants, sont en très grande minorité. J’en pourrais citer cependant, et l’un des plus célèbres parmi nos maîtres de la jeune école venait, m’a-t-on dit quand j’arrivai à Venise, de quitter la ville après un séjour de plusieurs mois, emportant ses cartons pleins. Sans parler de la lumière ni du paysage, ni des musées, ils ont tant de modèles autour d’eux, dans cette population pauvre et belle ! Les femmes de Chioggia sont renommées pour leur beauté grecque. Celles de Venise le sont aussi pour la finesse de leurs traits et la grâce de leurs mouvements. Et l’on pourrait choisir presque au hasard, parmi ces filles de pêcheurs ou d’artisans qu’on rencontre le matin, tête nue, vêtues de châles traînants et de robes claires, trottant le long de la Merceria ou arrêtées devant une boutique de frutti di mare, et déjeunant de trois petits poulpes cuits, qu’elles croquent en deux bouchées, du bout de leurs dents blanches.
Il me semble aussi que les écrivains devraient trouver un bien curieux champ d’expérience dans le monde cosmopolite de Venise. Que sont venus faire ici les Allemands, les Slaves, les Anglais, les Grecs enrichis dans le commerce du corail, qui ont acheté les palais de l’ancienne noblesse ou les louent par étages ? Venise n’est pas une ville de plaisir au sens commun du mot. On peut y passer par caprice, mais non pas y demeurer. À côté des artistes attirés par les raisons que je disais tout à l’heure, il y a là sûrement, dans ce coin qui tient à peine à la terre, et dont l’éloignement leur a plu, beaucoup de réfugiés de la vie. On devine autour de soi, à des signes légers, mais certains, des misères d’argent ou de cœur, des tristesses ou peut-être des bonheurs qui se cachent. Le roman est comme répandu dans l’air. On l’y respire. On se demande malgré soi quelles intrigues se nouent ou se dénouent derrière ces murailles de marbre qui ont vu trop de drames pour en avoir tout à fait perdu l’habitude, ou dans ces fêtes sur l’eau, continuelles en été, qui groupent tant de gondoles au même point, et les tiennent si bien serrées bord à bord, parfois des heures entières, que l’année dernière un marinier, vainqueur aux régates, a pu traverser tout le grand canal en sautant de l’une à l’autre. Quelles conversations s’échangent là, par les petites fenêtres aux glaces abaissées ? Quelle physionomie peuvent avoir nos costumes, nos idées, nos mœurs d’aujourd’hui dans le cadre bâti pour les patriciens des vieux siècles, dans ces immenses salons en enfilade, décorés de cuir de Cordoue et d’ornements de stuc, parmi les meubles disparates de tous les âges et de tous les pays, depuis l’estrade monumentale élevée au milieu d’une salle de bal, jusqu’aux lampes japonaises et aux tapis du Bon-Marché ? En quoi un si étrange milieu influe-t-il sur la comédie qui s’y joue ?
Cette atmosphère est si pénétrante que, même au loin, je me sens encore enveloppé par elle, et tenté de raconter une idylle dont je fus témoin à Venise. Je sais bien qu’en le faisant je sortirais de mon programme, mais en ne le faisant pas, je sortirais de la vérité. Je n’ai su trouver à Venise que de la lumière et de la douceur de vivre. Pourquoi parlerais-je d’autre chose ? Si je me suis renseigné sur son commerce et ses manufactures, ce n’est ni en ce moment-là, ni chez elle. Je n’avais l’esprit qu’à sa beauté merveilleuse. La prochaine fois nous traiterons d’autres sujets. Aujourd’hui, nous dirons un conte. J’espère qu’on me pardonnera. Et puis, allez vous-mêmes là-bas, et tâchez d’échapper à la chanson de ces petits frissons de la mer qui viennent, avec une étincelle à leur sommet, se briser le long des vieux marbres !
Une dame anglaise et sa fille vivaient donc, depuis quelques mois, dans un des grands hôtels du quai des Esclavons. La mère, tout le monde l’a rencontrée : elle s’appelle, si vous le voulez, mistress L. P. Q. R. Stewart, sur la liste des étrangers. Elle n’a point de domicile, et, comme l’hirondelle avec laquelle on ne saurait lui trouver d’autre point de ressemblance, elle monte au Nord quand il fait chaud, et descend vers le Sud quand il fait froid. Elle est grande, maigre, ridée, merveilleusement renseignée sur les pensions pas trop chères et néanmoins confortables, habile à choisir sa chambre, sa place à table et celle de sa malle sur les bateaux ; les ondes de cheveux qu’elle se plaque au-dessus des sourcils ont la double invraisemblance de l’uniformité blonde et de l’abondance juvénile ; ce n’est pas qu’elle prétende faire illusion à personne, mais c’est l’étiquette anglaise qui le veut ainsi ; pour la même raison, elle se plaint amèrement du thé qu’on lui fait boire en France, en Autriche, et paraît contente du reste : bonne femme au fond, à qui ne manquent, pour être charitable, qu’un domicile où elle se poserait et le temps d’apercevoir des misères autour d’elle.
Cette fois, sa fille est charmante. Ceux qui donnent vingt ans à miss Maud peuvent se tromper, mais je ne crois pas qu’elle en ait vingt-cinq. Elle est très gracieuse et très blonde, d’un type calme et de teint blanc comme une Hollandaise. Ses yeux bleus, d’une douceur un peu distraite et voilée, ont l’air de dire : « Que ce serait bon de regarder la même chose une heure de suite ! » N’en concluez pas qu’elle soit triste : son sourire, au contraire, est très jeune. Quand elle descend le soir, au salon de lecture, un rang de perles dans les cheveux, tous les journaux s’abaissent, et les têtes se relèvent. Elle s’en tire délicatement, en causant avec des enfants s’il y en a, avec sa mère, s’il n’y en a pas.