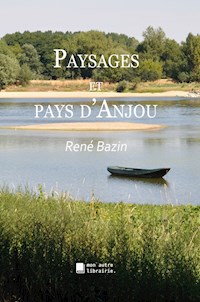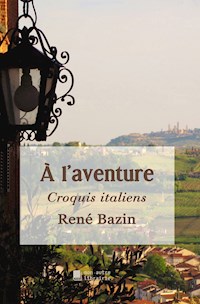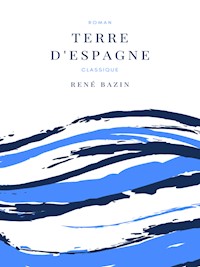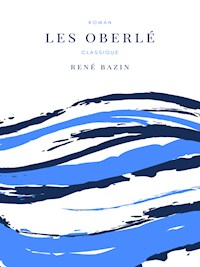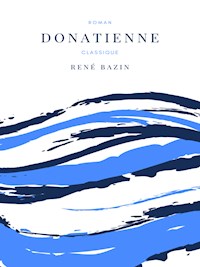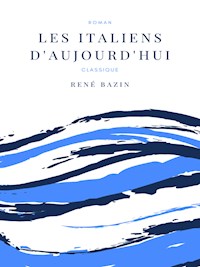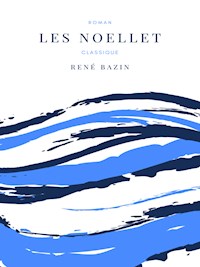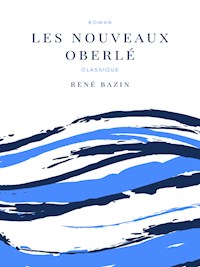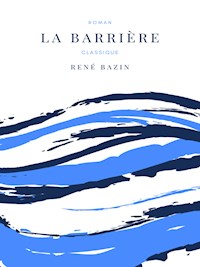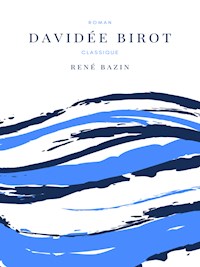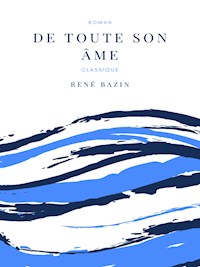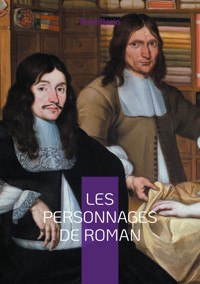
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les personnages de roman » de René Bazin est un ouvrage essentiel pour quiconque s'intéresse à l'art de la création littéraire et à l'analyse des oeuvres romanesques. Dans ce livre, Bazin, romancier reconnu et membre de l'Académie française, partage son expertise et ses réflexions sur l'un des aspects les plus cruciaux de l'écriture : la conception et le développement des personnages. Bazin commence par explorer les fondements de la création de personnages, mettant en lumière l'importance de la psychologie des personnages dans la construction d'un récit convaincant. Il examine comment les grands romanciers ont réussi à donner vie à des figures inoubliables, analysant les techniques narratives qui permettent de rendre un personnage crédible et attachant. L'auteur aborde ensuite les différentes facettes de la caractérisation, de la description physique à la révélation des pensées intimes, en passant par les dialogues et les actions. Il montre comment ces éléments s'articulent pour créer des personnages complexes et nuancés, capables de captiver le lecteur et de porter l'intrigue. Ce livre s'inscrit naturellement dans les catégories « Théorie littéraire », « Écriture créative » et « Analyse littéraire » sur les plateformes de vente en ligne. Bazin y déploie toute son expertise d'écrivain pour offrir des insights précieux tant aux aspirants romanciers qu'aux lecteurs passionnés. « Les personnages de roman » ne se contente pas d'être un simple manuel d'écriture ; c'est une réflexion profonde sur l'art du roman et sur la manière dont les personnages façonnent notre expérience de lecture. Bazin explore comment les personnages bien construits peuvent transcender les pages du livre pour devenir des figures emblématiques de la culture. L'ouvrage se distingue par sa capacité à allier théorie littéraire et exemples concrets tirés de la littérature française et internationale. Bazin analyse les oeuvres de grands romanciers, dévoilant les mécanismes subtils qui font la force de leurs personnages. « Les personnages de roman » reste une lecture incontournable pour les étudiants en lettres, les écrivains en herbe et tous ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de l'art romanesque. Sa perspective unique sur la création littéraire en fait un outil précieux pour développer un regard critique sur la construction des personnages dans les oeuvres de fiction.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Soit qu’on écrive des romans, des nouvelles, des contes, les règles restent les mêmes. Si les traits d’un personnage de roman peuvent s’appliquer à toute espèce de personnes, le personnage est mauvais. Il faut des personnages généraux, mais avec des détails particuliers.
Antoine Albalat, La formation du style par l’assimilation des auteurs.
Sommaire
Les personnages de roman
Le lecteur de romans
Les personnages de roman
Comment naissent les personnages de roman ; comment ils s’appellent et se groupent pour composer le drame, c’est ce que je voudrais essayer de dire.
Et d’abord, il n’est pas inutile de passer en revue quelques-unes des catégories innombrables auxquelles ils appartiennent, car, selon leur rang social, leur degré d’affinement ou de rusticité, ils offrent à l’écrivain des ressources ou des difficultés particulières, ils ont des qualités ou des défauts littéraires qui influent naturellement sur le choix du sujet.
Tout en haut, à la pointe de la pyramide que forme le monde, et dont la base est si large et le sommet si étroit, il y a les rois et les princes. On les voit de partout, mais aussi on les voit de loin. Le roman, à certaines époques, les a dépeints complaisamment. C’est que, bons ou mauvais, ils ont une vertu romanesque indéniable : une tête empanachée ; le droit d’avoir des rêves comme le commun des hommes et, plus que d’autres, le pouvoir de les suivre ; une cour où l’imagination peut impunément loger l’invraisemblable, réunir toutes les beautés à toutes les perfidies, tous les caprices, tous les crimes, tous les luxes, toutes les grandiloquences et toutes les idées même, sans que la conscience du lecteur, enfantine à jamais devant l’image d’un roi, s’en émeuve et proteste. Les passions qu’on leur prête s’agrandissent de la magnificence du cadre où elles se meuvent ; elles influent sur plus d’intérêts ; elles ont quelque chose de l’État même et de son pouvoir. Le préjugé les amplifie encore. Il croit volontiers qu’elles occupent, dans la vie des souverains, une place prépondérante, et que, pour beaucoup d’empereurs et de rois, comme pour beaucoup de femmes, l’idée générale du règne est d’aimer.
Je n’en suis pas persuadé. Le tableau que nous font les historiens des occupations d’un chef d’État ne semble pas laisser tant de loisir aux méditations sentimentales. À quoi bon, d’ailleurs, insister ? Pour observer les rois, aujourd’hui, nous serions obligés de voyager, ce qui est une condition fâcheuse pour tout comprendre. Nous ne connaissons rien en France qui rappelle une cour, même de loin. À peine pourrait-on étudier sur place un certain fond de courtisanerie survivant à son vrai milieu. Les modèles nous manquent. Les romanciers qui ont, le plus récemment, mis en scène des rois, leur ont prêté un trône dans un pays de rêve, ou bien ils les ont représentés en exil, après la couronne, et tellement après, que la trace en était effacée sur le front du héros.
Pleurons donc les romans royaux. Les ambassadeurs qui seraient presque seuls documentés pour écrire un tel livre ne peuvent pas l’écrire. Et les romanciers qui seraient tentés de le faire n’en ont pas les moyens.
Il faut même leur rendre cette justice qu’ils poussent le scrupule jusqu’à ne pas mêler, d’ordinaire, à leur drame, un personnage étranger. Sauf dans de courtes nouvelles, nous ne rencontrons guère un héros principal qui soit Italien, Allemand, Espagnol ou Anglais. Les ténèbres sont si profondes entre deux âmes qui ne parlent pas la même langue et n’ont pas vu les mêmes collines ! Quelle figure incomplète nous donnerions à ces étrangers ; comme ils resteraient imaginaires ; comme il nous serait impossible d’être vrais ou seulement équitables ! Nous avons déjà tant de peine à rendre l’aspect extérieur d’une terre étrangère, à comprendre à moitié les usages de ses habitants, leurs plaisirs, leur politesse et le goût particulier qu’ils trouvent à la vie ! La meilleure attention n’y suffit pas. Je me souviens que, dans mes notes sur l’Espagne, j’évoquais le souvenir de cette assemblée de savants tenue à Salamanque, et dans laquelle Christophe Colomb, méconnu et combattu, essaya de communiquer à ses auditeurs sa foi dans l’Amérique future. J’imaginais un vieux moine disant, de longues années après, un soir, à l’heure où toute la ville est rose, et où monte dans l’esprit la pensée du jour fini et celle du passé lointain : « J’étais de ce conseil ; j’y entendis parler don Christophe et, pour la joie de ma vie, je fus de ceux qui l’encouragèrent à partir sur les caravelles. » Hélas ! le volume n’avait pas paru depuis quinze jours, que je recevais d’un Espagnol ce petit billet : « Monsieur, vous commettez une erreur en parlant de “don” Christophe Colomb. Nous donnons ce titre, il est vrai, à nombre de personnages moins importants. Mais nos vieux héros s’en passent. Et nous ne disons pas plus don Christophe que vous ne dites mademoiselle Jeanne d’Arc. »
Après les rois et princes, les gens titrés forment une seconde catégorie, ducs, marquis ou comtes, dont le roman français, jusqu’en ces derniers temps, a fait une grande consommation. Elle est aujourd’hui un peu moins demandée. Elle est d’observation facile ; elle est précieuse même pour les écrivains qui savent très peu le monde. Voyez les auteurs qui font les grands romans pour petits journaux. Il y a presque toujours un duc dans leurs drames, ou quelque haut personnage qui représente la richesse et l’oisiveté, deux termes tout voisins dans la pensée de la foule, et qui expriment, hélas ! à peu près tout son idéal. Ces auteurs se servent très habilement de ce héros classique. Grâce à lui, ils ouvrent devant le public, éternellement ébloui par un certain état de maison qu’il croit être le bonheur, des perspectives de vie fastueuse, ou large, ou même ruinée, fortune présente, fortune passée, peu importe, puisque l’or a ruisselé devant ceux qui le connaissent à peine. Grâce à lui, ils ont la ressource des beaux coups d’épée, des mots braves, de certaines façons cavalières de sortir d’une difficulté, qui plaisent infiniment à tant de bonnes gens emprisonnés et emmurés dans la perpétuelle incertitude.
Enfin, grâce à lui, ils font entrer en scène, même sans en parler, le passé, le passé que toute noblesse évoque naturellement, et qui est en nous à l’état de passion, amour ou haine. Les feuilletonistes montrent ainsi un sens très exact de la psychologie populaire. Mais croyez bien que les romanciers, à leur tour, ne dédaignent pas de tels avantages. Ils en usent plus discrètement, devant des lecteurs mieux informés, plus exigeants. La préférence qu’ils ont longtemps marquée pour les personnages titrés avait cependant les mêmes causes. Elle en avait aussi de plus particulières, de plus subtiles. C’est que la race alliée à la fortune crée des êtres plus complexes, des êtres de sentiment et de plaisir et, par conséquent, de souffrance. Soustraits à certaines obligations, aux travaux absorbants, aux luttes pour le pain quotidien où une grande part de l’attention et de la volonté humaine se dépense, on peut supposer qu’ils ont, mieux que d’autres, le loisir de goûter ce que la vie a d’amer et de doux quand elle est la vie pleine, la vie calme. Hommes ou femmes, ils ont le droit de rêver, de regretter, de s’analyser eux-mêmes, d’écrire des lettres sans nombre, de tenir un journal sans fin de leurs pensées et de leurs sentiments. Et quelles merveilleuses ressources pour le dialogue ! Quelles nuances rares de charme, d’attitudes, de politesse, d’émotion, un écrivain ne pourra-t-il pas donner à des personnages auxquels rien n’aura manqué de ce qui peut constituer l’exception humaine ! Si, de plus, il sait bien voir, s’il ne croit pas, de parti pris, la société uniquement composée de femmes infidèles, de maris à plaindre, de fats, d’escrocs et d’égoïstes, je demande s’il n’aurait pas quelque chance de rencontrer des exemples de haute et pure vaillance, de dévouement sans espoir, de richesse très simple ou de pauvreté très fière, dans un monde où certaines vertus sont d’une trempe plus fine ?