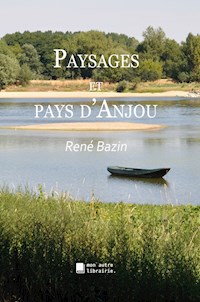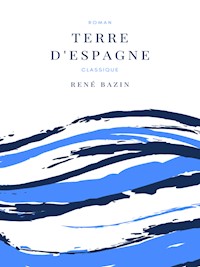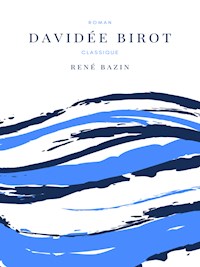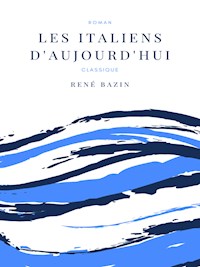
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Avec les «Italiens d'Aujourd'hui», René Bazin signe un récit de voyage. Il y parle des provinces du nord, de Rome et de la campagne autour de Rome, et en troisième partie, des provinces du sud de l'Italie. On y trouve des portraits d'italiens qu'il a trouvés typiques ou intéressants, des descriptions poétiques et colorées des paysages, des anecdotes amusantes et beaucoup de choses sur la pauvreté dans le milieu rural, due selon lui à la mauvaise gestion du pays. L'auteur détruit un certain nombre de stéréotypes prêtés aux Italiens, il les montre travailleurs, plus simples que les Français dans pas mal de cas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Les Italiens d'Aujourd'hui
Les Italiens d'Aujourd'huiI. PROVINCES DU NORD – LA VIE PROVINCIALEII. LES MAISONS DE ROME ET LA CAMPAGNE DE ROME.III. PROVINCES DU SUD.Page de copyrightLes Italiens d'Aujourd'hui
René Bazin
I. PROVINCES DU NORD – LA VIE PROVINCIALE
Elle est agréable à voir, après l’affreux Mont-Cenis, la grande plaine lombarde. Les barbares, au temps lointain, subirent son irrésistible séduction. Je crois qu’elle était alors ce qu’elle est aujourd’hui : toujours ensemencée, toujours fertile, toujours verte, et merveilleusement irriguée. Quelle fraîcheur sort de ces petits canaux, qui enveloppent le promeneur de leurs mailles bleues ! Ils traversent les routes, coupent les champs, se rapprochent, s’écartent, tombent dans un grand fossé qui porte plus loin l’eau fécondante, jamais lasse de courir, jamais perdue. Grâce à eux, les prés donnent quatre et cinq coupes de foin, les rizières se chargent d’épis, les luzernes ont l’air de maquis en fleur et les champs de maïs de plantations de cannes à sucre. Toute cette terre est merveilleusement riche. Et cependant la population est pauvre.
Il y a là un problème étonnant qu’on rencontre presque partout en Italie : en passant d’une ville à l’autre, sans même s’arrêter, ni interroger, on ne peut s’empêcher de remarquer le contraste entre le sol qui donne tout, ou pourrait tout donner en abondance, et le paysan, trop souvent misérable, rongé par la pellagre comme dans la Lombardie, ou réduit à émigrer, comme dans la Calabre. Les villages, sur la route, n’ont pas la mine joyeuse et nette des nôtres, ou de ceux de la Suisse. De loin, sur le sommet d’une colline, leurs toits de tuiles étincelants de soleil, ils ont une silhouette attirante. Tandis que le train court à toute vitesse, on se prend à songer : « Oh ! ce curieux pays, cet assemblage fantastique de pignons montant à l’assaut, ces ruelles aperçues comme des éclairs, ce château qui domine la vallée, tout ce coin inconnu, où personne ne s’arrête, que ce serait amusant à visiter ; que je voudrais !… » J’en ai visité plusieurs, des plus ignorés, des plus moyen âge. Et, de près, c’était si triste, si complètement misérable, que l’impression pittoresque, un instant souveraine, s’effaçait et tombait devant la pitié pour les hommes.
Car ce monde de pauvres gens est un monde de travailleurs opiniâtres. Je ne sais rien de plus erroné que ce préjugé qui consiste à nous représenter les Italiens comme un peuple de lazaroni étendus au soleil, en haillons de couleur, et tendant la main quand l’étranger passe. Regardez ceux-ci, qui creusent les rigoles des rizières, le long de la voie ; ceux-ci encore qui brisent les mottes de l’immense guéret où, demain, ils sèmeront le blé d’hiver ; ceux-là qui, vingt ensemble, hommes et femmes, pendent aux solives d’une ferme, à l’extérieur, les épis roux du maïs, les fusées de gran turco dont on fera la polenta. S’arrêtent-ils ? Ont-ils l’air de paysans d’opéra ? J’ai traversé leurs bandes, dans les grands domaines, au pied des monts ; je les ai retrouvés dans la campagne romaine, autour de Naples, à Reggio de Calabre ; en Sicile, un Français, chef des vignerons du duc d’Aumale, m’a affirmé qu’ils étaient plus laborieux, plus durs à la fatigue et plus patients que les nôtres ; d’autres m’ont dit, parlant des Romagnes que je n’ai pas visitées : « Il y a là les premiers remueurs de terre du monde » ; partout, et chaque fois que j’ai parcouru l’Italie, le même témoignage s’est élevé en faveur de cette race forte et malheureuse. Il lui a manqué le romancier, le poète, qui racontât avec amour les souffrances et le courage de ces humbles, les villages à moitié abandonnés pendant les mois d’hiver et de printemps, la vie, avec ses drames ignorés, des bandes campées dans l’Agro romano, sous la conduite du caporale, et ce qui se dit, le soir, dans les huttes où des bergers nomades fabriquent le fromage de brebis. Sans cela, le paysan italien aurait sa belle place, entre le moujik de nos rêves et l’obstiné tâcheron des terres françaises. Et la question se pose plus pressante : d’où lui vient cette misère ? Pour répondre, il faudrait prendre chaque province à part et étudier les causes locales, – régime de culture, division de la propriété, climat, salubrité, hygiène, différences profondes de races et de tempéraments, – qui permettent au paysan de l’Émilie ou de la Toscane, par exemple, d’élever une famille en demeurant fidèle au sol, et rendent si précaire la condition de certains autres. J’en indiquerai sans doute plusieurs, çà et là. Mais la grande raison de ce malaise se trouve dans l’excès de l’impôt dont la campagne est grevée.
« N’est-ce pas lamentable ? me disait un agriculteur du nord italien. Quelle prospérité, quel esprit d’entreprise, quel progrès voulez-vous attendre d’un pays où le sol est imposé à trente-trois pour cent du revenu net ? Et je ne parle pas des maisons, pour lesquelles, grâce aux évaluations fantaisistes du fisc, nous payons quelquefois jusqu’à cinquante et soixante pour cent du revenu réel. Le comte Iacini a pu écrire en toute vérité que l’État, les provinces, les communes, n’imposent pas la terre, mais qu’ils la dépouillent. »
Joignez à cela l’usure, encore très répandue, malgré la création des banques populaires, l’insuffisance et la mauvaise qualité de la nourriture qui engendrent, dans le nord, l’affreuse maladie de la pellagre, le déplorable état d’une foule d’habitations rurales, que le propriétaire n’a pas les moyens ou l’humanité de réparer, et, sans plus insister sur les causes, vous comprendrez comment le socialisme a trouvé ses premiers adeptes, en Italie, dans les classes agricoles. Le paysan n’avait pas souhaité le renversement des régimes anciens ; il n’avait pas été entamé par la propagande républicaine des mazziniens ; il est demeuré très indifférent à ses droits politiques ; mais, depuis vingt ans, il écoute de plus en plus les prédicateurs des doctrines socialistes, ceux qui lui tiennent ce langage, approprié à son éducation rudimentaire : « Tu n’as rien ; ils ont tout : prends leur place ». La Lombardie, la Vénétie, l’Émilie, les Romagnes, comptent des groupes ruraux très fortement imbus de socialisme. Le mal se répand. Des désordres annuels le manifestent sur un point ou sur l’autre. Et ce ne sont pas les journaux, peu lus par ces populations ignorantes, qui contribuent le plus à cette propagande, ni même les discours avoués des chefs, comme les députés Costa et Maffei : les vrais, les plus dangereux agents du socialisme rural, ce sont les instituteurs primaires[1].
Malgré cette part disproportionnée qu’ils prélèvent sur le produit du sol, ni l’État, ni les provinces, ni les communes ne sont riches. Il n’est pas nécessaire d’être économiste pour l’observer. Un sous-secrétaire d’État au ministère de l’instruction publique déclarait récemment, devant les électeurs de Gallarate, que trois cent quarante-huit communes, appartenant à trente et une provinces, payaient irrégulièrement leurs maîtres d’école, et se trouvaient en retard vis-à-vis de mille quarante-cinq de ces intéressants créanciers. C’est là un fait officiel. Mais la vie quotidienne en offre mille autres qui ne sont pas moins significatifs. Je me souviens qu’il y a deux ans, un employé des télégraphes italiens m’avait payé un mandat en or. Je lui en avais fait mon compliment, dont il avait souri. Cette fois, j’ai eu moins de chance. Je n’ai vu de pièces d’or que celles que j’ai données. La pièce d’argent de cinq lires est introuvable, celles de deux lires et de une lire n’abondent pas, et, souvent, dans les petits pays, on vous proposera, si vous changez un billet, de vous le payer en billon. Dix francs de sous, j’ai dû les accepter après avoir cherché mieux. C’est très lourd ! Et si vous demandez la raison de cette rareté de la monnaie d’appoint, on vous répondra, comme on m’a répondu : « Una piccola combinazione, monsieur. Écoutez bien. Voici la spéculation imaginée par un certain nombre de nos compatriotes. Ils récoltent les écus de cinq lires, les pièces blanches de une et de deux lires, les mettent en sacs, et leur font passer la frontière, souvent en contrebande. Or, dès que les lires italiennes ont franchi les Alpes, elles deviennent des francs, c’est-à-dire qu’elles gagnent de trois à quatre pour cent sur notre marché. Il ne reste plus à l’heureux collectionneur qu’à tirer une lettre de change sur la France ou la Suisse pour se faire un gentil revenu qui ne lui a rien coûté… Grâce à ce procédé, pour une bonne part du moins, notre voisine l’Helvétie s’est trouvée en possession, – elle a terminé son inventaire récemment, – de quatre-vingt millions de notre argent. Vous en avez bien davantage ».
On pourrait multiplier les exemples. À quoi bon ? les Italiens avouent volontiers leur pauvreté. La comparaison entre la France riche et l’Italie qui ne l’est pas leur est sans cesse présente : elle est même pour beaucoup dans le sentiment de jalousie, – bien plutôt que d’inimitié, – dont certains sont animés vis-à-vis de nous. Ils se sentent arrêtés ou gênés dans leurs entreprises, dans leurs grands travaux d’intérêt général, par le manque de capitaux. Et cette blessure d’amour-propre est avivée, chez eux, par la conscience très justifiée de leur mérite.
On ne peut pas séjourner, à plusieurs reprises, en Italie, sans être frappé, en effet, de la somme considérable de travail et d’intelligence qui s’y dépense, des projets de toute nature qui s’y agitent, de la valeur des hommes qu’on y rencontre. Et l’on vient à songer : « Une Italie qui arme et qui s’épuise pour armer est loin d’être, comme on l’a dit, une quantité négligeable. Mais une Italie qui se recueillerait et épargnerait serait bien redoutable. Tout est prêt chez elle pour un essor. Il lui manque l’argent. Si elle savait ! »
Milan, le jour des morts. – La cathédrale a été décorée, pour la fête d’hier, de la parure des grands jours, qu’on n’a point enlevée encore. Tout le long de la nef principale et dans les bras du transept, des tableaux drapés de rouge sont pendus entre les colonnes. Ils représentent les actes de la vie de saint Charles Borromée, archevêque de Milan. La hauteur où ils sont placés ne permet guère de juger le mérite de la peinture. Mais ils obstruent les ogives, et l’immense vaisseau, déjà pauvre de lumière, en est devenu tout sombre. Il y a foule aux messes du matin, une foule composée d’autant d’hommes que de femmes, et simple, et familière en sa dévotion, beaucoup plus que les fidèles de nos pays français. On ne voit pas de ces rangs symétriques de bancs ou de chaises, les premiers réservés aux abonnés payants, les autres, en arrière, laissés aux pauvres. Mais chacun va prendre sa chaise dans un gros tas dressé à l’entrée du transept, et se place à sa guise. Un employé de l’église en distribue aussi quelques-unes, çà et là. Il est en livrée courte, comme un valet de chambre, ce qui m’a paru un progrès, et ne demande aucune rétribution, ce qui en est sûrement un autre. Les groupes sont très curieux. Je vois une dame en toilette de ville, élégante, son mari en pardessus clair, entourés de menu peuple et ne cherchant pas à s’en dégager. Devant eux, les serrant, les pressant du bord de leurs manteaux troués, deux bergers crépus, très graves, très sales, très durs de traits ; à gauche, une demi-douzaine de jeunes filles, assises sur les talons et dont les châles traînants font une vague mouvante, car elles se penchent souvent pour causer, à voix très basse, sans cesser d’être attentives, par le fond de l’âme, à l’office qu’elles suivent ; derrière, une rangée de femmes de la campagne, éclatantes de rouge et de jaune. Tout ce monde se coudoie plus volontiers que chez nous, et l’esprit démocratique de l’Italie se révèle dans ce coin du Duomo, comme ailleurs.
Je sors. Un matin gris. Le tramway qui conduit au cimitero monumentale est assiégé. Aux deux bouts de la rue, tout un peuple est en marche vers le même point, très loin au delà des portes. Mais des milliers de vivants sont peu de chose dans ce champ des morts, le plus grand que j’aie vu en Italie, et, quand ils se sont répandus, en passant sous les arcades noires et blanches de l’entrée, dans les allées droites, parallèles, bordées de monuments et d’arbustes, ils disparaissent presque, ils n’enlèvent rien à la tristesse du lieu ni du temps. Les Milanais sont très fiers de leur cimetière, comme les Génois et les Messinois du leur. Il a dû coûter beaucoup de millions, tant à la commune qu’aux particuliers. Cependant, s’il y avait un concours, entre ces promenades funèbres, – car il y a du square et du jardin d’agrément dans les cimetières italiens, – Milan, je crois, n’aurait pas le prix. La situation du campo santo de Messine, sur la pente des montagnes siciliennes, dominant le détroit et la mer, ses arbres magnifiques, ses escaliers fleuris, lui donneraient un avantage signalé ; d’autre part, les chapelles privées m’ont paru plus nombreuses et plus riches à Gênes. Il y a là une profusion, une prodigalité de marbre incroyable. Nulle part on ne rencontre la pierre assouplie, condamnée à rendre plus de scènes de famille, plus de robes à queue et à volants, dont la soie est prodigieusement imitée, plus de dentelles, plus de jeunes gens en redingote et en chapeaux hauts de forme, venant prier et pleurer, avec leur mère, devant le lit de mort ou devant le tombeau du père. Le marbre n’a jamais été domestiqué à ce point. Mais c’est bien partout, à Milan comme à Messine, comme à Gênes, la même inspiration réaliste.
Je passe dans les allées où sont les tombes des gens de moyenne condition. Des fleurs, des rosiers, des chèvrefeuilles taillés, comme chez nous, des veilleuses en verres de couleur, posées sur un long pied, et qui ne doivent pas toutes brûler toute l’année : mais toujours le buste en plâtre, en pierre dure, en bronze, avec des lunettes, si le défunt en portait, ou la photographie encadrée, protégée par une glace. Ces cimetières italiens sont comme un grand album des générations disparues. On y retrouve les ancêtres avec leurs modes, leurs rides, leurs verrues ou leur sourire. Beaucoup de vivants même y sont représentés dans l’attitude de la douleur. Telle veuve remariée, alourdie par l’âge, peut s’y revoir encore dans sa beauté d’il y a vingt ans et dans le charme attendrissant de son premier chagrin. Et ces curieuses inscriptions, que j’avais déjà rencontrées ailleurs, et où l’héritier reconnaissant fait un mérite au défunt de son copieux héritage : « À Pierre V…, qui, par son esprit des affaires, son honnêteté, son travail, sut augmenter la fortune des siens. » Je pourrais citer dix variations sur le même thème. À côté, des idées charmantes, comme sur cette tombe d’enfant, où la main d’une mère, bien sûr, n’a gravé qu’une ligne : « Au revoir, maman ! » ou encore d’étranges énergies humaines qui s’étalent au jour, par exemple, dans les lettres de papier d’or, collées sur un ruban noir, et qui pendent là-bas, aux deux bras d’une croix. Je l’avais remarquée de loin, cette draperie de deuil, large et raide, dont les bouts se perdaient au milieu de gerbes de chrysanthèmes. J’approchai. Deux femmes agenouillées, immobiles, contemplaient le sable tout fraîchement remué, et, sur la banderole, il y avait : « À ma fille assassinée ! » Cette indication de la cause, ce réveil de passion vengeresse ne sont-ils pas suggestifs ? Et tout cela ne révèle-t-il pas, chez ce peuple très positif, une âme autrement orientée que la nôtre, moins portée à idéaliser l’image de ceux qui nous sont enlevés, et qui cherche la ressemblance absolue, la reconstitution d’une dernière scène de la vie, quand nous ne voulons plus voir qu’une figure immatérielle, embellie et transfigurée par la mort, et telle qu’un artiste de génie pourrait seul la deviner et la rendre ?
Quelques monuments, d’une richesse extrême, dans l’allée principale. L’un d’eux, surtout, un grand monument de bronze, provoque l’admiration des promeneurs. Il a été élevé à la mémoire d’une jeune femme de race noble, morte récemment. Elle est là, couchée sur un lit large et bas, nue jusqu’à la moitié du corps, et très belle de traits. La tête, un peu inclinée sur l’oreiller, porte l’empreinte d’une paix nouvelle, inconnue à la vie, et derrière, esquissée dans le panneau qui se redresse en forme de muraille, une procession d’anges, les ailes déployées, emporte l’âme dans la lumière. Cette œuvre, du sculpteur Enrico Butti, est une de celles, bien rares, qui sortent du pur métier. Autour d’elle, les groupes, incessamment renouvelés, ne se composent guère que de bourgeois et d’artisans. Ceux-ci ont l’air d’être en habits de travail. Les femmes, sans chapeau ni bonnet, pour la plupart, portent le châle long, qui ondule avec tant de grâce, sur toutes les rues et les routes d’Italie ; les hommes sont en veston ou en jaquette. Il est remarquable que l’ouvrier italien n’a pas son « vêtement du dimanche », comme l’ouvrier français. Du moins, je n’ai jamais observé de différence appréciable, à ce point de vue, entre la foule du lundi et celle de la veille. Les paysannes, au contraire, ne s’arrêtent point, ou s’arrêtent peu, à regarder la statue de bronze. Elles continuent et s’éloignent, graves, par petites bandes du même village, récitant tout haut le rosaire, qui pend sur leur tablier aux couleurs vives. Elles n’ont plus entièrement le costume d’autrefois, celui qu’on voit dans les livres et aux étalages des marchands de photographies. Hélas ! il faut aller plus loin pour rencontrer ces merveilles de goût populaire, ces ensembles d’une harmonie puissante, que la peinture a fixés dans nos yeux et qu’on s’attend à voir surgir, au détour du premier chemin, dès qu’on descend les Alpes. Cherchez le gilet à triple étage, les brayes blanches et le chapeau galonné du paludier du bourg de Batz ; cherchez les bergères de la Suisse ; cherchez les coiffes carrées, la guimpe échancrée, le tablier à rayures des Napolitaines ! Graziella n’a plus guère de sœurs. Je n’ai vu qu’une fois plusieurs milliers d’italiens habillés comme dans les estampes : au fond des Calabres, un jour de fête de la Madone.
Mais ni les vieux monuments, ni les vieux costumes ne tombent d’un seul coup. Il reste partout en Italie, avec une préférence marquée pour les étoffes aux teintes vives, une pièce ou deux du vêtement ancien, un accessoire, un bijou. Et, dans la campagne de Milan, c’est le grand peigne irradié que les femmes posent derrière leur tête, sur leurs cheveux roulés : un système d’épingles d’argent, aplaties au sommet, faisant le demi-cercle, ou, si vous le préférez, deux douzaines de petites cuillères disposées en éventail.
En sortant du Campo santo, j’allai passer une heure chez un de ces sculpteurs dont plusieurs, Enrico Butti, Ernesto Bazzaro, Barcaglia, Barzaghi, qui vient de mourir, ont acquis une réputation considérable. Il me montra une foule d’œuvres ou de maquettes, la plupart destinées à des tombes et dénotant une souplesse de main très grande, une entente consommée de la vérité plastique. Cependant quelque chose y manquait, presque toujours. En parcourant les ateliers avec cet homme aimable et fin, plus près de l’artiste, assurément, que de l’ouvrier, je revoyais sans cesse l’immortelle jeune fille, debout près de la tombe d’Henri Regnault. Et plus tard, je me suis demandé si le génie italien, momentanément affaibli, mais qui reprendra vigueur, n’avait pas été de tout temps plus réaliste que le nôtre. Même aux siècles où le plus merveilleux idéal soulevait les âmes, les artistes italiens se sont-ils beaucoup écartés du portrait anobli, je veux bien, divin par le sourire ou par les attributs, mais portrait cependant ? Comme les Romains, leurs pères très pratiques, ne se sont-ils pas montrés défiants de ces deux genres, où l’imagination n’a plus de guide qu’elle-même, l’allégorie et la légende ? Ont-ils jamais habité entre ciel et terre, dans le pays d’enchantement où les races du nord se sont promenées, inquiètes et ravies, durant tout le moyen âge ? Raphaël a-t-il tant rêvé ? Le grand Buonarotti, qui savait ce que c’était, aurait peut-être dit non.
— Je viens de voir le roi et la reine, de très près et pendant plusieurs heures. Les souverains devaient présider, devant quelques centaines d’invités, la fête d’inauguration d’un institut des aveugles, nouvellement élevé dans la via Vivaio. Les bâtiments, entièrement neufs, construits grâce aux libéralités testamentaires d’un Milanais, ouvrent sur une rue étroite, dans un quartier populaire. Ils sont très vastes, très gais de couleur, inutilement, hélas ! et de cette belle ordonnance comprenant, de toute nécessité, des portiques, des corniches, des cloîtres intérieurs, de larges escaliers, à laquelle les Italiens sacrifient souvent le confortable. Ce n’est pas le cas. Les aveugles seront bien chez eux. On entre dans une cour fermée d’une grille, puis, par un vestibule orné de colonnes, dans une longue salle de réunions et de fêtes, décorée jusqu’aux voûtes de fraîches peintures murales. Les ateliers d’hommes et de femmes sont disposés tout autour.
Le roi arrive le premier, de Monza, dans un landau à deux chevaux, très ordinaire. Il est en redingote et en chapeau de soie. À peine les présentations faites, sur son ordre, tout le monde se couvre, et le roi se met à causer familièrement avec les autorités de Milan et les administrateurs du nouvel institut, au milieu du vestibule où s’engouffre l’air froid du dehors. Je ne remarque point d’empressement excessif parmi ceux qui l’entourent. Il parle à chacun, par phrases très courtes, d’une voix basse, avec un haussement fréquent du menton. L’attitude est toute militaire, et l’on devine, à le voir, qu’il aime à causer debout, la poitrine cambrée, faisant deux ou trois pas, de temps à autre, habitude qu’il conserve dans les réceptions à la cour, et dont les tout jeunes diplomates ne se sont jamais plaints. La moustache est terrible, moins cependant que sur les pièces de monnaie, mais le regard, un peu étonnant de fixité, n’a rien de dur. Le roi Humbert a beaucoup gagné en popularité depuis le choléra de Naples, et il le sent.
Dix minutes plus tard, un mouvement se produit dans la foule massée le long de la grille, et une voiture à quatre chevaux, supérieurement attelée en poste, tourne devant le perron. La reine descend, et passe au bras du roi, entre deux haies d’invités. Elle porte un collet Médicis en velours noir, un chapeau de velours noir à grandes plumes et une robe bleu sombre. Les deux haies s’inclinent. La reine sourit, et son sourire est célèbre, comme on sait. Elle a aussi de longs cils dorés, qui rendent son regard charmant. Une dame d’honneur la suit. Et les deux souverains commencent à tenir ce rôle officiel que la pratique peut rendre aisé, mais non pas réjouissant.
Ils écoutent le discours d’un monsieur vénérable, de la musique, un compliment d’aveugle, d’autre musique. Puis il leur faut faire la visite complète du nouvel institut, et subir des explications sur bien des choses qui s’expliquent toutes seules. Je les suis avec la foule des invités, qui se heurte aux angles des portes, encombre les corridors, et remplit d’avance les salles où Leurs Majestés doivent passer. Elle est curieuse, cette foule silencieuse et empressée. Évidemment elle représente une partie de la haute société milanaise. Partout, autour de moi, un joli murmure distingué de paroles italiennes, des sourires discrets, des présentations cérémonieuses, de fins visages de jeunes filles et de jeunes femmes, avec ces yeux si vite changeants, toujours un peu humides au coin. Mais presque pas de toilettes : des fourreaux gris, mauves, bleus, des chapeaux du matin. À Paris, pour un prince nègre, on aurait assiégé Worth et Félix. Ici, on est venu très simplement. La plupart des hommes ne portent même que le chapeau rond. Cependant il serait imprudent de conclure trop vite, car, aux réceptions du soir, tout change comme par enchantement, et Milan est peut-être, avec Rome, la ville d’Italie où l’on voit, sous le feu des torchères et des lustres, le plus grand luxe de toilettes et de bijoux.
Une autre chose étonne encore : l’absence presque absolue d’uniformes, de barrières et de police. Le plumet blanc d’un aide de camp se promène çà et là parmi les groupes ; un questurino, sanglé dans sa tunique, demande le passage pour le roi et la reine : mais la personne des souverains ne semble pas gardée. On les approche, on les enveloppe comme dans un salon où tous les invités seraient connus et présentés. La reine s’arrête dans les salles d’étude, demande à cette jeune fille aveugle d’écrire le nom de Marguerite de Savoie, à cette autre de lire dans un livre aux caractères en relief, admire les ouvrages de couture ou de broderie d’une troisième. Elle connaît vraiment très bien son difficile métier de reine. On ne saurait mieux, ni plus obligeamment interroger, remercier, paraître s’intéresser à tout. Et cette visite souriante à de pauvres filles intimidées émeut comme un acte de charité et comme une chose très bien faite, surtout quand on peut suivre cette petite distribution de questions, – pareille à une distribution de récompenses, – posées d’une voix bien timbrée, et la mimique expressive et naturelle de ces doigts d’Italienne, qui parlent aussi clairement que les lèvres. Pendant ce temps, le roi cause, résigné, avec plusieurs personnages, et souvent avec l’abbé Vitali, un prêtre de cœur et de savoir, paraît-il, directeur de l’institut charitable, le même qui a composé les vers de la cantate exécutée tout à l’heure :
Il tuo spirito, o regina eccelsa et buona,
È ovunque, e dolce il nome tuo risuona,
Ma dove piu gentil corre il tuo core
È dove sta il dolore.
Ton esprit, ô reine grande et bonne,
Est partout, et doucement ton nom résonne,
Mais là où le plus volontiers court ton cœur,
C’est où se trouve la douleur.
Tout le monde italien vit sur ce pied de diplomatie familière. Quelqu’un m’a raconté qu’à Gênes, pendant les fêtes du centenaire de Colomb, le canot à vapeur du roi était entouré d’un grand nombre de barques, montées par des curieux de toute espèce et de tout rang, et que, parfois, des inconnus, des gens du petit peuple, venaient toucher l’épaule ou le bras du roi, et disaient : « Buona sera, maestà ! »
Je suis parti avant que la cérémonie fût achevée. Sur les degrés du vestibule, un laquais de la cour, en livrée rouge, s’entretenait gravement avec le premier postillon, immobile sur son cheval, fier de sa veste rouge à brandebourgs, de sa culotte safran, de ses bottes de poste, de son fouet orné de poils de blaireau qu’il tenait appuyé sur sa cuisse, et tous deux, par moments, sans tourner la tête, jetaient un regard protecteur sur le fretin pendu aux grilles.
À cent pas de là, le faubourg avait sa physionomie ordinaire. Des haillons séchaient aux fenêtres hautes, des femmes bavardaient sur les seuils, plus nombreuses là où le soleil chauffait encore. Seulement les questurini indiquaient aux marchands de figues d’Inde des détours par les petits vicoli, pour que la grande voie fût libre.
Je n’étais pas encore rentré chez moi, quand la voiture de la reine passa, les quatre chevaux piaffant et secouant leurs grelots. Tous les fiacres s’arrêtèrent, et se rangèrent le long des maisons ; presque tous les boutiquiers, les paveurs, les cochers, levèrent leur chapeau : mais personne ne cria. Comme je m’en étonnais : « Ici nous sommes monarchistes, me dit un ami, mais pas courtisans. »
Les Milanais ont, d’ailleurs, une très haute idée de leur ville, « la capitale morale de l’Italie, » ville artiste, ville musicienne, ville d’édition comme Turin, ville de grand commerce comme Gênes, ville grandissante et riche, prétend-on, mais qui a le capital prudent, et ne l’engage pas, pour le moment. C’est qu’elle a failli se laisser prendre et avoir son krach des maisons, comme la capitale. Il y a eu la même rage de construction, vers la même époque. Mais on a su mieux s’arrêter, et le quartier nouveau n’a pas l’aspect lamentable de ces pauvres prati di castello. Il est même fort joli. Si vous voulez le visiter, tournez le dos à la façade du dôme, allez tout droit : le vaste boulevard qui s’ouvre, la via Dante, est taillé dans les vieilles rues et bordé de palais nouveaux, jusqu’au théâtre dal Verme. Plus loin même, d’énormes îlots sont bâtis ou se bâtissent. Le château des Sforza, en partie démoli, va livrer les abords de l’ancienne place d’armes aux constructeurs de l’avenir, et le pavillon central, enveloppé d’arbres et de jardins, restera seul avec ses remparts crénelés, au milieu d’une enceinte immense d’habitations modernes. Le travail se poursuit, lentement et prudemment, comme je le disais, mais rien n’est plus curieux que la partie déjà remplie du programme édilitaire, cette via Dante, élevée dans un jour de spéculation hardie. Combien a-t-elle coûté de millions ? Je n’en sais rien. La municipalité de Milan avait promis un prix de dix mille francs à qui ferait la plus belle maison, et, moins pour le prix que pour l’honneur de gagner la couronne murale, les architectes se sont mis en frais d’imagination et les propriétaires en frais de maçonnerie. Les uns poussant les autres, la lutte est devenue épique, et, comme chacun de ces vastes palais devait avoir un nombre égal d’étages, on l’a vue tout de suite se circonscrire et devenir un concours de façades. Tous les genres de portes et de fenêtres, toutes les variétés de balcons, tous les types de cariatides, de modillons et de consoles, tous les enduits, les revêtements, les moulures, les médaillons, les chapiteaux et les chapeaux de cheminée s’y rencontrent, et voisinent drôlement. Il y a des façades peintes en grisaille renaissance. Il y en a une couverte de peinture, – à l’huile, je crois bien, – incontestablement moderne : sur un sofa, d’où s’élance un palmier aux feuilles retombantes, un monsieur en habit rouge, face à la rue, paraît attendre la réponse d’une jeune femme, en robe de bal blanche, qui regarde vers le château des Sforza. Que voulez-vous, tous les détails ne sont pas heureux, on devait s’y attendre, mais l’ensemble de ces palais, formant une des plus larges rues de Milan, ne manque pas de grandeur. Les tons légers des badigeons et des stucs s’harmonisent et se fondent. Par un rayon de soleil, toutes ces choses fraîches et neuves ont l’air de rire entre elles. Ajoutez à cela que les loyers ne sont pas élevés. Je me suis informé, et l’on m’a dit qu’un premier, composé de dix à douze pièces, se louait de deux à trois mille francs.
Malgré cela, les locataires ne se disputent pas encore les appartements de la belle rue Dante. Je vois d’assez nombreux écriteaux pendus aux balcons ouvragés : « Si loca ; affittasi piano nobile. » Ils disparaîtront avec le temps. Mais je crois qu’un second concours, s’il était proposé, ne serait plus accueilli avec le même enthousiasme.
J’oubliais de dire que la municipalité, devant ce débordement d’architecture, embarrassée sans doute, n’a pu se déterminer à décerner le prix : ce qui est au moins d’une administration économe.
— Je me trouve ici en pleine période électorale. Les murs sont couverts d’affiches où des comités « pour la paix », d’autres qui sont pour la guerre, et qui ne le disent pas, des groupes de vétérans reduci des guerres de l’indépendance, des Sociétés ouvrières ou rurales, recommandent leurs candidats à l’électeur qui passe. Les afficheurs ne respectent rien, ni les maisons particulières, ni les monuments publics. Ils collent partout : sur les colonnes neuves, à l’intérieur des passages, dans les péristyles des mairies, sur des parois lisses ou sculptées, peu leur importe : « Ça s’enlève si bien avec une brosse et de l’eau chaude ! » me disait un Italien. Et en effet, j’ai vu fonctionner la brosse jusque dans les belles galeries Humbert Ier à Naples.
Les réunions publiques se multiplient également, avec des succès divers, mais sans désordres graves. Je ne crois pas qu’il y ait un pays où l’on parle plus politique, avec plus de passion apparente et de scepticisme peut-être au fond. Vous entrez dans un restaurant. À côté de vous, se trouvent deux messieurs, l’un qui déjeune, l’autre, debout devant la table, le cigare allumé, un de ces longs cigares noirs, qui ont une paille au milieu. Ils causent politique, généralement ils discutent une candidature locale. Rien n’est plus facile que de les suivre, car ils parlent tout haut, pour la salle entière. Au début, une ou deux phrases sentencieuses, dans les tonalités grises, appuyées d’un carissimo. Ce sont des gens qui se sont vus au moins deux fois. La réponse vient plus vive. Le monsieur debout reprend avec force : « Permesso ! La questione è questa… » Et alors, avec une véhémence extraordinaire, des gestes fougueux et justes, des expressions de visage qu’un avocat d’assises ne démentirait pas, il plaide, il s’emporte. La riposte trouve à peine sa place. Elle est courte, comme il convient à un homme qui déjeune, mais d’une belle passion. Voilà deux adversaires bien ardents. On se demande comment cela va finir, et si la griserie des mots, la présence de ce public, n’entraîneront pas trop loin l’un des deux. Rassurez-vous. Après un quart d’heure, tout à coup, celui qui était debout tend la main à l’autre : « Au revoir, cher. Je suis attendu, une petite affaire. » Il est très calme. Son cigare ne s’est point éteint. Il sort de l’air le plus tranquille. L’autre commence le second service. Personne n’est ému dans la salle.
On découvre alors que ces passionnés à la surface ont gardé leur sang-froid, sous des apparences qui l’excluaient ; qu’ils ont raisonné leurs effets, et déduit logiquement leurs idées. Ils ont essayé, qu’on me pardonne le mot, de « se mettre dedans » l’un l’autre. Ils n’ont pas réussi. Mais ils n’en sont pas moins bons amis et assez près de s’entendre, car aucun principe sérieux ne les divise : il n’y a entre eux que des préférences personnelles et des intérêts du moment.
Cette petite scène, presque quotidienne, aide à comprendre la vivacité des discours et le calme de la rue. Elle explique la fluidité des partis italiens, impossibles à classer, grossis ou diminués inopinément, aux dépens les uns des autres, et qui fait penser à des vases communiquants, séparés, si l’on veut, par un voile de gaze…
— J’ai lu, nécessairement, d’innombrables professions de foi, comptes rendus de réunions électorales, harangues et lettres aux électeurs. Tout le monde sait que les Italiens ont conservé, dans la langue littéraire, la période ancienne, large et sonore. Plusieurs y sont passés maîtres, de Amicis, par exemple, dans le roman, et bon nombre de candidats à la députation dans leurs discours : si bien qu’on peut lire le premier ou écouter les seconds plus de cinq minutes, sans rencontrer un point. Ils sont dominés par la longue tradition latine, dont nous nous sommes dégagés, par leur tempérament, tout de logique et de mesure, qui trouve, dans l’ampleur des développements, le moyen de présenter l’idée avec les ornements, les commentaires, les objections et les réserves qu’il faut. Nous enfermons nos pensées en quelques mots nets, vibrants, excessifs quelquefois. Ils préfèrent élargir l’enceinte, en y ménageant beaucoup d’incidentes, comme autant de portes de sortie : c’est tout ce que je veux dire de la forme.