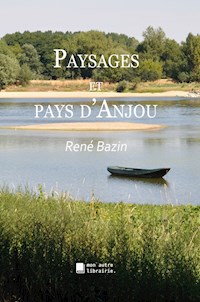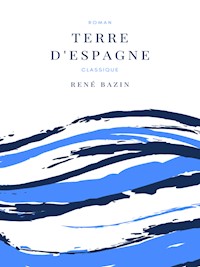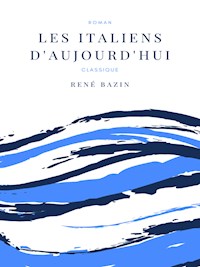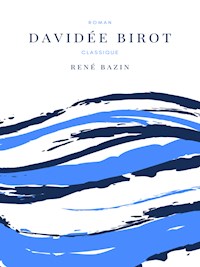3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'action se situe en Alsace, avant 1900, pendant l'occupation allemande, dans un contexte de résistance de toute la population à l'occupant: refus de parler l'allemand, de l'administration allemande, de la culture allemande, etc. Joseph Oberlé, riche industriel, collabore avec les occupants, envoie son fils faire ses études de droit en Allemagne, et souhaite que sa fille Lucienne Oberlé devienne l'épouse d'un Allemand. Son épouse Monique et son fils Jean, animés d'un esprit de résistance conforme au sentiment majoritaire de la population, sont opposés à ses projets. Tous les éléments du drame sont donc en place, et Jean en sera la figure centrale.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Les Oberlé
Les OberléI. NUIT DE FÉVRIER EN ALSACE.II. L’EXAMEN.III. LA PREMIÈRE RÉUNION DE FAMILLE.IV. LES GARDIENNES DU FOYER.V. LES COMPAGNONS DE ROUTE.VI. LA FRONTIÈRE.VII. LA VIGILE DE PÂQUES.VIII. CHEZ CAROLIS.IX. LA RENCONTRE.X. LE DÎNER CHEZ LE CONSEILLER BRAUSIG.XI. EN SUSPENS.XII. LA RÉCOLTE DU HOUBLON.XIII. LES REMPARTS D’OBERNAI.XIV. LE DERNIER SOIR.XV. L’ENTRÉE AU RÉGIMENT.XVI. DANS LA FORÊT DES MINIÈRES.Page de copyrightLes Oberlé
René Bazin
I. NUIT DE FÉVRIER EN ALSACE.
La lune se levait au-dessus des brumes du Rhin. Un homme qui descendait, en ce moment, par un sentier des Vosges, grand chasseur, grand promeneur à qui rien n’échappait, venait de l’apercevoir dans l’échancrure des futaies. Il était aussitôt rentré dans l’ombre des sapinières. Mais ce simple coup d’œil jeté, au passage d’une clairière, sur la nuit qui devenait lumineuse, avait suffi pour lui rappeler la beauté de cette nature où il vivait. L’homme tressaillit de plaisir. Le temps était froid et calme. Un peu de brume montait aussi des ravins. Elle ne portait point encore le parfum des jonquilles et des fraisiers sauvages, mais l’autre seulement qui n’a pas de nom et n’a pas de saison, le parfum des résines, des feuilles mortes, des gazons reverdis, des écorces soulevées sur la peau neuve des arbres, et l’haleine de cette fleur éternelle qu’est la mousse des bois. Le voyageur respira profondément cette senteur qu’il aimait ; il la but à grands traits, la bouche ouverte, pendant plus de dix pas, et, si habitué qu’il fût à cette fête nocturne de la forêt, lueurs du ciel, parfums de la terre, frémissements de la vie silencieuse, il dit à demi-voix : « Bravo, l’hiver ! Bravo les Vosges ! Ils n’ont pas pu vous gâter ! » Et il mit sa canne sous son bras, afin de faire moins de bruit encore sur le sable et sur les aiguilles de sapin du sentier en lacet, puis, détournant la tête :
– Trotte avec précaution, Fidèle, mon bon ami : c’est trop beau !
À trois pas derrière, trottait un épagneul haut sur pattes, efflanqué, fin de museau comme un lévrier, qui paraissait tout gris, mais qui était, en plein jour, feu et café au lait, avec des franges de poils souples qui dessinaient la ligne de ses pattes, de son ventre et de sa queue. La bonne bête eut l’air de comprendre son maître, car elle continua de le suivre, sans faire plus de bruit que la lune qui glissait sur les aigrettes des sapins.
Bientôt la lumière pénétra entre les branches, émietta l’ombre ou la balaya par larges places, s’allongea sur les pentes, enveloppa les troncs d’arbres ou les étoila, et, toute froide, imprécise et bleue, créa, avec les mêmes arbres, une forêt nouvelle que le jour ne connaissait pas. Ce fut une création immense, enchanteresse et rapide. Dix minutes y suffirent. Pas un frisson ne l’annonça. M. Ulrich Biehler continua de descendre, saisi d’une émotion grandissante, se baissant quelquefois pour mieux voir les sous-bois, se penchant au-dessus des ravins, le cœur battant, la tête aux aguets, comme les chevreuils qui devaient quitter les combes et gagner le pacage.
Ce voyageur enthousiaste et jeune encore d’esprit n’était cependant plus un homme jeune. M. Ulrich Biehler, – qu’on appelait partout, dans la contrée, M. Ulrich, – avait soixante ans, et ses cheveux et sa barbe d’un gris presque blanc en témoignaient ; mais il avait eu plus de jeunesse que d’autres, comme on a plus de bravoure ou de beauté, et il en avait gardé quelque chose. Il habitait au milieu de la montagne de Sainte-Odile, exactement à quatre cents mètres en l’air, une maison forestière sans architecture et sans dépendance territoriale d’aucune sorte, si ce n’est le pré en pente où elle était posée et, en arrière, un tout petit verger, ravagé périodiquement par les grands hivers. Il était demeuré fidèle à cette maison, héritée de son père qui l’avait achetée seulement pour y passer les vacances, et il y passait toute l’année, solitaire, bien que ses amis, comme ses terres, fussent assez nombreux dans la plaine. Il n’était pas sauvage, mais il n’aimait pas livrer sa vie. Un peu de légende l’entourait donc. On racontait qu’en 1870, il avait fait toute la campagne coiffé d’un casque d’argent au cimier duquel pendait, en guise de crinière, la chevelure d’une femme. Personne ne pouvait dire si c’était de l’histoire. Mais vingt bonnes gens de la plaine d’Alsace pouvaient affirmer qu’il n’y avait point eu, parmi les dragons français, un cavalier plus infatigable, un éclaireur plus audacieux, un compagnon de misère plus tendre et plus oublieux de sa propre souffrance que M. Ulrich, propriétaire de Heidenbruch dans la montagne de Sainte-Odile.
Il était resté Français sous la domination allemande. C’était sa joie et la cause, également, de nombreuses difficultés qu’il tâchait d’aplanir, ou de supporter en compensation de la faveur qu’on lui faisait de le laisser respirer l’air d’Alsace. Il savait demeurer digne, dans ce rôle de vaincu toléré et surveillé. Aucune concession qui eût trahi l’oubli du cher pays de France, mais aucune provocation, aucun goût de démonstration inutile. M. Ulrich voyageait beaucoup dans les Vosges, où il possédait, çà et là, des parties de forêts, qu’il administrait lui-même. Ses bois étaient réputés parmi les mieux aménagés de la Basse-Alsace. Sa maison, depuis trente ans fermée pour cause de deuil, avait cependant une réputation de confort et de raffinement. Les quelques personnes, françaises ou alsaciennes, qui en avaient franchi le seuil, disaient l’urbanité de l’hôte et son art de bien recevoir. Les paysans surtout l’aimaient, ceux qui avaient fait la guerre avec lui, et même leurs fils, qui levaient leur chapeau quand M. Ulrich apparaissait au coin de leur vigne ou de leur luzerne. On le reconnaissait de loin, à cause de sa taille élancée et mince, et de l’habitude qu’il avait de ne porter que des vêtements légers, qu’il achetait à Paris et qu’il choisissait invariablement dans les couleurs brunes, depuis le brun foncé du noyer jusqu’au brun clair des chênes. Sa barbe en pointe, très soignée, allongeait son visage, où il y avait peu de sang et peu de rides ; la bouche souriait volontiers sous les moustaches ; le nez proéminent et droit d’arête disait la race ; les yeux gris, indulgents et fins, prenaient vite une expression de hauteur et de défi quand on parlait de l’Alsace ; enfin, le front large mettait un peu de songe dans cette physionomie d’homme de combat, et s’agrandissait de deux clairières enfoncées en plein taillis de cheveux durs, serrés et coupés droit.
Or, ce soir, M. Ulrich rentrait de visiter une coupe de bois dans les montagnes de la vallée de la Bruche, et ses domestiques ne s’attendaient pas à le voir sortir de nouveau, quand, après dîner, il avait dit à la femme de chambre, la vieille Lise, qui servait à table :
– Mon neveu Jean a dû arriver ce soir à Alsheim, et, sans doute, si j’attendais jusqu’à demain, je pourrais le voir ici, mais je préfère le voir là-bas, dès aujourd’hui. Et je pars. Laisse la clef sous la porte, et couche-toi.
Il avait aussitôt sifflé Fidèle, pris sa canne et descendu le sentier qui, à cinquante pas de Heidenbruch, entrait sous bois.
M. Ulrich était vêtu, selon sa coutume, d’une vareuse et d’une culotte couleur feuille morte, et coiffé d’une bombe de chasse en velours. Il avait marché vite, et, en moins d’une demi-heure, se trouvait rendu à un endroit où le sentier rejoignait une allée plus large, faite pour les promeneurs et les pèlerins de Sainte-Odile. Le lieu était indiqué dans les guides, parce que, sur cent mètres de longueur, on dominait le cours d’un torrent qui traversait plus bas, dans la plaine, le village d’Alsheim ; parce que, surtout, dans l’ouverture du ravin, dans l’angle que formaient les pentes rapprochées des terres, on pouvait apercevoir, en jour, un coin de l’Alsace, des villages, des champs, des prés, très loin un vague trait d’argent qui était le Rhin, et les montagnes de la Forêt-Noire, bleues comme du lin et rondes comme un feston. Malgré la nuit qui bornait la vue, M. Ulrich, en arrivant dans l’allée, regarda devant lui, par la force de l’habitude, et ne vit qu’un triangle de nuit, de la couleur de l’acier, où brillaient en haut de vraies étoiles, en bas des points lumineux de grosseur égale, mais légèrement voilés et entourés d’un halo, et qui étaient les lampes et les chandelles du village d’Alsheim. Le voyageur pensa à son neveu, qu’il allait tout à l’heure serrer contre son cœur, et se demanda : « Qui vais-je trouver ? Que va-t-il être, après trois ans d’absence, et trois ans d’Allemagne ? »
Ce ne fut qu’un arrêt d’un instant. M. Ulrich traversa l’allée, et, voulant couper au plus court, entra sous les branches d’une futaie de hêtres qui descendait, en pente rapide, vers une nouvelle sapinière où il retrouverait le chemin. Quelques feuilles mortes tremblaient encore au bout des basses branches, mais la plupart étaient tombées sur celles de l’année précédente, qui ne laissaient pas à découvert un seul pouce du sol, et, devenues elles-mêmes minces comme de la soie, et toutes pâles, elles ressemblaient à un dallage extrêmement uni et blond ; les troncs se dressaient, marbrés de mousses, réguliers comme des colonnes, et les cimes se rapprochaient au-dessus, bien haut, et s’unissaient par leurs rameaux ténus, qui dessinaient seulement la voûte et laissaient passer la lumière. Quelques buissons rompaient l’harmonie des lignes. À une centaine de mètres en contrebas, le barrage des arbres verts formait comme le mur solide de cette cathédrale en ruines.
Tout à coup, M. Ulrich entendit un bruit léger et tel qu’un autre homme ne l’eût sans doute pas remarqué, en avant, dans les sapins vers lesquels il se dirigeait. C’était le bruit d’une pierre roulant sur les pentes, accélérant sa vitesse, heurtant des obstacles et rebondissant. Il diminua, et finit par un éclatement à la fois ténu et clair, qui prouvait que la pierre avait atteint le fond caillouteux d’un ravin et s’y brisait. La forêt reprenait son silence, quand une seconde pierre, beaucoup moins grosse encore, à en juger par le son qu’elle éveilla, se mit, elle aussi, à rouler dans l’ombre. En même temps, le chien hérissa ses poils, et revint en grognant vers son maître.
– Tais-toi, Fidèle, dit celui-ci, il ne faut pas qu’ils me voient !
M. Ulrich se jeta aussitôt derrière le tronc d’un arbre, comprenant qu’un être vivant montait à travers bois, et devinant qui allait apparaître. En effet, trouant le noir du rideau de sapins, il aperçut la tête, les deux pieds de devant, et bientôt le corps tout entier d’un cheval. Un souffle blanc, précipité, s’échappait des naseaux et fumait dans la nuit. L’animal faisait effort pour grimper la pente trop raide. Tous les muscles tendus, les pieds de devant en crochet, le ventre près de terre, il avançait par soubresauts, mais presque sans bruit, enfonçant dans la mousse et dans l’épaisse toison végétale du sol, et ne déplaçant guère que des feuilles, qui coulaient les unes sur les autres avec un murmure de gouttes d’eau. Il portait un cavalier bleu clair, penché sur l’encolure et tenant sa lance presque horizontalement comme si l’ennemi avait été proche. L’haleine de l’homme se mêlait à celle du cheval dans la nuit froide. Ils avancèrent, se démenant comme s’ils luttaient. Bientôt le voyageur distingua les ganses jaunes cousues sur la tunique, les bottes noires au-dessous de la culotte sombre, le sabre droit pendu à l’arçon, et il reconnut un cavalier du régiment de hussards rhénans en garnison à Strasbourg ; puis plus près, il distingua, sur la flamme noire et blanche de la lance, un aigle jaune, indiquant un sous-officier ; il vit, sous le bonnet plat, un visage imberbe, sanguin, en sueur, des yeux roux inquiets, farouches, fouettés par la crinière en mouvement et fréquemment tournés à droite, et il nomma tout bas Gottfried Hamm, fils de Hamm le policier d’Obernai, et maréchal des logis chef aux hussards rhénans. L’homme passa, frôlant l’arbre derrière lequel se cachait M. Ulrich ; l’ombre de son corps et de son cheval s’allongea sur les pieds de l’Alsacien et sur les mousses voisines ; une odeur de sueur et de harnais traînait en arrière. Au moment où il dépassait l’arbre, il tourna la tête, encore une fois, vers la droite. M. Ulrich regarda dans cette direction, qui était celle de la plus grande longueur de la hêtrée. À une trentaine de mètres plus loin, il découvrit, montant sur la même ligne, un second cavalier, puis un troisième, qui n’était déjà plus qu’une silhouette grise entre les colonnes, puis, à des mouvements d’ombre, plus loin encore, il devina d’autres soldats et d’autres chevaux qui escaladaient la montagne. Et soudain, il y eut un éclair dans les profondeurs du bois, comme si une luciole avait volé. C’était un ordre. Tous les hommes firent un à droite, et, se mettant en file, silencieux, sans un mot, continuèrent leur manœuvre mystérieuse.
Des ombres s’agitèrent encore un instant dans les profondeurs de la futaie ; le murmure des feuilles foulées et croulantes diminua ; puis il cessa tout à fait, et la nuit parut, de nouveau, inhabitée.
– Redoutable, dit à demi-voix M. Ulrich, redoutable adversaire, qui s’exerce jour et nuit ! Il y avait un officier, bien sûr, là-bas, dans le sentier. C’est vers lui qu’ils regardaient tous. Il a levé son sabre, clair sous la lune, et les plus proches l’ont vu. Tous ont tourné. Comme ils faisaient peu de bruit ! J’en aurais tout de même démoli deux, si nous avions été en guerre.
Puis, remarquant son chien qui le regardait, tranquille à présent, le museau levé et remuant la queue :
– Oui, oui, ils sont partis… Tu ne les aimes pas plus que moi…
Il attendit, pour reprendre sa route, qu’il fût certain que les hussards ne reviendraient pas de son côté. Il n’aimait pas la rencontre des soldats allemands. Il en souffrait dans sa fierté ombrageuse de vaincu, dans sa fidélité à la France, dans son amour qui craignait toujours une guerre nouvelle, une guerre dont il avait vu avec étonnement la date reculer et reculer toujours. Il lui arrivait de faire de longs détours pour éviter une troupe en marche sur les routes. Pourquoi ces hussards étaient-ils venus troubler sa descente à Alsheim ? Encore des manœuvres, encore la pensée de l’Ouest qu’ils ont tenace, là-bas ; encore la bête carnassière qui rôde, souple, agile, au sommet des Vosges, et qui regarde si elle doit descendre…
M. Ulrich dévalait la hêtrée, baissant la tête, l’esprit tout plein de souvenirs tristes qui revivaient pour un mot, pour moins encore, car hélas ! ils avaient, mêlée avec eux et prompte à se relever du passé, toute la jeunesse de cet homme… Il évitait, lui aussi, de faire du bruit, tenait son chien derrière lui et ne le caressait pas, quand la brave bête frottait son museau contre la main pendante de son maître, pour dire : « Qu’avez-vous donc, puisqu’ils sont partis ? » En un quart d’heure, par le chemin plus large qu’il retrouva au bout de la hêtrée, M. Ulrich gagna la lisière de la forêt. Une brise plus froide et plus vive courait dans les tailles de chênes et de noisetiers qui bordaient la plaine. Il s’arrêta, écouta à droite, et, mécontent, leva les épaules en disant :
– C’est comme ça qu’ils reviendront ! Personne ne les aura entendus ! Pour l’instant, oublions-les, et allons dire bonjour à Jean Oberlé !
M. Ulrich descendit un dernier raidillon. Quelques pas encore, et les écrans de baliveaux et de broussailles qui cachaient l’espace furent franchis. Le ciel entier se dévoila et, en dessous, devant, à gauche, à droite, quelque chose d’un bleu plus doux et plus brumeux, qui était la terre d’Alsace. L’odeur des guérets et des herbes mouillées par la rosée se levait du sol comme une moisson de la nuit. Le vent la poussait, le vent froid, passant familier de cette plaine, compagnon vagabond du Rhin. On ne pouvait distinguer aucun détail dans l’ombre où dormait l’Alsace, si ce n’est, à quelques centaines de mètres, des lignes de toits ramassés et pressés autour d’un clocher gris, tout rond d’abord et terminé en pointe. C’était le village d’Alsheim. M. Ulrich se hâta, retrouva bientôt le cours du torrent, devenu un ruisseau rapide, qu’il avait côtoyé dans la montagne, le suivit, et vit se dégager, haute et massive, dans son parc d’arbres dépouillés par l’hiver, la première maison d’Alsheim, celle des Oberlé.
Elle était bâtie à droite de la route, dont elle était séparée d’abord par un mur blanc, puis par le ruisseau qui traversait le domaine sur plus de deux cents mètres de longueur, fournissant d’abord l’eau nécessaire aux machines, et coulant ensuite, agrandi et dirigé savamment, parmi les arbres, jusqu’à la sortie. M. Ulrich franchit la large grille en fer forgé qui ouvrait sur la route, puis le pont, et, passant devant le petit chalet du concierge, laissant à droite les chantiers pleins de bois amoncelés, de planches levées en croix, de perches, de hangars, il prit à gauche l’avenue qui tournait entre les massifs et la pelouse, et arriva devant le perron d’une maison à deux étages, mansardée, construite en pierre rouge de Saverne et qui datait du milieu du siècle. Il était huit heures et demie. Il monta vivement au premier, et frappa à la porte d’une chambre.
Une voix jeune répondit :
– Entrez !
M. Ulrich n’eut pas le temps d’enlever sa bombe de chasse. Il fut saisi au cou, attiré et embrassé par son neveu Jean Oberlé, qui disait :
– Bonjour, oncle Ulrich ! Ah ! que je suis content ! Quelle bonne idée !
– Allons, lâche-moi ! Bonjour, mon Jean ! Tu viens d’arriver ?
– À trois heures cette après-midi. J’aurais été vous voir dès demain, vous savez ?
– J’en étais sûr. Mais je n’ai pas pu y tenir : il a fallu descendre et te voir. Trois ans que je ne t’ai vu, Jean ! Laisse que je te regarde !
– À votre aise ! répondit le jeune homme en riant. Ai-je changé ?
Il avait avancé à son oncle un fauteuil de cuir, et s’asseyait en face, sur un canapé revêtu d’une housse et placé contre la muraille. Entre eux, il y avait une table de travail, sur laquelle brûlait une petite lampe à pétrole en métal ciselé. Tout près, la fenêtre laissait voir, entre ses rideaux relevés, le parc immobile et solitaire sous la lune. M. Ulrich considérait Jean avec une curiosité affectueuse et fière. Celui-ci avait encore grandi ; il dépassait un peu son oncle. Son solide visage d’Alsacien avait pris des lignes plus volontaires et plus fermes. La moustache brune était plus fournie, le geste tout à fait aisé, comme celui d’un homme qui a vu le monde. On eût pu le prendre pour un Méridional, à cause de la pâleur italienne de ses joues rasées, de ses paupières cernées d’ombre, à cause de ses cheveux foncés qu’il portait séparés sur le côté par une raie, de ses lèvres pâles aussi, ouvertes sur de belles dents saines, transparentes, qu’il laissait voir lorsqu’il riait ou qu’il parlait. Mais plusieurs signes le désignaient comme un enfant de l’Alsace : la largeur du visage sur la ligne des pommettes, ses yeux verts comme les forêts des Vosges, et le menton carré des paysans de la vallée. Il gardait quelque chose d’eux, car son bisaïeul avait tenu la charrue. Il avait leur corps de cavaliers solides. L’oncle devina aussi, à la jeunesse du regard qui croisait le sien, que Jean Oberlé, l’homme de vingt-quatre ans qu’il revoyait, n’était pas très différent, moralement, de celui qu’il avait connu autrefois.
– Non, dit-il après un long moment, tu es le même ; tu es seulement devenu homme. J’avais peur de plus grands changements.
– Et pourquoi ?
– Parce que, mon petit, à l’âge que tu as surtout, il y a des voyages qui sont des épreuves… Mais, d’abord, d’où reviens-tu, au juste ?
– De Berlin, où j’ai passé mon Referendar Examen.
L’oncle eut un rire saccadé qu’il réprima vite, et qui se perdit dans sa barbe grise.
– Appelons cela la licence en droit, si tu veux bien ?
– Je veux très bien, mon oncle.
– Alors, donne-moi une explication plus complète, et surtout plus nouvelle, car, ta licence, voilà plus d’un an que tu l’as en poche. Qu’as-tu fait de ton temps ?
– Très simple. L’avant-dernière année, je l’ai passée, comme vous le savez, à Berlin, achevant mes études de droit. La dernière, j’ai fait un stage chez un avocat, jusqu’au mois d’août. À cette époque, je suis parti pour un voyage en Bohême, en Hongrie, en Croatie, et dans le Caucase, avec la permission paternelle. J’y ai mis six mois ; j’ai retraversé Berlin pour reprendre mes bagages d’étudiant et faire quelques visites d’adieu, et j’arrive…
– En effet, ton père… Je ne t’ai pas demandé, dans ma hâte de te revoir… Il va bien ?
– Il n’est pas ici.
– Comment, le soir de ton retour, il a été obligé de s’absenter ?
Jean répondit avec un peu d’amertume :
– Il a été obligé d’assister à un grand dîner chez M. le conseiller von Boscher… Il a emmené ma sœur. Il paraît que c’est une belle réception.
Il y eut un petit silence. Les deux hommes ne riaient plus. Ils sentaient entre eux, toute proche, s’imposant après trois minutes d’entretien, la question maîtresse, irritante et fatale, celle qu’on n’évite pas, celle qui unit et qui divise, qui est au fond de toutes les relations sociales, des honneurs, des vexations comme des institutions, celle qui tient, depuis trente ans, l’Europe en armes.
– J’ai dîné seul, reprit Jean… c’est-à-dire avec mon grand-père…
– À peine une présence, le pauvre homme. Toujours bien affaissé, bien infirme ?
– Très vivant par l’esprit, je vous assure.
Il y eut un second silence, après quoi M. Ulrich demanda, en hésitant :
– Et ma sœur, à moi ? Ta mère ? Elle est avec eux ?
Le jeune homme répondit affirmativement, d’un signe de tête.
Et la douleur fut si vive chez l’autre, que M. Ulrich détourna les yeux pour ne pas laisser voir toute la souffrance qu’ils exprimaient. Il les leva, par hasard, sur une aquarelle du maître décorateur Spindler, pendue au mur, et qui représentait trois belles filles d’Alsace s’amusant à la balançoire. Vite, il reporta son regard sur son neveu, il le regarda bien en face, et il dit, la voix fêlée par l’émotion :
– Et toi ?… Tu aurais pu dîner chez le conseiller von Boscher,… au point d’intimité où vous êtes avec ces Allemands… Tu n’as pas eu envie de suivre tes parents ?
– Non.
Le mot fut dit nettement, simplement. Mais M. Ulrich ne trouva pas le renseignement qu’il cherchait. Oui, Jean Oberlé était devenu un homme. Il refusait de blâmer sa famille, de donner son avis en accusant les autres. L’oncle reprit, avec le même accent d’ironie :
– Cependant, mon neveu, j’ai eu tout l’hiver dernier les oreilles rebattues de tes succès berlinois ; on ne m’épargnait pas ; je savais que tu faisais danser là-bas nos blondes ennemies ; je connaissais les noms…
– Oh ! je vous en prie, dit Jean sérieusement, ne plaisantons pas sur ces questions-là, comme des gens qui n’osent les regarder en face et dire leur avis. J’ai eu une autre éducation que la vôtre, c’est vrai, mon oncle, une éducation allemande. Mais cela ne m’empêche pas d’aimer tendrement ce pays-ci… au contraire.
M. Ulrich, par-dessus la table, tendit la main, et serra la main de Jean.
– Tant mieux ! dit-il.
– Vous en doutiez ?
– Je ne doutais pas, mon enfant, j’ignorais ; je vois tant de choses qui me peinent et tant de convictions qui fléchissent !
– La preuve que j’aime notre Alsace, c’est que mon intention est d’habiter Alsheim.
– Comment ! dit M. Ulrich stupéfait, tu renonces à entrer dans l’administration allemande, comme ton père le veut ? C’est grave, mon ami, de te dérober à son ambition. Tu étais un sujet d’avenir… Il le sait ?
– Il s’en doute, mais nous ne nous sommes pas encore expliqués là-dessus. Je n’ai pas eu le temps depuis mon retour.
– Et que veux-tu faire ?
Le sourire jeune reparut sur les lèvres de Jean Oberlé.
– Couper du bois, comme lui, comme mon grand-père Philippe ; m’établir parmi vous. Quand j’ai voyagé, en Allemagne et en Autriche, après mon examen, c’était beaucoup pour étudier les forêts, les scieries, les usines pareilles à la nôtre… Vous pleurez ?
– Pas tout à fait.
M. Ulrich ne pleurait pas, mais il était obligé de sécher, du bout du doigt, ses paupières mouillées.
– Ça serait de joie, en tout cas, mon petit ; oh ! de vraie et grande joie !… Te voir fidèle à ce que j’aime le plus au monde… te garder près de nous… te voir décidé à ne pas accepter de charges et d’honneurs de ceux qui ont violenté ta patrie… oui, c’est le rêve que je n’osais plus faire… Seulement, bien franchement, je ne m’explique pas… Je suis surpris… Pourquoi ne ressembles-tu pas à ton père, à Lucienne, qui sont si ouvertement… ralliés ? Tu as fait tes études de droit à Munich, à Bonn, à Heidelberg, à Berlin ; tu viens de séjourner quatre années en Allemagne, sans parler des années de collège. Comment n’es-tu pas devenu Allemand ?
– Je le suis moins que vous.
– Ce n’est guère.
– Moins que vous, parce que je les connais mieux. Je les ai jugés par comparaison.
– Eh bien ?
– Ils nous sont inférieurs.
– Sapristi, tu me fais plaisir ! On n’entend jamais répéter que le contraire. En France surtout, ils ne tarissent pas d’éloges sur leurs vainqueurs de 1870 !
Le jeune homme, que l’émotion de M. Ulrich avait gagné, cessa de s’appuyer au dossier du canapé, et, penché en avant, le visage illuminé par la lampe qui rendait plus ardents ses yeux verts :
– Ne vous méprenez pas, oncle Ulrich : je ne déteste pas les Allemands, et en cela je diffère de vous. Je les admire même, car ils ont des côtés admirables. J’ai parmi eux des camarades pour lesquels j’ai beaucoup d’estime. J’en aurai d’autres. Je suis d’une génération qui n’a pas vu ce que vous avez vu, et qui a vécu autrement. Je n’ai pas été vaincu, moi !…
– Heureux, va !
– Seulement, plus je les ai connus, plus je me suis senti autre, d’une autre race, d’une catégorie d’idéal où ils n’entraient pas, et que je trouve supérieure, et que, sans trop savoir pourquoi, j’appelle la France.
– Bravo, mon Jean ! Bravo !
Le vieil officier de dragons s’était, penché, lui aussi, tout pâle, et les deux hommes n’étaient plus séparés que par la largeur de la table.
– Ce que j’appelle la France, mon oncle, ce que j’ai dans le cœur comme un rêve, c’est un pays où il y a une plus grande facilité de penser…
– Oui !
– De dire…
– C’est cela !
– De rire…
– Comme tu devines !
– Où les âmes ont des nuances infinies, un pays qui a le charme d’une femme qu’on aime, quelque chose comme une Alsace encore plus belle !
Ils s’étaient levés tous deux. M. Ulrich attira son neveu, et serra contre sa poitrine cette tête ardente.
– Français ! dit-il, Français dans les moelles de tes os et dans les globules de ton sang ! Pauvre cher petit !
Le jeune homme reprit, la tête encore appuyée contre l’épaule du vieux :
– C’est pour cela que je ne peux pas vivre là-bas, au delà du Rhin, et que je vivrai ici.
– Alors, je dis bien : pauvre petit ! répondit M. Ulrich… Tout a changé, hélas !… Ici même, dans ta maison… Tu souffriras, mon Jean, avec une nature comme la tienne… Je comprends tout, à présent, tout…
Puis, laissant aller son neveu :
– Que je suis content d’être venu ce soir !… Assieds-toi là tout près de moi… Nous avons tant de choses à nous dire !… Mon Jean ! Mon Jean !
Ils s’assirent côte à côte, heureux, sur le canapé. M. Ulrich réparait le désordre de sa barbe en pointe, qu’il soignait beaucoup ; il se remettait de son émotion ; il disait :
– Sais-tu que nous avons commis ce soir des délits que j’adore commettre, en parlant de la France comme nous avons fait ? Ce n’est pas permis… Si nous avions été dehors et que Hamm nous eût entendus, notre affaire était sûre : un procès-verbal !
– Je l’ai rencontré cette après-midi.
– Moi, j’ai vu apparaître le fils en plein bois, tout à l’heure. Il est sous-officier aux hussards rhénans,… ton régiment prochain… N’est-ce pas la voiture que j’entends ?
– Non.
– Écoute donc ?
Ils écoutèrent, en regardant par la fenêtre le parc qu’éclairait la lune haute et pleine, la pelouse en forme de lyre, avec ses deux avenues blanches, les massifs d’arbres, et, plus loin, les toits de tuile de la scierie. Rien ne bruissait, que la chute du ruisseau, à l’écluse de l’usine, bruit monotone qui semblait s’éloigner ou se rapprocher, selon la force et la direction du vent qui fraîchissait, et qui devait venir, à présent, du nord-est, « de la plate-forme de la Cathédrale », comme disait l’oncle Ulrich, en songeant à Strasbourg.
– Non, vous voyez bien, fit Jean Oberlé après avoir écouté, c’est le bruit de l’écluse. Mon père a donné l’ordre au cocher d’aller l’attendre à Molsheim au train de onze heures trente. Nous avons le temps de bavarder !
Ils avaient le temps, et ils en profitèrent. Ils se mirent à parler doucement, sans plus de hâte ni de trouble, comme ceux qui ont reconnu qu’ils s’entendaient sur l’essentiel, et qui peuvent aborder sans danger toutes les autres questions, les moindres. Ils causèrent du volontariat d’un an que Jean avait été autorisé à retarder jusqu’à sa vingt-quatrième année, et de cette existence nouvelle qu’il allait commencer le premier octobre, d’un logement qu’il comptait prendre à Strasbourg, de la facilité qu’il aurait de revenir presque tous les dimanches à Alsheim. Puis, ce cher nom ayant été répété, l’oncle et le neveu se complurent dans des souvenirs du pays, d’abord d’Alsheim, puis de Sainte-Odile, de l’habitation forestière de Heidenbruch, d’Obernai, de Saverne où l’oncle avait des bois, de Guebwiller où il avait des parents. C’était l’Alsace qu’ils évoquaient. Ils s’entendaient bien. Ils fumaient, les jambes croisées, assis aux deux coins du canapé, laissant librement aller leurs mots et leur voix, qui riait souvent. La causerie fut si longue que minuit sonna au coucou de la Forêt-Noire pendu au-dessus de la porte.
– Pourvu que nous n’ayons pas réveillé ton grand-père ? demanda M. Ulrich, en se levant, et en désignant de la main le mur qui séparait la chambre du jeune homme de celle du malade.
– Non, dit Jean. Il ne dort presque plus, maintenant. Je suis sûr qu’il a été content de m’entendre rire. Comme ma famille m’a quitté à cinq heures, j’ai passé avec lui une grande partie de mon temps, et je l’ai observé. Il entend et il comprend tout. Il a reconnu votre voix, j’en suis sûr, et peut-être a-t-il saisi des mots…
– Cela lui aura fait plaisir, mon petit. Il est de la très vieille Alsace, lui, de celle qui vous paraît, à vous, fabuleuse, et à laquelle je me rattache, bien que je sois plus jeune que M. Oberlé. Elle était toute française, celle-là, et pas un homme de ce temps-là n’a varié. Vois ton grand-père, vois le vieux Bastian. Nous sommes la génération qui a souffert. Nous sommes la douleur, nous autres. Ton père est la résignation.
– Et moi ?
L’oncle Ulrich fixa le jeune homme, de ses yeux clairvoyants, et dit :
– Toi, tu es la légende !
Et ils auraient voulu sourire tous les deux, et ils ne purent pas, comme si ce mot avait été d’une justesse trop parfaite, que les jugements humains n’ont pas d’ordinaire, et comme s’ils avaient senti que la destinée était là, dans cette chambre, invisible, qui leur répétait, au fond du cœur et en même temps : « Oui, c’est vrai, celui-ci est la légende. »
Le trouble qui les étreignit ne s’expliquait que par ce voisinage du mystère de la vie. Il se dissipa. M. Ulrich tendit la main à son neveu, plus gravement qu’il n’eût fait avant cette parole qui lui avait presque échappé, qu’il ne regrettait pas, mais qui lui demeurait présente.
– Au revoir, mon cher Jean. Je préfère ne pas attendre mon beau-frère ; je ne sais plus quelle attitude j’aurais avec lui. Tout ce que tu m’as dit me gênerait… Tu lui souhaiteras bonne nuit de ma part. Je vais rentrer dans mes bois par un clair de lune !… C’est dommage de ne pas avoir un fusil entre les mains et la chance de rencontrer une couple de coqs de bruyère sur nos sapins !…
Ils firent quelques pas sur le tapis du couloir, avec précaution, pour gagner l’escalier.
– Mon oncle, dit Jean tout bas, si vous entriez chez grand-père ? Je suis sûr qu’il serait content. Je suis sûr qu’il ne dort pas.
L’oncle Ulrich, qui marchait devant, s’arrêta et revint sur ses pas. Jean tourna le bouton de la porte près de laquelle il se trouvait, pénétra le premier dans la chambre, et dit, en modérant la voix :
– Grand-père, je vous amène une visite : mon oncle Ulrich, qui a désiré vous voir.
Ils étaient dans la demi-obscurité d’une grande pièce dont les rideaux avaient été fermés, et qu’éclairait une veilleuse en porcelaine transparente, posée au fond, à gauche, entre la fenêtre close et un lit qui occupait le coin. Sur la table de nuit, dans le halo lumineux et court qui enveloppait la veilleuse, se trouvaient un petit crucifix de cuivre et une montre d’or, les seuls objets brillants de l’appartement. Dans le lit, un vieillard était plutôt assis que couché, le buste vêtu d’une veste croisée en laine grise, le dos et la tête soutenus par des oreillers, les mains cachées sous les draps, qui avaient gardé le pli de l’armoire. Un ruban de tapisserie servant de cordon de sonnette et terminé par une frange s’allongeait jusqu’au milieu du lit. Car l’homme qui dormait ou veillait là était un impotent. Chez lui, la vie se retirait de plus en plus à l’intérieur. Il marchait et remuait difficilement. Il ne parlait plus. Au-dessous des joues épaisses et pâles, la bouche ne s’agitait plus que pour manger et pour dire trois mots, trois cris, toujours les mêmes : « Faim ! Soif ! Va-t’en ! » Une sorte de paresse sénile laissait pendre cette mâchoire puissante qui avait commandé à beaucoup d’hommes. M. Ulrich et Jean s’approchèrent jusqu’au milieu de la chambre, sans qu’il eût donné le moindre signe révélant qu’il avait conscience de leur présence. Cette pauvre ruine humaine était cependant le même homme qui avait fondé l’usine à Alsheim, qui s’était élevé au-dessus de la condition de petit propriétaire campagnard, qu’on avait élu député protestataire, qu’on avait vu et entendu, au Reichstag, revendiquer les droits méconnus de l’Alsace et demander justice pour elle au prince de Bismarck. L’intelligence veillait, prisonnière, comme la flamme qui éclairait la chambre cette nuit ; elle ne s’exprimait plus. Dans ce songe ininterrompu, que d’hommes et que de choses devaient passer devant celui qui connaissait l’Alsace entière, qui l’avait parcourue en tous sens, qui avait bu ses vins blancs à toutes les tables des riches et des pauvres, voyageur, marchand, forestier, patriote !… Et c’était lui, cette tête chauve et ridée, ce visage tombant, ces paupières appesanties, entre lesquelles glissait, semblable à une bille dans la fente immobile d’un grelot, un œil lent et triste !
Cependant, les deux visiteurs eurent l’impression que le regard s’arrêtait sur eux avec une complaisance inaccoutumée. Ils se turent, pour laisser l’ancien à la douceur d’une pensée qu’ils ignoreraient éternellement. Puis, l’oncle Ulrich s’approcha du lit, et posant la main sur le bras de Philippe Oberlé, se baissant un peu, pour être plus près de l’oreille, pour mieux rencontrer aussi les yeux qui se levaient avec effort :
– Nous venons de causer longuement, monsieur Oberlé, votre petit-fils et moi… C’est un brave garçon, votre Jean !
Un mouvement de tout le buste, lentement, déplaça la tête de l’ancien, qui cherchait à voir son petit-fils.
– Un brave garçon, reprit le forestier, que le séjour à Berlin n’a pas gâté. Il est demeuré digne de vous, un Alsacien, un patriote… Il vous fait honneur.
Malgré le peu de lumière qui flottait dans la chambre, l’oncle Ulrich et Jean crurent voir un sourire sur le visage du vieillard, réponse de l’âme encore jeune.
Ils se retirèrent sans bruit, disant :
– Bonsoir, monsieur Oberlé ; bonsoir, grand-père !
La veilleuse agita sa flamme, déplaça les ombres et les lueurs ; la porte se referma, et le songe interrompu continua dans la chambre où n’entraient guère, depuis le coucher du soleil, que les heures sonnées au clocher de l’église d’Alsheim.
M. Ulrich et son neveu se quittèrent au bas du perron. La nuit était glacée, les pelouses toutes blanches de gelée.
– Beau temps pour marcher, dit M. Ulrich ; je t’attends à Heidenbruch.
Il siffla son chien, et lui dit, en caressant le museau couleur de feu :
– Ramène-moi, car je vais rêver tout le temps à ce que m’a dit cet enfant-là !
À peine s’était-il éloigné de quelques centaines de mètres, on entendait encore son pas sur la route qui montait vers le bois d’Urlosen, quand Jean reconnut, dans la nuit calme, le trot des chevaux qui venaient du côté d’Obernai. Le bruit de leurs sabots frappant le sol empierré sonnait comme celui des fléaux sur les aires, il était rural, il ne troublait rien, il ne brisait aucun sommeil. Fidèle, qui aboyait furieusement vers la lisière de la forêt, avait sûrement d’autres raisons de montrer les dents et de donner de la voix… Jean écouta s’approcher la voiture. Bientôt le bruit diminué, amorti, lui apprit que l’équipage était entré dans le bourg, entre les murs, ou au moins dans le cercle de vergers qui faisaient d’Alsheim, en été, un nid de pommiers, de cerisiers et de noyers. Puis il s’enfla et sonna clair, subitement, comme celui d’un train qui sort d’un tunnel. Le sable cria au bout de l’avenue ; deux lanternes tournèrent et coururent à travers le parc ; des gazons, des arbustes, le bas des troncs d’arbres surgirent brusquement de la pénombre et brusquement y rentrèrent, et le coupé s’arrêta devant la maison. Jean, qui était resté sur le haut du perron, descendit en courant et ouvrit la portière. Une jeune fille sortit aussitôt, toute rose de visage et enveloppée de blanc, mantille blanche, manteau de laine blanc, souliers blancs. En passant, presque en l’air, elle s’inclina à droite, frôla d’un baiser le front de Jean, entr’ouvrit deux lèvres accablées de sommeil :
– Bonsoir, frérot !
Et, relevant sa jupe, mollement, vacillante, la tête déjà sur l’oreiller, elle monta les marches et disparut dans le vestibule.
– Bonsoir, mon ami ! dit une voix d’homme autoritaire ; tu nous as attendus ; tu as eu tort… Viens donc vite, Monique. Les chevaux ont très chaud… Auguste, vous leur donnerez demain douze litres, et vous les conduirez à la forge… Tu aurais mieux fait, Jean, de nous accompagner. C’était très bien. M. von Boscher a demandé deux fois de tes nouvelles.
Le personnage qui parlait ainsi aux uns et aux autres avait eu le temps de descendre de voiture, de serrer la main de Jean, de se retourner du côté de madame Oberlé, encore assise dans le fond du coupé, de monter jusqu’à la moitié du perron et d’inspecter, d’un coup d’œil de connaisseur, les deux percherons noirs dont le poil mouillé avait l’air frotté de savon. Ses favoris gris encadrant un masque plein et solide, son pardessus d’été déboutonné, laissant saillir le gilet ouvert et la chemise où luisaient trois cailloux du Rhin, la main oratoire, n’apparurent d’ailleurs qu’un instant. Après avoir donné son avis et ses ordres, Joseph Oberlé, patron vigilant, qui n’oubliait jamais rien, leva prestement son double menton et tendit tout l’effort de ses yeux vers l’extrémité de l’enclos, où dormaient les pyramides d’arbres abattus, afin de voir si aucune menace de feu ne se révélait, si aucune ombre ne rôdait autour de la scierie ; puis, lestement, deux marches à la fois, il gravit la seconde volée du perron, et entra dans la maison. Son fils n’avait rien répondu. Il aidait madame Oberlé à descendre de voiture, lui prenait son éventail et ses gants, demandait : « Vous n’êtes pas trop fatiguée, maman bien-aimée ? » Les chers yeux souriaient, la longue bouche mince et fine disait : « Pas trop, mais ce n’est plus de mon âge, mon chéri. Tu as une vieille maman. » Elle s’appuyait sur le bras de son fils, par orgueil de mère plus que par besoin ; elle avait une tristesse infinie au fond de son sourire, et elle semblait demander à Jean, qu’elle regardait en montant chaque marche : « Tu me pardonnes d’avoir été là-bas ? Je n’ai pas pu faire autrement. J’ai souffert. » Elle portait une robe de satin noir ; elle avait des diamants dans ses cheveux encore très noirs et un collet de renard bleu sur les épaules. Jean lui trouvait un air de reine malheureuse, et il admirait l’élégance de sa marche et le beau port de tête qu’avait cette Alsacienne de vieille race, et il se sentait le fils de cette femme avec une fierté qu’il voulait ne montrer qu’à elle. Il l’accompagna, lui donnant toujours le bras, pour avoir la joie d’être plus près d’elle, et de l’arrêter presque à chaque marche de l’escalier.
– Maman, j’ai passé une excellente soirée ;… elle aurait été délicieuse, si vous aviez été là… Figurez-vous que mon oncle Ulrich est arrivé à huit heures et demie, et qu’il n’est reparti qu’à minuit, tout à l’heure…
Madame Oberlé souriait mélancoliquement, et disait :
– Il ne reste jamais aussi longtemps pour nous. Il s’éloigne…
– Vous voulez dire qu’il s’éloignait ; je vous le ramènerai.
– Ah ! jeunesse, jeunesse, si tu savais tout ce que je vois s’éloigner…
Elle s’arrêtait à son tour, regardait ce fils qu’elle n’avait pas assez vu depuis l’après-midi, souriait plus gaiement.
– Tu l’aimes, mon frère ?
– Mieux encore qu’autrefois. Je l’ai presque découvert.
– Tu étais trop jeune, autrefois…
– Nous avons bavardé, vous pensez ! Nous nous entendons sur tous les points.
Les doux yeux maternels cherchèrent ceux de l’enfant, dans le demi-jour de l’escalier.
– Sur tous ? demanda-t-elle.
– Oui, maman, sur tous !
Ils arrivaient aux dernières marches.
Elle posa son doigt ganté sur sa bouche ; elle retira son bras qu’elle avait passé dans celui de son fils. Elle était devant la porte de sa chambre, en face de celle de M. Philippe Oberlé. Jean l’embrassa, se recula un peu, revint à elle, et la pressa de nouveau contre sa poitrine, silencieusement.
Puis il fit quelques pas vers le fond du couloir, et regarda encore cette femme vêtue de noir, et à laquelle le deuil allait naturellement bien, si simple, avec ses mains pâles tombantes, sa tête droite, si ferme de traits, si douce d’expression.
Il murmura, gaiement :
– Sainte Monique Oberlé, priez pour nous !
Elle n’eut pas l’air d’entendre. Mais elle demeura, la main sur le bouton de la porte, sans entrer, tant que Jean put encore la voir, Jean qui s’enfonçait à reculons dans l’ombre du couloir.
Il rentra dans sa chambre, le cœur tout joyeux, l’esprit plein de pensées qui étaient toutes celles de la soirée, revenant à grand vol dans la solitude qui se faisait à présent. Sentant qu’il ne dormirait pas tout de suite, il ouvrit la fenêtre. L’air froid passait, régulier et fixé au nord-est. La brume s’était dissipée. De sa chambre, Jean pouvait apercevoir, au delà d’une large bande de terres cultivées et montantes, les forêts où l’ombre toute la nuit faisait et défaisait ses plis, jusqu’aux sommets que couronnait, çà et là, un épi de futaies qui rompait la ligne des montagnes, et s’enveloppait d’étoiles. Il cherchait à deviner la place où se cachait la maison de l’oncle Ulrich. Et il revoyait en pensée celui-ci, qui devait être maintenant bien près d’arriver chez lui, lorsque des voix se mirent à chanter sur la lisière de la forêt. Un frisson de plaisir secoua les nerfs du jeune homme, musicien passionné. Les voix étaient belles, jeunes, justes. Il y en avait plus de vingt ensemble, à coup sûr, peut-être trente ou cinquante. Les mots lui échappaient à cause de la distance. C’était comme un bruit d’orgue dans la nuit. Elles livraient au vent d’Alsace un Lied d’un rythme fier. Puis trois mots vinrent, distincts, aux oreilles de Jean. Il leva les épaules, irrité contre lui-même de n’avoir pas compris tout de suite : c’était un chœur de soldats allemands qui revenaient de la manœuvre, de ces hussards rhénans qu’avait croisés, en descendant la montagne, M. Ulrich Biehler. Suivant la coutume, ils chantaient pour se tenir mieux éveillés, et parce qu’il y avait dans leurs chants la vertu du mot de Patrie. Le pas des chevaux faisait à la mélodie comme un accompagnement de cymbales voilées. Les mots s’échappaient et vibraient :
Stimmt an mit hellem hohem Klang,
Stimmt an das Lied der Lieder,
Des Vaterlandes Hochgesang,
Das Waldthal hall es wieder…
Entonnez d’une voix claire et haute,
Entonnez la chanson des chansons,
Afin que l’écho des vallées répète
L’ode sublime à la patrie !
C’est à toi, patrie des vieux bardes,
À toi, patrie de l’honneur,
À toi, pays libre et indompté,
Que, de nouveau, nous nous consacrons…
Cette chanson, Jean aurait voulu l’arrêter. Combien de fois, cependant, et dans toutes les provinces de l’Allemagne, n’avait-il pas entendu chanter les soldats ? Pourquoi éprouvait-il une tristesse à la chanson de ceux-ci ? Pourquoi les paroles lui entraient-elles dans l’âme, douloureusement, bien qu’il les connût de longue date et qu’il eût pu les redire de mémoire ? Ils se turent à deux cents mètres du bourg. Seul, le piétinement des chevaux continua de s’approcher et de rouler au-dessus d’Alsheim.