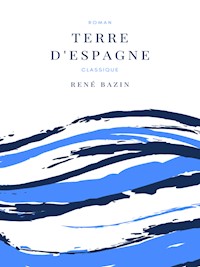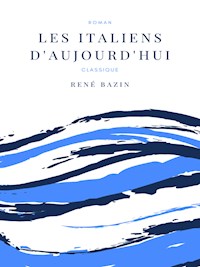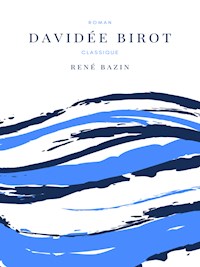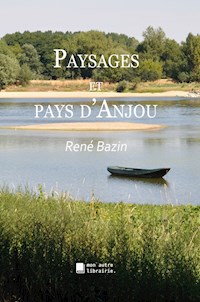
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Angers, la Loire, les confins de la Vendée, paysages, rencontres, souvenirs d'enfance... Les châteaux bien sûr, mais aussi l'Université catholique d'Angers, où l'auteur obtint son doctorat en droit, le souvenir de La Fontaine en pays de Loire, et puis la pêche à la carpe, les forêts en automne, un souffle d'Italie, et une belle rencontre avec les frères Pavie, Victor et Théodore, l'écrivain et le voyageur. Une délicieuse promenade, champêtre et érudite, dans le style ciselé de ce grand auteur de la langue française.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paysages et pays d’Anjou
René Bazin
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Calmann-Lévy, Paris, 1930.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-87-4
Table des matières
L’Anjou
La Loire des châteaux
Les quatre saisons de chez nous
Le printemps sur l’eau
L’été dans la vallée
L’automne dans la forêt
L’hiver dans la Vendée
Quand j’étais écolier
Victor Pavie
Théodore Pavie
Souvenirs de l’Université catholique d’Angers
Autorité
La faible monnaie
La troisième Sicile
Chasse en 1926
Changement
L’oncle d’Italie
L’Anjou
L’Anjou n’est pas d’une seule pièce ; il a cent paysages ; ses habitants descendent, sans doute, de peuples différents, que le même goût poussait à sortir des forêts, à s’établir au bord des fleuves, sur les terres à blé préparées par les eaux : toute son unité lui vient de son histoire.
Province belle, d’ailleurs, en chacune de ses parties ; chemin vert et courtois, qui va vers l’Île-de-France, et l’annonce, et lui ressemble par plus d’un trait. Si vous avez du temps, en notre âge où le loisir est un luxe, visitez le nord-ouest du département de Maine-et-Loire, que nous appelons encore le Craonnais ; le nord-est forestier, qui se nomme le Baugeois, puis, au sud de la Loire, le Saumurois et la Vendée angevine : vous aurez touché les quatre coins d’un domaine inégal et, s’il vous plaît de vous attarder ensuite dans la Vallée, dont le nom prend un V majuscule, la Vallée large où passe le fleuve, où passe le vent des marées, où il y a tant de grèves de sable, tant de peupliers et tant de raisin, vous aurez vu le cinquième canton de l’Anjou, et sa plus grande beauté. Mais, en chemin, vous aurez causé avec les gens ; demandé la route à un enfant ; interrogé un vigneron, grive à demeure, qui bricole entre les ceps, de janvier à décembre ; vous serez entré dans une ferme des Mauges, où la métayère, digne et défiante un peu, vous aura reçu en rappelant autour d’elle sa marmaille, et, chaque fois que dans les villes, les villages, les fermes, vous aurez ainsi renouvelé l’expérience, la vérité vous sera apparue : à savoir que ces Angevins, d’honnêtes manières et d’esprit délié, n’ont cependant, d’une région à l’autre, ni la même humeur, ni tout à fait le même parler, ni la même longueur de sourire.
On a porté, sur eux, bien des jugements qui ne sont que des médisances. On a dit de l’Angevin : « Sac à vin ». Qui ne voit que c’est pour la rime ? On a dit, en latin : « Andegavi molles. » Le mot est attribué à César. Mais nul ne l’a découvert dans le texte de la Guerre des Gaules. On peut même affirmer que l’épithète dédaigneuse ne put venir à l’esprit du proconsul romain, vainqueur, mais non sans peine, des Gaulois de la Loire. Le dicton n’est qu’une de ces plaisanteries latines qu’on se décochait, aux quinzième et seizième siècles, entre étudiants des différentes « nations de France », Normands, Gascons, Bretons, Provençaux, Bourguignons. L’ancienne histoire crie, au contraire, que les Andes furent vaillants entre tous, et celle d’hier, racontant les guerres de 1870 et de 1914, n’a pas eu, chacun le sait, à diminuer l’éloge.
Que firent donc ces lointains aïeux, au temps où les tribus dispersées eurent à lutter contre la redoutable armée romaine ? Le peu qui est certain est tout à leur honneur. Dès l’année 57 avant Jésus-Christ, César se défiait d’eux, et il envoya, pour les maintenir, toute une légion, de Lyon dans les environs de la capitale des Andes, expédition plus difficile alors que ne l’est aujourd’hui la traversée de l’Afrique. Cinq ans après, en 52, la grande insurrection gauloise éclatait. Alésia fut la forteresse, Vercingétorix, le jeune grand chef, qui faillit bien battre César, et fit grand’peur au Sénat de Rome. Toute la Gaule fut remuée. Des coureurs traversèrent la vaste forêt et ses clairières, appelant aux armes. Est-ce que les Gaulois de ce qui fut plus tard l’Anjou se cachèrent à cette heure-là ? Nullement. Ils furent des premiers à comprendre déjà la patrie : ils se réunirent, au nombre de six mille guerriers, et gagnèrent Alésia, Verdun d’autrefois. Celui qui les commandait est encore populaire parmi les conseillers municipaux de la Vallée. De nos jours, plusieurs communes faillirent demander à la justice, qu’elles eussent peut-être embarrassée, de choisir l’heureux bourg de pêcheurs où naquit, voilà deux mille ans, Dumnacus, bel homme assurément, et fier, et tout autre, j’imagine, que ce courtaud, tout en moustache et en casque, dont la statue, sur un pont des Ponts-de-Cé, regarde à présent passer les aloses de Loire et girer les ablettes. On comprend ces rivalités : Dumnacus est bien du pays. Lorsque le grand chef Vercingétorix eut été vaincu et fait prisonnier, ce lieutenant, ou ce partisan, resta fidèle à la cause – voilà nos pères : – il ne se rendit pas. Tout l’été de 51, traqué par le général romain, il refusa de se rendre. C’était un chouan de l’époque. Connaisseur des bois, des landes et des gués, il s’échappa, et s’en alla mourir, libre, dans les forêts de Bretagne.
J’ai demandé son avis à l’historien qui connaît le mieux les choses de la Gaule, à mon confrère Camille Jullian. Il m’a dit : « C’est évidemment un des plus beaux exemples de ténacité militaire et d’attachement à la liberté que présente l’histoire de la guerre des Gaules. » Ni en ce temps-là, ni depuis, il ne fut permis de dire : Andegavi molles.
Peut-on parler, du moins, de la « douceur angevine » ? Oui, à la condition de comprendre le mot et de l’appliquer aux choses plutôt qu’aux hommes. La douceur ne va pas sans la force ; elle en est la parure et la grâce ; elle ajoute la mesure et l’éducation à ce qui serait, sans elle, estimable peut-être, mais dénué de sympathie. Celui qui commence par supporter, acquiert des droits nouveaux ; celui qui n’élève pas tout de suite la voix, sera entendu quand il criera ; celui qui commande à son propre instinct, et propose le pardon avant de faire justice, celui-là est le vrai justicier, et le civilisé. Lorsque la force est douce, elle a plus de chances de durer. Si l’on pouvait changer quelque chose à ces puissants dictons, qui traversent les siècles, et fondent des préjugés, innocents ou fâcheux, on ferait mieux, au lieu de célébrer la douceur de l’Anjou, de le louer de sa fidélité. La fidélité suppose la passion. Elle en est la preuve ardente, souvent muette. L’Angevin est un passionné, qui ne parle pas toujours de son amour, mais qui sait le défendre. Sa fidélité à sa foi religieuse est un des traits les plus communs de son histoire. Il garde vingt autres traditions moins aisées à reconnaître, et sa politesse en est une. Qui la racontera ? Elle régit la campagne bien plus minutieusement que la ville. Ce laboureur, cet artisan des bourgs descend d’une antique lignée, qui vit la cour du roi de France, et celles de beaucoup de vrais seigneurs. Il a, dans son voisinage, plus de châteaux habités et plus de logis qu’on n’en peut voir ailleurs. Il est riche assez souvent ; s’il ne l’est pas, trois fois sur quatre, c’est qu’il n’a pas voulu l’être. Il boit le vin de sa vigne, avec recueillement. Dans la Vallée, où le beau langage fut en honneur, les gens de métier ne l’ont sûrement jamais parlé : ils le comprennent toujours. Quelque chose de raffiné s’est transmis de père en fils. Le chef-d’œuvre que dut être, en beaucoup de parties de l’Anjou, la famille ouvrière et paysanne, est encore reconnaissable. Avec les plus simples on peut causer de tout, pourvu qu’ils soient du terroir, et racinés depuis un peu de temps. Leurs réponses montrent qu’ils sont difficilement étonnés ; leurs yeux, qu’ils ont le goût de l’idée, du mot, de la nouveauté qui vient à eux, et l’attention du sens commun habitué à juger. Rien n’est plus près du juge qu’un vieux paysan madré, rasé, ridé, auquel, devant une table de cabaret, ou sous le toit léger d’un jeu de boules, un ami raconte une histoire. Je crois qu’il y a peu d’hommes qui comprennent mieux la plaisanterie, la plus grosse, cela va sans dire, mais la plus fine, et c’est ce que signale le drapeau à la pointe du mât : le sourire au coin des paupières.
Quand Joachim du Bellay, répétant, sans nul doute, une expression proverbiale, célébrait « la douceur angevine », il entendait surtout élogier la nature, la terre, les eaux, le ciel de l’Anjou. Rien n’est alors plus vrai. La lumière de Loire, en cette partie du fleuve ainsi que dans la Touraine, a une douceur italienne, qui commence avec le printemps, ne cesse qu’après l’automne, et, pour n’être point oubliée, et se faire espérer, réapparaît, prometteuse, entre deux giboulées d’hiver. J’ai vu des jours de février où les merles, chargés de faire les annonces, criaient à plein gosier, se répondant l’un à l’autre : « Oui, oui, son souffle nous arrive ; le message est certain : le soleil se ranime, et nous sentons la sève dans les branches qui nous portent ! » D’un bout à l’autre de la province, les mouvements du sol sont doux aussi ; les paysages ont un air tendre que la couleur des feuilles, vieillissant, durcissant, finissant, ne leur fait pas perdre ; car si nos bois, l’été venu, sont d’une couleur plus sombre, nous ne les apercevons qu’à travers une brume infiniment légère, où baignent ces campagnes chaudes coupées de tant de rivières.
La Fontaine fut sensible au charme de la Vallée. Le plus grand de nos poètes devait aimer le plus clair de nos fleuves. Au tome IX de ses œuvres, dans la collection des Grands Écrivains de la France, on rencontre six lettres qu’il écrivait à sa femme, et qui sont intitulées : « Relation d’un voyage de Paris en Limousin. » Il allait en compagnie, voituré de relais en relais, regardant la route, causant ou sommeillant, et, le soir, prenant gîte dans l’auberge réputée de la ville ou du bourg, dernière image de la journée. Une de ses lettres est datée de « Richelieu, ce 3e septembre 1663 ». La Fontaine y raconte que la Beauce lui a semblé « ennuyeuse » – jugement sévère, et dont on peut appeler, car rien de la terre n’est ennuyeux – mais que le pays d’Orléans et d’Amboise lui parut, au contraire, tout à fait « agréable et divertissant ». Le compliment, on le voit, s’adresse à la Vallée. Le poète suit la rive de la Loire ; il arrive au château de Blois ; il a le goût des belles choses, et parle bien de celle-là, mais il le fait en prose, tandis que, pour raconter le lendemain, ayant eu, tout le jour, « beau temps, beau chemin, beau pays », il ne peut se tenir de rimer, et que c’est en vers libres, sur une table d’auberge, le soir, à la chandelle, qu’il décrit à madame de La Fontaine les beautés de la Loire :
Que dirons-nous que fut la Loire
Avant que d’être ce qu’elle est ?
Car vous savez qu’en son histoire
Notre bon Ovide s’en tait.
Fut-ce quelque aimable personne,
Quelque reine, quelque amazone,
Quelque nymphe, au cœur de rocher,
Qu’aucun amant ne sut toucher ?
Ces origines sont communes ;
C’est pourquoi n’allons point chercher
Les Jupiters et les Neptunes,
Ou les dieux Pans qui poursuivaient
Toutes les belles qu’ils trouvaient.
Laissons là ces métamorphoses,
Et disons ici, s’il vous plaît,
Que la Loire était ce qu’elle est
Dès le commencement des choses.
La Loire est donc une rivière
Arrosant un pays favorisé des cieux.
Douce quand il lui plaît, quand il lui plaît si fière,
Qu’à peine arrête-t-on son cours impérieux.
Elle ravagerait mille moissons fertiles,
Engloutirait des bourgs, ferait flotter des villes,
Détruirait tout en une nuit.
Il ne faudrait qu’une journée
Pour lui voir entraîner le fruit
De tout le labeur d’une année,
Si le long de ses bords n’était une levée
Qu’on entretient soigneusement :
Dès lors qu’un endroit se dément,
On le rétablit tout à l’heure ;
La moindre brèche n’y demeure
Sans qu’on y touche incessamment...
Vous croyez bien qu’étant sur ses rivages,
Nos gens et moi nous ne manquâmes pas
De promener à l’entour notre vue :
J’y rencontrai de si charmants appas
Que j’en ai l’âme encore tout émue.
Coteaux riants y sont de deux côtés,
Coteaux non pas si voisins de la nue
Qu’en Limousin, mais coteaux enchantés,
Belles maisons, beaux parcs et bien plantés,
Prés verdoyants dont ce pays abonde,
Vignes et bois, tant de diversités,
Qu’on croit d’abord être en un autre monde.
Mais le plus bel objet, c’est la Loire sans doute
On la voit rarement s’écarter de sa route ;
Elle a peu de replis dans son cours mesuré ;
Ce n’est pas un ruisseau qui serpente en un pré ;
C’est la fille d’Amphitrite ;
C’est elle dont le mérite,
Le nom, la gloire et les bords
Sont dignes de ces provinces
Qu’entre tous leurs plus grands trésors
Ont toujours placé nos princes...
Encore trois ou quatre vers, et puis la prose reprend. Il est tard ; la chandelle doit être sur le point de s’éteindre : La Fontaine a encore de l’esprit. Il termine son épître : « J’emploie les heures qui me sont les plus précieuses à vous faire ces relations, moi qui suis enfant du sommeil et de la paresse. Qu’on me parle, après cela, des maris qui se sont sacrifiés pour leur femme ! Je prétends les surpasser tous... »
On peut regretter que cet excellent mari n’ait pas plus souvent écrit à madame de La Fontaine. Il a chanté la Loire : que ne s’est-il promené au large des deux rives, dans les campagnes d’Anjou ! Connaître ses chemins creux, c’est connaître un trésor presque partout dissipé, chez nous préservé, çà et là. Il y a cent autres beautés : le climat, la couleur du ciel, l’abondance de la fleur, les terres bien cultivées, l’intime perfection des paysages clos, et cet air de forêt qu’ils prennent tous ensemble, quand on monte d’un étage. Dans le Craonnais, dans le Baugeois, dans la Vendée angevine, les champs sont bordés d’arbres, souvent têtards de chênes ou d’ormes, parfois tiges de haute futaie, qui forment des avenues vers les ruisseaux d’en bas. Le gauleur de noix ou de châtaignes, monté aux plus hautes fourches, et qui regarde entre les branches, le chasseur qui fait halte au sommet des coteaux, croient voir, au-dessous d’eux, un massif forestier que les géographes ont oublié de marquer sur les cartes, et d’où s’élèvent des clochers, blancs et pointus. Je vous souhaite de contempler ces horizons de demi-rêve et de demi-vérité, à l’heure où les poiriers sauvages et les aliziers mêlent leurs flammes de pourpre violette ou de pourpre cerise aux frondaisons tenaces des rouvres. Et si vous dites : « Où sont les observatoires, d’où l’on peut ainsi contempler ces lignes boisées, confondues par la distance, et qui font à la terre un si beau vêtement ? » je dirai : Il y en a partout. Nous n’avons pas de montagnes, mais nous avons des points où la terre est un peu soulevée en motte, en falaise, en glacis : cinquante mètres d’altitude leur font une royauté. La colline des Gardes, en pays choletais, s’élève sans doute plus haut encore, puisque les gens disent tous : « le mont des Gardes », mais les hauteurs moins sourcilleuses ne manquent pas ailleurs. Chaque canton en possède deux ou trois ; plusieurs une demi-douzaine. Des noms me viennent en mémoire, et tout ensemble la bienheureuse image qui fond le cœur d’amour. Falaises de Saumur et de Saint-Florent-le-Vieil ; colline du Baugeois, qui levez au-dessus des bois le château de Landifer ; Saint-Saturnin qui avez la forme pointue d’un volcan ; massifs tordus du Louroux et de Chazé, où sont posés des moulins ; plateaux boisés, qui descendez en si belles pentes sur les vallons de Candé : celui qui vous a vus, même une fois, en a l’âme réjouie à jamais. Il a compris ce que les poètes ont appelé la douceur angevine : il a deviné que les terres sont profondes autour des métairies et des fermes ; il a cru, et rien ne dément les rêves faits dans la solitude, que les hommes doivent vivre ici tous heureux, dans la lumière et dans la paix.
La Loire des châteaux
La Loire est donc une des beautés de la France : mais tous ceux qui la vont visiter ne la comprennent pas.
Quelle pente elle a suivie pour descendre à la mer ! la plus longue, en vérité, qui soit chez nous. Aucun autre fleuve ne touche aussi longtemps la terre que nous avons gardée, difficilement, contre tant d’envieux. Quand elle a fait sa courbe, et qu’elle prend, à Orléans, sa route océanique, on commence de la célébrer dans les livres. Elle coule entre des coteaux modérés, parmi des prés qui deviendront des plaines un peu plus loin ; elle roule des feuilles de chênes, de peupliers, de ces saules argentés que les gens de la rive appellent luisettes ; personne n’a fait le compte de ses îles ; elle reflète des vignobles inclinés vers elle, raisins blancs, raisins rouges, qui mijotent sur l’espalier crayeux, et toujours des petites maisons blanches, à toit d’ardoise, qui ont leur cave à flanc de coteau ; elle est déjà salée, et soumise au régime des marées, qu’elle porte encore et fait mouvoir l’image des pampres, car la vigne l’accompagne jusqu’aux falaises de la côte de Nantes, où mûrit quelquefois un gros plant au goût de poivre. Tout cet agrément de la Loire, et cette verdure des bords, trompent les voyageurs qui ne sont pas de son intimité. Ils disent, de deux provinces traversées par le fleuve, Touraine et Anjou : « C’est le jardin de la France. » Ils n’ont pas tort entièrement, quand ils font cette louange. Les fleurs poussent bien, même dans les terres pauvres des deux provinces ; nulle part, les pêches, les poires, les brugnons, les groseilles, les fraises, les fruits tendres, en un mot, n’ont un parfum plus égal, mieux répandu jusqu’au fond de la pulpe. Et si j’excepte les cerises, qui sont douces pourtant aux quenouilles des vallons de Loire, c’est que je pense à la vallée du Rhône, où le bigarreau a ses bois sacrés ; et si je ne parle pas des raisins, dont les grappes invitent les passants – demandez aux grives ! – c’est que j’ai visité la Sicile, et grappillé l’alicante des domaines du grand Sud. Oui encore, il y a, chez la plupart des hommes, un goût du potager et du verger, un goût de retraite aussi et de pêche à la ligne, qu’émeut infailliblement une promenade au bord du fleuve, de ses affluents, ou de leurs « boires » endormies, je veux dire de ces lagunes, creusées le long des rives par les inondations, et où les nénuphars, tout l’été, ouvrent en paix leurs feuilles sans un pli et leurs fleurs de porcelaine jaune. Mais l’aspect du pays n’est ni celui d’un parc, ni celui d’un jardin. En employant ces mots, on diminue l’image, on définit l’une ou l’autre province comme on ferait d’une belle femme, en disant seulement qu’elle a de longs cheveux dorés et crêpelés, mais sans dire ses yeux, ni le son de sa voix, ni son âme, ni la race dont elle sort, ni le roman qu’elle a vécu.
Loire, vous êtes autre chose. Quoique la feuille pousse drue aux arbres que vous mouillez, et que les prés abondent sur vos bords, le vert n’est pas la couleur de vos domaines. Vous êtes blonde, charrieuse de sable ; vos grèves, tout l’été, sont foulées par les chevaux, les baigneurs, les pêcheurs et les rouisseurs de chanvre ; la craie de vos coteaux, le tuf de vos maisons ont tant bu de soleil, qu’ils ont blondi, et la terre légère de la Vallée est blonde aussi, la terre sableuse et sans motte, qui coule sur la pelle. Si l’on s’écarte de votre Vallée, sans même faire grand chemin, l’erreur est encore plus manifeste de cette appellation de « jardin », que des observateurs un peu courts, anciens d’ailleurs, ont donnée à la Touraine et à l’Anjou. Comme si les deux provinces étaient d’un seul bloc ! Oh ! non. Dans l’une et dans l’autre, il y a des terres bien rudes à labourer, d’autres tout à fait ingrates. La Gâtine de Touraine ressemble, d’assez près, aux pays pauvres, et surtout la Champeigne et le plateau de Sainte-Maure, qui sont au Sud de la Loire. L’Anjou, de même, tient son joyau de fleuve au large, entre des collines qui l’approchent seulement, et le regardent couler, sans presque jamais s’y baigner : mais il s’en faut qu’ils soient pareils les uns aux autres, les coteaux du Baugeois, ceux du Saumurois, ceux du Craonnais, ceux des Mauges, ainsi que les peuples qui vivent là ! Quelles différences ! Saumur boit son vin au soleil ; Baugé le sableux coupe ses bois et vend ses fruits ; le métayer du Craonnais ne se lasse point d’atteler ses bœufs et de défoncer l’argile de ses champs petits, que limitent de hauts talus plantés de têtards ; les Mauges ont de grandes houles, et mille chemins verts qui vont de l’une à l’autre, et des fermes aux toits de tuile veillant sur les hauteurs. Ces beaux pays ont une parenté cependant. Laquelle ? Hier encore, René Boylesve, qui avait des raisons de bien connaître et aimer la Touraine, observait justement, en deux pages dictées par trente années de souvenirs, que la beauté de cette province est dans la mesure, l’harmonie et l’esprit du moindre paysage : « Pour peu qu’on y prenne garde, disait-il, le sol, avec ses calmes accidents, sa végétation éclectique, sa richesse modérée, le souple contour de ses coteaux, la surprise égayante de ses vallées nombreuses, présente les mêmes caractères que son ancienne architecture. On n’en sent point communément le charme au premier contact, on croit ce pays « ordinaire ». C’est un visage qui ne frappe pas par des traits saillants ; ... ce n’est pas le pays des opulentes couleurs, ni des ombres tragiques, ni, non plus, celui des grâces convenues : ... c’est le pays du dessin français ... S’il est un coin classique en France, plus peut-être que l’Île-de-France, un peu grande dame : c’est la Touraine en ses régions modestes. »
Les mêmes mots, sans le moindre changement, conviennent à l’Anjou.