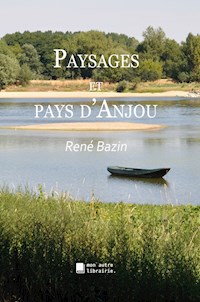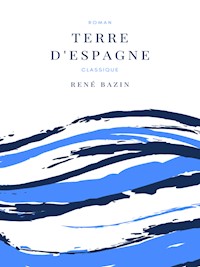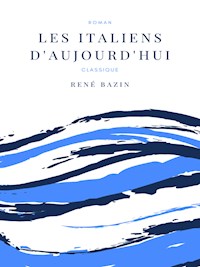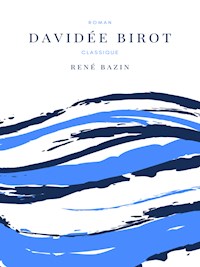
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Institutrice de l'école laïque pour filles dans un village de tailleurs de tuiles d'ardoises, Davidée Birot se tourmente pour l'âme de ses petites filles. Le tragique destin de l'une d'entre-elles lui montre le chemin à suivre...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Davidée Birot
Davidée BirotIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVPage de copyrightDavidée Birot
René Bazin
L’ARDÉSIE
Beaucoup plus tôt qu’à l’ordinaire, Maïeul Jacquet, que tout le monde sur les carrières appelait Maïeul Rit-Dur, parce qu’il ne riait pas souvent, laissa l’ouvrage, entra sous le tue-vent, et, ôtant ses sabots, délia ses guêtres de chiffons, qu’il accrocha, soigneusement, à une traverse de l’abri. On le vit un moment, tête nue, dans l’ouverture triangulaire que laissent entre elles les deux premières claies du tue-vent, écartées à la base et jointes par le sommet. Il observa le lointain, du côté du Sud-Ouest, et il eut sans doute une pensée pour quelqu’un qui demeurait par là.
– Tu t’en vas ? demanda un homme qui travaillait à dix mètres de la hutte. C’est la pierre qui te dégoûte ? Je suis comme toi : depuis trois mois je n’ai eu que du déchet.
– Peut-être bien, dit Rit-Dur.
– À moins que tu n’aies des affaires, des raisons qu’on ne sait pas, pour quitter l’ouvrage avant quatre heures ?
Rit-Dur ne répondit pas. Il rentra, en se courbant, sous les claies, et prit une petite soupière vide, une cuillère de métal blanc, et un reste de pain qu’il posa au milieu d’un mouchoir à carreaux étendu sur le sol. Puis, ramenant les coins de l’étoffe, il s’appliqua à les nouer deux à deux par-dessus la desserte de son dîner de midi, tandis qu’un troisième ouvrier d’à-haut, voisin de gauche, répliquait :
– Pourquoi lui fais-tu des questions ? S’il a des secrets, celui-là, il ne te les dira pas, même quand il sera saoul, et il ne l’est jamais.
– Il a de la chance, fit le voisin.
– Pour sûr !
Le bruit des voix cessa, et on entendit mieux le crépitement de l’ardoise brisée, qui s’élevait de toutes les buttes de la carrière, les ondes très sonores et musicales des blocs frappés par les pics d’acier, les coups plus sourds des maillets sur les ciseaux de fendage, le crissement des lamelles d’ardoise taillées par les couteaux à contrepoids qui se levaient et tombaient en mesure, ici et là, devant les tue-vent. Trois cents hommes qui se seraient amusés à casser du verre avec des marteaux, auraient obtenu à peu près la même musique. Dans les chemins, tout remplis d’une boue bleue, des fardiers à bascule, conduits par des enfants, portaient des blocs énormes et plats, qui sonnaient aux cahots, et, quand ils avaient déchargé la pierre, les gamins, debout sur le plancher de la charrette sans rebords, fouaillaient le cheval qui prenait le trot, en secouant la machine, la poussière et l’enfant. Alors, le roulement des roues ébranlait tout le terrain, et mêlait sa rumeur aux cascades de notes légères que faisait, sur les buttes, l’ardoise attaquée ou rompue.
Le tue-vent de Rit-Dur était presque neuf, vaste, composé de trois belles palissades, une de fond, deux formant le bonnet de police, et que le fendeur avait faites lui-même, de bruyères, de genêts bien serrés entre des lattes de bois, et de brins de bourdaine ajoutés aux genêts, de cette bourdaine dont les tiges lisses, noires et effilées, rendent fous les chevreuils au printemps. À droite de l’entrée, des rangées d’ardoises fabriquées, petites et grandes, fines ou grossières, depuis le « poil roux » jusqu’à la « grande anglaise », attendaient que le compteur passât et enlevât la marchandise. La matinée avait été hargneuse, comme il arrive si souvent en mars, et toute l’après-midi était restée humide. Les moindres éclats d’ardoise dont le sol était jonché retenaient une goutte d’eau sur leur pointe ou leur tranche. Les nuages gris n’avaient cessé de venir de l’Ouest, de la même allure, sans aucune déchirure par où le bleu pût se montrer. Cependant, depuis un moment, la nappe des nuées s’était rompue, et le ciel, au ras de l’horizon, vers l’occident, était d’un vert fin et lavé, d’une lumière sans force, sur laquelle se projetaient, moins mornes, les toits de quelques maisons lointaines, les lignes vallonnées des buttes, plusieurs cheminées d’usines, quelques cimes d’arbres et le haut chevalement du puits de la Fresnais, pareil à un moulin sans ailes posé sur un échafaudage de gros madriers. Maïeul Jacquet sortit de son tue-vent, poussant de la main une bicyclette, et portant en sautoir le paquet noué dans la serviette et pendu à une ficelle.
– Bonsoir, vous tous ! dit-il.
– Bonsoir !
Ce n’était pas un homme ordinaire, ce Rit-Dur. Très bon ouvrier, il avait eu « sa part d’homme » depuis le jour de ses dix-huit ans ; il était fendeur à quatre hottées, ce qui veut dire qu’à chaque distribution de pierre, le fardier s’arrêtait devant son tue-vent et renouvelait la provision de blocs d’ardoise qui séchaient devant la porte. Mais surtout, par le caractère et le goût de la solitude, il ressemblait à peu de compagnons. On l’avait vu venir, autrefois, des îles qui sont entre les bras de Loire, vers Savennières. Déjà grandet et songeur plus que d’autres, il avait plu par son visage et par sa politesse. S’il ne parlait guère, il était musicien, poète, mais non pour la romance dans les noces. Les fendeurs chantaient parfois, sous les tue-vent, des chansons qu’on disait composées par lui. Et même, en quelques rares nuits, on avait entendu descendre des genêts, du côté des buttes de la Gravelle, des airs d’un « flutiau » que personne n’avait vu, mais qui sonnait à faire pleurer. Et les voisins avaient dit : « C’est Maïeul qui est dans ses jours. »
Il marcha une centaine de mètres, sur les débris craquants, puis, enfourchant la machine, il prit, sans se hâter, le chemin qui conduit vers l’Ardésie, la petite commune, toute voisine, où il habitait. Chaque matin et chaque soir il suivait cette route, presque jusqu’au village, mais pas tout à fait. Car pour sortir de chez lui ou pour y rentrer, il fallait nécessairement faire un détour. La Gravelle n’était pas située en bordure d’un chemin, bien sagement. Si Maïeul ne ressemblait pas à tout le monde, on pouvait en dire autant de sa maison, vieille, haut perchée, isolée au milieu des remblais et des fonds d’anciennes carrières abandonnées depuis plus de cent ans. Quelle idée drôle il avait eue d’aller se loger là, loin de l’auberge et des voisins qui ont toujours au moins une nouvelle à raconter, un journal à prêter, ou une sottise à dire ! Il ne se pressait pas, mais les muscles étaient solides, et, pour escalader un raidillon, il ne faisait aucun effort apparent. En quelques minutes, il fut au milieu de la petite place de l’Ardésie, où il n’y avait pas même une maison d’autrefois avec un beau long toit, une fenêtre à meneau ou une tourelle, mais une épicerie neuve, un bureau de tabac neuf, deux masures repeintes et maquillées à la chaux, et un hangar énorme, magasin abandonné de la Commission des Ardoisières, et dont la charpente, effondrée par endroits, laissait passer le soleil, les étoiles et la pluie. Personne ne traversait la place quand il s’y engagea ; mais comme il entrait dans la rue qui fait suite, et qui est un des morceaux de ce village éparpillé, une bande de gamines se précipitèrent hors de l’école, les mains levées, chantant, criant. Deux d’entre elles, emportées par l’élan, heurtèrent le bicycliste qui faillit tomber, laissa pencher sa machine à droite, mit un pied sur le chemin, et s’arrêta, en haussant les épaules. Alors, toutes les petites, une vingtaine au moins, applaudirent et manifestèrent la joie la plus bruyante de ce que ce grand jeune fendeur avait été obligé de s’arrêter, sans que, d’ailleurs, il y eût le moindre mal pour personne.
– Monsieur Maïeul ! Il a tombé ! Il a tombé ! C’est la course d’obstacles !
Une voix nette coupa les cris :
– Ernestine, vous serez en retenue demain soir !
Tout le bruit cessa. Les petites filles se rangèrent d’elles-mêmes en deux groupes, qui se tournèrent le dos et disparurent, l’un montant, l’autre descendant.
– Monsieur Maïeul, je suis bien contrariée.
– Pas moi. N’y a pas d’offense.
Il se tut, son épaule se leva du côté des écolières qui s’éloignaient en lignes, six par six, ayant du jour entre elles, comme des dents de râteau. Mais il n’exprima pas autrement sa pensée.
L’institutrice, qui venait d’assister au départ de ses élèves, se tenait sur le seuil de la porte, dont les montants de tuf étaient crépis de boue brune et de boue gorge de pigeon jusqu’à hauteur d’homme, c’est-à-dire un peu plus haut que la tête de mademoiselle Davidée Birot. Elle était jeune, elle se tenait bien droite, et ses yeux, las de lecture et d’écriture, avaient plaisir à regarder la route, l’éclaircie au bas du ciel, le paysage morne et ce grand carrier démonté, arrêté au milieu du chemin. Entre sa jupe noire et les montants de la porte, on voyait le sol, flaqué d’eau et de sable, de la cour de l’école, et, plus loin, des poiriers sans feuilles et les cercles d’une tonnelle.
Quand Maïeul eut considéré un moment la troupe des petites filles, il saisit les deux poignées du guidon, et il rejeta en arrière, d’un tour de rein, son paquet qui s’était déplacé. Mais il réfléchit qu’il serait malhonnête de partir sans avoir seulement fait un bout de conversation avec la maîtresse d’école, et il la regarda. Sa figure exprima l’étonnement le plus profond, et une de ses mains lâcha la bicyclette.
– Qu’est-ce que je vois là, mademoiselle, le long de vous ? une pelle ?
– Bien sûr, monsieur Maïeul.
– Elle est grosse comme la mienne !
– Je l’ai trouvée à l’école. Nous n’en avons pas d’autre.
– Vous n’allez pas vous en servir ?
– Mais pardon, je vais m’en servir, et tout de suite !
Elle n’avait pas le rire de beaucoup de femmes du peuple, le rire tout en notes de musique et qui ouvre la bouche. Mais elle riait d’une manière réfléchie et retenue, qui laissait l’esprit sur les lèvres. Elle ne se moquait pas. Elle montrait un peu ses dents. Elle connaissait Maïeul. Elle pensait : « Ce brave garçon me prend évidemment pour une sorte de princesse ! »
– Vous croyez donc que nous avons un jardinier, monsieur Maïeul ? Non, la commune ne nous en offre pas. Monsieur le maire de l’Ardésie serait bien étonné si je lui en demandais un. Nous bêchons nous-mêmes, nous semons nous-mêmes nos carottes, nos oignons, notre persil, nos petits radis… Évidemment ce n’est pas du travail de praticien. Mais voilà le printemps qui s’annonce. Si nous voulons varier notre ordinaire, il faut nous mettre à l’œuvre. Et vous voyez, je m’y mets.
Cette façon de rire, en pensant plus de choses qu’elle n’en disait, intimida et attira le fendeur. Déjà mademoiselle Davidée s’était détournée, elle traversait la cour, elle poussait la barrière à claire-voie qui terminait, près de la cuisine de l’école, le mur bas du potager ; elle entrait, enjambait une plate-bande semée de mâche, et se campait debout au commencement de la planche voisine. Allait-elle vraiment, avec ces mains habituées à écrire, et blanches, et effilées, pas plus grosses qu’une pomme de fenouillet, soulever la pelle pleine de terre, la retourner, et cela jusqu’à la brune ? Sans doute. Elle avait déjà relevé le bras gauche en glissant, allongé le droit, appuyé le pied sur la lame de fer, quand Maïeul empoigna le manche, le secoua et le tira à lui.
– Bien ! bien ! Laissez-moi donc cet outil-là ! Il me connaît mieux que vous. Je vais vous le bêcher, votre jardin !
– Oh !
– Et en moins de temps !
– C’est vrai ?
– Et ça fera plaisir à… Enfin suffit, je n’ai qu’à me presser.
Elle était debout, au milieu de la planche de mâche, prête à rire ou à s’attendrir un peu, sans savoir ce qui convenait. Mais Maïeul quittait sa veste, la jetait sur la pyramide d’un petit poirier, et se mettait à défoncer la terre qui, au contact de l’air, s’écroulait sur elle-même, toute grasse, mêlée de paille et de brins de seneçon.
– Ma foi, puisque c’est vrai, je vous remercie bien, monsieur Maïeul. J’ai justement des devoirs à corriger ; vous me rendez service.
Mais lui, il ne répondait pas, ayant pour habitude de ne point dépenser sa force en paroles. Déjà, en huit coups de pelle, il avait remué, sur un pied de large, toute l’étroite bande de jachère ; il commençait à attaquer la seconde tranche. L’institutrice s’éloigna, par l’allée toute martelée de talons menus, les siens et ceux de mademoiselle Renée Desforges, la titulaire. Elle monta les trois marches du perron, au fond de la cour de récréation et en vue du jardin ; elle s’appliqua, involontairement, à monter bien droit, sans balancer le corps. Arrivée sur le seuil, en ouvrant la porte, elle tourna la tête et la renversa pour voir le ciel, du côté de la route : les nuages avaient repris possession de toute l’étendue ; la claire coupure à l’occident s’était fermée.
– Quelle pauvre lumière, mademoiselle ! J’en ai le cœur tout sombre !
– Ne faites pas la sensible, ma petite. Et ne blaguez pas : je vous entendais plaisanter à l’instant.
– Oui, avec Maïeul Jacquet, qui a voulu, à toute force, bêcher notre jardin. C’est drôle, n’est-ce pas ?
– Peut-être.
– Pourquoi peut-être ?
– Il a ses raisons, n’en doutez pas.
– Moi je trouve que c’est drôle. Je n’en cherche pas plus long. Mais je vous assure, mademoiselle, qu’à cause de ce gris, de cette pluie, de cette brume, je suis toute…
– Quoi ?
– Désemparée ? non… Triste ? non : disposée au triste.
– Vous direz cela à monsieur l’inspecteur, quand il viendra à l’Ardésie. Il vous conseillera de vous marier, ou peut-être vous fera-t-il nommer dans une ville de la Côte d’Azur… Ciel toujours bleu.
Mademoiselle Renée Desforges courba en arc ses longues lèvres qui avaient le pli dédaigneux. Brusquement elle cessa de rire. Le corsage qu’elle raccommodait tomba sur ses genoux. Elle dit avec volubilité, avec passion :
– Vous êtes encore une débutante après trois ans et demi de professorat, et, comme une nouvelle arrivée, naïve, après six mois de séjour à l’Ardésie. Et vous me faites pitié ! Vous ne parlez pas de mariage, mais vous entretenez, vous cultivez, vous perfectionnez votre sensibilité ; à propos d’une enfant malade, d’une femme qui meurt, d’une grève, d’un chat qui miaule ou d’un martinet qui se casse l’aile, je vous vois vous agiter, souffrir, chercher la solution du problème du mal, tandis que vous n’êtes qu’une pauvre petite institutrice adjointe, exilée au bourg de l’Ardésie, jalousée par le curé, peu écoutée des habitants, surveillée par l’administration, et en somme assez mal partie. Fausse route ! Croyez-moi : vivez pour vous, faites le nécessaire pour avancer, ayez une bonne classe, bien tenue, des cahiers propres : le reste est du superflu dont personne ne vous saura gré. Pas de zèle pour la correction du mal ; un joli doute universel, qui vous fera bien voir ; surtout pas de rêve d’amour conjugal. L’autre, vous pouvez y rêver, si cela ne contredit pas vos principes. Mais le mari de l’institutrice de village, qui est-il ? Trois fois sur quatre, un homme qui vit de nous, de notre travail. Et quand nous le prenons parmi les instituteurs, nous renonçons à l’avancement, car il en faut de la chance, pour trouver les deux postes vacants, l’un à côté de l’autre ! Et puis, ma petite, je ne connais pas beaucoup de nos collègues masculins que je consentirais à épouser… Non, voyez-vous, il faut aimer le métier pour lui-même, mettre son cœur entre deux feuilles de papier buvard pour qu’il se dessèche bien, dire toujours oui à l’administration, et arriver à la bonne petite retraite, sans se fouler trop.
– Quelle profession de foi ! Et quelle ardeur vous y mettez, mademoiselle ! Je vous assure que je ne vous donne aucun prétexte de me sermonner à propos du mariage possible ou impossible : aucun parti à l’horizon, je vous jure ; l’horizon est tout brumeux. Je viens de le regarder : pas une lumière vive.
Elle riait, en douceur, le cou un peu rentré dans son col droit.
Mademoiselle Renée répliqua :
– D’ailleurs, vous auriez raison, peut-être, de ne pas ressembler à toutes les institutrices : vous avez une dot, vous, un père riche. Vous êtes une espèce d’aristocrate.
Elle se leva, plia le corsage soigneusement, piqua l’aiguille sur l’épaulette, et posa l’étoffe sur la table de la cuisine.
– Puisque je suis de semaine, je vais faire la soupe. Corrigez donc vos devoirs près de moi, voulez-vous ? Vous corrigerez bien aussi quelques-uns de mes cahiers ?
– Oh ! oui, très volontiers.
Mademoiselle Davidée traversa le petit couloir au fond duquel était l’escalier qui conduisait aux chambres ; elle entra dans la pièce carrelée, à peine meublée, que les demoiselles de l’école appelaient le salon, prit quelques cahiers, revint dans la cuisine, et s’assit près de la table, tournant vers la fenêtre sa tête jeune et ardente. « Cours moyen » – c’était celui de mademoiselle Desforges. – « Cahier appartenant à Madeleine Bunat. Vendredi 26 mars. Écriture : Imitez les bons exemples. » D’un coup de crayon, mademoiselle Davidée marqua la note passable. « Problème… Composition française : Exposez comment vous comptez employer les vacances de Pâques utilement, tout en vous reposant des fatigues de l’étude. »
– Tiens, ça n’est pas mal, ce qu’a fait Madeleine… Vous m’écoutez, mademoiselle Renée ?
– Oui, oui, j’écoute.
La titulaire, penchée au-dessus du foyer de la cheminée, suspendait la marmite à la crémaillère. Sur les cendres mortes, elle entassa quelques poignées d’épines sèches, prit un journal qu’elle eut soin de plier en lame étroite, pour qu’il brûlât moins vite, l’alluma, porta la flamme sous les épines qui crépitèrent et jetèrent un grand éclat blanc. Aussitôt, elle mit le pied, en travers, sur le papier qui s’éteignit, et elle serra soigneusement, pour le lendemain, le reste du journal : geste de ménagère, aveu de la pauvreté. Toutes les femmes de l’Ardésie faisaient ainsi. Davidée regardait.
– Mais lisez donc le chef-d’œuvre ! dit mademoiselle Renée.
– C’est vrai. Voici : « Je compte employer mes vacances utilement, car je suis maintenant trop grande pour toujours jouer. D’abord, le matin, j’aiderai à faire le ménage, je ferai des courses, j’éplucherai des légumes. Ensuite, j’emploierai mon après-midi au travail manuel, soit à la couture, à la broderie ou à d’autres travaux. Mais j’aurai aussi mes heures de loisir. Ces heures-là, quand je serai seule, je les emploierai à la lecture et au dessin. Souvent j’inviterai mes petites amies à jouer avec moi ; j’aurai ainsi passé mes vacances utilement, et, en même temps, agréablement. »
– Vous avez raison, c’est tout à fait bien ! dit mademoiselle Renée, qui se redressait, le visage tout rouge, et ses yeux bleus tout fulgurants du reflet de la flamme. J’ai toujours eu confiance dans Madeleine Bunat.
Mademoiselle Davidée, comme il arrivait souvent, secoua la tête et renia ce qu’elle venait de dire. Elle avait une parole prompte. Le jugement suivait, et corrigeait souvent les premiers mots.
– Vous ne trouvez pas que c’est pauvre, tout de même, l’idéal de vacances de Madeleine Bunat ?
– Qu’est-ce que vous voulez de mieux ?
– Je ne sais pas. Pendant que je vous relisais le devoir, je pensais : « Formule, formule apprise, et qui ne défendra pas la petite. » Je suppose que…
– Moi, je suppose, raisonneuse, que vous ne surveillez guère votre jardinier ! Est-il encore là ?
La chose légère, et preste, et agile, qu’était mademoiselle Davidée Birot, quitta la table, passa devant mademoiselle Renée, et s’appuya aux vitres de la fenêtre, tout à fait dans l’angle.
– Mais oui ! Il est là ; il a terriblement chaud ; la planche est presque entièrement bêchée. Si vous le voyiez ! Nous lui aurions donné une haute paye qu’il ne travaillerait pas avec plus d’ardeur. Là ! Là ! Là ! Quelle pelletée, mon pauvre Maïeul Rit-Dur !… Je crois que l’ombre le grandit… Il a l’air d’un géant qui se démène entre nos poiriers.
La jeune fille se détourna, et revint à ses cahiers. Elle se pencha, et dit :
– C’est gentil ce qu’il a fait là, cet homme !
– Je le trouverais peut-être, s’il l’avait fait pour moi.
– Oh ! je vous assure !… Pauvre garçon !
Les deux maîtresses d’école de l’Ardésie, l’une qui levait son visage et l’autre qui l’abaissait un peu, dans le jour presque éteint, s’interrogèrent des yeux l’une l’autre. Chacune demandait silencieusement : « Quelle idée avez-vous donc, tout au fond ? » Elles étaient jeunes toutes deux, inégalement, et leur jeunesse donnait une profondeur singulière à l’émotion que le mot sous-entendu de l’amour avait éveillée en elles. Leurs longues années d’études arides étaient là, prêtes à parler et à dire : « Serons-nous récompensées ? Y aura-t-il une trêve ? »
Tant d’efforts ! Une telle solitude ! L’ennui des choses toujours les mêmes ! L’affection légère de quelques enfants et l’ingratitude de toutes les autres ! L’heure présente se plaignait et cherchait à être plainte. Elle était résignée à se taire ; elle murmurait très bas, dans les âmes qu’une pensée vague troublait : « Voyez, cette cuisine, cette cour, ce jardin, les cahiers, la marmite qui grésille, toute l’humble vie : nous n’avons que juste ce qu’il faut de courage pour la vivre, parce que c’est pour nous ; mais si c’était pour lui ! pour lui l’inconnu ! l’impossible peut-être ? » Le songe était le même dans les yeux de mademoiselle Davidée et dans les yeux de mademoiselle Renée. Mais celle-ci ne croyait plus aux mots qui viennent ainsi dans le silence, avec leur musique douce et leurs images tentatrices. Elle avait été déçue, elle commençait à vieillir. Ses très beaux cheveux blonds avaient perdu de l’or et du reflet. Son teint se chargeait de rougeurs tenaces. L’autre, la plus petite, n’avait pas quatre ans de professorat. Elles se regardèrent. Le sourire, qui était mêlé d’ironie sur les lèvres de mademoiselle Renée ne changea pas. L’adjointe qui, en une seconde, avait vécu l’avenir heureux, et senti passer le printemps, devint triste la première ; elle eut une pensée de remerciement pour la sympathie qu’elle croyait que mademoiselle Renée lui exprimait. Puis elle se remit à la correction des devoirs. Les deux maîtresses d’école n’avaient pas échangé une parole. Mademoiselle Renée tira, d’un buffet, un plat de fer blanc où il y avait de la viande dans de la sauce figée, et l’approcha du feu.
– Cours élémentaire ; écriture : « Tempérance conserve santé… » Elle est incroyablement paresseuse, cette petite Philomène Letourneur ! Si vous pouviez voir sa page d’écriture ! Je mets un « mal ».
– Le père la battra.
– Non : il boit ; tout lui est égal. La mère est une bonne femme, par exemple.
Mademoiselle Davidée reprit la plume, effaça « mal », et écrivit en marge : « Pas assez appliqué. »
– Cours élémentaire : « Tempérance conserve santé… » Voici maintenant la petite Anna Le Floch.
– La Bretonne ? Nous en avons trop de Bretonnes ! Il nous en vient des bandes de Poullaouen, du Huelgoat et de Redon.
– Ce n’est pas bien écrit ; ça va en tous sens, tempérance… conserve… santé. Mais elle n’a pas de santé, elle, quoiqu’elle observe la tempérance assurément. J’ai peur de la voir mourir… Ce serait ma première élève morte… Je vais lui mettre un « passable » : ça sera des larmes de moins.
Elle continua d’ouvrir et de fermer des cahiers, de plus en plus penchée, à cause de l’ombre qui s’épaississait. Sa bouche sérieuse, rouge, lisse et qui prononçait bien, murmurait les noms des élèves : « Julie Sauvage, Lucienne Gorget, Corentine Le Derf, Jeannie Fête-Dieu… » Parfois, elle faisait tout haut une remarque, à laquelle mademoiselle Renée, d’un coin ou de l’autre de la cuisine répondait. Quand elle eut fini, elle mit les cahiers en pile, sur la table, et alla jusqu’à la porte du couloir qui donnait sur la cour. Elle ouvrit avec précaution, fit deux pas sur le sable, écouta, et revint presque aussitôt.
– Il est parti, dit-elle.
– Sans vous avoir dit adieu !… Ce sont les façons de ces gens-là : des rustres.
– Mais le carré est bêché. Après tout…
Elle n’acheva pas sa pensée. Elle dit seulement :
– Il va falloir allumer la lampe. La nuit est venue.
Mademoiselle Davidée prit, sur l’appui du buffet, une lampe en verre, coiffée d’un abat-jour opaque et décoré avec mauvais goût : des cartes à jouer sur fond verdâtre. Elle alluma la mèche, s’assura que le verre entrait bien jusqu’au fond dans la gaine de cuivre dentelée, – car c’était une soigneuse personne, – puis elle commença de mettre le couvert. Les demoiselles de l’école mangeaient chaque matin et chaque soir sur une nappe, de grosse toile, mais une nappe, quelque chose de blanc, de doux aux yeux, et qui n’était pas de la campagne. Mademoiselle Davidée étendit le linge sur la table, et effaça, du bout des doigts, les plis qu’elle referait de même, dans une demi-heure. Mademoiselle Renée, penchée de nouveau au-dessus du feu, enlevait la marmite, et versait le contenu dans la soupière, qui attendait, à demi pleine de pain, découverte, près du chenet. Elle se détourna, sans se redresser, la marmite encore au bout du bras.
– Dommage que Maïeul Jacquet vive si mal ! Ce n’est pas un mauvais homme, en effet.
– Qu’est-ce que vous appelez vivre mal ?
– Êtes-vous naïve !
– Que lui reprochez-vous ?
Mademoiselle Davidée, le buste penché en avant, de l’autre côté de la table, les mains écartées et touchant la nappe, s’irritait contre le sang qui montait ridiculement à ses joues, à ses lèvres, à son front.
– Vous ne savez donc rien ? Moi je savais cela six semaines après mon arrivée à l’Ardésie : Maïeul Jacquet, celui qu’on appelle Jacquet Rit-Dur, est l’amant de Phrosine.
– De la femme qui balaie nos classes ?
– Sans doute.
– Que je reverrai demain ?
– Oui, et les jours suivants, de la mère d’Anna Le Floch.
– Ah ! comme vous me la diminuez ! Je ne pourrai plus la regarder sans penser à cela…
– Vous deviendrez indulgente, allez !
– Je le suis. Je ne reproche rien tout haut. Je passe parmi leurs vices. Mais, tout de même, je voudrais reposer mes yeux. Cette femme-là, je la devinais malheureuse ; je la voyais parfois révoltée, sauvage, dure et fermée de visage : mais je lui trouvais une dignité.
– Fiez-vous-y ! Elle ne peut pas vivre avec ce que nous lui donnons. C’est clair.
– Je n’aurais jamais cru… Elle va toujours nu-tête ; elle a l’orgueil de ses cheveux sans doute : moi, je l’imaginais coiffée d’une coiffe des Ponts-de-Cé, à deux ailes…
– Vous croyez que les coiffes protègent ?
– Je lui trouvais un air rangé, un air de mère à qui manque son enfant. Je n’ai jamais causé avec elle, autrement que pour lui dire : « Faites ceci, faites cela, au revoir, vous oubliez de remettre le balai dans le placard. »
– Vous ne le regrettez pas, je suppose ?
– Combien de créatures n’ont de rencontres avec notre esprit que par des mots pareils, et par ceux qui y répondent : « Oui, mademoiselle ; non, je n’ai pas le temps ; à demain. »
Le rire sonore de mademoiselle Renée éclata dans la pièce paisible, elle-même tout enveloppée dans le silence de la cour, du jardin, du chemin, et des brumes qui tombaient, à l’infini, sur les campagnes.
– Mangez, ma chère, vous avez besoin de vous refaire ! Vous philosopherez demain ! Est-ce que les Charentes ont beaucoup de philosophes de votre espèce ?… Ah ! je vous avoue que je suis incapable de vous suivre, et que je ne m’inquiète pas de tout, comme vous. Quand j’ai bien fait ma classe, je laisse l’humanité tranquille… Voulez-vous une troisième cuillerée de soupe ?
– Merci, non, je n’ai pas faim.
– Voilà ce que c’est : si vous aviez bêché vous-même la plate-bande, vous auriez l’appétit d’un jeune loup.
L’une en face de l’autre, les deux femmes se mirent à manger. Elles reprirent la conversation, lente, sans intérêt, mais nécessaire, qu’elles avaient chaque soir au sujet du travail du lendemain, de l’emploi des heures, des devoirs à donner. Mademoiselle Davidée Birot, bien qu’elle s’appliquât à ne pas paraître distraite, songeait évidemment à d’autres choses, et il y avait un courant profond d’émotion et d’idées, sous cette demi-attention et cette lueur à demi éteinte du regard. Elle aussi, en ce moment, elle ne donnait point son esprit et elle ne livrait point son cœur à son prochain, elle disait : « Oui, non, parfaitement. » Son visage ne pensait plus ; comme tant d’autres, il témoignait seulement que la vie l’animait, que le sang continuait son mouvement, ce visage qui n’était pas très régulier, mais qu’on ne pouvait regarder sans intérêt, à cause de sa pâleur, des yeux très noirs et des lèvres très rouges.
La blonde et grasse mademoiselle Renée aurait souhaité, chez sa compagne, une humeur plus abandonnée. Avait-elle connu la même inquiétude de tout, qui agitait mademoiselle Davidée ? Elle avait dû alors la vaincre aisément. Cette fille de trente-deux ans vivait presque à l’abri du frisson qui vient de la haute mer. Elle n’aimait pas la mélancolie ; elle en combattait les accès, de plus en plus rares et légers, en cherchant à s’étourdir, à ne pas réfléchir, à ne pas voir la fin, à ne plus s’émouvoir des questions qu’elle avait une fois décidé de ne point approfondir. Il y avait chez elle une gaieté prompte, qui n’était pas de la bravoure, qui était une fuite au contraire, devant la douleur, devant l’inquiétude morale, devant l’idée de la mort, mais qui faisait illusion. « Elle est toujours d’un bon tour », disaient les parents qui venaient causer avec l’institutrice. Ils sortaient de cet entretien sans émotion, sans réconfort, sans autre souvenir que celui des mots, qui étaient nets et incolores, mêlés de petites familiarités et plaisanteries étudiées. On n’aurait pu citer que trois ou quatre circonstances où mademoiselle Renée se fût montrée violente, agressive, d’une rigueur sans repentir. Le curé de l’Ardésie était l’un des habitants qu’elle haïssait, bien qu’elle le connût à peine. Les deux autres ennemis de mademoiselle Renée étaient des femmes, des jeunes, dont l’une s’était plainte que l’institutrice eût déchiré, en classe, le catéchisme d’une élève ; dont la dernière avait osé dire que « cette blonde serait bientôt couperosée ». Pour distraire son adjointe, elle se mit à raconter la dernière réunion d’institutrices à laquelle elle avait assisté au chef-lieu ; elle décrivit des toilettes, – oh ! des toutes petites prétentions, – rapporta des histoires, commenta les dernières nominations dont elle approuva seulement celles qu’elle ne pouvait envier, et finit par dire :
– Tenez, ma petite, allons nous promener ; il ne fait pas beau dehors ; mais ça fouette le sang, et ça change les idées : vous avez besoin de distractions. Ah ! que vous êtes jeune !
Rapidement, les deux femmes lavèrent les assiettes et la soupière, au-dessus de l’évier qui était près de la cheminée. Elles faisaient nerveusement cette besogne, la titulaire surtout, qui aspirait à un poste mieux rétribué, où l’on eût une petite chambrière. Elle avait d’ailleurs lavé plus de vaisselle que l’adjointe.
Bientôt elles furent dehors.
– Comme il fait doux ! dit mademoiselle Renée.
– Vent du Sud-Ouest, pluie pour demain, dit l’autre.
Elles avaient mis, par-dessus leurs bottines, des sabots à brides, qui claquaient, quand elles relevaient le pied, contre le talon de cuir. La boue grasse coulait sous les semelles. Le chemin n’était bordé de maisons que d’un seul côté. Après l’école, il y avait une bâtisse carrée, relativement neuve, crépie de blanc, puis les toits s’abaissaient, les maisons n’avaient plus d’étage et plus d’âge, et, jusqu’au carrefour et même au delà, elles tendaient à la lueur faible de la nuit leurs longs toits feutrés de mousse et de poussière, qu’on eût dits tissés avec de la pauvre laine brune, fabriqués et rapiécés avec les vieilles vestes et culottes de droguet que les paysans portaient autrefois. Elles semblaient mortes, car elles dormaient déjà. Les deux « demoiselles » descendirent vers le carrefour qui n’est bâti que du côté du Sud et de l’orient. Le café était éclairé et les quatre vitres de la porte laissaient passer une lumière qui s’allongeait sur la boue du chemin. À l’orient, un mur en ruine, une maison devant laquelle il y avait un arbre, le seul arbre qui donnât son ombre et le frissonnement de ses feuilles à ce village ouvrier ; au Nord, une maison abandonnée, dont l’escalier extérieur servait de couchette aux errants et aux chiens, dans les jours chauds : le carrefour avait fini de travailler ; le sol ne ployait plus sous les chariots longs, chargés d’ardoises, et deux femmes seulement écoutaient le vent de la nuit. Toute la vie était réfugiée dans les deux rues qui partaient de là, divergentes, vers le Sud et le Sud-Est, rues bordées de masures, de maisons neuves, de « logements ouvriers », de débits de boisson, où les clients n’entraient plus, mais où quelques-uns s’obstinaient à boire. Là, une partie des élèves de l’école habitaient. Mademoiselle Renée et mademoiselle Davidée, sans quitter le carrefour, l’une près de l’autre, regardèrent des façades, des fenêtres fuyantes qu’elles reconnaissaient dans l’ombre avec certitude.
– Il faudra que j’aille voir, un de ces jours, la grand’mère de Jeannie Fête-Dieu, dit mademoiselle Davidée.
– Elle est plus malade ?
– La petite m’a dit que ça allait plus mal.
– Ah ! ma chère, vous ferez bien. Je vous envie. Moi, je ne peux pas voir souffrir : c’est plus fort que moi.
L’adjointe fut tentée de répondre : « Alors ne me regardez pas. » Mais elle se tut, car elle ne savait pas bien pourquoi cette tristesse l’avait saisie et ne la quittait pas, ou si elle le savait, elle n’avait pas encore les mots qui l’expriment.
Elle dit seulement, après un moment :
– Nous sommes des personnages, ne trouvez-vous pas ? J’ai besoin de me dire cela.
– Beaux personnages, en effet ! Un fichu sur la tête, des sabots aux pieds, la solitude autour ! Ma pauvre mademoiselle Davidée, quand vous aurez vécu six mois de plus ici, vous comprendrez que nous sommes des sacrifiées, presque des condamnées.
Un éclat de rire discret et musical s’en alla dans la nuit étonnée, comme le chant d’un oiseau qui s’éveille.
Le carrefour, les deux rues qui s’enfonçaient dans la nuit et s’y perdaient, tout était désert. Mais les hommes tout de même étaient là, innombrables et présents dans le vent. Le vent charriait le bruit de la ville et le versait sur les campagnes. Roulement confus, d’où s’échappaient, bulles d’air emprisonnées dans la vague et qui montent à la surface, tantôt une voix, tantôt le sifflet d’une locomotive, ou deux mesures nettes d’une valse que jouait une musique militaire, très loin sur une place de la ville. Une cloche sonna plusieurs coups, voilés. Quelquefois, c’était un appel de sirène, libérant une équipe de travailleurs ; quelquefois le halètement d’une pompe d’épuisement, établie sur les buttes des carrières, du côté des puits de Champ-Robert ; puis le grand bercement des sons fondus, entrelacés et balancés, reprenait, et la chanson de la vie était faite de douleurs, de travail et de joie qu’on ne distingue point l’un de l’autre. Des phares électriques veillaient sur des chantiers éloignés et formaient des îles de lumière. Une chaleur molle se glissait dans les replis de la brume. Les pierres, les murs, les écorces suintaient. On respirait le printemps qui n’était pas partout, qui n’avait pas de parfum, qui venait en soupirs, chauds et moites, fugitifs.
– Vous avez raison, dit mademoiselle Davidée, la nuit est douce.
– Les poètes diraient : voluptueuse, répondit mademoiselle Renée.
Elle entoura de son bras la taille de l’adjointe, et toutes les deux elles remontèrent vers la maison déserte qui est au nord de la place. Là aussi, il y a un chemin, mais tout à fait désert, qui coupe des pâtures, des champs de pierraille bleue, où poussent des touffes d’herbe et des pelotes de mousse. Les promeneuses le suivirent, lentement, émues, ne parlant guère. Elles voulaient gagner ainsi un autre hameau, où est l’église, et revenir à l’école. Quand elles furent vers le milieu du chemin, tressaillant toutes deux, au bruit d’une bête nocturne, chevêche ou hulotte, qui secouait en s’envolant la ramille d’une souche, elles s’arrêtèrent. La peur passée, elles ne rirent pas : mais mademoiselle Renée, serrant sa compagne contre son corsage et se penchant vers elle, l’embrassa.
– Je vous embrasse, ma chère, murmura-t-elle. Je vous aime bien. Et vous ?
Davidée, un peu surprise, fut aussitôt reconnaissante, et dit :
– Moi aussi, mademoiselle.
Elles se remirent à marcher, évitant les fondrières ; elles passèrent devant quelques maisons, elles virent le clocher, un peu plus sombre que la nuit, elles tournèrent et redescendirent vers la maison, où elles vivaient pour apprendre aux enfants à vivre.
Elles étaient des forces, sinon des personnages, comme le disait l’adjointe ; des forces jeunes, l’une en pleine ferveur, décidée à se dépenser pour ses élèves, l’autre désabusée, revenue d’un enthousiasme qui n’avait jamais été très vif, ramenée à des ambitions moins hautes, mais pénétrée de la lettre du règlement. Toutes les deux elles avaient beaucoup travaillé. Elles savaient plus de choses que toute l’Ardésie ensemble, si l’on exceptait du reste le curé, et deux ou trois ingénieurs qui habitaient la commune. Les petits garçons allaient à l’école dans une des communes voisines, et l’Ardésie, à cause de son peu d’importance, n’avait point d’autre école que celle que dirigeait mademoiselle Renée Desforges, assistée de mademoiselle Birot. Comme leurs collègues, les deux maîtresses avaient quitté leur famille, pour enseigner ; elles habitaient parmi des pauvres, sans relations agréables, très absorbées par les obligations professionnelles, assez loin d’une ville, dans un paysage étrange et sévère ; elles ne faisaient point d’économie sur leur mince traitement ; elles ne se marieraient que difficilement selon leur condition présente, car elles appartenaient à un monde d’exception, déclassées par leur instruction même, devenues, par la culture de l’esprit, capables de souffrir d’un mariage inégal, et cependant demeurées très proches du milieu qu’elles instruisaient, d’où elles sortaient, par leur éducation, la plupart de leurs goûts, et plusieurs de leurs jalousies.
Neuf heures avaient sonné quand les institutrices ouvrirent la porte de l’école. Elles allumèrent deux bougies, posées dans des bougeoirs tout pareils, blancs avec un filet bleu, et qui attendaient sur une tablette de la cuisine. Arrivées au palier du premier étage, elles se séparèrent pour entrer chacune dans sa chambre. Avant de se détourner, leurs visages éclairés par la lumière des bougies se sourirent l’un à l’autre.
– Bonsoir, mademoiselle !
– Bonne nuit !
Est-ce une amitié qui naît ? se demandait mademoiselle Davidée. Est-ce que vraiment mademoiselle la titulaire va être autre chose pour moi que ce qu’elles sont bien souvent, une voisine, une autorité vigilante, une vie morale indifférente à la nôtre, une compétence qu’il est utile de consulter et difficile d’aimer ? Elle ne pensa pas longtemps à mademoiselle Desforges. À travers les vitres de la fenêtre, ayant relevé les petits rideaux de cotonnade blanche, elle avait essayé de reconnaître, en avant et au Nord, la lueur qui veillait là, parfois, dans une chambre haute. Car Maïeul habitait une maison vaste et presque noble, plantée sur une butte aux siècles passés, et qui dominait tout le pays de l’ardoise. Elle ne vit rien. De petites étincelles rapprochées lui parurent désigner le village de la Morellerie. « Ce Maïeul, songea-t-elle, je le déteste à présent ! » Elle effaça, avec ses doigts, le brouillard que sa bouche avait soufflé sur le verre. « Ah ! ces hommes qui vivent des années avec une femme, et qui l’abandonnent, l’espèce en est commune ! et odieuse !… Phrosine n’a probablement pas pu se faire épouser : elle est plus âgée que lui… Quel âge a-t-elle ? Trente-cinq ans peut-être. Je ne sais pas. Elle a l’air jeune… Et lui ? vingt-six ? vingt-sept ? Voilà dans quel milieu vit cette petite Anna Le Floch ! Je ne m’étonne pas qu’elle soit triste et si sauvage. Moi qui l’ai grondée souvent ! Elle n’est pas mon élève. Je voudrais qu’elle le fût, et la presser là, maternellement, sur mon cœur, puisque la mère est indigne… Que j’aurai de mal à ne pas faire mauvais visage à Phrosine demain !… Mais ce serait une belle affaire, si je disais ce que je pense ! Nous sommes surveillées de si près ! On peut plaindre, mais blâmer quelque chose ? Blâmer ?… Pourquoi ce Maïeul a-t-il proposé de bêcher le jardin ? Il paraissait content de m’obliger, ou de nous obliger. Mais que sait-on ? Il n’est guère parleur… Je le verrais si bien dans une honnête famille, comme il n’en manque pas, tout de même, à l’Ardésie, jeune marié, bon travailleur, rangé, dans sa maison basse et bien tenue, avec deux enfants sur les genoux ! ou trois ! ou quatre ! si c’est possible d’en embrasser quatre ensemble ! »
Elle sourit de cette image qui lui venait. Elle était maternelle. Le souci de la classe du lendemain la reprit. Elle se coucha rapidement, dans le lit de fer qu’un seul rideau d’étoffe jaune défendait contre le vent. Le vent soufflait en lame, par les fentes de la fenêtre, et les deux petites boucles de faux cheveux que Davidée avait placées sur la table, au pied du chandelier, s’allongeaient et se rebiffaient en mesure, tout comme la flamme de la bougie. Elle éteignit la bougie et s’endormit.
La nuit était commencée, mais pas pour tous. La douleur, le plaisir, la misère, un peu de devoir, veillaient, pour combien de temps ? Ô nuits inégales ! Ce soir-là, au cabaret, dans le chemin bas, vers les Plaines, deux filles faisaient boire un jeune fendeur qui avait reçu sa paye. Près du lit de la grand’mère, la petite Jeannie, les pieds nus pour faire moins de bruit, et seule éveillée avec la bougie qui dansait en arrière, regardait le visage très pâle de la dormeuse qui avait appelé, dans le rêve, et elle joignait les mains. Debout près du lit d’une fille accouchée d’un enfant avant terme, non loin, l’affreuse matrone Sansrefus bordait les draps de la cliente et disait : « On ne naît plus guère parmi mes paroissiens. » Un rire plein d’aveux soulignait la phrase. Des charretiers, des rouleurs de wagons, sous la lumière des phares électriques, transportaient des déchets. Quelques fureteurs de lapins, rôdeurs, colleteurs, suivaient les pistes des carrières abandonnées. La lune passait à travers les pelotes de brume.
LA FAMILLE BIROT
D’où venait Davidée Birot ? D’un village situé au bord de la mer, dans ce pays des Charentes où la côte est taillée en biseau, et glisse ses plages indéfinies sous les vagues sans profondeur. Elle était de famille terrienne, mais née au bord du flot, en vue du large. Le père n’avait pas toujours vécu de ses rentes, comme il vivait à présent. Compagnon tailleur de pierre, adroit dans le métier, tenace en toute affaire, bourru, intelligent, Constant Birot avait fait son tour de France, fendu, martelé, sculpté un peu toute pierre marchande, la pierre dure et le tuffeau, le granit, le marbre, les vieilles laves du Massif Central, et les agglomérés, couleur de crème et de rouille, où il aimait trouver des coquillages.
Rentré au pays, ayant amassé quelques centaines de francs, il s’était associé avec un fils de famille nommé Hubert. À eux deux ils avaient acheté une carrière de pierre dure, à la porte du village, dans la plaine sans arbres qui enveloppe Blandes aux volets verts, et, Hubert fournissant les fonds, Birot faisant le métier de contremaître, l’affaire s’était lentement développées. Birot n’avait aucune instruction générale. Il en souffrit quelque incommodité dans son commerce ; il s’en irrita comme d’une injustice à mesure que son ambition grandissait, et, par une illusion où la vanité trouvait son compte, exagérant la vertu des études qu’il n’avait pas faites, il en vint à croire que cela seul lui manquait et le limitait. Aussi, quand il eut deux enfants, – toute ma charge, disait-il, – de son mariage avec une petite rentière du pays, il déclara que son fils serait ingénieur et que sa fille « aurait une bonne place aussi. » Le fils ne réussit pas. Médiocre élève au lycée, plusieurs fois menacé de renvoi, il finit par entrer comme employé aux écritures dans les bureaux d’une préfecture du Midi. On ne le voyait plus guère à Blandes. Les amies de madame Birot racontaient que l’employé n’était maintenu, dans ce poste secondaire, que grâce aux relations et à l’influence politique du père Birot. Celui-ci, en effet, déjà riche et continuant de travailler, rachetait la part de son associé, devenait le seul maître de la carrière, et prenait figure de personnage non seulement à Blandes, mais dans la région voisine et jusqu’au-delà de La Rochelle. À Blandes même, il régnait, il était maire, toujours réélu, sûr de l’être, autoritaire, de ceux qu’on peut appeler des maires absolus.
Il avait les dons qui conviennent pour la conquête violente de la primauté communale, en période de trouble et de jalousie. Son intelligence était précise, sa mémoire implacable, sa haine aussi, et sa serviabilité promise à tous ceux qu’il ne détestait point. Il était bon homme et jovial avec tout le monde au premier abord. Si on pliait, il restait ainsi, la paume ouverte pour la poignée de main, bavard en apparence, observateur soupçonneux sous le dehors de l’abandon. À la première faute, ou simplement à la première erreur commise contre sa magistrature ou contre ses intérêts, il répondait immédiatement, et avec une brutalité singulière. Les paroles, les gestes, les menaces, les histoires collectionnées depuis trente ans dans cette mémoire tenace, les insinuations, s’il le fallait, mais qu’on savait soutenues par des preuves toutes prêtes, accablaient le coupable. Le père Birot courait à la préfecture. Il ne dénonçait pas en cachette. Il criait sa colère. Il demandait vengeance. Il revenait avec une promesse, la promesse était tenue, l’instituteur déplacé, la receveuse envoyée en disgrâce, le conseiller municipal voyait refusée la demande de sursis faite par Auguste, réserviste, et le fils de la mère Michelin, soldat, n’obtenait pas la permission de moisson. Le sexe, la jeunesse, le regret du coupable, n’avaient nulle influence sur les décisions du père Birot, celles qu’il avait prises, celles qu’il allait prendre.
Jamais on ne l’avait vu pardonner. Jamais un débiteur n’avait obtenu un délai de ce gros prêteur rougeaud, qui riait en disant : « Payez, après nous verrons » ; mais qui riait uniquement de sa force, du sentiment de son droit, de l’inévitable légalité. Personne ne l’accusait de lâcheté. Il allait droit chez l’habitant inculpé d’avoir dit quelque mal de lui. « C’est-il vrai, que tu m’as dénigré ? C’est-il un mensonge ? Es-tu mon ennemi ? Es-tu mon ami ? Voilà le moment de te déclarer. » On l’accusait d’être impitoyable. Il l’était. On disait aussi couramment : « Cet homme-là n’a pas de cœur ». Et cela était faux.