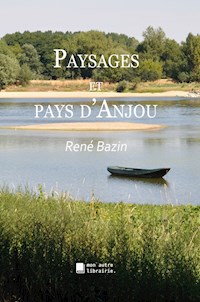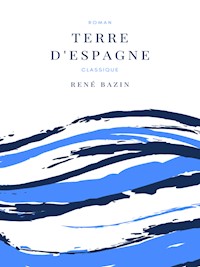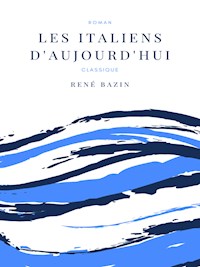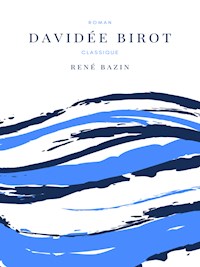Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
La lumière de la Loire, présente et vivante à travers ce roman, contraste avec les pages sombres et réalistes de multiples cadres de vie d'hommes et de femmes, autour des années 1880. Or, ce poids si lourd de douleurs physiques et morales est allégé, voire supprimé, par la féminité rayonnante d'Henriette qui, rentrée chez elle, écrivit sur le cahier gris cette seule ligne : "De toute son âme !" René Bazin exprime ici, comme dans toute son oeuvre littéraire, son affirmation de la place essentielle de la femme dans la Cité et la force entraînante de son action face au mal. L'écrivain, observateur-peintre, nous fait revivre l'ardente quête, en cette fin du XlXe siècle, du monde ouvrier pour atténuer sa lourde peine. " Henriette Madiot " - premier titre retenu par l'auteur de ce roman social - rayonne de lumière et de joie profonde car son âme n'est qu'offrande et rédemption.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De toute son âme
De toute son âmeIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVPage de copyrightDe toute son âme
René Bazin
I
Ils sortaient des ateliers et des usines de la Ville-en-Bois, les mains et le visage rouillés par la fumée, par les débris du fer, du cuivre, du tan, par la poussière qui vole autour des poulies en marche. Sept heures sonnaient encore à des horloges en retard, et c’était vers la fin de mai. Une douceur était dans l’air. Ils sortaient. Le ronflement des machines diminuait ; au-dessus des cheminées de brique, les spirales de charbon en poudre commençaient à s’amincir ; des voix s’élevaient entre les murs de la rue de la Hautière et du vieux chemin de Couëron, dans la partie haute de Nantes, voisine de Chantenay.
Heure saisissante où le travail lâche son armée par la ville ! Recrues, vétérans, filles, femmes, petits auxquels on aurait donné dix ans, si le timbre de leur voix et la perversité précoce des mots n’avaient révélé en eux de jeunes hommes, ils se divisaient au-delà des portes des usines, montaient, descendaient, coupaient par les ruelles, vers le gîte où la soupe les attendait. Les groupes se formaient en route. Les femmes retrouvaient leurs maris ; les frères, les amants, les camarades logés dans le même garni se rejoignaient, sans hâte, sans plaisir apparent. Quelque chose de morne et d’usé, même chez les jeunes, ternissait l’éclat des regards ; le poids de la journée pesait sur tout ce monde, et la faim commandait en eux. On se disait de grosses choses lourdes, des plaisanteries sans entrain, des bonsoirs rapides. Cependant, il y avait, çà et là, des visages roses de gamines ; des têtes imberbes et vagues de jeunes Bretons des pays d’Auray et de Quimper, que l’usine n’avait pas encore entamés ; des yeux qui s’en allaient, levés, avec un rêve ; quelques anciens, rudes comme de vieux soldats, qui tenaient dans leurs mains des mains d’enfants, et marchaient sans rien dire, dans une joie lasse et muette. Le vent soufflait de la Loire, de la mer lointaine. Des grappes de lilas, débordant l’arête des murs, en deux ou trois endroits pendaient sur la foule grise.
Une partie de cette population ouvrière, – ceux qui étaient mariés ou vivaient en famille, – laissant les autres se disperser dans les quartiers bas, montait vers les collines de Chantenay, d’où venaient des groupes pareils qui retournaient à Nantes. Au milieu de ce chassé-croisé de blouses, de jaquettes, de corsages de percale mal ajustés sur des jupons défraîchis, un homme, un bourgeois, en haut du chemin de la Hautière, avait arrêté sa charrette anglaise. Il était grand, avec une figure jeune et empâtée déjà, qu’allongeait un peu la barbe noire en pointe. Son costume, de coupe soignée et d’étoffe commune, la façon dont il tenait les guides, indiquaient, aussi bien que le bon goût du harnais et les tons calmes de la peinture, une famille riche, parvenue depuis au moins quinze ou vingt ans. Que faisait-il là, au milieu de ce peuple des usines que tant de ses pareils évitent volontiers, quand ils le peuvent, et sans savoir pourquoi ? Il aurait pu tourner et descendre par quelque rue voisine, moins encombrée. Mais non, il restait, un peu penché en avant, sur le coussin de drap bleu, les mains gantées, le fouet croisant les guides lâches, les yeux fixés en avant, sur l’étroite rue en pente. Dévisagé par tous les ouvriers qui passaient, durement par quelques-uns, indifféremment par les autres, salué rarement d’un coup de chapeau honteux, montré, du bout du doigt, par les bandes de femmes en cheveux qui cambraient la taille et riaient, d’une mauvaise envie, fascinées par le nickelage des boucles et le vernis de l’attelage, il regardait les files d’hommes qui se suivaient, du même regard impassible de maître habitué aux foules. À peine aurait-on pu saisir, dans l’expression reposée et terne de son visage, une nuance de pitié et de tristesse, quand certains de ceux qui frôlaient les roues de la voiture affectaient de ne pas saluer, ou se retournaient en disant : « C’est le fils à Lemarié ! » Le mot courait, comme transmis par une force électrique, le long de la voie toute brune d’hommes en mouvement ; il courait et revenait, chuchoté sur tous les tons, de l’indifférence, de l’étonnement ou de la colère sourde : « Le fils à Lemarié ! le fils à Lemarié ! »
Lui, cherchait quelqu’un. Tout à coup, sa main qui tenait le fouet s’éleva au-dessus des guides, et fit signe. Un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui montait au bras de deux autres de son âge, tourna la tête vers lui. Ses camarades essayèrent de le retenir, par enfantillage insolent et presque inconscient. Il s’échappa, s’approcha du marchepied, en touchant le bord de son chapeau de mauvais feutre, et il attendit. Ses yeux aigus, d’un gris changeant, avaient rencontré ceux du fils de bourgeois qui l’appelait, et il dressait sa figure en lame de couteau, barrée de deux petites moustaches droites, sa figure vivante, ardente, où se reflétait le continuel remuement de la passion, comme si des houles se fussent écroulées et reformées sans cesse au fond de ses prunelles.
– Antoine, dit posément M. Lemarié, est-ce que votre oncle va mieux ?
– Non, il ne va guère.
– La main ne revient pas ? A-t-il pris les remèdes que ma mère avait envoyés ?
– Il crie une partie de la nuit, des fois. Et puis, c’est le tremblement qui le gêne.
– Pauvre homme !
– En effet ! Des remèdes, est-ce que ça sert quand on a la main écrasée ? Personne ne croit qu’il guérira, voyons ! C’est de la comédie, tout ça. Lui faudrait sa pension, monsieur Lemarié !
Celui-ci, un peu embarrassé, répondit, en regardant le bas de la rue :
– Que voulez-vous ? Il fera bien d’essayer encore… mais qu’il aille lui-même ! Pas de lettre, pas de menaces timbrées, surtout ! Ça ne réussit pas avec mon père, vous le savez bien, Antoine.
– Il ira, n’ayez pas peur ! répondit le jeune homme, dont un rire haineux tendit en ligne droite les lèvres… Il ira, et puis on le mettra à la porte comme moi. En voilà un pourtant qui a travaillé trente ans dans l’usine. Vous lui devez un bon morceau de vos chevaux et de vos voitures…
De sa main gantée, Victor Lemarié, voyant que des camarades écoutaient, fit signe à l’ouvrier de continuer son chemin.
– Vous oubliez, dit-il froidement, que pendant trente ans mon père l’a fait vivre. Je voulais simplement vous demander des nouvelles de Madiot. Pour le reste, je ne suis pas le maître.
L’homme s’éloigna de trois pas, puis revint, en enlevant, cette fois, à moitié son chapeau :
– Et si vous étiez le maître, monsieur Lemarié ?
Victor Lemarié n’eut pas l’air d’entendre, et regarda de nouveau vers le creux du chemin, d’où montaient toujours des bandes inégales d’hommes et de femmes. Au-dessus de la terre piétinée, une grande poussière s’élevait maintenant, et le soleil couchant, à la hauteur des toits, la traversait et la dorait.
Pendant une minute, l’ouvrier, qui avait rejoint ses compagnons, attendit pour voir si le fils du patron lui répondrait ou s’il fouetterait le cheval. Puis, il tourna les talons, et se perdit dans les groupes qui avaient dépassé la voiture et que poussaient, d’un mouvement continu, les foules venues d’en bas.
Elles étaient déjà plus sombres, ces foules, et plus lamentables, dans le jour qui diminuait. Parmi elles, Victor Lemarié ne cherchait plus personne. Il assistait, les yeux vagues, à ce long défilé d’êtres inconnus, tous pareils, qui se succédaient à intervalles réguliers, comme les anneaux d’une chaîne. Et il souffrait, dans le fond de son âme qui n’était pas mauvais, dans son amour-propre aussi, de sentir contre lui et si près de lui tant de haine imméritée. Elle l’enveloppait, l’étreignait. Il était resté droit sur son coussin de drap, aussi froid d’apparence, ayant l’air d’être occupé de quelque scène lointaine, si bien que des gens se détournaient pour examiner la partie basse de la rue, vers l’usine ; mais il ne fixait son regard sur aucune figure ni sur aucune scène déterminée ; de toutes les images mobiles que recevaient ses yeux, une seule image se formait et il la contemplait : c’était la foule grise qui n’a qu’un visage et qu’un nom, l’ouvrier d’usine qui roulait, le frôlait, continuait son chemin, n’ayant que deux sentiments, la lassitude du travail et la haine du riche. « Que leur ai-je fait ? pensait-il. Pourquoi étendre leur inimitié jusqu’à moi, qui ne suis pas leur patron et qui n’ai pas affaire avec les ouvriers de mon père ? Une des choses qui ont adouci en moi le regret de ne pas être mêlé à la vie active de l’usine, c’était l’illusion que j’échapperais à la défiance de ceux-ci. Et ils me traitent en ennemi né. Quelle affreuse guerre, que celle qui nous range ainsi en deux camps, sans que nous le voulions ! Que de fautes il a fallu, de la part de ceux qui possèdent, pour en arriver là ! Et que c’est dur d’être détesté de la sorte, de l’être ici, ailleurs, partout, à cause de l’habit que je porte et du cheval que je conduis ! »
Ils montaient toujours. Cependant les rangs s’espaçaient. Quelques vieilles femmes, marcheuses traînantes, indiquaient que l’arrière-garde défilait. Les pointes des hautes branches, les tuiles des pignons, les cheminées blondes de lumière, émergeaient de l’ombre où les choses basses étaient plongées. Car là-bas, derrière Chantenay, le soleil devait mourir et tremper son globe fauve dans la verdure des herbes ; des voiles de bricks et de goélettes, tendues par le vent qui fraîchissait, blanches seulement au bout des hunes, remontaient sans doute la Loire, de l’autre côté des maisons, là, tout près. Dans l’ouverture du chemin, le peu qu’on apercevait de la ville, entre les toits d’usines, se voilait d’une brume venue du fleuve et qui gardait encore la transparence des eaux bleues. Une vitre étincelait, très loin. Victor remarqua aussi que les hautes cheminées des manufactures avaient cessé de fumer, et que les petites, autour de lui, partout, se couronnaient de l’humble panache couleur de cendre, qui se tordait, s’élargissait et se perdait dans l’air, signe qu’on était rentré ; que la famille se retrouvait ; que, pour une heure de veille, bien courte et bien douce, la mère avait tous ses enfants autour d’elle. La journée était achevée. Et de sentir cette harmonie rétablie, et de la savoir si brève, et de penser qu’il y en avait une autre, aussi nécessaire, et détruite cependant, brisée à jamais peut-être, il éprouvait une tristesse mêlée de colère contre ceux qui sont venus avant nous. Il était d’une génération qui souffre des rancunes amassées par les autres. Il se sentait, d’ailleurs, plus de pitié que de courage. Et cela encore l’assombrissait et l’humiliait.
À quelques pas de là, sans qu’il s’en doutât, sous le couvert de quelques arbustes et d’un cèdre qui formaient son jardin, un vieux prêtre, habitué de la paroisse Sainte-Anne, se promenait, regardant le même horizon et pensant aux mêmes choses. En dehors du quartier, il était presque aussi inconnu que ces humbles qu’il secourait. Chaque soir, quand l’armée de l’usine montait, ce vieil ami sans lassitude et sans récompense humaine sortait, gagnait la motte pelée de son cèdre entre les branches duquel on voyait toute la ville, et, écoutant marcher, de l’autre côté du mur, cette misère qu’il connaissait, ému de la même sorte depuis douze ans qu’il venait là, il disait cette prière qu’avait composée son cœur tout simple :
« Seigneur, bénissez la terre qui se voile, bénissez la ville et la banlieue, les riches là-bas pour qu’ils aient pitié, les pauvres ici pour qu’ils s’entr’aiment : surtout les pauvres, mon Dieu, et envoyez au-devant du père qui rentre les enfants avec l’ange qui les fait sourire. Écartez les querelles entre les époux ; mettez la paix entre les frères ; rendez heureuse pour tous la seule heure où ils sont ensemble, les petits et les grands, afin qu’aucun d’eux ne vous maudisse ; qu’ils vous aiment plutôt, Seigneur ! Je vous prie pour tous ceux qui ne vous prieront pas ce soir, je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas encore, je vous donne ma vie pour que la leur soit meilleure et moins dure. Prenez-la, si cela vous plaît. Amen. »
Dieu ne la prenait pas. Il la savait utile.
II
Le chemin était devenu tout sombre et presque désert. Victor Lemarié rassembla les guides, et descendit au pas. Bientôt, tournant par les rues du faubourg, il gagna l’avenue de Launay, et coupa au plus court vers le boulevard Delorme, où il demeurait. Les becs de gaz étaient allumés dans le jour très diminué. L’heure du dîner rendait rares les passants. Victor Lemarié menait à grande allure. Au moment où il arrivait à l’angle de la rue Voltaire, une jeune fille, qui allait traverser, recula, un peu effrayée, et remonta sur le trottoir. Elle leva la tête, et, comme il la saluait, s’inclina légèrement. Dans le salut du jeune homme, il y avait eu cette hâte qu’un homme éprouve à se découvrir devant une femme jeune et agréable, et aussi quelque chose d’étonné qu’on aurait pu traduire : « Est-il possible que cette charmante fille soit la sœur de l’ouvrier qui m’a parlé là-haut ? » Dans le salut d’Henriette Madiot, rapide, à peine indiqué, rien ne trahissait la coquetterie, la surprise, ou même une attention vive.
Elle était de ces ouvrières fines, souples, toujours pressées, qu’on rencontre le matin dès huit heures, deux par deux, trois par trois, filant sur le trottoir, vers l’atelier de la couturière ou de la modiste. Un rien les habille, parce qu’elles sont jeunes, – que deviennent les vieilles dans ce monde-là ? – et ce rien est délicieusement chiffonné, parce qu’elles ont des doigts d’artistes, un petit goût à elles et vingt modèles à copier. Quand elles ont passé, la rue perd une grâce. Il y en a qui toussent et qui rient. Elles sont du peuple par le geste quelquefois, et toujours par leurs mains piquées, par l’ardeur fiévreuse et la vaillance de leur vie ; elles n’en sont ni par leur métier, ni par le monde où leur esprit pénètre, ni par les rêves qu’il leur donne. Pauvres filles, dont la mode affine le goût et désoriente l’imagination ; qui doivent aimer le luxe pour être habiles ouvrières, et sont par là plus faibles contre lui ; guettées à la sortie de l’atelier, considérées comme une proie facile à cause de leur pauvreté élégante et de leur liberté nécessaire, entendant tout, voyant le mal d’en bas et devinant celui d’en haut, ressaisies par l’étroitesse de leur condition quand elles rentrent le soir, et toujours comparant, qu’elles le veuillent ou non, le monde qu’elles habillent avec celui d’où elles sortent. L’épreuve est dure, presque trop, car elles sont jeunes, délicates, aimantes, et plus que d’autres sensibles à la caresse des mots. Celles qui résistent ont vite pris une dignité à elles, une indifférence voulue, de regard, qui est une défense, une allure vive qui en est une autre. Henriette Madiot était de celles-là. Elle avait reçu beaucoup d’hommages, et s’en défiait.
Son salut fut donc bref. Elle était pressée. On veillait, ce soir, dans le « travail » de madame Clémence. De sa main gantée de gris, elle ramassa plus étroitement les plis de sa robe, et, légère, les yeux un peu au-dessus des passants, elle traversa la rue.
Victor Lemarié trouva quelques personnes dans le salon de l’hôtel qu’habitait son père, boulevard Delorme. C’était d’abord sa mère, puis deux vieux commerçants, M. Tomaire et M. Mourieux, et une demoiselle de trente ans, Estelle Pirmil, deuxième prix du Conservatoire, qui donnait des leçons, connaissait toute la ville, et passait pour originale.
Comme il s’excusait d’être en retard, sa mère l’embrassa.
– Est-ce que nous ne sommes pas en famille ? Mourieux et Tomaire sont des sortes de cousins, n’est-ce pas, Mourieux ?
– Trop honoré ! répondit le gros homme en s’inclinant.
– Vous m’oubliez ? dit mademoiselle Pirmil.
– Je ne vous compte pas, ma chère, vous êtes chez vous.
Heureusement M. Lemarié n’avait pas encore paru. Il était sévère sur l’exactitude.
Un moment après, il entra, petit, maigre, les cheveux tout blancs et en brosse, la barbiche longue au-dessous des moustaches courtes. D’un regard habitué à dénombrer le personnel d’une salle, il compta les convives, s’aperçut qu’il n’en manquait pas, et alors, la main tendue, il s’avança. M. Lemarié ne s’abandonnait jamais, et parlait bien. Il avait l’espèce de raideur d’esprit et de corps d’un homme qui a beaucoup lutté pour parvenir, et qui lutte encore pour se maintenir. Quand il serra la main de son fils Victor, il dit, du bout des lèvres :
– Jolie promenade aujourd’hui ? L’air était bon ?
– Médiocre.
– Dommage. Moi, j’ai eu une journée fiévreuse.
On dîna, et, comme la soirée était belle, on passa, aussitôt après le dîner, dans le jardin, vaste carré humide, enveloppé de hauts murs, mal entretenu, et qui faisait contraste avec la tenue confortable de la maison. La mousse envahissait l’allée tournant autour de la pelouse ; les arbres, plantés en bordure, sur trois côtés, avançaient en désordre leurs branches au-dessus des massifs de géraniums épuisés.
La conversation, assez vive jusque-là, subit un refroidissement. Les hommes se groupèrent sur un banc, les deux femmes sur un autre qui faisait suite, tout au fond du jardin, dans l’ombre des acacias. Devant eux la pelouse s’étendait, d’une teinte funèbre, et au delà, loin semblait-il, les trois marches du perron, toutes jaunes, éclairées violemment par le feu des lampes et des bougies qui continuaient de brûler dans la salle à manger. Dans cette découpure lumineuse, qui attirait le regard et le fatiguait, la silhouette d’un domestique faisait, par moments, un dessin noir, mouvant comme une fumée. Bien haut, si haut que personne ne pensait à elles, les étoiles, d’un bleu léger, dormaient entre les feuillages.
Un coup de sifflet aigu, prolongé, fendit l’air.
– Tiens, ce sont les ouvriers de chez Moll qui partent, dit M. Lemarié. Ils veillent, depuis un mois, à cause des grandes commandes de la marine chilienne.
– C’est dur, dit Victor.
– Tu les plains ?
– Sincèrement.
Les quatre hommes, M. Lemarié, M. Tomaire, M. Mourieux et Victor, étaient en ligne sur le banc. La fumée de leurs cigares formait, à la hauteur de leurs yeux, un petit nuage qu’ils regardaient monter. M. Lemarié demeura ainsi un moment, et tira de son cigare quelques bouffées rapides. Son visage s’était comme affermi encore et resserré, au premier mot de contradiction. Les sillons marqués au coin des lèvres et entre les sourcils s’étaient creusés. Il reprenait sa physionomie de chef d’usine, prompt et autoritaire dans la défense de ses intérêts. Cela lui déplaisait, cette divergence de vues entre son fils et lui, conséquence d’une différence d’éducation, d’époque et de milieu. Toute allusion aux souffrances de l’ouvrier avait le don de le blesser, dans sa conscience de patron certain d’avoir été juste, de respecter la loi, et d’être impopulaire. Il répondit, d’un ton d’ironie batailleuse :
– La journée de huit heures, n’est-ce pas ?
– Non.
– Ou de dix, ça m’est égal. Eh bien ! moi, mon cher, je travaille quatorze heures par jour, et je ne me plains pas. Si tu crois que le métier de patron soit enviable aujourd’hui, c’est que tu ne le pratiques pas. Nous gagnons peu, nous risquons tout, nous sommes en butte à des revendications ineptes de gens qui n’y connaissent rien, sans parler de celles des ouvriers qui s’y entendent trop bien. Profits nets : beaucoup d’ennuis et beaucoup d’ennemis. N’est-ce pas, Tomaire ? n’est-ce pas, Mourieux ?
– C’est bien vrai, dit Tomaire.
– Pas entièrement, dit Mourieux.
– Oh ! je sais bien que vous êtes une âme tendre, vous, Mourieux, et ce que vous faites pour vos employées de la mode le prouve bien. Vous les placez, vous les aidez, vous leur donneriez votre maison pour les loger. Mais enfin, on n’est pas obligé à cela. Et est-ce qu’elles vous le rendent ? Vous n’êtes pas assez naïf pour le croire. Elles se fichent de vous.
– Quelques-unes, fit tranquillement Mourieux.
– Moi, je n’aime pas qu’on se fiche de moi. Je ne le souffrirais pas dans mes ateliers. Je n’admets pas davantage que des journalistes, des théoriciens, qui n’ont jamais eu seulement un employé sous leurs ordres, des pleureurs de la misère d’autrui, comme il en pleut depuis dix ans, viennent se mêler de critiquer le patron et de plaindre l’ouvrier. Quand Victor voit un homme en blouse, il s’émeut.
– Pas à cause de la blouse.
– Il lui voudrait des rentes. Parbleu, ils en auraient des rentes, au prix que nous les payons, s’ils savaient économiser ; mais ils veulent toujours gagner davantage, se reposer de même, et se faire donner des retraites qui les dispensent d’épargner. Voilà ! Peux-tu me dire…
– Je ne suis pas de force à discuter avec vous. Ces choses-là ne sont qu’un sentiment, chez moi. Seulement je sens qu’il y a un malaise grandissant, un besoin nouveau.
– Pas du tout, mon cher, il y a toujours eu une question de tout, une question de la vie, plus ou moins aiguë selon les temps. Rien n’est nouveau.
– Si, quelque chose.
– Et c’est ?…
– L’absence d’amour, de fraternité, si vous préférez. Presque tout le mal vient de là, et le reste serait vite résolu, si l’on s’aimait. Tenez, je viens d’en voir défiler plusieurs milliers, de ces ouvriers, et ils avaient l’air de me regarder comme un ennemi. Par naissance, je leur suis suspect. Ils ne me connaissent pas, et ils me détestent. Ils n’entrent pas chez moi, et je n’entre pas chez eux.
– Ils entrent chez moi, par exemple !
– Pardon, ils n’entrent pas chez vous. Ils entrent dans votre usine, ce qui est différent. D’un bout de l’année à l’autre, ces hommes-là ne voient guère que deux représentants du patron : son argent et ses contremaîtres. Il n’y a pas là de quoi les toucher beaucoup. En cas de renvoi, le patron opère lui-même, c’est vrai ! Mais où sont le lien, la fête commune, la marque journalière ou seulement fréquente de cordialité, de bon vouloir, capables de compenser la jalousie qui renaît sans cesse et les conflits d’intérêt qui ne manquent pas ? Cherchez ; moi, je n’en trouve pas. Quant aux autres bourgeois, qui ne fabriquent rien et ne vendent rien, comme moi, ils ne s’égarent pas souvent dans les quartiers pauvres, puisqu’il est entendu que les riches et les pauvres ont leurs quartiers séparés, dans les villes d’à présent. Ils naissent, vivent, s’amusent ou pleurent à côté, tout à fait à côté. Pas même une apparence de relations, d’estime, de quoi que ce soit. Je vous dis que cela fait souffrir quelquefois, et que moi, j’en souffre. La haine qu’ils ont est faite de cela, bien plus que de revendications positives.
– Bravo ! cria mademoiselle Estelle Pirmil, désireuse d’opérer une diversion. Vous prêchez très bien, Victor, vous aviez la vocation !
Le jeune homme, qui s’était animé contrairement à toutes ses habitudes, et, du bout de ses bottines, remuait le sable de l’allée, répondit avec humeur :
– C’est bien possible.
– Ma foi, ajouta la petite femme qui, de toute la conversation, n’avait retenu que le mot d’amour, je ne comprends pas ce que vous dites, Victor. Pas d’amour ? Ils n’ont pourtant pas l’air de s’en priver chez les gueux. Vous n’avez qu’à compter les enfants dans les faubourgs : ma boulangère en a sept.
Elle se mit à rire de ce qu’elle disait, et sa voix grêle monta seule un moment dans la grande nuit tranquille.
– Ces gens-là ne devraient avoir qu’un ou deux enfants. Ça serait raisonnable. Qu’en pensez-vous ?
Madame Lemarié, la mère, dont le visage lourd et commun trahissait rarement les émotions, remua les lèvres sans parler, et posa le bras sur le bras du second prix du Conservatoire, pour l’engager à se taire. Celle-ci ne comprit pas la leçon, mais elle se tut.
Et le silence qui suivit fut d’autant plus pénible que ce chant de linotte écervelée, ne provoquant aucune réponse, prouvait que la discussion entre Victor et son père, sous des formes courtoises, cachait une mésintelligence et tendait les esprits.
M. Lemarié, toujours renversé en arrière, appuyé au dossier, jeta son cigare qui étoila le gazon, comme un gros ver luisant. Tout le monde se mit à regarder le point rouge au milieu du rond noir. Et cela durait. Ni Mourieux, ni l’autre ami de M. Lemarié n’avaient envie de s’engager dans la querelle, le premier parce qu’il savait ce qu’elles valent toutes, le second par précaution d’hygiène et de peur des émotions. Mais leur présence seule et leur silence étaient une excitation.
M. Lemarié haussa la voix, et dit :
– C’est charmant à toi de parler de l’amour du peuple. Cependant il serait bon de donner l’exemple. Le donnes-tu ?
– Aucunement, reprit Victor en relevant la tête. Je suis parfaitement inutile, et je le sais. Et probablement je le resterai.
– Alors ?
– J’aurais pu avoir une tout autre vie. Je vous ai demandé d’entrer dans l’usine : vous avez refusé.
– Je le crois bien ! J’ai trop de peine à maintenir ma fabrique contre les concurrences. Je le fais pour mes ouvriers, quoi que tu en penses. Toi, mon cher, tu la laisserais tomber.
– Merci.
– J’en suis si persuadé que, après moi, la fabrique fermera ses portes. Je le veux, et j’aurai soin que cela soit.
– Ne craignez rien, allez ! C’est bien fini, à présent : l’habitude du travail est perdue…
Le jeune homme s’aperçut de l’inconvenance de cette scène, et essaya de rompre sans paraître céder.
– J’ai vu Madiot, le fils, ce soir…
– Triste sujet.
– Oui. J’ai rencontré sa sœur également.
– Ah !
M. Lemarié tourna la tête, sur le dossier du banc, et regarda, avec une curiosité âpre et singulière, du côté de son fils qu’il pouvait à peine voir dans l’ombre.
– Tu lui as parlé ?
– Non. Elle est gentille, et si différente de son frère ! N’est-ce pas, monsieur Mourieux, qu’elle est bien ?
Le vieux marchand, qui ne s’attendait pas à être mis en cause, fit une grimace, hésita, et répondit avec un désir évident de ne pas s’avancer :
– Mais oui, pas mal, comme beaucoup d’autres de la mode. Elles viennent toutes chez moi.
Puis, élevant la voix, de façon à être entendu des deux femmes, qui s’étaient remises à causer sur le banc voisin :
– Ne trouvez-vous pas qu’il fait un peu frais, mesdames ?
Les hommes eux-mêmes furent d’avis que la soirée était fraîche, bien qu’il ne fît ni rosée, ni vent, ni brume. Et tout le monde se leva.
Quand les invités rentrèrent au salon, madame Lemarié, restée en arrière avec Mourieux, lui dit tout bas, en traînant les mots :
– C’est triste, n’est-ce pas, Mourieux ? mais je crois que c’est Victor qui a raison.
– Oui, madame, répondit le brave homme ; seulement ces choses-là ne s’enseignent pas, et ne se discutent guère.
– Il a bon cœur, mon Victor ?
– Mais oui, dit Mourieux timidement.
Elle cachait entre ses doigts deux pièces d’or qu’elle avait prises dans sa poche. Elle les mit dans la main de Mourieux.
– Prenez cela… pour vos apprenties, pour la bibliothèque…
Mourieux pensa : « Elle est vraiment la seule de cette maison qui soit bonne. Elle l’est tout à fait. Cela lui sert d’esprit. Et cela vaut mieux. »
III
Après avoir traversé la rue derrière la voiture de Victor Lemarié, Henriette Madiot continua, en se hâtant, vers la rue Crébillon. À sept heures, au moment où la journée finissait, madame Clémence, la patronne, avait ouvert la porte de l’atelier, et prononcé la formule connue : « Mesdemoiselles, on veille ce soir. » Aussitôt l’apprentie avait couru chercher un peu de jambon et de pain, et les ouvrières avaient soupé rapidement sur le coin des tables. C’était pendant ce temps qu’Henriette Madiot, n’ayant pas faim, était sortie pour acheter quelques fournitures indispensables.
Elle rentrait donc, portant un petit paquet enveloppé de papier de soie : des plumes, des fleurs, des bobines de fil de laiton, achetées chez Mourieux. Elle se hâtait pour réparer le temps perdu. Comme la soirée était belle, la jeune fille en avait profité pour faire le tour de deux ou trois pâtés de maisons, boire un peu d’air, détendre son corps énervé par tant d’heures d’immobilité. Il n’en fallait pas plus pour que sa belle jeunesse reprît le dessus ; le rose montait à ses joues ; elle se sentait légère ; ses lèvres un peu longues s’ouvraient toutes seules sur ses dents blanches. Ses amies l’avaient d’ailleurs remarqué : la vie et la joie en elle renaissaient plus vite que chez d’autres. C’était une vaillante. On l’eût prise pour une Anglaise, à première vue, avec ses cheveux ondés, d’un blond égal, qui se levaient en broussaille autour du front et qu’elle tordait par derrière à pleine main, en belles torsades luisantes, comme une gerbe de paille fraîche qui rit quand on la courbe ; avec ses yeux couleur d’eau de mer, d’un vert très pâle, qui donnaient une impression de profondeur et de limpidité ; avec son teint délicat, sa taille plate, son air de volonté calme. Mais le rire spirituel, prompt à s’épanouir sur sa bouche et lent à s’effacer, les mains, le goût surtout, le goût parfait de sa simple toilette d’ouvrière aisée, disaient : « Française de race. » M. Mourieux, qui l’avait connue toute petite, déclarait qu’elle n’avait pas sa pareille, ni pour l’adresse ni pour la distinction naturelle. Il lui voulait du bien, sans pouvoir lui en faire beaucoup, car mademoiselle Henriette demandait peu de conseils, même à M. Mourieux. Il était content, cependant, lorsque les camarades de la jeune fille, peu indulgentes d’ordinaire, avouaient qu’on n’avait rien à reprendre dans la conduite d’Henriette Madiot, et qu’elle arriverait sûrement à être première chez madame Clémence, quand mademoiselle Augustine serait partie.
Vers la moitié de la rue Crébillon, elle s’arrêta un moment, le pied sur la marche d’un couloir, à l’intérieur duquel une plaque de marbre noir portait, écrit en lettres d’or : Madame Clémence, modes, au premier. Le haut du buste un peu renversé, la tête penchée à gauche, elle considéra, avec un intérêt de connaisseuse, l’étalage d’un passementier, puis, jetant un regard sur la rue fuyante, sans y rien chercher, seulement pour dire adieu au bon air du dehors, elle entra dans le couloir et monta l’escalier.
En haut du deuxième palier, il y avait une porte sur laquelle était reproduite l’inscription d’en bas, Henriette tourna le bouton de cuivre, fit un petit signe de tête à la caissière qui songeait devant ses comptes ouverts, et suivit le corridor que couvrait un tapis gris de haute laine. L’appartement était le plus luxueux de tous ceux des modistes nantaises. Le corridor, – éclairé à droite par un mur de verre dépoli et gravé, qui dissimulait des chambres, des magasins, et, tout au bout, l’atelier, – ouvrait, de l’autre côté, sur deux pièces d’un goût savant et capiteux. La première, qu’on apercevait dès l’entrée dans l’entre-bâillement de deux portières, était une exposition permanente de chapeaux de toutes formes et de toutes nuances, modèles venus de Paris ou créés sur place, ornés de rubans, ou de plumes, ou de fleurs, posés sur des champignons de bois noir de tailles inégales, groupés avec une science consommée de la lumière qui convenait et des voisinages heureux. Dans la seconde, on essayait. Et ce salon d’essayage avait fait une partie de la fortune de madame Clémence. Les murs, les fauteuils, le canapé étaient tendus de peluche bleu pâle. L’étoffe s’enroulait autour de quatre grandes glaces, en haut desquelles retombaient, légères et remuées par le vent des robes en mouvement, des lianes de serre chaude qui sortaient de jardinières invisibles, cachées dans les draperies des angles. Toutes les femmes entraient là avec plaisir. L’atmosphère de boudoir qu’on y respirait, le velouté des tissus, l’éclat amorti des glaces, qui renvoyaient les images encadrées de nuances neutres, quelques modèles particulièrement chers semés dans les coins et multipliés par la combinaison des reflets, séduisaient les clientes les plus sages et déroutaient les plus économes. Madame Clémence le savait. On choisissait ce qu’elle voulait, sur le conseil muet du petit salon de peluche.
Henriette Madiot suivit le corridor, passa devant les modèles, devant le salon d’essayage, et, tout au fond, à droite, ouvrit la porte du travail.
– Ah ! c’est vous, mademoiselle Henriette ? dit la première avec humeur. Vous avez mis le temps ! Voilà plus de dix minutes que nous avons fini de souper.
– Vous croyez, mademoiselle ? répondit tranquillement Henriette.
– J’en suis sûre, mademoiselle.
Louisa, la petite apprentie rousse, aux joues bouffies, interrompit :
– Même que le jambon était d’un salé !
Les jeunes filles qui composaient l’atelier se mirent à rire, contentes d’en avoir l’occasion, parce que cela délasse. Il y eut, chez les plus jeunes, un rire de la voix, des yeux, des lèvres, de tout le visage épanoui, mais surtout, chez les grandes, un sourire silencieux, les yeux baissés, un sourire d’aînées que les plaisanteries des gamines amusent un moment ; puis, quelques regards se levèrent, tandis que la main tirait encore l’aiguille, vers Henriette Madiot. Celle-ci, habituée aux observations de la première, approchait son tabouret du coin de la table, près de la porte. Elle releva sa robe, s’assit et dit, prenant une forme de paille à moitié garnie, sur laquelle se dressaient trois coques de ruban crème :
Il fait si doux dehors qu’on en revient de bonne humeur.
Mademoiselle Augustine n’eut pas l’air d’entendre, et déroula le paquet apporté de chez Mourieux. L’apprentie tourna la tête vers le haut de la fenêtre, qui n’était pas garni, comme le bas, de vitres cannelées, et par où l’on voyait une pointe d’arbre balancée dans le ciel. Elle eut l’air de trouver ce carré bleu beau comme le paradis, et elle soupira. Toutes les têtes se penchèrent au-dessus des tables, et l’on n’entendit plus que le bruit des ciseaux coupant les fils, le glissement des formes sur les ongles des femmes, le gémissement d’un vieux tabouret dont les barreaux se plaignaient, ou des mots à demi-voix : « Passez-moi le laiton, mademoiselle Irma ? – Savez-vous où est mon tulle crème, mademoiselle Lucie ? – Ce que je serai contente de sortir ce soir ! J’ai les yeux qui me piquent. » Il y avait, de temps à autre, un bâillement étouffé. Les gestes des mains étaient plus nerveux que le matin. Parfois une des employées étendait les doigts à plat sur la lustrine verte, les contemplait, et, sans mot dire, les repliait sur l’aiguille.
Les douze jeunes filles que madame Clémence occupait pendant la saison, travaillaient le long de deux tables parallèles, qui allaient de la porte jusqu’à la fenêtre, ne laissant qu’un étroit passage au milieu, et deux autres le long des murs couverts d’un papier gris à fleurs bleues.
Un poêle, près de la fenêtre, à gauche ; un grand placard brun où l’on enfermait les vêtements, de l’autre côté ; des tabourets de paille à barreaux solides, formaient tout le mobilier permanent. Le reste sortait le matin des tiroirs, et y rentrait le soir ; c’étaient les menues fournitures et les instruments du métier : des bobines de fil blanc, de fil noir ou de laiton, des écheveaux de soie, de petits champignons pour poser le chapeau, des ciseaux, des boîtes de fleurs artificielles, des coupes de rubans, des plumes que délivrait la manutentionnaire de la salle voisine. Les jeunes filles étaient assises du même côté de chaque table, l’apprêteuse près de la garnisseuse, et il n’y avait que mademoiselle Augustine qui eût, outre l’apprêteuse, une « petite main » sous ses ordres. L’apprentie n’était attachée à aucune ouvrière en particulier, et son apprentissage consistait, réellement, à faire les courses de la maison.
Le soir avait fait monter l’ombre, peu à peu, jusqu’aux dernières roses du haut. Les douze femmes travaillaient, appliquées, mais on devinait, à leur physionomie, l’effort trop prolongé qui tue l’idée et rend la main inhabile. Leurs yeux étaient cernés, et souvent l’une d’elles passait la main sur ses paupières pour écarter le sommeil. Dans l’atmosphère lourde, tout un jour respirée, qu’échauffaient encore les lampes que venait d’allumer l’apprentie, les poitrines jeunes se soulevaient plus vite, cherchant la vie là où elle se raréfiait de plus en plus. Mademoiselle Irma toussait d’une petite toux sèche. Au bout des tables, l’une en face de l’autre, mademoiselle Augustine et Henriette Madiot garnissaient chacune un chapeau. La première plaçait et déplaçait un piquet de pavots rouges sur une forme à bords relevés, et ne parvenait pas à le poser élégamment. Elle était nerveuse. Sur sa maigre figure d’ouvrière déjà fanée, les lèvres s’écartaient, d’un mouvement rapide et douloureux. Henriette Madiot, les bras un peu arrondis, les doigts rapprochés, assemblait en éventail les coques d’un large ruban crème, et souriait, au fond de ses yeux pâles, en voyant que, du premier coup, ce soir, elle réussissait à donner à son œuvre ce tour qui est le souci, la joie et le gagne-pain de toutes ces filles de la mode, ce rien d’art où entrent leur jeunesse, leur imagination de femmes, le rêve que leurs vingt ans feraient volontiers pour elles-mêmes, et qu’elles cèdent aux riches, indéfiniment, tant que leur tête peut inventer et leur main suivre une pensée.
Dehors, les étoiles hésitantes, combattues par un reste de jour, ne luisaient pas encore, mais elles emplissaient les profondeurs du ciel, comme une poudre impalpable dont aucun grain n’est visible. L’heure se levait où la rosée abreuve et redresse l’herbe ; où les chevaux, dans les prés, s’endorment sur trois pieds à l’abri des saules nains ; en ouvrant la fenêtre, on aurait pu entendre le cri peureux d’un oiseau de marais, gagnant son gîte : les femmes cousaient, taillaient, modelaient les étoffes.
– Huit heures et demie ! murmura mademoiselle Lucie, une grosse blonde qui avait toujours ses manches retroussées, et sur la peau tendue de ses poignets des gouttelettes de sueur qui l’empêchaient de prétendre à l’emploi de garnisseuse. Dans une demi-heure, mesdemoiselles, nous serons libres, et c’est demain dimanche !
Elle fit un geste du bras, comme pour lancer un bonnet par-dessus les moulins. Quelques-unes sourirent. La plupart, enfiévrées, ne virent pas, et n’entendirent pas. Il fallait finir certaines commandes pressées. La préoccupation les rendait sérieuses et aussi la pensée, toujours présente aux jours de paye, de la maison où le gain de la semaine était attendu et souvent dépensé par avance. Sous les cheveux bruns ou blonds, que le feu des lampes éclairait ardemment, la même vision passait : la mère vieillie qu’elles avaient presque toutes à leur charge, les frères, les sœurs, les dettes d’héritage qu’elles achevaient de payer. Même celles qui vivaient avec un amant aidaient presque toutes quelque proche parent, et se rencontraient avec les meilleures et les plus pures dans ce sentiment de solidarité généreuse qui donnait une dernière force aux doigts engourdis, à l’esprit tendu vers ce nœud de ruban qu’il fallait coudre ou poser.
Les nuques blanches, douces dans leur collier d’ombre et de lumière, ne se relevaient plus.
Le timbre de la porte d’entrée sonna un coup. Et, un moment après, la caissière parut :
– Mademoiselle Augustine, c’est une ouvrière qui se présente ?
– À cette heure-ci !
– Elle demande s’il y a du travail.
– La patronne est à dîner ; on ne la dérange pas. D’ailleurs, il n’y a pas de travail, vous le savez bien : nous allons entrer en morte-saison.
Puis, se ravisant, comme la caissière fermait la porte :
– Enfin, allez donc voir, mademoiselle Henriette. Je ne peux pas me déranger. Vos fleurs de chez Mourieux ne se tiennent pas. Ça n’a aucun chic.
Henriette se leva, et alla jusqu’à l’extrémité du couloir, près de l’entrée, où se trouvait une jeune fille dont on ne voyait ni la taille, ni la jupe, enveloppées dans un manteau long, d’étoffe noire, mieux fait pour l’hiver que pour l’été. Instinctivement, elle considéra d’abord les bottines, – le grand signe, – et vit qu’elles étaient misérables, écrasées par la marche, blanchies au bout par l’usure ; puis elle regarda le visage que l’ombre projetée par le bord du chapeau coupait en deux, un visage plein, très pâle, dur de traits, avec des yeux noirs, enfoncés et brillants. Ce qui frappait le plus, chez cette inconnue toute jeune, c’était l’expression tragique et presque farouche. Elle avait dû subir bien des refus, la pauvre fille, avant de venir là. On devinait, à cette physionomie, qui ne se faisait pas aimable et qui ne suppliait point, que le cœur était sombre comme la mort, et que, pour cette passante de la rue, sauvage et presque hautaine, qui demandait du travail, il y avait derrière la réponse un problème terrible, indifférent aux autres et bien gardé par elle. Elle tenait d’une main la porte de l’escalier, prête à descendre.
Les deux jeunes filles se considérèrent ainsi un moment l’une l’autre. La physionomie de la blonde Henriette Madiot devint compatissante :
– Vous vouliez parler à madame Clémence, mademoiselle ? Elle ne peut pas vous recevoir à présent.
– Il n’y a pas de travail, n’est-ce pas ? fit l’ouvrière d’une voix sourde.
– Je ne crois pas… La saison finit, voyez-vous…
De ce même ton éteint et sans charme, l’ouvrière dit :
– C’est bien.
Elle se détourna aussitôt, et se remit à descendre vite, vite. Elle avait hâte ; évidemment ce n’était qu’à force d’énergie qu’elle se raidissait ainsi contre la malchance. Le bruit de ses pas sur le tapis, puis sur le chêne des marches diminuait. On ne la voyait plus. Henriette Madiot était demeurée debout, à la même place. Elle songeait que c’était le malheur qui était venu frapper là, et qui s’en allait ; elle voyait encore l’expression dure de ce regard ; elle entendait ce son de voix où il semblait qu’il n’y eût pas d’âme, parce que l’âme était trop triste pour se montrer. Un mouvement de pitié la saisit, l’entraîna, la fit courir jusqu’au bas de l’escalier. Elle heurta presque dans le couloir, près de la rue, l’inconnue qui sortait. Celle-ci tourna la tête, par-dessus l’épaule, et continua.
– Mademoiselle ?
L’ouvrière s’arrêta, reconnut Henriette, et fit un pas, timidement, pour revenir sur la grande pierre blanche, usée au milieu, qui formait le seuil de la maison, et elle attendit, immobile, ses yeux noirs fixés sur Henriette qui baissait les siens, ne sachant que dire, ni quelle forme donner à cette pitié qui l’étreignait :
– Écoutez… c’est vrai que la saison finit, et qu’il n’y a pas de travail… Mais peut-être, en parlant à madame Clémence… Vous avez l’air si malheureux !
L’autre se redressa, et dit d’un ton offensé :
– Mais non. Je ne suis pas malheureuse. Je demande du travail, voilà tout.
Henriette craignit de l’avoir blessée, et dit très doucement :
– Pardonnez-moi. Comment vous appelez-vous ?
– Marie Schwarz.
– Vous savez travailler ?
– Si je savais bien, j’aurais trouvé, vous comprenez.
– Pourriez-vous faire une apprêteuse ?
– Je n’ai pas appris. Je viens de Paris. J’ai été mannequin chez un couturier, voyez…
Elle écartait son manteau, en parlant, et sa taille apparaissait entre les plis, fine et longue.
– Oh ! alors, si vous ne savez rien…
Une tristesse subite avait assombri le visage d’Henriette. Plus d’espérance à donner, pas la plus petite chance d’aider cette malheureuse. La jeune fille la regarda comme on regarde ceux qu’on ne verra plus jamais, et qui vont s’enfoncer dans la nuit, et qu’on aurait voulu retenir, ombres étrangères qui avaient au front je ne sais quel signe fraternel. Elle ouvrit la bouche pour dire adieu, et tout à coup une idée lui vint, qui la fit rougir de joie. Vivement elle étendit le bras, et, soulevant le grand chapeau de feutre :
– Avez-vous beaucoup de cheveux ?
Une masse noire, désordonnée, emmêlée, mais opulente et lourde, descendit à moitié défaite sur l’épaule de Marie.
– Oh ! oui, je vois, beaucoup, beaucoup ! Avec un peu de frisure, vous pourriez vous placer comme essayeuse.
Marie Schwarz pâlit encore. Ses yeux s’adoucirent, s’allongèrent. Une larme et un peu de joie y montèrent ensemble. Elle avança la main, très peu :