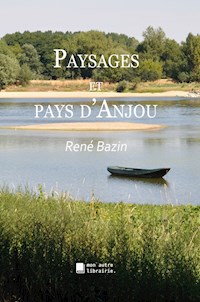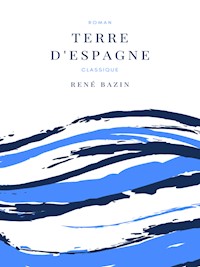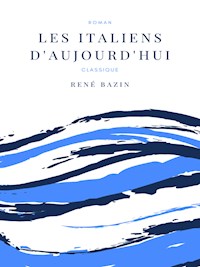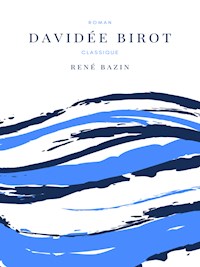3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Comme «Les Oberlé», livre paru en 1903 qui eut un grand succès, l'action de ce roman patriotique paru en 1919 se situe d'Alsace, mais l'écrivain est dans un état d'esprit différent, le contexte n'est plus le même: en 1919, la France est victorieuse, l'Allemagne défaite, au contraire de l'année 1903 où l'Alsace était occupée par l'Allemagne. Au moment de la déclaration de guerre, les deux fils de Sophie Ehrsam, veuve d'un industriel bien implanté à Masevaux, qui ont repris l'entreprise familiale, se déchirent sur le choix à faire: Pierre, l'aîné fait le choix de s'évader vers la France et de s'engager dans l'Armée. Joseph, le second, est convaincu du futur succès allemand et, pour assurer la continuité de l'affaire familiale, rejoint les unités allemandes, sur le front russe en Lituanie... Pierre, blessé au combat, est envoyé dans un hôpital da campagne. Il y fait connaissance de Marie, engagée bénévole avec son père le baron de Clairépée, et une histoire d'amour nait entre les deux jeunes gens, mais les obstacles ne manqueront pas.... Dans cette période de guerre impitoyable et meurtrière, le ton des propos échangés est parfois vif, voire hostile et violent, par la force des choses. Néanmoins, au-delà de ces affrontements inévitables dans un tel contexte, ce livre est profondément vrai. Il reflète, de façon étonnante, le caractère propre de l'Alsace, ses traditions et sa sensibilité, un tableau attachant de l'âme alsacienne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Les Nouveaux Oberlé
Les Nouveaux OberléI. LES DEUX ROUTES.II. L’ACCUEIL.III. MASEVAUX ATTEND LA FRANCE.IV. MASEVAUX REÇOIT LA FRANCE.V. LE MAS DE l’ABADIÉ.VI. LA CHANSON DU VIN ROUGE.VII. L’ALLIÉE IMPRÉVUE.VIII. LA NUIT DE GUET ET LE JOUR D’APRÈS.IX. LA FÊTE DES ROIS.X. LES LETTRES DE PIERRE.XI. HUBERT.XII. CELUI DE VILNA.XIII. LES STATUES DES ROIS.XIV. L’INVITATION.XV. LE SALON ROUGE.XVI. LA PROMENADE AU BUCHBERG.Page de copyrightLes Nouveaux Oberlé
René Bazin
I. LES DEUX ROUTES.
Jamais la paix de la campagne d’Alsace n’avait été si grande qu’en cette fin de jour, ni dans cette vallée ; jamais les cœurs ne s’étaient ainsi refusés à la recevoir ; jamais non plus, depuis qu’il commandait au Baerenhof, c’est-à-dire depuis huit années que son père était mort, on n’avait vu le maître des plus beaux blés de la vallée, qui en produit peu, Victor Reinhardt, laisser les travailleurs, ses voisins, ses amis, achever seuls de couper la moisson.
Le matin, une petite fille venait de naître, dans cette ferme aux longs toits, encapuchonnée contre la neige et le vent, et qui est bâtie sur un plateau de terres de labour, au sud de la ville de Masevaux. Elle naissait pour être éprouvée, comme les autres créatures, par la peine et le travail, mais aussi pour louer Dieu. Et c’est pourquoi le monde, autour d’elle, sans bien savoir quelle merveille il célébrait, envoyait les femmes faire leur compliment à la jeune mère, Anne-Marie, que plusieurs appelaient, en dialecte alsacien : Amarei. Elles montaient les trois degrés de terre, limités et contenus par des troncs de sapins : elles entraient, rôdaient un moment autour de cette nouveauté, tâchaient de voir ces yeux de moins d’un jour, qui n’avaient point été touchés par l’ombre, parlaient bas, toutes de la même manière, puis elles sortaient, contentes, parce que cette naissance les avait émues dans leur maternité, et qu’Anne-Marie, pâle dans son lit, près du berceau, leur avait fait, à toutes, un salut de la tête. Dehors, la lumière dorée les enveloppait, et aussi la chaleur du soleil de toutes parts amassée, reflétée, foulée comme au pressoir entre les montagnes. Dans le ciel, des nuages blancs, très haut, voyageaient. Rien à craindre du temps. Mais des hommes ! oh ! quelle inquiétude ! Elles jetaient un coup d’œil sur les moissonneurs et les moissonneuses qui ne s’arrêtaient point de travailler, car le maître, ce solide Victor Reinhardt, jetant sa faux, avait dit : « Hâtez-vous, pendant que je vais aux nouvelles, nul ne peut savoir si nous aurons encore des hommes demain. » Elles regardaient ce champ d’épis qui commençait à leurs pieds, à toucher la maison, et s’étendait en arrière, vers la montagne du Südel, puis elles descendaient le raidillon du plateau, longeaient les murs de la fabrique Ehrsam, retrouvaient la route en face du cimetière, et rentraient dans Masevaux.
Vers cinq heures et demie, une femme grande, bien faite, très simplement mise, quittait la maison familiale bâtie dans l’enclos de la fabrique, et, passant devant la porterie, montait à son tour, pour aller visiter l’accouchée, sa plus proche voisine. Elle était coiffée d’un chapeau de deuil, attaché par deux brides autour d’un visage presque jeune, dont on pouvait dire que le nez était un peu court, les lèvres un peu pleines, le menton un peu fort, mais qu’il avait l’autre beauté : celle d’un regard intelligent, celle d’un sourire de bonté, de confiance même, que le chagrin ni l’ennui de la vie n’avaient encore usé. Elle portait à la main un sac de cuir verni, que gonflait un paquet. N’étant point de la campagne songeuse ; toujours occupée, comme tant de mères, du présent et de l’avenir des enfants ; assez peu sensible aux choses du dehors, elle ne vit point les travailleurs, ni les montagnes faisant la ronde autour de Masevaux, boisées depuis leurs cimes jusqu’aux prairies et jusqu’aux vergers en pente, ni la ville aux toits de tuiles, qu’on commence à découvrir en arrivant au seuil du Baerenhof ; mais, parvenue au bord du plateau, devant la ferme, elle poussa la porte, traversa la cuisine où il y avait des commères assemblées, et, pénétrant dans la chambre au fond, s’approcha du large lit de cerisier massif, où reposait, les yeux mi-clos, Anne-Marie Reinhardt.
— Oh ! madame Ehrsam ! Je vous attendais !
— Tu vois, Marie, je suis venue.
La voix, plus faible, répondit :
— Aux autres, je ne dis pas ma peine : elle est grande.
— Tu as une jolie pouponne, pourtant ! Elle te ressemble. Elle sera blonde comme toi, comme mon Joseph à moi.
— Connaîtra-t-elle son père ?
— Et pourquoi non ?
— Vous ne savez donc rien ?
— Non : je suis demeurée chez moi, comme à l’ordinaire. Mes fils sont dans les ateliers.
— Vous croyez qu’ils y sont ?
— Où seraient-ils ?
— Moi qui comptais que vous me diriez ce qu’il faut croire ! Écoutez !
Madame Ehrsam se pencha ; Anne-Marie, lentement, tourna la tête vers elle :
— Ils disent que la guerre va être déclarée.
— Quand cela ?
— Demain, ce soir, tout à l’heure. Cela court partout. Victor est parti, voilà deux heures, et il n’est pas rentré : mauvais signe. Vos fils, madame Ehrsam, ils sont comme mon mari, de la jeunesse qui va se battre ;… oh ! je suis malheureuse !
Lasse, la fermière du Baerenhof détourna le visage, et ferma les yeux. Deux larmes coulaient de ses paupières. Un pas glissant s’approcha de la porte. Une femme passa la tête, curieuse, dans l’ouverture.
— Tu n’as besoin de rien, Marie ?
— De la paix.
Madame Ehrsam tira de son sac un paquet laineux, bouffant, d’où s’échappaient, çà et là, des bouts de faveurs bleues.
— J’ai tricoté, pour ta fille, une brassière, des bonnets et des chaussons, et je te défends bien de défaire le paquet ; ce sera l’affaire de tes commères, quand je serai partie… Je voudrais te dire : repose-toi ! Mais tu es de ce pays qui n’a point eu de repos depuis plus de cent années, ma pauvre fille, et sans doute depuis plus longtemps. Je te souhaite courage. C’est notre devise, à nous, comme aux hommes d’ici… Dis-moi : si la guerre est déclarée, que fera ton Victor ? Le sais-tu ?
— Il ne m’a rien dit.
— Tu le sais quand même ?
— Il fera ce que feront vos fils.
— Crois-tu ?
— Tous les mêmes ! Et les jeunes, qui n’ont pas connu le temps français, plus enragés que les vieux !
Les deux femmes restèrent en silence une minute, elles se regardaient l’une l’autre, le cœur battant.
— Surtout, ne parlez à personne, madame Ehrsam ! Si les Schwobs se doutaient !…
La visiteuse ne répondit point. À quoi bon, entre Alsaciennes ? Elle avait l’habitude de ne point parler tout haut des choses graves, c’est-à-dire des moindres choses de la vie, et de se confier à peu de gens.
— Demeure en paix jusqu’à ce que tu saches, Anne-Marie ! Il faut que je rentre. À présent je vais chercher mes fils. Peut-être vont-ils me dire que ce sont là des nouvelles fausses, comme il en a tant couru : rappelle-toi ?
— Non, madame, non : je sens mon cœur trop lourd ; la place du malheur y est déjà toute faite.
— Je reviendrai.
— Adieu !
Madame Ehrsam reprit le chemin de la fabrique ; elle passa rapidement devant la loge du concierge, elle qui avait coutume de parler, ne fût-ce qu’un moment, par charité, à la mère impotente d’Antoine Kuhn. Elle releva sa robe pour franchir un petit canal d’eau courante, de quarante centimètres de largeur, qui traversait les terrains de l’usine, d’une extrémité à l’autre, et entra dans sa maison, bâtie dans la partie la plus haute de l’enclos, à peu de distance du mur d’enceinte, et qui n’était, à vrai dire, que la première de toute une série de constructions, ateliers, magasins, bureaux, bâtiments des machines à vapeur, alignés le long de la pente, séparés l’une de l’autre par un espace de quelques mètres seulement, et qui descendaient jusqu’à l’endroit où la route de Rougemont prend le nom de Porte Saint-Martin. La maison, comme plusieurs des autres bâtiments, datait de la fin du XVIIIe siècle. Elle n’avait d’autre beauté que ses larges et hautes fenêtres encadrées de pierres rouges de Rouffach, et qui tendaient encore à la lumière des vitres verdâtres de l’ancien temps. Un lierre pauvre et poussiéreux, exposé au nord, grimpait aux deux angles. Il y avait, au-dessus de la porte, une niche, vide de son saint. La porte elle-même, épaisse comme une cloison, et faite en cœur de chêne, se plaignait de travailler encore après un siècle et demi : elle ne cédait qu’avec un bruit de canonnade, que suivait un frémissement grave de tout le bois et de toute la ferrure. Madame Ehrsam l’ouvrit, et appela :
— Anna ?
Une domestique répondit, du palier du premier étage :
— Madame ?
— Est-ce que mes fils sont rentrés ?
— Madame, j’ai vu sortir monsieur Pierre vers quatre heures, mais je pense que monsieur Joseph est dans la fabrique.
La mère monta l’escalier, et, au-dessus de la porte d’entrée, pénétra dans le cabinet de travail de son fils aîné, Pierre, qui était le chef visible de la maison d’industrie, le maître des relations extérieures, l’acheteur principal du coton : peu habile pour commander les réparations à faire aux machines ou pour combiner les articles d’un règlement, il s’entendait à aplanir les difficultés d’application ; il parlementait avec les employés et ouvriers de la fabrique ; il représentait la firme dans les réunions que tenaient les industriels, filateurs ou tisseurs de coton, soit à Masevaux, soit à Mulhouse, soit ailleurs. Le cadet s’occupait plus particulièrement de la vie intérieure de la fabrique, des comptes, de l’achat et de l’entretien des machines.
La pièce, meublée de meubles modernes, en chêne bruni, – une table à tiroirs, deux chaises, deux fauteuils garnis de reps vert, – n’avait d’autre décoration que la photographie du père des deux jeunes gens, de cet intelligent et patriote Louis-Pierre Ehrsam, que toute la vallée de la Doller avait connu et aimé, vétéran de la guerre de 1870, qui n’avait changé, sous la domination allemande, ni la coupe de sa barbe, – une solide impériale allongeait le menton, – ni l’habitude de parler français chez lui et dehors, comme faisaient beaucoup d’Alsaciens de cette vallée, moins tyranniquement gouvernés que les habitants des petites villes de la plaine. En toute occasion, il s’empressait d’exprimer pour la France une sorte de tendresse intransigeante et rude, qui ne se démentit jamais. La preuve en est encore fameuse dans toute l’Alsace. On la raconte autour du poêle, dans les soirs de veillée. Le souci de conserver la filature de coton, transmise de père en fils, depuis trois générations, n’avait pas permis à Louis-Pierre Ehrsam, après la guerre, d’opter pour la France. On ne pouvait quitter ce bien de famille, ces ouvriers, cette vallée. Peut-être aussi l’industriel avait-il songé qu’il rendrait à la France un grand service en demeurant Français dans l’Alsace annexée. Quoi qu’il en soit, il n’était pas parti pour la France ; il avait pu faire ce que d’autres, moins maîtres d’eux-mêmes, eussent été incapables d’accepter : vivre quarante ans sous le régime prussien. Classé dès le début parmi les ennemis de l’Allemagne, soupçonné plus d’une fois, on n’avait cependant jamais pu l’impliquer dans une de ces affaires qui rappelèrent souvent, jusqu’au début de la guerre, que l’Alsace conquise n’était point résignée.
Quand il était mort, en 1910, on avait trouvé, dans le tiroir de sa table de travail, – de ce même bureau de chêne qu’en ce moment touchait de la main madame Ehrsam, – une enveloppe portant cette suscription : « Testament à ouvrir par ma chère femme. » L’enveloppe avait été ouverte, et, sur une feuille de papier pliée en deux, on avait pu lire ces simples mots : « Ceci est mon testament et toute ma volonté dernière. Je demande qu’on mette sous ma tête, dans mon cercueil, un oreiller rempli de terre de France. » Aucune autre disposition. On avait été chercher un peu de terre, en cachette, sur le territoire de Rougemont, et l’Alsacien, au cimetière de Masevaux, dormait, la tête appuyée sur une motte du sol français qui n’avait jamais subi la domination allemande.
La photographie, pendue près de la fenêtre, à gauche du bureau, représentait un homme d’une quarantaine d’années, – l’âge qu’il avait quand il épousait, en secondes noces, Sophie Riffel, – large de visage et d’épaules, qui avait le nez épais et bossué, des lèvres fermes, des yeux très clairs, et dont les paupières ne devaient pas fréquemment ciller. Physionomie où la volonté dominait, et l’honnêteté. Quelque chose du grand-père, maître tisserand, qui avait fondé l’usine, revivait dans cette image du père de Pierre et de Joseph.
La famille était fort ancienne. Les registres de Masevaux attestent que les Ehrsam figuraient parmi les principaux de la corporation, aux siècles où la ville était ceinte de remparts, ville très riche et très libre, où la primauté appartint, selon les temps, aux bourgeois élus ou au chapitre des chanoinesses nobles de Saint-Léger, que le vieux duc Maso avait doté en 728, et qui entreprit tant de procédures dans les siècles suivants. Lointaines époques, où s’affirmait déjà l’esprit particulariste, tenace et discuteur de l’Alsacien ; où chaque corporation avait sa maison commune, son sceau, sa bannière, sa fortune en florins et en terres, sa justice. On voit des Ehrsam inscrits, par acte de dernière volonté, sur les « livres d’âmes » de la paroisse de Saint-Martin, en raison des fondations pieuses qu’ils avaient faites. Ils donnaient aussi à l’hôpital et à la maladrerie. C’étaient de vieux bourgeois, souvent contents d’eux-mêmes et rarement d’autrui, batailleurs en affaires, tendres dans la famille. Ils avaient fait souche et grossi leur fortune. Aucun n’avait déchu. Le nom, dans la tranquille vallée, avait gardé son prestige ancien.
D’une autre manière encore, les Ehrsam se rattachaient au passé de la cité. Car leur fabrique et leur maison, bâties près du cimetière, au sud et un peu en dehors de la ville, occupaient la place même où s’étaient groupés les premiers Gaulois, fondateurs de Masevaux, ceux qui virent un jour venir à eux des missionnaires chrétiens partis de Lyon.
Combien de tragédies en pays d’Alsace, depuis ces temps reculés ! Dans chacune, un ou plusieurs Ehrsam avaient eu un rôle, presque toujours celui de la souffrance et des recommencements.
Et voici que la famille était menacée encore, la fabrique menacée. Madame Ehrsam regardait la photographie ; elle était debout ; elle demandait conseil, comme si son mari eût été vivant, comme le jour où l’on avait décidé, tous deux, mari et femme, de quelle manière les fils seraient élevés. Ce jour-là, dans ce même cabinet de travail, elle avait dit : « Notre aîné est à l’âge où il faut choisir un collège. Mon cœur me pousse à te dire, mon ami, que je voudrais le faire élever en France, ce Pierre si intelligent, et après lui, notre Joseph. Il y a de bons collèges, à Nancy, mais, tu sais mieux que moi ces choses… » Pendant quelques moments, dont elle se souvenait, elle était demeurée angoissée, les yeux fixés sur le visage du mari qui venait de rentrer après la journée faite, et qui, chassant toutes les autres préoccupations, se tenait assis, la tête et les yeux baissés, calculant le pour et le contre, pesant les souvenirs et les chances, et ne prononçant pas une parole. Enfin, il s’était redressé ; il l’avait regardée ; il avait dit, de cet air qui ne permettait pas de réplique : « Colmar ». Puis, comme il la voyait très émue et qu’elle ne répliquait point, il avait embrassé sa femme. Ainsi l’avenir était engagé. À présent, s’il était là, lui, le mari qui mettait du temps à se résoudre, mais qui ne se repentait jamais de ses résolutions, qu’ordonnerait-il ?
Elle se pencha, entendant du bruit dans l’enclos, et vit que les ouvriers et les ouvrières sortaient par la porte ouverte à deux battants. Ils marchaient comme à l’ordinaire, pas plus bruyants, pas moins ; les jeunes allaient en troupes, les anciens deux par deux, ou tout seuls dans la foule. Puis, les vantaux se refermant, elle n’eut plus devant elle que les lignes parallèles, descendantes, des bâtiments de la fabrique, et la bande de terrain, à droite, que les fils après le père avaient réservée pour les constructions à venir, rectangle long, pelé, sablé de noir par les détritus des fourneaux, divisé en deux parties inégales par le ruisseau d’eau bouillonnante, contenu entre des briques, et qui allait se perdre, au delà des murs, dans un affluent de la Doller, la petite rivière d’Odile, l’Odilienbächle.
Quelques instants encore, et un pas rapide se fit entendre dans l’escalier. Une voix appela :
— Maman ?
La porte s’ouvrit. Madame Ehrsam vit devant elle son fils aîné, Pierre, qui la considéra avant de l’embrasser, se demandant : « Que sait-elle ? » Elle ne savait rien, ou si peu de chose : elle craignait seulement. Il ouvrit ses grands bras, baisa ce front maternel, soucieux à cause de lui, s’écarta, se mit à rire d’un bon rire jeune, et dit :
— Eh ! Maman, qu’avez-vous donc ce soir ? Vous n’avez pas encore quitté votre chapeau ? Mais c’est l’heure du dîner !
— Et Joseph ?
— Rentré avec moi.
— Où étiez-vous ?
— Nous étions en ville, maman. Il fallait avoir des nouvelles ! Je vous raconterai cela en dînant.
Elle, prime-sautière, prompte à l’angoisse comme à la joie, lui prit la main, la tint entre les siennes.
— Oh ! mes enfants, est-ce que c’est vrai ? Qu’allons-nous devenir tous, tous ?
Il se détourna pour ne pas répondre, s’effaça le long de la porte :
— Passez, dit-il, venez dîner.
Elle descendit, et trouva, au bas de l’escalier, Joseph qui l’attendait, silencieux, sanglé dans sa jaquette brune et toujours boutonnée, sa tranquille figure offerte au baiser maternel.
La salle à manger, au rez-de-chaussée de la maison Ehrsam, était tapissée d’un papier rouge ponceau, imitant le feutre, que des baguettes noires partageaient en panneaux. Au-dessus du poêle, haut et large, en faïence décorée de Strasbourg, le vieux père avait disposé le massacre d’un cerf tué à l’affût, dans la forêt de la Hardt, il y avait bien longtemps, un héron empaillé, deux éperviers, un coq de bruyère, un chat sauvage, trophées dont il savait la date, et racontait volontiers l’histoire détaillée.
Les trois couverts étaient disposés autour d’une table carrée. Pierre se trouvait placé en face de sa mère, qui avait le dos au feu, selon l’usage. Chacun dit le bénédicité, s’assit, et commença de manger en silence. C’était l’habitude de M. Ehrsam, autrefois, de ne parler jamais avant d’avoir achevé le potage : ce que peut expliquer l’appétit d’un homme laborieux et passant au travail plus de douze heures par jour. On continuait de faire de même. Puis Anna était là, robuste blonde d’Alsace, à la double tresse roulée en chignon, aux bandeaux d’un or si clair qu’involontairement le regard allait vers eux, comme au reflet d’un miroir, Anna qui écoutait, et qu’on entendait ensuite rire dans l’office.
La domestique partie, Madame Ehrsam demanda :
— Mes pauvres petits enfants, vous allez bien me raconter votre journée ? Je ne vis pas ce soir !
Elle les regardait, l’un après l’autre. C’étaient deux rudes hommes, très dissemblables, exemplaires de ces deux types d’Alsaciens qu’on rencontre si souvent dans la même famille.
L’aîné, Pierre, grand, élancé, le visage régulier et avenant, les yeux plein de vie, – des yeux très bruns, – sa jeune moustache frisant un peu, les dents vite découvertes par des lèvres mobiles, assouplies à suivre les nuances de la parole, était un vrai Latin. Pendant la période d’études au collège de Colmar, l’année même où Pierre avait passé l’Abitur, le baccalauréat allemand, son maître de mathématiques, Prussien renforcé, lui avait dit : « Ehrsam, vous êtes le plus latin des hommes que j’aie rencontrés ; et ce n’est pas un compliment que je vous fais, croyez-le ! » Pierre rappelait, par les qualités de son corps et de son esprit, les aïeux du peuple alsacien qui vinrent au Moyen âge, de la province de Franche-Comté, où le sang d’Espagne et celui de France étaient si bien mêlés. Des pays du Midi, il avait jusqu’à ce coup d’œil aigu, rapide, défiant, qu’il jetait sur ses interlocuteurs, pour s’assurer qu’on l’écoutait, puis qu’on était convaincu, tout au moins ébranlé, qu’on ne se moquait pas de lui, qu’on reconnaissait sa supériorité. Souple, remuant, tout en passion, parlant bien, vite emporté, vite pardonnant, clair dans les explications qu’il donnait, prompt à comprendre celles des autres, doué d’une mémoire assez courte ; incapable de rancune, imaginatif à l’excès, généreux sans effort, et sans réflexion, il était comme l’opposé de son frère Joseph, jeune homme blond, aux yeux bleus, à la barbe en pointe, aux épaules rondes, au corps tassé et solide, plus lent d’esprit, très peu parleur, mais d’une sincérité qui allait jusqu’à la brutalité ; d’une sensibilité extrême et pudique ; d’une incroyable susceptibilité ; obsédé lui-même par l’abondance d’une mémoire qui n’oubliait rien ; assez gauche, devant une femme ; au demeurant l’homme du monde le plus sûr qu’on pût imaginer. Les yeux de ce cadet n’avaient point de flamme, sinon quand il se mettait en colère ; alors, en vérité, ils étaient flambants et fous. Et cette flamme durait, assombrie seulement, pendant des jours et des semaines.
Pierre et Joseph s’étaient succédé, à deux ans d’intervalle, sur les bancs du collège de Colmar. Sorti du collège à la fin de 1905, l’aîné, qui se destinait alors au barreau, avait fait deux années de droit à l’Université de Strasbourg, puis l’année de volontariat, à Mulheim, sur la rive droite du Rhin. Il continuait ses études juridiques, en 1909 et 1910, à Dresde, où il retrouva Joseph, entré, l’année précédente, à l’école centrale, la Technische Hochschule. Pierre venait de passer le referendar, lorsque, à la fin de 1910, M. Louis-Pierre Ehrsam mourut subitement. Pour sauver la fabrique, Pierre renonça au barreau. Sans hésiter, donnant rendez-vous à Joseph qui, plus tard, viendrait l’aider et apporterait, dans la direction de l’industrie, des aptitudes plus certaines et la science acquise dans une des meilleures écoles industrielles de l’Allemagne, il revint à Masevaux. Là, depuis dix-huit mois, les deux frères se trouvaient réunis et associés. L’aîné avait près de vingt-sept ans ; le second vingt-cinq. La même ambition les animait : continuer de vivre dans la vallée, développer la fabrique. Entre eux, l’entente industrielle était parfaite. Chacun avait son domaine, sa compétence, son autorité particulière. Sur le reste, c’est-à-dire à propos des questions les plus graves, et notamment de l’attitude politique, très absorbés par le travail, ils avaient eu peu d’occasions de s’expliquer. Il n’y avait eu, de l’un à l’autre, que des escarmouches. Ils savaient qu’ils n’étaient pas entièrement du même avis, bien que chacun d’eux fût opiniâtrement et résolument opposé à la domination allemande.
En ce moment, dans le silence du commencement du repas, Pierre songeait à Joseph, et Joseph songeait à Pierre, parce que l’heure allait venir, et qu’elle était venue, où leurs deux natures s’affronteraient, où ils se révéleraient l’un et l’autre, l’un à l’autre, par les mots qu’il fallait dire enfin, par les décisions qu’il fallait prendre.
Les différences entre eux, si profondes, ils les avaient pressenties lorsque, par exemple, après la mort du père, on avait pensé à acheter des machines nouvelles. L’aîné voulait renouveler tout le matériel de l’usine ; le cadet, ménager, entendait ne pas jouer si gros jeu ; le premier disant : « Invention merveilleuse ! » et le second : « Peut-être aventure ! ». De même, ils n’acceptaient point, avec la même philosophie, les relations nécessaires avec les Allemands immigrés ou de passage en Alsace, et dont Joseph seul, lorsqu’il était hors de Masevaux, accueillait les invitations à dîner. Au fond, celui-ci, pas plus que l’autre, n’avait de goût pour l’Allemagne. Ils l’avaient, croyaient-ils, jugée et mesurée. Ils étaient de trop bonne souche alsacienne pour ne pas sentir leur propre supériorité et ce qu’il y avait d’essentiel dans l’animosité réciproque des deux races ; mais les faits, sur l’esprit du plus jeune des frères Ehrsam, avaient une puissance à laquelle l’aîné, autant qu’il le pouvait, publiquement et dans le privé, refusait de se soumettre.
La mère, quand elle eut achevé de manger le potage, voulut voir les yeux toujours parleurs, et incapables de mensonge, de son fils Pierre, que lui cachait la lampe placée au milieu de la table ; elle se pencha, et, dans le cône de lumière qui tombait de l’abat-jour, son visage apparut, tendre et troublé.
— Alors, vous étiez en ville. Mais où donc ?
— Au café, maman.
— Toi, Pierre ? Encore, à Joseph, cela pourrait arriver, mais toi !…
— À l’auberge de l’Ange, au coin de la rue de la Mairie et de la rue de la Porte-Neuve. Vous vous souvenez ?
— Mais oui.
— Et nous n’étions pas seuls, croyez-m’en, à regarder qui entrait dans la rue et qui en sortait ; nous nous étions mis tout près de la fenêtre ; quand l’appariteur municipal s’est avancé au milieu de la rue, nous nous sommes levés, nous l’avons suivi.
— Quelle heure ?
— Cinq heures. Il avait son uniforme des grands jours, à deux rangs de boutons d’or, son sabre, sa casquette bleue à bordure noire, et, naturellement, son petit tambour plat, dont il battait.
— Et qu’a-t-il annoncé ?
— Mobilisation de précaution.
— Menterie, Pierre, menterie, Joseph ! Ce peuple ment tout le temps. Ils mobilisent pour la guerre !
Les deux frères dirent, en même temps :
— C’est sûr, parbleu ! C’est la guerre !
— Contre la France ?
Ils répétèrent ensemble :
— Oui, contre la France !
Le grand nom qui divisait déjà le monde en deux camps avait été prononcé. Toute l’histoire d’Alsace en était évoquée. Elle emplissait les âmes de ces bourgeois de petite ville, causant autour d’une table. Elle les conseillait, elle les dressait, elle faisait, de ces simples gens, des principes armés, des combattants.
— Alors, mes enfants ? Alors ?
Madame Ehrsam attendit, toujours penchée, regardant les lèvres de son fils aîné comme celles d’un juge.
Pierre répondit :
— Nous sommes tous deux sous-officiers dans l’armée allemande… Maman, vous savez cela depuis bien longtemps : nous devons rejoindre le régiment.
Elle devint très pâle.
— Il y a un délai ?
— Demain au plus tard. Songez donc : armée active et sous-officiers ! Nous devons nous rendre à Mulheim, rive droite du Rhin, XIVe corps. Voilà !
Madame Ehrsam se redressa. Elle posa ses deux belles mains sur la table, et baissa à moitié les paupières, pour mieux garder la possession de soi-même, et pour reprendre courage.
— La seconde guerre allemande en moins de cinquante ans !
Puis, élevant la voix, décidée à savoir, devenue audacieuse :
— Ce que tu viens de dire, c’est l’ordre allemand, c’est la consigne militaire. Mais qu’est-ce que vous ferez, vous autres ? Toi, Pierre, d’abord ?
Elle commençait par lui, parce qu’elle était moins sûre de l’autre.
— Maman, ce qu’aurait fait mon père.
— Ah ! pardon ! dit Joseph violemment : mon père, après la guerre de 1870, n’a pas réclamé la qualité de Français. Il est devenu…
— Tais-toi ! Ne dis pas le mot qu’on n’aime pas ici… Tu n’ignores pas pour quelle cause ton père, mon mari, n’a pas quitté l’Alsace !
Il se tut, mais le coin de sa bouche était secoué d’un mouvement nerveux. Ses yeux, dont l’expression tranquille n’avait pas changé, étaient fixés sur sa mère. Il écoutait, semblait-il, comme il eût écouté une conversation d’affaires.
— Et tu sais bien aussi, Joseph, que ce qui est fait de force n’a pas de valeur ; que le cœur ne se donne point parce que le nom est inscrit sur des registres, et qu’ici, tout ce qui est honorable, dans la vallée, se considère comme Français… Tu disais donc, Pierre, que tu ne rejoindrais pas ?
La réponse ne vint pas. La servante ouvrait la porte. Elle remarqua le silence et la gêne entre les fils et la mère. En se retirant, quand elle eut déposé sur la table une pièce de bœuf entourée de pommes de terre, elle regarda ses maîtres : Pierre, qui avait l’air de rêver, les yeux au-dessus de la lampe ; Joseph, courbé sur l’assiette vide et tortillant sa jeune moustache jaune ; madame Ehrsam, appuyée au dossier de la chaise, les mains jointes sur sa robe, et oubliant de prendre, comme elle faisait tout de suite, d’ordinaire, le grand couteau et la fourchette à découper. Dans la cuisine, un moment après, Anna confiait à la cuisinière :
— Je vous dis, moi, que c’est la vraie guerre. Si vous pouviez voir la figure des maîtres !
La pauvre fille n’avait pas tout compris, en voyant le visage des maîtres. La famille de Louis-Pierre Ehrsam, si unie, jusqu’à cette heure, si heureuse et enviée, était menacée du plus grand malheur qui pût l’atteindre : les deux frères allaient peut-être se ranger dans deux camps ennemis. À cette mère alsacienne, la guerre n’apportait pas seulement l’épreuve de la séparation, les inquiétudes, les attentes redoutées : elle armerait Pierre contre Joseph et Joseph contre Pierre. Et même si la mort épargnait les enfants, ils demeureraient irréconciliables, les souvenirs, l’orgueil, l’intérêt, l’ambition, devant continuer, après que les hommes se seraient battus, à plaider les causes opposées, à nourrir les haines et à souffler l’injure qui ne se pardonne point : « Renégat ! » Cependant, rien d’irrévocable n’avait encore été dit. La phrase de Joseph, inquiétante, n’exprimait point une résolution. Il ne fallait pas brusquer cette nature obstinée, que la contradiction fermait à tout raisonnement du dehors. La mère connaissait bien ce dur et silencieux garçon qui, provoqué, avait l’air d’une citadelle d’autrefois, pleine de colère intérieure, mais muette en attendant l’attaque de l’adversaire, impénétrable au regard, sans communication, sans route, sans fenêtre, hérissée, insolente. Elle avait déjà, avec son rapide esprit et ce don d’imagination qui faisait d’elle la plus Française des Masopolitaines, aperçu, en ce qui concernait sa maison, les conséquences possibles de l’ordre de mobilisation, et du choix que ses fils pourraient faire entre Allemagne et France. Elle se croyait sûre de Pierre. L’autre ? eh bien ! l’autre, elle ne devait point le contredire ouvertement : il se serait tenu, par point d’honneur, à l’opinion une fois exprimée. Jusqu’à présent, rien de net, heureusement. Mais, dans ces heures si courtes qui restaient, en ce moment même, elle avait le devoir, elle, la mère, la veuve, de défendre la mémoire du père, et d’empêcher qu’un de ses enfants ne s’égarât, trompé par des faits anciens, qu’elle seule pouvait juger.
— Je me souviens, mon Joseph, que votre père m’a raconté, non pas une fois, mais cent fois, la peine qu’il avait eue de ne pas suivre tant d’amis, de parents, qui optaient pour la France. En 1871, il avait vingt-deux ans ; il s’était battu à Wissembourg, à Reichshoffen, puis avec l’armée de la Loire. Pendant des mois, il avait vécu avec des Français d’autres provinces que l’Alsace. Les récits qu’il en faisait, surtout aux premiers temps de notre mariage, quand la revanche, mon Dieu, paraissait être une pensée grande et sincère chez les Français de la politique, c’était comme le pain, et comme le vin, et comme le sel, et comme les histoires de notre fabrique : une chose de la vie quotidienne. Je suis sûre qu’il n’a jamais regretté d’avoir lutté contre les Allemands. Je dois dire cela, comme si Dieu devait me juger dans l’instant !
Elle avait, en disant ces choses, un grand air d’autorité et de dignité. Elle parlait ainsi par conscience, pour que la vérité fût maintenue : ses fils ne le verraient-ils pas ?
— J’étais la seule à qui votre père confiât sa secrète pensée. Quoiqu’il y eût, entre nous, une grande différence d’âge, il me confiait tout ; il n’a point varié, jusqu’au bout.
Joseph fit un signe d’assentiment. Madame Ehrsam coupa une tranche de rôti, et, obéissant à une inspiration maternelle, elle fit signe qu’elle voulait comme autrefois, ce soir, le dernier soir, servir elle-même ses enfants.
— Mange, mon Joseph ; vous avez couru la ville, et beaucoup parlé : vous devez avoir faim.
Elle servit de même son fils aîné, qui, avec passion, suivait le plaidoyer de sa mère. Par-dessus la table, il avançait le bras, et, dans sa main, comme dans celle d’un enfant, l’assiette tremblait. Incapable de se taire plus longtemps, il essaya de prendre, lui aussi, le ton détaché de ceux qui racontent une histoire de jeunesse, mais la voix demeurait rude, frémissante, accordée avec la douleur d’un cœur jeune et indigné.
— Joseph, peut-être, n’a pas cela aussi présent que moi dans l’esprit. Mais, deux fois au moins, quand j’avais huit et dix ans, nous sommes allés en partie de plaisir, avec mon père, au delà de la frontière. Il voulait nous faire voir la source de la Moselle. La première fois, je me rappelle, quand nous fûmes là, il dit : « Enlevez vos casquettes, mes petits, et buvez de l’eau de la rivière de France. »
— Je me souviens très bien, répondit Joseph, et tu vas le voir : comme j’étais le plus petit, mon père, alors, m’a pris sur son épaule, pour que je pusse découvrir, par-dessus les buissons, plus de terre et plus de villages. Est-ce vrai ?
— Oui, je n’ai pas oublié non plus.
— Et les autres mots qu’il disait, les voici : « Comme on est bien en France ! Je respire mieux ! Même si un Schwob m’entendait, je répéterais encore : on est bien ici ! » Il était très ému. D’ordinaire, sa voix n’était pas chantante.
— Oh ! non, dit madame Ehrsam, en essayant de rire…
— Eh bien ! ce jour-là, elle chantait.
— Il avait, reprit l’aîné, cueilli des coquelicots, des bleuets, des marguerites, et il passa, au retour, devant le poste de douaniers, avec une cocarde tricolore à son chapeau.
La mère, d’un signe de ses yeux prompts, montra à Pierre ce cadet qui mangeait avidement, et qui n’avait pas renié les exemples du père. Pierre sourit un peu. Dans leur cœur, ils songeaient : « Joseph vient à nous ! Ce qu’il a dit d’abord n’était qu’une boutade, et le premier grognement par où s’exprime l’ennui de ce blond d’Alsace, troublé tout à coup dans sa quiétude. » Ils rappelèrent plusieurs autres souvenirs, que l’ingénieur associé écouta sans répondre. Mais, quand il eut avalé la dernière bouchée de rôti, repoussant l’assiette et croisant les bras, rassasié maintenant et plus sûr de sa force, il se tourna vers son aîné, et dit :
— Nous perdons notre temps, et je n’en ai plus beaucoup, Pierre.
— Autant que moi.
— Moins. Tu t’en vas à l’aventure, et cela commence quand on le veut. Moi j’obéis à la loi de ce qui est mon pays légal.
— Moi, à celle de ma conscience.
— Quand nous appellerions nos volontés de tous les noms, beaux ou pénibles à entendre, ce sont deux volontés, la mienne, la tienne : je rejoins mon régiment à Mulheim, et tu désertes.
— Je rejoins la France, et toi l’Allemagne.
À peine ces mots-là étaient dits, que Pierre, Joseph et leur mère se trouvèrent debout.
— Ah ! mes fils, si vous devez vous séparer, ne vous injuriez pas !
Elle s’était rapprochée de Joseph, elle avait mis les deux mains sur l’épaule de celui qui était le plus violent de ses fils, de celui qui, pour la fougue et l’éclat de la colère, était semblable au père.
— Ne réponds plus… Retiens les mots qui blessent… Moi, je crois te comprendre, je devine tes raisons, mon enfant : tu veux te sacrifier pour moi…
Il secouait la tête, et regardait maintenant le parquet.
— Mais si, je devine !… tu ne pourras pas me faire croire que tu n’es pas un généreux, un dévoué !… tu l’as trop montré !… Je t’en prie, si tu veux seulement sauver la fabrique, et notre fortune, en rejoignant l’armée allemande, ne considère pas mon avenir, auquel tu penses, j’en suis sûre ! Il ne sera pas long, quoi qu’il arrive ; ne considère que le tien : vois si tu dois aller d’un côté, quand ton frère va de l’autre… Même si la fabrique était confisquée par les Allemands, j’aurais de quoi vivre, à Masevaux, dans une chambre, à côté d’une de mes ouvrières… Tout me sera léger, pourvu que mes fils ne se haïssent point… Écoutez-moi tous deux : épargnez-moi les souvenirs qui me tueraient dans ma solitude, demain. Que je vous voie partir sans colère l’un contre l’autre, même si vous ne comprenez pas de même votre devoir…
Joseph ne répondit rien, et ne releva pas les yeux.
Alors Pierre, passant de l’autre côté de la table, s’approcha vivement de sa mère.
— Laissez-nous causer, mon frère et moi ! Je vous promets, maman, que vous n’entendrez même pas de votre chambre un mot plus haut que l’autre. Montons, veux-tu, Joseph ?
En silence, madame Ehrsam, puis l’aîné, puis Joseph sortirent de la salle à manger, et, comme ils faisaient chaque soir, montèrent au premier, par le grand escalier carré, en chêne des forêts de Kirchberg. Avant de quitter la pièce où ils venaient de dîner, Joseph se pencha au-dessus de la table, baissa la mèche de la lampe, et la mit en veilleuse.
Il rejoignit son frère dans le cabinet de travail, où ils fumaient d’habitude, l’un des cigarettes, l’autre une pipe. Mais ce soir-là, ils oublièrent de fumer. Les deux jeunes hommes s’assirent, le long de la table à tiroirs, tournés l’un vers l’autre, et ils parlèrent à voix basse. Une bougie, posée sur un guéridon, derrière Pierre, éclairait un peu le visage de Joseph, qui, maintenant, seul avec son égal, regardait droit et durement. Ils s’aimaient depuis vingt-cinq ans, et la colère n’était que dans leur esprit ; mais elle y était forte.
— Pourquoi veux-tu faire autrement que moi, Joseph ?
— Tu ne te souviens donc pas ? Avez-vous assez répété, tous et toutes, que nous devions rester Alsaciens en Alsace, ne pas quitter, garder la terre, l’usine, l’influence, empêcher l’Allemand de vivre ici, en ne lui cédant pas la place, le gêner sans lui désobéir ? Je ne change pas de direction, moi, quand j’ai pris une route.
— C’était la politique du temps de paix !
— La crois-tu tout à fait inutile en temps de guerre ?
— Évidemment ! Tu vas faire nombre !
— Cela ne veut pas dire force.
— Mais si ! Tu seras une force de plus dans l’armée allemande, contre l’armée française.
— Soit, j’aurai l’air d’en être une. Tu entends : j’aurai l’air. C’est une chose qui m’est imposée par ma fidélité à notre Alsace…
— Que dis-tu là ?
— Par son malheur, par sa faiblesse que je n’augmenterai pas : mais je ne serai pas le même ennemi que l’Allemand.
— Refuseras-tu de te battre ?
— Non, je ne peux pas.
— D’avancer ?
— Non plus.
— De reculer ?
— Sûrement non.
— Alors, je ne comprends pas ce que tu penses, Joseph.
Le jeune homme réfléchit un moment, le regard perdu, l’âme absente, comme il faisait souvent au milieu d’une conversation d’affaires.
— Peu importe ce que je pense ; j’ai réfléchi à tout, parce que, d’ordinaire, je ne parle de rien.
Pierre sourit de l’allusion, et dit, enveloppant son frère d’un regard de tendresse :
— Il y a dans tes mots, et dans ce que tu me caches, de l’amour pour la France ; et je ne sais quoi qui est la marque de la race…
— Ne t’y trompe pas : la France, je ne l’aime pas autant que tu l’aimes.
— Ce serait déjà quelque chose de l’aimer moins.
— Si elle n’était pas attaquée, en ce moment…
— Ah ! que tu me plais, en disant cela !
— … je te parlerais d’elle sévèrement…
— Injustement, j’en suis sûr !
— Que sais-tu d’elle, mon pauvre Pierre, homme d’imagination, et qu’a-t-elle fait pour toi ?
— Mon père et ma mère, qui sont les tiens.
— Et, dans la suite, qu’a-t-elle fait pour eux ?… Non, ne me réponds pas !… tu me répondrais des mots en l’air, et je ne te croirais pas. La France, pas plus que moi, tu ne l’as habitée. Tu as lu ses livres, feuilleté ses images, rêvassé d’elle…
— Écouté mon sang !
— J’écoute aussi le mien, qui ne parle pas de même. Raisonnons comme des hommes et sur ce que nous savons. Or, tu sais aussi bien que moi qu’elle est une nation faible…
— Qui a le bon droit pour elle !
— … faible, tu entends, et que voici aux prises avec un monstre puissant.
— Formidable.
— Préparé depuis longtemps, et qui a tout prévu. Eh bien ! dans la guerre qui va passer sur l’Alsace, moi j’ai un devoir que je veux remplir : je sauve ta fortune, ta famille de plus tard et la mienne.
— Nous y voilà.
— Suppose que la France ne réussisse pas dans cette guerre nouvelle !
— J’attendais le mot : tu crois qu’elle sera battue ?
— Assurément.
— Elle triomphera.
— Suppose que non ! Que ferez-vous, le lendemain de la défaite, et que deviendra l’Alsace que vous aurez abandonnée ? Elle sera germaine, entièrement, à jamais. Je ne veux pas que cela soit : je la garde.
— Elle redeviendra française, et tu auras servi dans les rangs de ses ennemis vaincus.
— Je garde aussi, quelle que soit la fortune des armes, la fabrique que le grand-père a fondée ; je me préoccupe du sort des deux cents ouvriers dont nous avons charge. Toi, tu oublies tout.
— Je sacrifie, ce n’est pas la même chose…
— Toi, c’est bien, peut-être, mais les autres ?
— Ah ! mon cher, dans tous les grands moments, quoi qu’il semble, l’homme qui fait son devoir peut faire souffrir d’autres hommes, ses enfants, sa femme, ses parents. Je compromets nos biens, ma part tout au moins, et la sécurité de ma mère : mais, sacrebleu, je crois relever l’honneur !
— Et les ouvriers ?
— Ils auraient toujours du travail dans la vallée, même si notre maison fermait. Tu la maintiendras, soit : dès lors, le préjudice n’existe pas pour eux, et je leur aurai donné un exemple…
— D’irréflexion, laisse-moi te le dire. Mais, pour la deuxième fois, je te le déclare : nous sommes des têtes carrées, toi, moi ; il y a autre chose à faire, maintenant, que d’essayer de me détourner, par des souvenirs d’enfance ou par des raisonnements, de ce que j’ai résolu. Vous ne gagnerez rien, ni maman, ni toi, ni d’autres.
— Alors, c’est fini ?
— Pas encore… Nous pouvons redevenir, pour une heure, des industriels.
— En effet.
— Des associés, qui vont entreprendre, chacun de son côté, un voyage long et périlleux. À qui confier la direction, pendant l’absence ? J’avais pensé à Eugène Denner.
Pierre, par un effort de volonté que Joseph n’avait pas eu besoin de faire, écarta les arguments qui affluaient dans son esprit. Il considéra un instant la photographie pendue au-dessus du bureau, et répondit :
— Comme tu voudras. Denner a été formé par mon père ; c’est un homme un peu âgé, encore capable de résolution, et bien au courant de nos affaires. Si tu pars demain matin, il faudrait examiner la situation à ce jour.
— Je l’ai déjà fait établir.
— Donner des ordres aux banques ; tâcher de prévoir quelques hypothèses ;… rédiger aussi une procuration, pour Denner, et pour notre mère surtout, qui sera la gardienne la meilleure…
— Tu as raison, Pierre, je n’avais pas pensé à elle. Tu vois que les collaborations servent. Descendons ! Prends la clé du bureau des écritures.
Le frère aîné saisit, accrochée à un clou, la clé qu’un employé, chaque matin, venait demander, et rapportait chaque soir. Puis, éclairés par une lampe électrique, que Joseph avait tirée de sa poche, les deux frères descendirent avec précaution. Ils passèrent près de la chambre de leur mère. Un instant même, sans s’être concertés, ils s’arrêtèrent pour écouter. Aucune parole ne fut dite pour les rappeler. Et cependant la mère dut les entendre. Elle veillait. Une lame de lumière passait au-dessous de la porte. À travers les cours, les deux hommes se dirigèrent vers le bâtiment central, plus vieux que les autres, au toit plus long, et que perçait, à l’extrémité, vers l’est, une cheminée. C’était un magasin pour les balles de coton, au bout duquel on avait réservé et aménagé, en 1911, une salle claire où se tenaient le caissier et les employés chargés de la correspondance et de la comptabilité.
Joseph ouvrit un coffre-fort, prit plusieurs livres, des liasses de papiers, et, s’asseyant près de Pierre, devant l’une des tables de chêne blanc verni, – luxueux mobilier commandé par l’aîné, – il se mit au travail. Pendant plus de trois heures, il établit des comptes, demanda des renseignements à son frère, nota les principales instructions qu’il fallait laisser à Eugène Denner, écrivit quelques lettres, rédigea la procuration par laquelle les deux frères confiaient à leur mère et à leur employé principal la direction provisoire de la fabrique Ehrsam frères. Quand ils eurent signé tous deux, onze heures sonnaient à l’horloge, vieille d’un demi-siècle, encagée dans le grenier au-dessus d’eux, et qui réglait la vie de l’usine.
Joseph dit :
— Tu tâcheras de faire passer, par maman, une partie de tes fonds en France. D’ailleurs, si le gouvernement, – il parlait de l’Allemagne, – confisque tes biens, je suis sûr, tu entends ? sûr de trouver ce qu’il faudra, par emprunt, et de continuer à faire marcher la fabrique. J’ai des amitiés, que tu n’as pas su ménager.
— Que je n’ai même pas cherché à acquérir.
— C’est le tort que tu as eu.
— Ou la loyauté, cela dépend !
— En effet ; mais tout cela est passé maintenant, n’est-ce pas ?
— Irrévocable.
Les deux frères se levèrent. Ils s’approchèrent, sans s’être donné le mot, de la fenêtre en face de laquelle ils travaillaient, et qui ouvrait au nord-ouest. Ce fut Pierre qui tourna l’espagnolette, et il le fit en pensant que cette vieille ferraille avait été commandée, payée, regardée, puis bien des fois touchée par le père et le grand-père. Les vantaux s’écartèrent. Les vitres vieilles tintèrent, mal assujetties par le mastic usé, puis, silencieusement, Pierre et Joseph se tinrent debout dans l’air frais, les mains posées sur l’appui de la fenêtre.
La nuit continuait la douceur du jour. Au delà des derniers bâtiments de la fabrique, on apercevait, entre les arbres devenus indécis de contour et gris comme des fumées, les toits de Masevaux, très pâles sous la lune, et la tour de Saint-Martin, puis les grands plis des montagnes, les uns revêtus d’une ombre légère, encore parente de la lumière, et les autres d’une teinte d’argent mat, nappe tombante des prés, où brillait ça et là le flot droit d’une cascade. Le recueillement était immense, total, et chacun des deux frères songeait : « Que de pauvres gens, cependant, torturés comme nous par l’ordre qui s’est abattu, ce soir, sur la vallée ! Combien qui ne dorment pas ! Et demain, tous ces départs ! Cette terre heureuse dont c’est le dernier moment, et qui sait que ce moment est venu ! »
Ils restèrent plus d’un quart d’heure ainsi, ne disant rien, goûtant la certitude et la suprême joie d’une pensée commune. Puis Joseph, qui avait toujours posé pour l’homme que rien n’émeut, se prit à rire d’un gros rire de brasserie, qui sonna singulièrement, parmi ces hangars vides et cette campagne seule.
— Dis donc, il faudra tâcher, tout de même, de ne pas tirer l’un sur l’autre !
Pierre leva les yeux au ciel ; il avait pensé à cela, lui aussi, mais il ne répondit point, n’ayant rien, hélas ! à répondre.
Il dit seulement :
— Que de sujets traités entre nous, ce soir, dont jamais nous n’avions causé ! Tu avais des idées si différentes des miennes : à peine si je m’en doutais.
— Que veux-tu ? Je suis de ceux qui ne parlent que les jours de catastrophe… Tu ne m’y reprendras plus j’espère. D’ailleurs, à quoi bon ?
Pierre serra la main de son frère, tendrement, le cœur tout brisé, ne voulant pas montrer ce qu’il souffrait, et, ayant fermé la fenêtre, il sortit du bureau dont Joseph prit la clé en disant :
— Tu peux monter dans ta chambre. Je vais accrocher la clé à la place habituelle, puis je verrai maman.
L’aîné monta, en effet, il passa devant la chambre de sa mère, et continua jusqu’au bout du couloir. Il avait oublié de prendre le bougeoir qui, chaque soir, était placé sur une console, dans le vestibule du rez-de-chaussée. Quand il eut passé, il tourna la tête. À ce moment, une petite lumière brilla à l’autre extrémité du corridor. C’était le frère cadet qui tenait d’une main la lumière, et de l’autre la clé du bureau de l’usine. Pierre, immobile dans l’ombre, vit ce lourd garçon, tranquille en apparence, comme d’habitude, se diriger vers le cabinet de travail, et ouvrir la porte ; il entendit le petit choc de la clé qui retrouvait sa place, pendue au clou ; il vit ce sous-officier de demain dans l’armée allemande, qui sortait, traversait le couloir, frappait deux coups à la porte de la chambre de madame Ehrsam. La réponse vint à lui, comme elle vint à Joseph, immédiate :
— Entre, mon petit.
La dernière chose qu’il aperçut, au moment où Joseph pénétrait dans la chambre, ce fut l’éclair furtif de la barbe blonde en pointe, tendue en avant, et des yeux au-dessus, tout fixes.
La mère ne s’était pas couchée ; elle avait dû prier ; son prie-Dieu était un peu écarté du mur ; le lit, contrairement à l’ordinaire, était encore recouvert d’une étoffe brune qui, d’aucun côté, ne faisait de plis.
Madame Ehrsam, assise dans son fauteuil au pied du lit, et tournée vers la porte, regarda Joseph pour voir si quelque chose avait changé ; si la conversation, si longue entre les deux frères, les avait déterminés à partir ensemble, du même côté. Toutes les suppositions, depuis plusieurs heures, elle les avait faites, et, de chacune d’elles, elle avait éprouvé la douleur. Tout de suite, elle lut sur ce visage sans rayonnement, dans ce regard terne, nullement rajeuni par la joie d’un projet nouveau, que Pierre n’avait rien obtenu. Elle n’interrogea pas son fils. Joseph dit, simplement, posant le bougeoir sur la table de nuit :
— Voilà, maman : tout est arrangé, je viens de remettre la clé à sa place. Désormais, c’est vous qui la prendrez, maman, car nous vous avons donné tout pouvoir, ainsi qu’à Denner, de gérer la fabrique. Les comptes sont en ordre. Je crois bien que tout a été prévu.
— Tout, mon Joseph ?
Ils se considérèrent l’un l’autre avec une grande tendresse et une grande tristesse. La mère reprit, n’ayant point eu d’autre réponse :
— Tu as une conscience : dans toutes ces terribles choses, il faudra la suivre, n’est-ce pas ?
Ces mots, si lourds de sens, brisèrent, un moment, deux courages. Des larmes, brusquement, coulèrent des yeux du jeune homme. Il ouvrit les bras, et il serra sur son cœur, passionnément, sa mère qui s’était levée, qui pleurait aussi ; plusieurs fois, il l’embrassa, puis il se recula un peu ; ils demeurèrent l’un devant l’autre, désespérés de sentir que la séparation était accomplie déjà, immobiles, incapables encore d’agrandir ce petit intervalle et de se quitter tout à fait. Ce fut la mère qui prononça les derniers mots :
— Comme tu dois partir de grand matin, Joseph, la cuisinière ne sera pas levée. J’ai préparé moi-même quelque chose que tu emporteras pour manger. C’est sur la table de la cuisine, enveloppé. N’oublie pas !
Il fit signe avec les yeux qu’il remerciait, mais il ne pouvait plus résister à l’émotion : sa poitrine se soulevait ; il devenait lui-même aussi pâle que sa mère. D’un geste rapide il prit le bougeoir, ouvrit la porte, et, suivant le corridor à droite, se dirigea vers sa chambre.
Au petit jour, Pierre alla frapper à la porte de son frère : Joseph était parti. Pierre passa la matinée, comme il l’avait promis, en conversation avec Denner, et fit, pour le service de la fabrique, plusieurs courses dans Masevaux. La petite ville avait sa physionomie ordinaire. Les ménagères allaient aux provisions vers la place du Marché et le long de la Grand’Rue qui passe devant l’église ; quelques charrettes étroites, à quatre roues, conduites par des paysans, croisaient, dans les rues, les automobiles militaires ou civiles, un peu plus nombreuses que de coutume.
Les visages des Alsaciens, pour qui connaissait bien cette race, s’éclairaient d’une petite flamme intérieure lorsque, dans les boutiques ou sur la chaussée, les hommes, les femmes s’abordaient les uns les autres. Même par signes, on ne parlait qu’aux amis dont on était sûr. Tous les fonctionnaires allemands étaient demeurés dans la ville ! On commentait en phrases rapides la grande nouvelle de la veille, et déjà il y avait des gens bien informés pour dire ce qui arriverait bientôt. On citait le nom de plusieurs jeunes hommes qui, dans la nuit même, avaient essayé de franchir la frontière de France. Avaient-ils réussi ? Nul ne le pouvait dire. Mais, de tant d’oreilles aux écoutes, dans la campagne et dans la ville, de tant de mères, de frères, de sœurs qui n’avaient pas dormi, il ne s’en trouvait pas qui eussent entendu plus de trois ou quatre coups de fusil tirés dans les bois du côté de l’ouest.
Pierre fut accosté par le tailleur, par deux ouvriers du tissage de M. André, par un contremaître de la fabrique de M. Lauth, qui est près de Thann ; il apprit que son tout proche voisin, Victor Reinhardt, le mari de la jeune femme accouchée de la veille, était parti dès minuit, le premier de tous, laissant la pauvre petite si dolente qu’on ne savait si tant de chagrin ne tournerait point en maladie. Une ou deux fois, ses interlocuteurs le questionnèrent, à la manière d’Alsace, indirecte et goguenarde :
— Eh bien ! monsieur Pierre, je pense que vous allez faire un petit voyage, vous aussi ?
Les yeux, glissant entre les paupières, indiquaient toujours le côté de l’ouest.
Le jeune homme, habitué à cette mimique prudente des pays opprimés, y répondait gravement, comme s’il traitait une question de commerce :
— J’ai l’intention d’aller voir quelques vieux amis de mon père.
Alors une main se tendait vers lui.
— Bonne chance, monsieur Pierre ! Au revoir, monsieur Pierre !
Et, s’éloignant l’un de l’autre, il y avait là, dans la Grand’Rue, ou dans la rue de l’Hôpital, ou dans la ruelle du Lièvre, deux Alsaciens qui songeaient à la France, et n’en disaient pas le nom.
Au début de l’après-midi, Pierre se rendit à la fabrique, avec sa mère. On vit madame Ehrsam et son fils au milieu des employés, dans les hangars, dans la machinerie, dans les salles où le coton est peigné, étiré, filé. Les ouvriers, porteurs de ballots de marchandises, pousseurs de wagonnets, huileurs de rouages, toutes les ouvrières rattacheuses de fils, qui surveillent les broches en mouvement, tournaient la tête et observaient cette mère et ce fils qu’on n’avait point vus ensemble dans les ateliers, depuis la mort de M. Louis-Pierre Ehrsam. Que serait le lendemain ? Qu’allait faire celui-ci, dont la mine était plus soucieuse que d’habitude ? Et que ferait celle-là, qui avait la force de sourire, bonnement, et qui se rappelait tous les noms : Honner, Lutz, Diringer, Kuntz, Richter, Comis, Roos, et les autres ?
Vers deux heures et demie, le jeune patron rendit visite à un ami plus âgé, et non atteint par la conscription, qui habitait dans la partie neuve de Masevaux, vers l’est, une villa depuis six semaines seulement terminée. Il revint avec lui et passa sur la place des Blés. Ce n’était pas sans raison. Là, se trouve l’hôtel de l’Aigle d’Or, et, en face, la bâtisse, en style nurembergeois, de la perception allemande. Les officiers allemands aimaient la bière de l’Aigle d’Or, et cette maison voisine leur plaisait, comme une image patriotique, une laideur allemande dans une ville trop alsacienne à leur goût. Pierre était assuré de rencontrer là quelques « autorités », et, en effet, un gendarme et un sous-officier causaient, surveillant les passants, à côté de la porte de la perception. Les deux amis se promenèrent de long en large au fond de la place, et, chaque fois qu’ils s’approchaient des deux Allemands, Pierre avait soin de parler plus haut, en langue allemande, comme un homme qui ne cache pas ses projets :
— Voici, je rejoins demain mon régiment ; il a fallu mettre ordre à mes affaires ; mais on peut être à Mulheim de bonne heure, tu sais. Mon frère est parti avant moi. Moi non plus, je ne manquerai point à mes obligations.
L’autre répondait des mots vagues, et les deux fonctionnaires prussiens écoutaient, et notaient administrativement.
Le soir, après le dîner, la mère et le fils veillèrent un peu de temps dans la salle à manger. Ils causèrent bas, la main dans la main, près de la fenêtre, tandis que l’ombre descendait pour la seconde fois, depuis que l’appariteur de la municipalité de Masevaux avait, au son du tambour, annoncé la « mobilisation de précaution ». Les journaux de France n’arrivaient plus. Madame Ehrsam avait lu et médité les brèves nouvelles de la Thanner Zeitung. Deux numéros du journal étaient encore sur ses genoux.
— Pourtant, mon Pierre, tu vois bien, la Gazette de Thann le dit expressément : ce n’est pas la guerre ; tiens, ici, dans le n° 205, du mardi 28 juillet, il est dit que l’Angleterre essaye d’arranger le conflit entre l’Autriche et la Serbie ; dans le numéro du 31, que j’ai reçu ce matin, tu peux lire une dépêche de Berlin, rassurante. C’est au bas de la page… Je sais le texte par cœur : « L’information d’après laquelle l’Empereur aurait ordonné la mobilisation de l’armée et de la flotte est inexacte. » De même, regarde, un peu plus loin : la Chambre de Commerce de Strasbourg recommande le sang-froid ; elle proteste contre le retrait des dépôts des caisses d’épargne, contre l’accaparement des vivres et de la monnaie… Eh bien ! si, après huit ou dix jours, la tension entre les deux pays diminue, si tout s’arrange, tu auras fait une équipée dangereuse.
— Sans aucun doute.
— Ne crois-tu pas que si tu attendais un peu, si tu te cachais…
L’ardent et brun visage de son fils s’éclaira d’un sourire :
— Oh ! maman, maman ! Comment pouvez-vous, vous qui êtes de l’Alsace qu’on ne trompe point, avoir encore des illusions sur l’Allemagne ? N’en doutez pas : nous sommes en guerre, et moi, je n’ai plus que des minutes à rester ici.
— Alors, mon bien-aimé, va-t’en !
Le regard qu’ils échangèrent fut celui de la plus parfaite communion d’intelligence et de cœur : regard de Français, regard de Française, comprenant de même l’honneur, souffrant de même, s’estimant l’un l’autre pour ce qu’ils sentaient en eux de supérieur à toute douleur.
À ce moment, Anna entra, et dit :
— Monsieur, il y a un ouvrier qui vous demande. Il dit que l’ordre de mobilisation a été affiché, dans toute la ville, à cinq heures.
Pierre se leva, sortit, et rentra quelques instants après.
— C’est ce bon Brogne, qui venait me prévenir, et, naturellement, me conseiller… Encore un cœur d’Alsacien, celui-là !
— Tu n’as rien dit, j’espère ?
— Évidemment. Mais désormais la guerre est déclarée, officiellement. Demain, dimanche, 2 août, est le premier jour de la mobilisation.
Rappelée à la réalité dont elle n’avait jamais été bien loin, madame Ehrsam demanda :
— Peux-tu me dire par où tu vas passer ? nous sommes seuls ici ; je voudrais te suivre, par la pensée, aussi loin que je pourrai ; ce n’est pas beaucoup : j’ai si peu voyagé !
Penché vers elle, et parfois l’embrassant, Pierre confia à sa mère son projet. Il semblait que ce fût un condamné, et qu’il fît ses dernières recommandations :
— Quand je ne serai plus là, vous aurez soin de ne pas raconter ce que je viens de dire ;… je vous remets en garde les papiers qui sont dans ma chambre, mes dessins, mes lettres… Vous pourrez répondre peut-être à quelques lettres qui viendront pour moi ; je penserai à vous à toute heure.
Le dernier mot qu’ils échangèrent, très bas, vers dix heures du soir, fut celui-ci :
— Maman, je tiens beaucoup à savoir, vous comprenez, où se trouvera mon frère Joseph. Tachez de faire porter des lettres en France…
La mère n’eut pas la force de répondre. Elle avait entr’ouvert, sans bruit, la porte de la maison ; Pierre avait passé ; il était sur la seconde marche du perron ; entre eux, il y avait un peu de nuit ; des nuages couraient sur la lune. La mère vit la grande et svelte silhouette de son fils se perdre dans l’ombre du côté du portail ; elle n’entendit même pas le bruit du portillon qui se refermait. Pierre était déjà sur le chemin, l’immense aventure commençait.
II. L’ACCUEIL.
Il avait pris un costume de chasse brun, et un chapeau mou ; dans l’une de ses poches était un revolver, et dans sa main droite un bâton ferré.
Avant de sortir de l’ombre du mur, il regarda du côté où le chemin s’abaisse vers la ville. Il vit seulement une forme indécise, une femme peut-être, qui traversait en bas la route, et entrait dans la rue du Chariot. Il attendit qu’elle eût disparu, et remonta, sans bruit, à pas rapides, le long du cimetière, par la route de Rougemont, la route de France. L’extrême silence l’étonnait. Pourquoi, l’ordre de mobilisation ayant été lancé, n’y avait-il aucun mouvement de troupes dans cette direction ? Cependant, il avait beau regarder, entre les platanes, tantôt vers les prairies qui descendent, à gauche de la route, tantôt vers les collines cultivées, qui se lèvent à droite, il n’apercevait aucun groupe de soldats. Derrière lui, devant lui, pas de convoi en marche ou garé. Partout la nuit tranquille aux images familières. Sur le plateau, les bâtiments du Baerenhof ressemblaient à une grosse meule de paille ; dans le champ à côté, les javelles, debout, en tas, se dressaient en files régulières, comme les tentes d’un camp endormi. Des perdrix seules y dormaient, et des alouettes. Il entendit un cri d’oiseau dans la nuit. Un peu plus loin, quand il fut arrivé dans la région des vergers hauts, où sont tant de pommiers, de pruniers et de cerisiers, il se détourna, et essaya, une dernière fois, de reconnaître la ville en arrière ; mais la lune était toujours voilée : Masevaux, dans le creux des terres, n’était plus qu’un peu d’ombre, et, dans le cercle des montagnes, il n’y avait plus qu’une seule petite lumière, grosse à peine comme une étoile de dixième grandeur, et qui veillait, entre ses sapins, on ne sait où. Pierre se sentit séparé de tout ce qu’il aimait. Encore un peu de marche, et il approcha de la lisière de la forêt qui est toute en haute futaie, et qui couvre inégalement les deux côtés de la route, simple dentelure à gauche, et vastes étendues de l’autre bord.