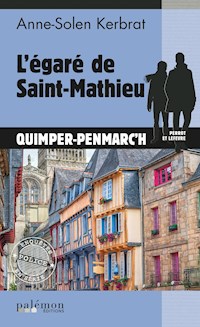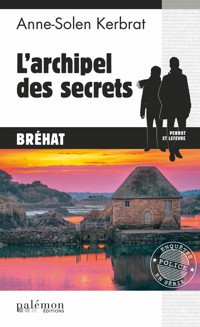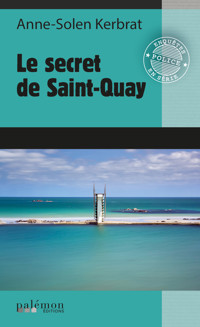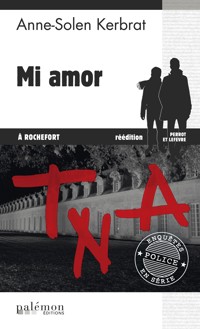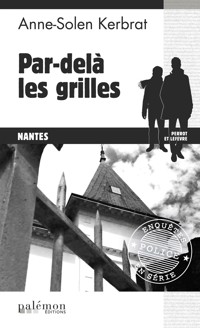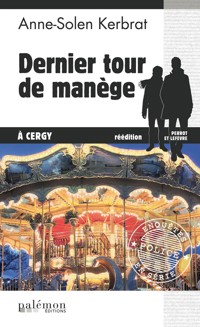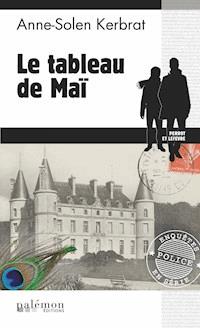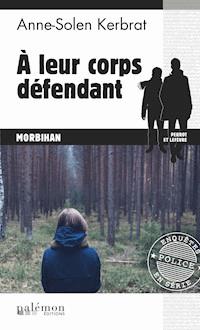
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Palémon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commandant Perrot
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Les commissaires Perrot et Lefèvre se lancent sur la piste d'un mystérieux serial killer...
Le corps mutilé de Sabrina Boucheul est découvert dans un chemin forestier nantais au petit matin.
Fait troublant, le même mode opératoire a présidé au meurtre d'une autre jeune femme quelques mois plus tôt dans le Morbihan.
Les commissariats de Nantes et Vannes sont conjointement saisis, aussi Perrot et Lefèvre posent-ils leurs valises à Vannes pour prêter main-forte au capitaine Jeanne Sixte.
Mais lorsqu'une troisième jeune femme au profil similaire disparaît à son tour dans les mêmes conditions, nos enquêteurs s'orientent sur la piste d'un meurtrier en série.
Avec beaucoup de finesse, Anne-Solen Kerbart dresse à travers ce thriller une analyse sociologique très juste.
EXTRAIT
Une masse sombre se découpe sur le sol à moins de trois mètres devant eux, en partie dissimulée par des feuilles mortes. Perrot brandit la torche en direction du corps allongé sur le dos mais légèrement appuyé sur le flanc gauche. Puis, lentement, il fait décrire à sa torche un mouvement circulaire large sur le sol autour de la dépouille.
Ensuite, il oriente la lumière à hauteur d’homme et tourne sur lui-même, toujours aussi lentement. Satisfait, il redescend le faisceau vers la dépouille et s’en approche d’une grande enjambée, toujours pour réduire au maximum la contamination de la scène. Au vu de la taille et de la corpulence générale, Perrot a l’impression qu’il s’agit d’une femme, mais on ne peut d’emblée exclure la possibilité d’un homme de petit gabarit. Autour du visage rendu invisible par les végétaux qui le recouvrent partiellement, une chevelure longue s’emmêle. Noyée dans les senteurs du sous-bois en automne, Perrot croit déceler une odeur vaguement fétide émanant de la masse gisant sur le sol terreux. Mais il ne jurerait pas que cet effluve qui lui effleure n’est pas le fruit d’un inconscient habitué à anticiper certaines sensations olfactives pas toujours plaisantes.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Anne-Solen Kerbrat est née en 1970 à Brest, et a d’abord vécu entre Côtes d’Armor et Finistère sud.
Professeur d’anglais dans le secondaire puis le supérieur, elle est passée par le Val-d’Oise, la Charente-Maritime et le Bordelais avant de poser ses valises à Nantes.
Elle se consacre aujourd’hui à l’éducation de ses quatre enfants, à la traduction et...à l’écriture.
Son style féminin, à la fois sensible et incisif, et la qualité de ses intrigues sont régulièrement salués par la critique.
Son premier roman a été récompensé par le Prix du Goéland Masqué en 2006.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Remerciements à Jordan Sanchezpour sa photo tirée du site « Unsplash.com »
Un mois plus tôt
« Ça y est, j’y suis. »
« Parfait, moi aussi. »
Elle resserre les pans de son manteau, souffle à l’intérieur de son écharpe pour créer une atmosphère chaude autour de son visage que crispe le froid. Elle frappe doucement du talon pour activer la circulation dans ses pieds chaussés de bottines trop légères. Elle aurait dû enfiler une paire de chaussettes par-dessus son mi-bas trop fin. Elle s’est dit la même chose hier matin, mais voilà, le poids des habitudes… Ce rituel mille fois recommencé : les chaussettes en nylon, le jeans ajusté, les bottines ou les baskets et ce regret, une fois arrivée dehors, lorsqu’il est déjà trop tard pour remonter se changer. Elle souffle de plus belle dans son cache-col, sent son nez picoter, ses yeux s’embuer comme lorsque l’éternuement va vous saisir, intempestif et violent. Il fait encore nuit, mais on devine déjà l’amorce d’un petit jour humide et brumeux. Dans un grincement de tôle usée, le tramway s’avance, masse sombre aux contours indéfinissables, presque invisible sur le quai de l’Erdre. En contrebas, les péniches amarrées se pelotonnent contre l’assaut de la bruine. Certaines, habitées, laissent échapper de la fumée à travers les conduits en inox qui se dressent sur leur toit de métal. Deux ou trois mouettes trop matinales viennent de s’élancer de la rambarde du pont et on devine leur vol plané au-dessus des eaux noires. Le tramway d’un autre âge s’immobilise dans un crissement de freins un peu lugubre. Ils ne sont que trois à monter à bord, ils sont peut-être les seuls usagers du convoi tout entier à cette heure précoce. Elle grimpe lestement, pressée de se retrouver dans la chaleur bienfaisante, et valide sa carte de transports. Comme tous les jours, elle veille à choisir une place dans le coin du wagon, là où on ne viendra pas la déranger. Elle se réserve la possibilité de poursuivre sa trop courte nuit sur la banquette au skaï fatigué, loin des commentaires ou questions indiscrètes de passagers qui ont suffisamment dormi ou qui, au contraire, comptent sur une conversation paresseuse avec un voisin pour tromper la tentation du sommeil. Les lampadaires jettent une lumière blafarde sur le quai, nimbant le paysage d’une auréole pâle et triste. Un chien galeux fait un saut de côté pour éviter le monstre noir qui déboule sur les rails visqueux, visibles de lui seul. Un peu à contrecœur, elle sort son portable de la poche de son manteau et se force à taper le SMS.
« Je suis dedans. »
« Nickel, moi aussi. »
Puis elle verrouille son mobile, le glisse dans sa poche et repose paresseusement la tête sur le dossier. Sa tête dodeline mollement, au rythme des oscillations du train qui avance dans la nuit. Les cahots irréguliers la bercent doucement, elle sent la torpeur l’envahir, ramollir ses muscles, amoindrir ses réflexes. Pour un peu, elle céderait au sommeil, mais quelque instinct de prudence venu du fond de son être lui intime de résister. Elle se force à entrouvrir les yeux et respire profondément. Ce n’est pas le moment de s’endormir, là, sur cette banquette fatiguée d’avoir accueilli trop de passagers éreintés. Elle ne doit pas rater son arrêt, sans quoi elle arrivera en retard. Ça lui est arrivé à une reprise, c’était une des premières fois qu’elle attrapait le tram de cinq heures quinze. Elle s’était réveillée, hagarde et confuse, au terminus du tramway, surprise de voir monter ces têtes inconnues qui ne la voyaient même pas. Elle s’était levée péniblement de sa banquette avec l’impression désagréable de s’être fait avoir ou d’avoir fait preuve d’une quelconque faiblesse. Elle avait vite changé de voie et repris le train dans l’autre sens. Elle était arrivée en retard au travail et sa chef de service n’avait pas manqué de lui en faire la remarque. Elle s’était empressée de passer au vestiaire afin de quitter sa veste et ses chaussures et d’enfiler sa blouse et ses chaussons de caoutchouc blanc. Elle était repassée devant la vitre du bureau des surveillantes en baissant la tête et était allée consulter le tableau de la nuit. C’était de l’histoire ancienne, mais il était hors de question que cela se reproduise. Elle ouvre plus franchement les yeux et essaie de scruter les ténèbres. Il n’y a pas un chat dehors, les chanceux sont encore couchés, les autres émergent lentement des limbes du sommeil en tirant la couette sur leur museau fatigué et en détournant les yeux du cadran lumineux du réveil qui déroule implacablement ses minutes sur la table de chevet.
Il a reçu le SMS, il est rassuré. Il regarde au-dehors à travers la vitre qui aurait besoin d’être lavée à grande eau savonneuse pour faire disparaître les strates graisseuses qui la ternissent. Au loin, des immeubles aux contours flous dressent leur armature vers le ciel. Sur leurs façades se découpent de petits carrés dont une poignée sont déjà éclairés. Réveil matinal ? Insomnie ? Nuit de fête prolongée ? Cauchemar ou biberon de cinq heures ? Qui peut savoir ce qui se joue à l’abri de ces petits espaces de lumière, autonomes et pourtant imbriqués dans l’anonymat de la structure de fer et de béton ?
Il consulte les dernières informations sur son téléphone, même s’il préfère nettement tourner les pages un peu bruyantes d’un journal papier. Mais à l’heure où il attrape son train, le kiosque à journaux est encore fermé, tout comme le bureau de tabac du coin de la rue. Inconditionnellement, il s’assoit dans un recoin du wagon, ainsi il se prémunit contre l’installation d’un passager à ses côtés. Le risque d’être dérangé par un bavard ou un humain en manque de contact est cependant minime à cette petite heure du matin où la rame est quasiment vide. Pourtant, il sait comme son congénère peut parfois se montrer surprenant, animal social ayant besoin de renifler son semblable pour se sentir vivant. De toute manière, quand un tel individu choisit de se glisser près de lui alors qu’il y a des places vacantes partout, il feint de ne pas sentir le frôlement du corps inconnu. Tout au long du trajet, il garde les yeux obstinément tournés dans la direction opposée ou fixés sur l’écran de son mobile. Dieu qu’il déteste la question stupide de celui qui veut créer un semblant de lien : « Vous pouvez me dire l’heure s’il vous plaît ? » « Cinq heures moins le quart ». « Ouf, merci, je me croyais en retard ! » Ne surtout pas enchaîner, sans quoi, on est fichu. Il jette un œil à l’application météo et fait la grimace en constatant que la journée s’annonce maussade. Il espère que le soleil sera de retour ce week-end, ainsi il pourra aller courir sur la côte ou dans les bois environnants.
*
— Alors, Sabrina ? Terminé pour aujourd’hui ?
— Ouf, oui ! répond la jeune femme à sa collègue souriante qui termine la préparation d’un chariot. C’est pas trop tôt, je me sens tellement ramollo ces temps-ci…
— Ce n’est guère étonnant. Et ça ne va pas aller en s’arrangeant…
Sabrina interrompt son rhabillage et cherche le regard de sa collègue.
— Pourquoi tu dis ça, Marie-Noëlle ?
— Pour rien, répond la plus âgée d’un ton énigmatique sans quitter des yeux les instruments qu’elle est occupée à désinfecter.
— Très bien, réplique Sabrina en haussant les épaules et en attrapant son sac à main dans son casier. À d’main.
— À demain, Sabrina.
L’aide-soignante fait rouler ses épaules d’avant en arrière tandis qu’elle enfile le couloir où se mêlent des odeurs variées : antiseptique, parfum bon marché, ragoût du déjeuner, peinture fraîche. Elle hâte le pas, soudain pressée de se retrouver à l’air libre. Le soleil n’est pas parvenu à percer l’épaisseur des nuages et l’atmosphère est toujours aussi humide. Son nez se met à la picoter et elle bloque un éternuement en se pinçant les narines. Elle fait deux tours à sa large écharpe qui, même une fois nouée, pend encore jusqu’en haut de ses cuisses. Elle ouvre son sac à main en faux cuir souple et attrape un paquet de chewing-gums à la menthe sans sucre. Elle ôte l’emballage, plie le rectangle en accordéon et le glisse dans sa bouche. Devant le CHU, la route se prolonge en pente douce herbue vers les immeubles anciens qui se sont installés sur le lit aujourd’hui asséché de la Loire. À la belle saison, les jeunes investissent les pelouses avec l’impression d’être à la plage. Mais en ce mois de novembre, elles se comptent sur les doigts d’une main les frileuses silhouettes serrées les unes contre les autres, agrippées à leur cigarette. Elle prend à gauche en direction de son arrêt Place du Commerce. Les tramways de la ligne deux se croisent, pas encore bondés en ce début d’après-midi. Les piétons se bousculent, étudiants oisifs, lycéens désœuvrés, femmes noires aux hanches larges et boubous colorés, hommes d’affaires avec leur mallette au bout du bras, chômeurs au regard triste. Elle n’a soudain plus envie de grimper tout de suite dans le tram pour se précipiter chez elle. Elle décide de marcher jusqu’au prochain arrêt, l’exercice physique lui fera du bien. Elle ne fait presque plus jamais de sport et s’en veut de cet état de fait et de ses justifications oiseuses pour expliquer son manque d’envie. Elle se débrouillait plutôt bien en athlétisme au collège et au lycée, mais depuis qu’elle a passé son bac professionnel, elle a cessé toute activité sportive. À l’exception de la marche, toutefois. « Bien obligée », songe-t-elle en grimaçant intérieurement, « puisque je n’ai toujours pas trouvé le temps de passer mon permis. Ni l’argent pour acheter une voiture », ajoute une petite voix vicieuse. Elle s’arrête au croisement du cours des Cinquante Otages et de la rue du Calvaire afin de laisser passer les bus qui descendent l’un derrière l’autre. Le tram qui remonte la rue de la Boucherie en direction de la Tour de Bretagne fait penser à un funiculaire paré à grimper une colline. Elle traverse le carrefour et admire les jolis meubles contemporains dans la vitrine de chez Habitat. Elle se dit qu’un jour, elle s’arrêtera dans cette enseigne. Lorsqu’elle sera reçue au concours d’infirmière, se promet-elle en accélérant le pas comme s’il n’y avait soudain plus une minute à perdre. Elle arrive à l’arrêt au moment où s’immobilise le tram. Elle grimpe dedans, choisit une place près de la fenêtre et se met à consulter ses mails sur son téléphone portable. Deux ou trois messages sans importance apparaissent sur l’écran. Mais un dernier la rassure : son inscription au concours d’infirmière ainsi que celle aux cours du soir sont validées. Elle verrouille son téléphone, le fourre dans la poche de son manteau et enlève son écharpe. Il fait presque trop chaud dans le wagon et les vitres sont noyées d’une buée qui empêche de voir au-dehors. Une femme avec son bébé qui gémit est assise sur un siège de l’autre côté de la travée. Le nourrisson a les joues rouges de fièvre et la femme aux traits tirés le berce doucement pour éviter qu’il se mette à pleurer. Sabrina remarque que le petit fiévreux est trop couvert pour que sa température baisse. Elle se retient de dire à la mère qu’elle devrait ôter la doudoune du petit lorsqu’elle passe du froid du dehors à la touffeur des transports en commun. Mais la femme ne comprendrait pas ce conseil prononcé par une inconnue et l’enverrait certainement promener. Alors la jeune aide-soignante retient sa phrase et se concentre sur le magazine qu’elle vient d’acheter. Elle l’ouvre comme d’habitude en commençant par la fin et se plonge dans l’horoscope de la semaine : « Amour : montrez-vous réceptive, la rencontre peut se faire n’importe où, n’importe quand, surtout lorsqu’on s’y attend le moins ! Cela peut arriver sur le chemin du travail ou dans l’épicerie de votre quartier, alors baissez la garde ! » Instinctivement, elle redresse le buste et jette un œil circulaire : l’homme de sa vie est-il en ce moment même dans le wagon ? Elle se mord la lèvre et secoue imperceptiblement la tête. Quelle midinette elle fait, tout de même ! Elle replonge le nez dans le magazine aux feuilles trop fines. « Travail : croyez-en vous, l’horizon s’éclaircit ! Si vous êtes en recherche d’emploi, vous allez avoir sous peu une opportunité. Si vous êtes en reprise d’études, la période est favorable avec Vénus en Mercure. » « S’ils pouvaient dire vrai », soupire-t-elle en croisant les doigts, sans interrompre sa lecture. « Santé : attention, petits pépins en vue ! Rien de méchant, rassurez-vous, mais un refroidissement est toujours possible. » Elle regarde le bébé cramoisi à sa gauche et porte mécaniquement la main à son nez comme pour prévenir une éventuelle contamination. « Un pépin d’un autre genre peut vous arriver, mais celui-là vous remplira de joie ! » Elle laisse retomber le magazine et passe le revers de sa main sur son front qui vient de se couvrir d’une sueur froide. Elle regarde autour d’elle, scrute les visages au repos, aux yeux perdus dans le vague, et les faces animés de ceux qui échangent avec leurs voisins. Elle repense à la remarque pleine de sous-entendus de sa collègue Marie-Noëlle tout à l’heure. Était-ce une parole en l’air, comme ces mots que l’on prononce pour meubler le silence ? Doit-elle prêter garde aux propos de cette femme qui se repaît de romans à l’eau de rose mais dont la vie sentimentale se réduit au bonjour-bonsoir échangé avec le boulanger sexagénaire du coin de la rue ? Décidément, ça n’en vaut pas la peine, se dit Sabrina en reprenant son magazine au début, afin de découvrir les potins sur ceux qu’on appelle des stars pour l’unique raison qu’ils ont soi-disant lutté pour leur survie, en bikini ou micro-maillot de bain sur quelque île déserte truffée de caméras. Pendant quelques minutes, elle vit par procuration la vie rêvée d’une starlette de la téléréalité confrontée au terrible dilemme de savoir si en changeant de bonnet de soutien-gorge, elle retiendra l’attention du culturiste décérébré qui doit choisir entre quatre prétendantes peroxydées. « Si seulement la vie pouvait être aussi simple que pour ces gens-là… » soupire la jeune femme en refermant lentement son magazine. Elle, a tellement de choses à gérer, entre son emploi qu’elle aime mais qui réclame tant d’énergie et son ambition qui la pousse à aller plus loin. « Allons, se reprend-elle, il n’y a aucune raison de se laisser aller. Je suis dans la force de l’âge et j’ai la vie devant moi. » Elle tourne la tête sur la gauche, attirée par les gémissements sourds du bébé malade que sa mère continue de bercer doucement.
— Excusez-moi…, dit-elle en se penchant brusquement au-dessus de la travée.
— Oui ?
— Votre bébé, il risque de convulser si sa fièvre reste trop haute.
La mère lui lance un regard sans expression. A-t-elle seulement entendu ?
— Votre petit, il faut lui enlever son manteau, répète-t-elle en désignant le blouson matelassé. Je suis aide-soignante, se croit-elle obligée de préciser.
— Ah ?
— Oui, je vous assure. Vous le lui remettrez en sortant. Et une fois chez vous, donnez-lui du Doliprane et laissez-le en body.
— Merci, souffle la femme en faisant docilement descendre la glissière de la doudoune, avant de l’ôter.
— Je vous en prie.
Elle reprend sa position, satisfaite d’avoir vaincu sa réticence à conseiller cette mère un peu désemparée. Pourtant, la femme assise sur sa gauche est bien plus âgée qu’elle, elle doit approcher les quarante ans. Mais elle semble inexpérimentée, ou bien simplement, songe Sabrina, lasse de la vie et du peu de joies qu’elle lui apporte. Elle a pourtant un petit, elle ne devrait pas se laisser aller comme ça au découragement. « À moins, réfléchit soudain Sabrina, que cet enfant n’ait pas été le bienvenu, peut-être est-il un fardeau dont elle n’a pas osé se débarrasser ? » Le soubresaut du tramway qui freine l’arrache à sa rêverie et la replonge dans la réalité. Elle descend au prochain arrêt. Elle se met donc debout, quand une idée lui traverse soudain l’esprit. Elle se met à fouiller dans son sac et au moment précis où le tramway s’immobilise, elle donne sa carte de visite à la mère de l’enfant malade. Celle-ci tend mécaniquement la main et tout aussi mécaniquement murmure un merci à peine audible. Sabrina se hâte dans la travée et se retrouve sur le quai qui se noie encore dans la brume. Elle ne sait pas ce qui l’a poussée à agir ainsi, elle qui est d’un naturel plutôt prudent et réservé, mais la détresse muette de la femme l’a touchée. À moins que ce ne soit son instinct de soignante qui ait guidé son geste. Ou encore une autre raison plus personnelle. Quoi qu’il en soit, elle se félicite d’avoir tendu sa carte à l’inconnue, songe-t-elle en regardant le convoi s’éloigner au son du grincement de ses essieux usés. Elle marche rapidement sur le trottoir au bitume luisant, en resserrant frileusement les pans de son manteau contre son buste. Le paysage disparaît presque dans la brume qui dénoue toujours plus ses écharpes cotonneuses. Elle va rentrer, se préparer un thé et s’atteler à son cours sur l’anesthésie. Ce n’est pas la partie qu’elle préfère, mais elle sait qu’elle doit maîtriser parfaitement le sujet pour le concours dont la date approche. Elle étouffe un bâillement, balaie l’éventualité de s’allonger pour une sieste sitôt arrivée dans son studio. Pourtant, ce ne serait pas un luxe car, dès mercredi, elle va enchaîner avec deux nuits au service. Mais elle n’a pas le loisir de faire un somme, chaque heure de son temps est comptée si elle veut être prête pour l’examen au printemps. D’un autre côté, si elle avait attrapé un tram dès sa sortie du CHU au lieu de flâner cours des Cinquante Otages, elle aurait pu s’octroyer une petite sieste avant de se remettre dans les livres. « Cependant, se console la jeune femme en pressant davantage le pas, si j’avais pris mon tram à l’arrêt habituel, je n’aurais pas croisé cette femme et son bébé. Et je n’aurais donc pas eu l’occasion de lui donner un conseil pour s’occuper de son petit fiévreux. Alors, non, pas de regret, je pense que tout a un sens, même cette idée un peu folle de tendre ma carte à une parfaite inconnue ! »
*
Elle a fait ses deux nuits et a bénéficié d’une journée de repos qu’elle a mis à profit pour potasser le concours. Elle a décliné l’offre de Maylis, son amie de lycée à présent mariée et mère au foyer, d’aller boire une bière pendant que le mari de cette dernière s’occuperait des enfants. « Enfin quoi, s’est écriée Maylis lorsque Sabrina a refusé de sortir avec elle, tu devrais profiter d’être encore célibataire pour brûler la vie par les deux bouts ! Ce sera trop tard après ! », a soupiré la jeune mère sur un ton joyeux démentant la frustration qu’elle affichait.
En réalité, Sabrina sait comme son amie est épanouie dans son rôle de maman à plein temps au service de ses deux enfants de trois et un an et demi. Elle a la même formation que Sabrina mais n’a jamais exercé car elle est tombée très vite enceinte de son mari gendarme et a choisi de s’occuper de leurs enfants. Sabrina se demande dans quelle mesure elle se mettra un jour à travailler, car sa vie actuelle la comble. « Mais ses enfants vont grandir, songe Sabrina en regardant son tram qui approche dans le noir, elle n’aura, un jour, plus de raison de rester à la maison. À moins que Steph y trouve son compte, après tout, ça doit être bien agréable de retrouver une petite épouse épanouie et des enfants réjouis dans leur pyjama fleurant bon la lessive lorsqu’il rentre le soir… »
La situation familiale de Maylis la renvoie à la sienne, placée sous le signe du travail et d’une solitude revendiquée. Revendiquée, vraiment ? Elle se mord la lèvre en laissant échapper un éclat de rire muet. Elle n’est pas bien sûre d’avoir tout choisi dans ce qui lui arrive aujourd’hui. Elle sait ce dont elle ne veut pas, ça oui, elle le sait, mais pour le reste… A-t-elle réellement tout vu venir ? Allons, soyons honnête, elle n’a pas tout maîtrisé, loin s’en faut, sinon elle ne serait pas confrontée à ce dilemme. Ce soir, elle a accepté de faire deux heures supplémentaires pour pallier l’absence de Coralie, une collègue qui vient d’être placée en congé maternité. Elle se sent découragée à l’idée de terminer à minuit au lieu de vingt-deux heures, mais elle se dit que l’argent supplémentaire sera le bienvenu. Et puis, il faut être juste, rien ne la retient à la maison, ni mari ni enfant, alors c’est normal qu’elle se porte volontaire pour assurer les heures en trop.
L’après-midi puis la soirée ont passé sans qu’elle s’en rende compte, accaparée par les urgences qui se sont accumulées au fil des heures : accidenté en scooter, crise d’asthme aiguë, infarctus foudroyant, fausse alerte d’appendicite, accouchement prématuré… La litanie toujours recommencée et pourtant jamais la même d’un service des urgences. Elle a bien failli s’assoupir dans le tram qui la ramène chez elle, vaincue par ces heures ininterrompues de tension. Mais la force des habitudes fait qu’elle sent toujours quand elle approche de son arrêt. Dans le wagon, ils sont une poignée : deux jeunes qui sortent probablement de quelque bar et parlent trop fort, un couple d’une vingtaine d’années qui se murmure des mots doux à l’oreille, un homme dont elle ne voit que la nuque aux cheveux mal taillés et les grosses chaussures de chantier, et une femme dont elle devine qu’elle est une femme de ménage qui travaille après la fermeture des bureaux. « Quelle drôle de vie elle doit mener, songe Sabrina en regardant la femme aux épaules un peu voûtées qui s’empêche de s’endormir en faisant des mots croisés dans son magazine télé. Moi, au moins, j’ai la chance de vivre des expériences enrichissantes, de rencontrer des gens différents tous les jours. Alors qu’elle, se contente d’astiquer les mêmes poignées de portes chaque soir, de vider les mêmes corbeilles, d’aspirer les mêmes linos, de regarder la jolie blonde et le gamin qui sourient dans leur cadre sur le bureau du directeur des ventes, de soupeser le presse-papiers en bronze dont elle se dit qu’il pourrait lui briser un pied s’il venait à lui tomber dessus. D’un autre côté, réfléchit Sabrina en étouffant un bâillement, elle n’est pas confrontée au stress de situations difficiles, à l’épreuve des familles en détresse, voire brutalement endeuillées… »
Une vibration dans la poche de son manteau la tire de ses réflexions un peu amères. Ah oui, elle a failli oublier d’envoyer son texto. Elle s’en acquitte avec un vague sentiment de culpabilité. Puis elle promène son regard sur le wagon aux trois quarts vide. L’ouvrier aux chaussures épaisses semble avoir piqué du nez tandis que la femme de ménage a l’air plus déterminée que jamais à remplir ses grilles de mots croisés ou fléchés. Les deux amoureux sont en train de se bécoter en gloussant et les deux camarades de fête ont l’œil un peu vitreux de celui chez qui l’excitation provoquée par l’alcool laisse progressivement place à une léthargie pâteuse. Encore trois arrêts et elle devra s’extraire de sa banquette et affronter le froid de la nuit. Dix minutes plus tard, elle est la dernière à descendre du wagon. Elle se répète alors pour la énième fois qu’elle serait bien mieux en voiture, plus en sécurité surtout. Mais une voiture grèverait un budget déjà serré, alors inutile de rêver à l’impossible. Pour l’heure, ce qui importe c’est d’avaler les presque deux kilomètres qui la séparent de la résidence près du quartier de l’Hippodrome où est situé son studio. Cela lui prend un peu plus de dix minutes en marchant d’un bon pas, le temps hélas d’être bien réveillée lorsqu’elle arrive chez elle, alors qu’elle est censée aller se coucher si elle veut récupérer. Ne surtout pas penser à ça, se réprimande-t-elle sinon elle est certaine de faire fuir le sommeil. Elle emprunte la première rue bordée de cyprès et tressaille, malgré l’habitude, à l’aboiement du berger allemand caractériel du numéro douze. Elle peste à haute voix tandis qu’elle s’engage dans la rue suivante, celle qu’elle aime moins à cette heure tardive, car les lampadaires y ont été chichement installés. À deux ou trois endroits qu’elle connaît par cœur, la visibilité est quasiment inexistante et d’autres qu’elle auraient le ventre serré de s’aventurer seuls sur cette partie de la route. Mais Sabrina connaît ce trajet comme sa poche et n’est pas d’un tempérament peureux. Et puis, elle habite un coin tranquille, pas de raison de s’inquiéter, elle n’est ni la première ni la dernière à rentrer seule dans la nuit. On n’est pas à Chicago, tout de même, ça se saurait !
*
Coup de sifflet du paquebot qui s’éloigne du quai emportant à son bord Sofia et les enfants qui agitent leur mouchoir joyeusement. Ils ne voient donc pas que le bateau part sans leur père resté en bas ! Il faut absolument qu’il fasse arrêter le navire ! Mais à quoi bon faire des signes désespérés, pauvre pantin dérisoire qui disparaît dans l’ombre du géant des mers. Personne ne le voit ni ne l’entend. Et pourquoi la sirène du paquebot continue-t-elle ainsi à percer le silence en étouffant son cri ? La corne de brume lui écorche les oreilles, il porte la main à ses tempes. Puis un sursaut, la main qu’on tend à l’aveuglette et l’objet familier qu’on étreint, banal.
— Allô…
— Je vous réveille, commandant, désolé. Ici Yannick, du quart de nuit…
— Allez-y, je vous écoute, fait Perrot en se mettant laborieusement sur son séant, pas encore certain d’avoir quitté le port de Saint-Nazaire d’où s’éloignait The Empire of the Seas.
— On vient de trouver un corps du côté de l’Hippodrome.
— Qui « on » ?
— Un gars qui sortait son chien avant d’embaucher. C’est le chien qui l’a flairé.
— OK. Vous êtes sur place ?
— Oui, on est venus vérifier dès que le gars a appelé et on a sécurisé la zone.
— Bien. Et le témoin ?
— On l’a laissé repartir chez lui, il était sonné.
— Vous avez son adresse, tout de même ? lance Perrot tout à fait réveillé à présent.
— Évidemment, rétorque le gardien, on connaît la procédure.
— Oui, bien sûr. Bon, ne bougez pas, je suis là au plus vite.
Après le renfort saisonnier effectué aux Sables, Perrot est de retour sur ses terres nantaises et a réintégré l’aile du manoir que possède et habite sa vieille amie, Yvonne Madec. À cette heure matinale, la bâtisse trop grande pour sa logeuse et lui-même est encore plongée dans le noir. De toute manière, il ne croise jamais la vieille dame avant le soir, moment où il passe lui dire bonjour de temps en temps, quand le cœur lui en dit, mais certainement jamais par obligation morale ou sentiment de culpabilité. Il se douche rapidement, enfile un pantalon gris anthracite, une chemise bleu pâle et un pull-over bleu foncé, et descend à la cuisine. Pas le temps de prendre un petit-déjeuner, mais un expresso n’est pas négociable. Cinq minutes plus tard, il referme la portière de sa voiture, remonte l’allée de la propriété et actionne l’ouverture des grilles à distance. La circulation inexistante lui permet de rallier sa destination en un peu moins de vingt minutes. Les indications du dénommé Yannick étant claires, il trouve rapidement l’endroit où a été signalée la découverte macabre. Une estafette aux couleurs de la police nationale est garée sur le bas-côté, légèrement penchée du côté du fossé. Un gardien est au volant, occupé à pianoter sur un téléphone portable. Perrot, qui a pris soin d’emporter sa vieille paire de bottes Aigle, tape au carreau du véhicule. Le gardien d’une vingtaine d’années sursaute légèrement avant de descendre sa vitre.
— Ah, c’est vous ! s’exclame-t-il en reconnaissant le commandant et en descendant du fourgon. Vous venez pour le corps ?
— À votre avis ? ironise Perrot avec un sourire.
— Évidemment, quelle question ! se reprend le jeune homme en secouant la tête.
— Il n’y a pas de mal, vous avez le droit d’être fatigué. C’est par où ?
— Là-bas, au bout du chemin, après les conteneurs. Vous verrez les collègues…
Perrot laisse le gardien se remettre au chaud dans l’habitacle et prend la direction indiquée. La pluie des derniers jours rend le terrain meuble et le sol a tendance à se dérober sous les semelles de caoutchouc de ses bottes. Il avance lentement afin d’éviter les ornières en pointant devant lui la torche dont il s’est muni. Le bruit de voix assourdies qui lui parvient lui indique qu’il arrive bientôt à destination. Deux collègues à l’avant-bras ceint d’un brassard fluorescent piétinent en bavardant pour tromper l’attente. Ils tapent du pied pour se réchauffer et ont enfoncé leurs mains profondément dans les poches de leur veste fourrée réglementaire. Celui qui fait face au chemin par lequel arrive Perrot, annonce son arrivée à son collègue d’un hochement de menton. Derrière eux, on aperçoit les cordons de sécurité qui ont été tendus pour tenir les curieux à distance. Les bandes orange fixées aux troncs des arbres constituent, avec le faisceau de la torche et l’écran du téléphone mobile du gardien à la carrure massive, les seules présences lumineuses dans l’obscurité du sous-bois.
— Bonjour, alors ça se trouve où ?
— Par-là, commandant, venez, je vous montre, l’invite le plus costaud en rempochant son téléphone pour soulever le cordon de police.
Le gardien plie son corps imposant avec difficulté et se faufile sous le cordon en soufflant. Puis il tient le ruban levé afin de laisser le passage à son supérieur. Le gardien ouvre la marche, suivi de Perrot qui veille à glisser ses pas dans les empreintes de son collègue afin d’éviter de trop souiller la scène. Ils progressent lentement sur le terrain accidenté, manquant de perdre l’équilibre dans les creux boueux du chemin. Mais déjà, ils s’arrêtent. Une masse sombre se découpe sur le sol à moins de trois mètres devant eux, en partie dissimulée par des feuilles mortes. Perrot brandit la torche en direction du corps allongé sur le dos mais légèrement appuyé sur le flanc gauche. Puis, lentement, il fait décrire à sa torche un mouvement circulaire large sur le sol autour de la dépouille. Ensuite, il oriente la lumière à hauteur d’homme et tourne sur lui-même, toujours aussi lentement. Satisfait, il redescend le faisceau vers la dépouille et s’en approche d’une grande enjambée, toujours pour réduire au maximum la contamination de la scène. Au vu de la taille et de la corpulence générale, Perrot a l’impression qu’il s’agit d’une femme, mais on ne peut d’emblée exclure la possibilité d’un homme de petit gabarit. Autour du visage rendu invisible par les végétaux qui le recouvrent partiellement, une chevelure longue s’emmêle. Noyée dans les senteurs du sous-bois en automne, Perrot croit déceler une odeur vaguement fétide émanant de la masse gisant sur le sol terreux. Mais il ne jurerait pas que cet effluve qui lui effleure n’est pas le fruit d’un inconscient habitué à anticiper certaines sensations olfactives pas toujours plaisantes.
En se pinçant les narines, Perrot se penche davantage et dégage le visage à l’aide de sa main qu’il a pris soin de glisser dans un gant en latex. La face maculée de boue donne peu d’informations sur l’identité de la victime.
— L’individu me paraît plutôt jeune.
— C’est ce que je dirais aussi, répond le gardien resté en arrière. Une jeune femme.
— Une femme, difficile à dire, murmure Perrot toujours penché au-dessus du corps sans vie.
— Les cheveux longs, commandant.
— À notre époque, ça ne veut pas dire grand-chose.
— Ben, si c’est pas une femme, argue le gardien au physique de demi de mêlée, c’est un homme vraiment petit et mince.
— Ça existe.
— Vous pensez à Lefèvre, là ?
— Je lui dirai comment vous le voyez.
— Oh non, commandant, j’disais ça comme ça !
— Moi aussi, réplique Perrot sur un ton uni.
Il se relève doucement, faisant naître au passage une légère douleur dans son genou droit. Un souvenir d’entorse enfantine qui ne demandera qu’à se raviver au fur et à mesure que l’arthrose se mettra dans ses articulations. « Perspective réjouissante ! Un souci que n’aura pas cet individu… », ironise Perrot avec un sentiment d’impuissance amer.
— Bon, j’appelle les collègues de l’IJ et en attendant, on ne touche à rien. De toute manière, on ne pourra pas faire grand-chose avant qu’il fasse complètement jour.
— On a au moins deux heures à poireauter, alors…
— Je ne vous le fais pas dire. Mais vous pouvez rentrer au service si vous voulez, je vais rester attendre les renforts ici.
— Non, pas question, j’attends avec vous.
— Merci.
N’ayant pas besoin de rester à proximité immédiate du cadavre, les deux hommes rebroussent chemin en écartant les fougères et autres ronces qui s’accrochent au bas de leur pantalon. L’odeur de végétation en décomposition est encore plus prégnante à mesure que l’on s’approche de l’aube, à moins que ce ne soit le déplacement de leur corps dans l’air humide qui leur donne cette illusion.
La porte s’ouvre à la volée, laissant passage à une silhouette étrangement frêle dans son anorak ajusté. Le visage disparaît presque derrière les multiples tours de l’écharpe tricotée d’un point lâche dans une laine à la couleur indéfinissable, entre le marron et le jaune moutarde.
— Je ne connaissais pas encore ce modèle, lance Perrot avec un demi-sourire, la dernière œuvre de maman ?
— Absolument, approuve Lefèvre qui tient deux gobelets fumants à la main et un sachet de viennoiseries tout juste sorties du four. Elle a des doigts de fée, n’est-ce pas ? riposte le capitaine en déposant ses provisions sur le bureau.
— Ou tu dois beaucoup l’aimer, c’est au choix…
— Bon, trêve de blagues à deux balles, pourquoi tu m’as fait venir dès potron-minet ? J’aurais bien pioncé un peu plus, moi.
— Moi aussi, figure-toi, réplique Perrot en étouffant un bâillement réflexe et en s’appuyant contre le dossier de son fauteuil pivotant. On a un macchabée du côté de l’Hippodrome.
— Je t’écoute, fait Lefèvre en se laissant tomber en face de son collègue et ami. Tiens, sers-toi, je suppose que tu as zappé le p’tit déj’…
— En effet, merci, fait Perrot en mordant dans un croissant. J’ai été appelé un peu après cinq heures, un type qui promenait son chien est tombé nez à nez avec un cadavre.
— On a pu l’identifier ?
— Non, pas pour le moment. Pas de portefeuille ou sac à main à proximité. Pas de portable non plus.
— Évidemment, ce serait bien trop facile… La mort a-t-elle été violente ?
— Impossible à dire pour l’instant. Personnellement, je n’ai rien constaté.
— Qu’en dit le légiste ?
— Pas grand-chose. Il a parlé d’une femme, sans doute assez jeune.
— Nue ? Habillée ?
— Habillée, enfouie sous des feuillages et de la terre, répond Perrot en avalant une gorgée de café.
— Pas enterrée, donc.
— Non, pas enterrée.
— Son meurtrier a peut-être été dérangé dans sa besogne… avance Lefèvre en vidant d’un coup son chocolat chaud.
— Ou bien espérait qu’on la trouve.
— Ou s’en fichait éperdument.
— On ne peut que supputer à ce stade.
— On a croisé avec des disparitions de femme récentes ?
— Je te signale que je viens juste de rentrer, Hubert, je ne suis pas une machine.
Lefèvre laisse échapper un rire amusé en écrasant son gobelet avant de viser la corbeille d’une main experte. Le service commence à s’animer, les bureaux s’éclairent les uns après les autres, les imprimantes et autres ordinateurs plus ou moins récents commencent leur ronronnement.
— L’autopsie est programmée à quelle heure ?
— Bascouret nous attend à quinze heures.
— Nous ? feint de s’étouffer le cadet.
— Oui, mon cher, je compte sur ta présence réconfortante.
Lefèvre fait une grimace de dégoût avant de demander :
— Que pense Bascouret pour la date du décès ?
— Il ne se prononce pas catégoriquement, entre un et deux mois environ.
— OK, ça permet de cibler les disparitions. Je vais jeter un œil au fichier des personnes disparues depuis moins de six mois.
— Entendu, je m’occupe du rapport préliminaire.
Lefèvre est déjà sorti et prend la direction de son petit bureau au bout du couloir. Perrot se lève également pour se servir une nouvelle tasse de café avant de se plonger dans la paperasse. La cafetière électrique est pleine sur son socle où rougeoie le bouton marche. Il se remplit une tasse sur laquelle trône un chien habillé en veste de tweed avec monocle sur le museau. Cadeau de son fils pour la dernière fête des Pères. Il sourit en revoyant le gamin si fier de tendre son cadeau « payé avec mes sous ». À ses côtés, Clara avait esquissé la moue un peu suffisante de la sœur aînée qui offre des présents bien plus originaux. Il les a reçus le week-end dernier et ils ont passé un agréable moment ensemble, entre achat de nouveaux tee-shirts pour Clara qui commence à s’intéresser sérieusement à son allure et exposition au Muséum d’histoire naturelle. Il leur a fait des crêpes comme souvent quand ils sont ensemble et a laissé Simon noyer la sienne de sucre en poudre. Un pli d’inquiétude vient soudain barrer le front large du commandant. Clara lui a semblé un peu trop pâle, avec les yeux un peu creux. Il lui a demandé si elle dormait bien et elle a répondu par l’affirmative. Ne se couchait-elle pas trop tard ? « Mais non, papa, tu sais comment est maman ! Tellement à cheval sur les heures de coucher ! » C’est vrai, réfléchit-il, en avalant un peu de café, que Sofia a toujours veillé à ce que les enfants dorment tout leur saoul en période d’école. Même si elle est un oiseau de nuit, toujours prête à accepter quelque invitation qui lui permettra de se mêler à la foule des gens heureux. « Il va falloir que j’en parle à Sofia, je m’étais promis de le faire, mais ça m’est sorti de la tête. C’est peut-être la fatigue normale de l’adolescente qui fait sa poussée de croissance, mais mieux vaut vérifier. » Il se retient de le faire tout de suite, de crainte de l’importuner à l’heure où elle quitte la maison pour se rendre dans l’agence de graphisme parisien où elle travaille. Il ne veut pas qu’elle décroche en conduisant, et puis il n’y a aucune raison de l’inquiéter. Il est en train de terminer la description de l’environnement dans lequel a été trouvé le corps quand Lefèvre réapparaît, la mine réjouie. Il est à présent en sous-pull en acrylique dans les tons bruns dont Perrot pensait qu’il avait été à jamais relégué aux archives des vêtements importables. Aucun enfant normalement constitué de la génération des années quatre-vingt ne penserait encore à enfiler un tel vêtement. Sauf Lefèvre. À croire que l’horloge s’est arrêtée pour lui à l’heure du Manège enchanté et des desserts de La Roche aux Fées…
— On n’a pas plus de six femmes disparues signalées ces six derniers mois.
« Ou comment voir le verre à moitié plein », songe Perrot avec une indulgence quasi paternelle en constatant encore une fois la propension à l’optimisme de son sémillant collègue.
*
Ils viennent d’entrer dans le hall du CHU où s’agitent en une valse étonnamment feutrée blouses blanches, fauteuils roulants et visiteurs à la mine plus ou moins grave. Les deux officiers doivent montrer patte blanche au niveau du rez-de-chaussée puis à nouveau au sous-sol avant d’être autorisés à gagner l’unité médico-judiciaire. Une odeur piquante d’antiseptique et d’eau de javel annonce bien mieux que le panneau à l’entrée du couloir leur arrivée au royaume des morts qui n’ont pas encore gagné le droit au repos éternel. Le corridor sans fin qui conduit aux salles d’examen et aux box réfrigérés est pauvrement éclairé par des néons fatigués qui rendent encore plus blafard le vert d’eau de ses peintures. Le silence au sous-sol contraste avec celui qui régnait à l’étage au-dessus, fait de conversations murmurées entrecoupées par le cliquetis des chariots et le signal de l’ouverture des portes d’ascenseur. Ici, le silence est tout autre, complet, pesant, presque palpable. Sans s’en rendre compte, les deux policiers ont arrêté de parler et avancent en suivant des yeux les rainures du linoléum usé. Mais soudain, le silence se fait moins dense, plus vivant, malgré l’atmosphère sinistre des lieux. Perrot redresse la tête avec curiosité avant de comprendre ce qui a causé ce changement subtil : un doux air de jazz leur parvient, qui filtre à travers la porte entrouverte d’une salle située à l’extrémité du couloir. Ils s’approchent du bureau du médecin légiste Pierre Bascouret avec lequel ils ont déjà eu l’occasion de travailler. Une lampe à abat-jour saumoné diffuse une lumière chaleureuse dans la pièce dénuée de fenêtre et fait ressortir les couleurs chatoyantes des posters exotiques qui tapissent les murs. Aucune photo de famille, cependant, sur le bureau du médecin, comme pour marquer une frontière symbolique entre son foyer innocent et son lieu de travail dédié à l’analyse de l’origine du mal. Perrot avance le buste et salue :
— Bonjour, Pierre, on peut ?
— Ah, entrez, je vous en prie. Je termine un rapport et je suis à vous. Encore un gosse tombé dans la Loire…
— Accident ? demande Perrot en entrant.
— Comme d’habitude, soupire le médecin d’une cinquantaine d’années en apposant sa signature au bas des conclusions. Ça sort en ville après les exams, ça picole, ça s’amuse à se lancer des défis du genre « Cap’ que je monte sur le parapet du pont ! ». On fait ça pour se faire peur ou se faire prendre en photo et c’est la chute. Dans une eau à douze degrés, la survie est de courte durée. Surtout avec un taux d’alcool conséquent dans le sang.
— Et comme les copains sont à peu près dans le même état d’ébriété, renchérit Lefèvre qui a croisé ses deux mains sur ses épaules en un geste frileux ou d’autoprotection, les secours sont appelés trop tard.
— C’est tout à fait ça, opine Pierre Bascouret, l’air navré. Celui-ci avait à peine vingt ans, fait-il en pointant le dossier du menton, disparu depuis plus de trois semaines. Ses proches espéraient encore qu’il avait décidé d’aller voir du pays sans prévenir personne. Mais bien évidemment, un jeune homme sensé et équilibré ne fait jamais ça, n’est-ce pas ? Surtout quand il réussit bien ses études et qu’il a une petite amie.
Perrot hoche du chef silencieusement. À quoi bon faire des phrases quand tout a déjà été dit. Il pense à ses deux enfants pas encore entrés dans l’âge des expérimentations dangereuses et se dit qu’il devra redoubler de vigilance, le moment venu. Mais pourra-t-il vraiment prévenir ce type de débordements lorsque ses enfants seront en âge d’aller et venir à leur guise ? Surtout s’il continue à vivre à quelques centaines de kilomètres de chez eux. À moins, se prend-il à espérer, qu’entre-temps, Sofia ait enfin décidé de déménager en province. Peu probable, hélas. Son ex-femme apprécie tant la vie tumultueuse de la capitale, sa fièvre, son énergie. Mais peut-être que les enfants, une fois le bac en poche, choisiront de venir étudier à l’université de Nantes, auquel cas, il aura le bonheur de les voir plus souvent. Quoique, rien de moins sûr, se dit Perrot avec un soupçon d’amertume, car ils auront certainement passé l’âge de venir faire la bise à papa à tout bout de champ. Il suspend sa réflexion en croisant le regard interrogateur de Bascouret posé sur lui. Celui-ci est manifestement en train de lui poser une question.
— Pardon Pierre, tu disais ?
— Qu’il est temps d’y aller, sourit le légiste en se levant.
— On te suit, fait Perrot en attrapant au fond de sa poche un paquet de chewing-gums à la menthe extra-forte et en plaçant deux dragées sur sa langue. Il tend le paquet à Lefèvre qui se sert avec gratitude tandis que le légiste refuse en précisant :
— Je n’en ai plus besoin depuis bien longtemps !
Par-dessus leurs vêtements de ville, les deux policiers enfilent la combinaison, les sur-chaussures et le calot jetables puis pénètrent dans la pièce d’à côté. Le corps est sur la table carrelée, entièrement dissimulé par un drap vert d’eau. Il fait quelques degrés de moins qu’à côté et les deux officiers ne peuvent réprimer un frisson. À moins qu’il ne s’agisse plutôt d’un frémissement d’appréhension. Ou les deux mêlés. La salle carrelée de blanc du sol au plafond renvoie la lumière crue des néons d’une manière presque aveuglante par comparaison avec l’éclairage tamisé du bureau du légiste. Ce dernier ne semble nullement incommodé par le changement brutal de luminosité. Également vêtu de la tenue réglementaire, il est déjà en action, allant et venant dans ses sabots en plastique aussi silencieusement qu’un danseur classique évoluant sur la scène. Son assistant a préparé tous les instruments de travail sur le chariot en inox rutilant : scies, scalpels, leviers, pinces, cuvettes, morceaux de ouate. Après un bref hochement de tête à l’adresse des deux policiers, le médecin soulève délicatement le drap et dévoile la dépouille. Une vague de dégoût submerge les visiteurs à la vue du corps à la peau d’un marron presque rougeâtre et à l’abdomen renflé sous l’effet des gaz produits par la putréfaction.
— J’ai déjà procédé à l’inspection externe, précise le médecin en désignant la jeune femme.
— Vos premières conclusions ? demande Lefèvre sans s’approcher de la table de dissection.
— Nous ne parlons jamais de conclusion à ce stade, riposte Bascouret en s’adressant volontairement à Perrot plutôt qu’à son impatient équipier.
— Vos suppositions, alors, Monsieur le médecin spécialiste du service médico-légal du CHU de Nantes.
— J’aime mieux ça, Monsieur le capitaine, sourit Bascouret en s’adressant cette fois au cadet. Disons que le corps paraît intact à première vue.
— Façon de parler, s’étrangle Lefèvre en regardant à la dérobée le corps putréfié sur lequel les asticots ont prélevé leur dû depuis un temps certain.
Le visage de la morte est méconnaissable avec ses yeux béants dont la couleur est à présent totalement uniforme. La peau, ou plutôt ce qu’il en reste, est tendue en lambeaux accrochés aux reliefs du squelette. Les cheveux longs forment un lit de broussailles autour du visage aux pommettes trop saillantes. Le corps est élancé, les muscles longs affleurent à travers les fragments d’épiderme. Le corps mince offre une apparence repoussante, pourtant Perrot sent son œil irrésistiblement attiré par un détail. Il s’approche un peu plus et étrécit la paupière pour mieux voir l’extrémité des doigts d’une main dont les phalanges ne sont plus protégées par le derme.
— On dirait du vernis à ongles, n’est-ce pas ?
— Bien vu, Jean-Louis, les ongles étaient effectivement maquillés, ce qui nous confirme, si besoin était, que nous avons bien affaire à un individu de sexe féminin.
— Tout le monde peut se maquiller, ronchonne Lefèvre par-derrière, sur le ton du sale gosse qui n’a pas apprécié d’être mouché par son professeur.
— À chacun ses pratiques, en effet, persifle le médecin en se retournant vers le plus jeune. Libre à vous de…
— C’est bon, passons, le coupe Lefèvre en s’éloignant un peu plus et en mâchant furieusement son chewing-gum…
— Tu penseras bien à prélever un échantillon du vernis ? s’inquiète Perrot.
— Sois sans crainte, Jean-Louis, ce sera fait. Selon mes premières observations, la mort remonte probablement à trois semaines, peut-être plus, mais vraisemblablement pas moins. C’est l’examen bactériologique et entomologique qui nous en dira plus.
À ces mots, Lefèvre étouffe un haut-le-cœur, arrachant au légiste un sourire en coin. Imperturbable, celui-ci poursuit :
— Je pourrai donner une indication assez précise de l’âge de la victime une fois son squelette débarrassé du derme et nettoyé. Une fois aussi que les radios auront été faites.
— Ce qui nous amène à quand ? demande Perrot d’une voix qu’il voudrait moins pressante.
— Après-demain matin, si tout va bien. Mais je peux d’ores et déjà vous dire que l’individu est de type féminin, voyez comme l’os iliaque est étroit, et d’un âge adulte compris entre vingt et quarante ans environ. La marge est grande, je vous l’accorde, mais pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Type caucasien. Bien, allons-y maintenant, fait-il en attrapant la scie sur le chariot métallique.
Les deux officiers se sont retranchés vers l’entrée de la salle, attendant que le médecin ait pratiqué les incisions permettant d’avoir accès aux organes internes de la victime. Au fur et à mesure des prélèvements, le médecin commente à haute voix ses gestes pourtant explicites. Mais c’est comme si cette description inutile permettait de donner un semblant d’humanité à une scène autrement parfaitement inhumaine. Quelques minutes plus tard, il tourne la tête en direction des policiers et, ses bras gantés toujours au-dessus de la dépouille, indique :
— Il s’agit bien d’une femme très jeune, je dirais entre vingt et trente ans. Elle était en bonne santé : cœur, foie, reins sains, pas d’artérome. Poumons sains : elle n’était pas fumeuse.
— Des signes distinctifs ? Fractures, cicatrices ?
— Étant donné l’état du derme, réplique le médecin en se penchant à nouveau au-dessus du corps, impossible de voir la moindre cicatrice. Pour les fractures, rien d’évident à l’œil nu, mais cela n’exclut pas que les radios nous en révèlent. En revanche, je peux vous certifier qu’il y avait un début de grossesse.
— À quel terme ?
— Récent, entre dix et quinze semaines, je dirais.
— Et pour les causes de la mort ? ne peut s’empêcher de demander Lefèvre.
— Probablement un coup mortel porté à l’abdomen, approchez voir…
Les deux policiers s’exécutent avec réticence et suivent des yeux la direction pointée par le doigt recouvert de latex.
— Ce n’est pas flagrant pour un œil non exercé, mais il n’y a pas de doute possible : la victime a reçu un coup violent au ventre.
Perrot et Lefèvre essaient de déceler dans la masse informe qui gît sur la table d’examen ce qui pourrait ressembler à la marque d’une lésion profonde. En vain. Les chairs malmenées refusent de livrer leur secret aux deux policiers pourtant expérimentés. L’expertise de Bascouret est absolument indispensable pour déchiffrer l’illisible. Le légiste continue :
— La victime a reçu un coup violent qui a provoqué une entaille profonde des tissus et de la cavité abdominale.
— Et le fœtus alors ? demande Perrot d’une voix blanche.
— J’allais y venir, fait le médecin en gardant les mains en l’air tel un marionnettiste sinistre, tout en rétroversant légèrement le bassin avec une grimace. Ces stations prolongées debout, ça me tue… ajoute-t-il en soupirant.
Il s’interrompt en s’entendant prononcer cette expression malvenue puis reprend :
— La cavité a été vidée de son contenu.
— Quoi ! ne peut s’empêcher de s’exclamer Lefèvre en scrutant la dépouille dans le vain espoir d’y voir quelque chose de précis.
— C’est comme je vous dis. L’utérus déformé est sans conteste celui d’une femme enceinte, mais il n’y a plus de fœtus à l’intérieur.
— Elle aurait pu avorter peu avant sa mort ?
— Elle aurait pu, mais non, elle ne l’a pas fait. Sinon, la cavité utérine ne présenterait pas ce volume caractéristique.
— Le fœtus aurait été prélevé à quel moment ? s’enquiert Perrot d’une voix sourde, priant intérieurement pour que son imagination ne lui donne pas raison.
— Après le décès, prononce le légiste d’une voix assurée. Dieu merci ! ajoute-t-il en dessinant un improbable signe de croix en l’air.
Un sentiment de soulagement envahit Perrot. Au moins, cette victime n’aura pas subi le pire des outrages qu’on puisse imposer à une femme. Il se recule en direction de l’entrée de la salle et va s’adosser au chambranle, suivi de Lefèvre. Bien que de dos, le médecin a été sensible au déplacement d’air provoqué par le mouvement des policiers. Il prononce à leur intention :
— Vous pouvez y aller, le reste de l’examen ne nous apprendra rien de nouveau. Je vous tiens au courant pour la suite…
— Merci beaucoup, Pierre, et bonne fin de journée ! lance Perrot en tournant les talons.
Lefèvre a bougonné deux mots qui étaient peut-être un salut. Les deux collègues reprennent le couloir en sens inverse, à une allure bien plus rapide qu’à l’aller. Parvenus sur l’esplanade devant l’entrée principale du CHU, ils s’autorisent une pause, le temps de renouveler l’air fétide accumulé dans leurs poumons. Le ciel que le soleil n’a pas daigné honorer de ses rayons un seul instant, commence déjà à s’obscurcir. Deux ambulances s’arrêtent à leur niveau et, sans arrêter leur moteur, aident leurs patients à descendre. Un infirmier de l’hôpital vient à la rencontre du premier véhicule sanitaire et escorte un vieux monsieur appuyé à sa canne anglaise jusqu’à l’intérieur du bâtiment. Le couple de l’autre ambulance salue le conducteur et s’éloigne sans aide jusqu’au bâtiment blanc. La femme d’une soixantaine d’années tient le coude de son mari et porte un petit sac à la main. Ils discutent paisiblement tandis qu’ils se dirigent vers l’accueil. « Rien de grave pour ces deux-là… », se dit Perrot que cette idée réconforte un peu après l’épreuve de l’autopsie.
De retour au service, Perrot passe faire un compte rendu des premiers éléments de l’enquête au commissaire Law occupé à parcourir un épais dossier ouvert sur son bureau. Un mug à l’effigie de la reine mère est rempli d’un thé au lait qui achève de refroidir.
— C’est vous, Jean-Louis ? l’accueille-t-il en levant un visage agréable marqué par la couperose de l’Anglais à la peau trop fine. Du nouveau ?
Il a prononcé « dou » à la place de « du » car, même après plus de quinze ans passés en France, il ne s’est toujours pas départi d’un accent furieusement marqué qui méprise les « r » et snobe les « u ».
— On rentre à l’instant du CHU où on vient d’assister à l’autopsie de la victime de l’Hippodrome.
Law ne peut refréner une grimace compatissante.
— Il s’agirait d’une jeune femme, entre vingt et trente ans, disparue il y a environ trois semaines.
— On wisque de twouver un gwand nombwe de disparues, non ?
— Sauf que celle-ci était enceinte. Et que le fœtus a été extrait de son utérus.
Le père de quatre filles a un haut-le-cœur à l’énoncé de ce détail.
— Vous voulez dire que…
— Non, le fœtus a été sorti après la mort.
— Thank God ! soupire Law en secouant une tête navrée. Du coup, le champ des possibilités est plus restreint.
— Lefèvre est en train de consulter la liste des personnes disparues depuis moins d’un mois en Loire-Atlantique.
— Elle peut venir d’ailleurs, fait Law en portant sa tasse à ses lèvres avant de la reposer avec une mine dégoûtée en constatant que la boisson a refroidi.
— Évidemment, acquiesce Perrot en tournant les talons.
Huit mois plus tôt
« J’y suis. »
« Moi aussi, merci. »
« Bonne route ! »
« À vous aussi. »