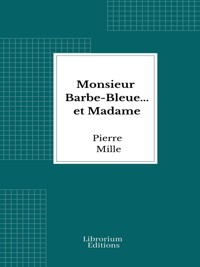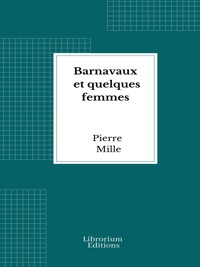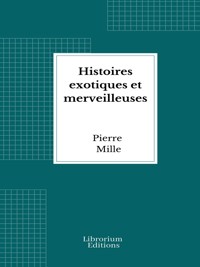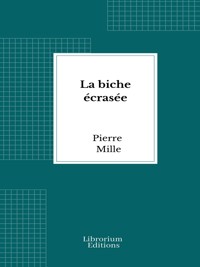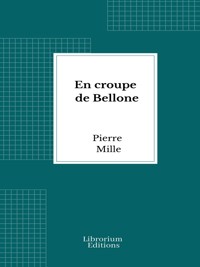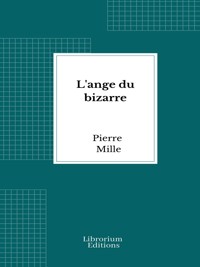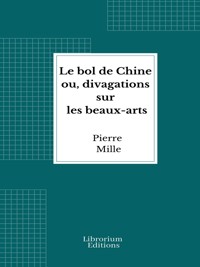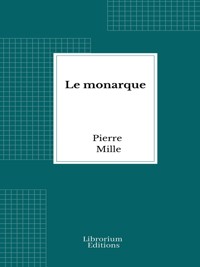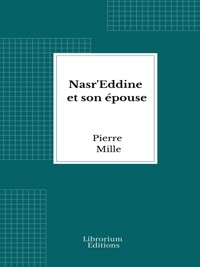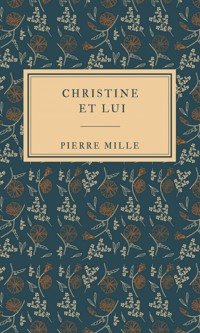
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
C'est dans un monastère que j'entendis, pour la première fois, parler d'amour. Je n'avais pas dix ans. J'imagine que j'aurais aujourd'hui entièrement perdu la mémoire de cette conversation en soi bien insignifiante, ce qu'elle pouvait avoir de scabreux restant voilé sous les termes les plus décents dont puissent user des personnes accoutumées à surveiller leur langage, si le souvenir n'en était demeuré attaché aux suites de la misérable aventure sentimentale — la seule, hélas ! de mon existence — qui va faire l'objet de ce qu'on va lire. Je crois par ailleurs devoir signaler que je n'ai écrit ces pages qu'avec une timidité, un découragement qui sans cesse ont grandi au lieu de diminuer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PIERRE MILLE
CHRISTINE ET LUI
AVANT-PROPOS
Il importe qu’on en soit averti : je n’aurais pas dû signer ces pages, n’ayant pas changé un moi au manuscrit que les dernières volontés de son véritable auteur ont mis entre mes mains. Je n’ai fait qu’attribuer des noms de fantaisie aux personnages, et — mon devoir d’écrivain m’impose cet aveu — m’efforcer de dérouter le lecteur en transportant dans une autre partie de la France le récit des événements.
Que je ne sois pour rien dans ce qu’on va lire, ceux qui par hasard ont jeté les yeux sur quelques-uns de mes modestes ouvrages s’en apercevront bien vite. Ce n’est point mon habituelle manière d’écrire, ni même de penser, de montrer les hommes, les femmes, les choses, de les apprécier. En réalité, il s’agit des « Mémoires » authentiques d’un homme dont seul le véritable nom n’apparaîtra pas ici, et d’un drame qui fut réellement vécu et souffert — à la fois assez ordinaire et pourtant, à mon avis du moins, singulièrement cruel.
Il m’eût été facile de rendre la composition moins lâche en plusieurs endroits, de supprimer des passages qui détournent l’attention des péripéties principales, de corriger certaines faiblesses de style, d’atténuer en revanche la violence, que je ne saurais me dissimuler pénible, de quelques épisodes. Mais cela m’est interdit par le testateur, que le hasard m’avait fait rencontrer une première fois, il y a bien longtemps, dans l’autre hémisphère.
« Les choses sont telles que je les ai dites » m’a-t-il imposé dans un codicille péremptoire. « Qu’on les dise telles que je les dis, ou qu’on ne les dise point. »
Je ne pouvais que me soumettre à cette exigence. C’est donc celui que je me suis permis d’appeler Frédéric Lemore, et non pas moi, qu’on va entendre.
CHRISTINE ET LUI
PREMIÈRE PARTIE
J’ai faim, mais je ne puis pas manger avec la bouche.
MATHIAS CRISMANT.
C’est dans un monastère que j’entendis, pour la première fois, parler d’amour. Je n’avais pas dix ans. J’imagine que j’aurais aujourd’hui entièrement perdu la mémoire de cette conversation en soi bien insignifiante, ce qu’elle pouvait avoir de scabreux restant voilé sous les termes les plus décents dont puissent user des personnes accoutumées à surveiller leur langage, si le souvenir n’en était demeuré attaché aux suites de la misérable aventure sentimentale — la seule, hélas ! de mon existence — qui va faire l’objet de ce qu’on va lire. Je crois par ailleurs devoir signaler que je n’ai écrit ces pages qu’avec une timidité, un découragement qui sans cesse ont grandi au lieu de diminuer. Je ne suis pas un écrivain de profession. Je ne sais ni composer un livre, ni inventer des épisodes. Durant trente années de ma vie, dans des pays barbares, bien loin du ciel d’Europe, je n’ai jamais rédigé que des rapports administratifs. Et peut-être à cette heure que me voilà vieilli, oisif, ai-je cédé à ce sentiment dont il advient si souvent qu’il prête à rire, et qui jette tant de femmes à se vanter : « Si je vous contais mon histoire, quel roman vous en pourriez faire ! » Sur quoi, de s’épancher en confidences qui n’ont d’intérêt que pour elles-mêmes.
Tout ainsi, me relisant le soir sous la lampe, dans mon amère solitude, je me prends à songer : « Pauvre homme, tu es fou ! Il n’y a rien dans tout cela, rien qui puisse d’aucune façon susciter la sympathie ni la curiosité, même du lecteur le plus indulgent. C’est l’histoire de quelqu’un qui a été « mal commencé ». A l’instant que tu n’étais pas encore-tout à fait sorti de l’adolescence, tu fus privé de ta capacité d’aimer. Conservant toutefois ta vigueur virile, tu as été comme châtré sinon de ta sensibilité, du moins de la sorte de courage qu’il faut pour l’oser montrer. Qu’est-ce que cela peut faire aux gens ? »
Et puis, à d’autres moments, tout cela, qui sans doute est si peu de chose, me paraît malgré tout exceptionnel, poignant, atroce. Alors je prends mon courage à deux mains, j’écris pour qu’on juge, et qu’on me juge...
***
Tous les samedis soir, à cinq heures, ma mère m’emmenait avec elle en visite chez Mme de Versoris, au couvent des Dames de la Sainte-Plaie. J’ignore quels étaient les rites particuliers de cet ordre, les règles de ces religieuses. Je n’ai jamais qu’entrevu, dans les étroits et longs corridors, leur éblouissante robe de bure blanche, toujours immaculée, éclaboussée d’une tache écarlate. Elles nous devançaient en silence, ou se dissimulaient bientôt, je ne sais où, semblant fuir le contact des personnes, même de leur sexe, qui continuant de mener la vie du siècle en apportaient avec elles le parfum délétère. Dès que la sœur tourière, sœur Sainte-Marthe, petite femme ronde et alerte qui souriait toujours, parlait toujours abondamment, gardant les mains croisées sur sa poitrine, nous avait ouvert la porte, nous montions au quartier des Dames pensionnaires.
Elles étaient une vingtaine, presque toutes portant des noms fort aristocratiques « ayant au moins un manche à ce nom » comme disait ma mère : c’est-à-dire qu’elles étaient « de » quelque chose. Et Mme de Versoris jouissait, dans cette société, d’une considération particulière, du fait de ses revenus, assez minces, mais plus considérables toutefois que ceux des autres pensionnaires, ordinairement presque pauvres — du fait aussi qu’elle était « chanoinesse » de je ne sais quel chapitre qui exige, pour qu’on ait le droit d’en faire partie, je ne sais plus combien de quartiers de noblesse. On disait « madame de Versoris » encore qu’elle fût demoiselle : il paraît que c’est ainsi qu’on doit s’adresser aux chanoinesses. Du reste, ayant eu, à l’époque du second Empire, une période d’éclat où l’on disait qu’elle n’avait pas dédaigné d’user de ses charmes. On ne lui en tenait pas rigueur. Le respect où elle était tenue n’était dépassé que par celui qu’on professait pour la vieille vicomtesse de Masparault, laquelle, de façon quelconque, était alliée à la famille royale de Bourbon.
Le protocole, au cours de ces réceptions du samedi chez Mme de Versoris, était invariable. Ce qu’on appelait « la cellule » de la chanoinesse apparaissait en réalité une pièce assez vaste, séparée en deux par une courtine de velours grenat. Derrière cette courtine se trouvait le lit, à ce que je suppose, n’ayant jamais été admis, non plus qu’aucun des visiteurs, à pénétrer jusque là. Du côté « salon », si je puis employer cette expression, on voyait, rangés en demi-cercle devant la cheminée, un assez grand nombre de fauteuils, et deux chaises. Mme de Versoris siégeait sur le fauteuil le plus rapproché de la cheminée, à droite, et gardait cette place jusqu’à l’arrivée de la descendante, ou de l’alliée, des Capétiens, Mme de Masparault, à qui elle la cédait avec une révérence. Elle s’allait alors asseoir dans le fauteuil de gauche. Les autres étaient réservés à Mme de Crucé, à Mme de Pigenat, à Mme de Sourdonnet... J’ai oublié le nom de celles qui venaient ensuite dans cet ordre de préséance. Les deux chaises revenaient à ma mère, d’évidente roture, puisqu’elle s’appelait Mme Lemore tout bourgeoisement née Despringes, et à Mme Octave Havry, désignée d’ordinaire seulement comme « madame Octave », pour la distinguer de sa belle-sœur, Mme Théodore Havry, la femme du médecin.
Pour moi je n’avais qu’un tabouret, près de la table où m’attendaient l’album de photographies de Mme de Versoris et un volume dépareillé des Veillées des Châteaux. Aux premières feuilles de l’album brillaient le portrait de Sa Majesté Henri V, comte de Chambord, avec sa signature autographe, et celui du roi de Hanovre, derrière lequel se tenait, avec déférence, un parent fort titré de la chanoinesse. Mme de Versoris se vantait que, fonctionnaire du ministère des Beaux-Arts sous Napoléon III, — accepter cet emploi d’un usurpateur n’était pas, disait-elle, ce qu’il avait fait de mieux, — ce parent avait reçu du souverain dépossédé une décoration pour lui avoir fait visiter le Musée du Louvre : distinction qui m’a toujours paru d’autant plus méritée que, à ce qu’assurait la chanoinesse, et me fut confirmé depuis, ce monarque était aveugle.
Les Veillées des Châteaux m’intéressaient beaucoup plus que les photographies. Il y régnait un certain Raoul de Navéry, auteur d’un roman sur les Fénians irlandais, héroïques incendiaires, qui me semblait le comble du dramatique. J’étais donc, ce jour-là, fort absorbé par les exploits de ces Fénians, lorsque Mme de Masparault fit son entrée, en retard sur tout le monde, selon son usage habituel et ses intentions bien délibérées : ceci obligeant les personnes admises à ce petit cénacle à se lever, et Mme de Versoris à lui offrir son fauteuil. Elle marquait ainsi les distances, y tenant d’autant plus que sa médiocrité de fortune les lui faisait paraître plus chères : sa cellule n’avait pas les dimensions de celle de Mme de Versoris, et l’on disait que les Dames de la Sainte-Plaie, en raison de ses origines ainsi que de recommandations toutes spéciales et pressantes de Rome, lui faisaient grâce d’une partie du prix qu’elle aurait dû acquitter pour sa pension.
Mme de Masparault était une petite vieille, mince, droite, si alerte que, derrière elle, ne voyant que sa taille et sa démarche, on aurait dit d’une jeune femme. De face, toute sèche et fâcheusement ridée. Du reste habillée, de la façon la plus bizarre du monde, d’une jupe de soie noire, si vaste qu’elle faisait songer à la crinoline, disparue depuis dix bonnes années, et encore élargie par une infinité de volants. Ces volants, autour d’elle, s’agitaient, bruissaient comme avec une conscience valeureuse de la haute naissance de celle qui les portait. Sur sa poitrine plate, par-dessus une sorte de gilet violacé, aux boutons en cailloux du Rhin, une jaquette indescriptible, ou plutôt une sorte de sac, en soie noire également, ouverte sur le devant. Aux pieds des souliers plats d’étoffe mérinos. Rien de tout cela ne m’étonnait. Ce n’est qu’à cette heure que j’en distingue l’étrangeté comique. Mais ce qui me remplissait de stupeur, c’était son chignon postiche, un chignon de la couleur des cheveux blonds qu’elle avait eus jadis, posé avec assurance sur ce qui lui restait de cheveux devenus d’un gris cendré — et, dominant altièrement cette coiffure, un invraisemblable petit bonnet de dentelles, blanches ou noires suivant les jours, en forme de diadème. Mais aucune de ces dames n’eût osé suggérer qu’elle avait l’air ainsi d’un épouvantail à moineaux : la majesté de son port, qu’elle avait grand, la défendait contre l’audace injurieuse de cette appréciation.
S’étant avancée, puis assise avec son alacrité habituelle, tout de suite, elle s’empara de la conversation.
— Vous ne sauriez soupçonner, dit-elle, l’édifiante, la sainte nouvelle que je viens de recevoir de ma famille de Belgique. Mon jeune et charmant cousin, le marquis Amédée...
— Cet intéressant jeune homme, se permit d’interrompre Mme de Versoris, dont vous nous avez récemment annoncé les heureuses fiançailles...
— ...Avec une des filles de ma vieille amie, la duchesse de Bavy-Pontville. Je vous ai dit qu’ils s’adoraient... Non pas même un mariage d’inclination, un mariage d’amour. D’amour ! Ils s’aimaient depuis leur enfance... Eh bien ! au sortir de la messe de mariage, sacrifiant au ciel son affection terrestre, Gertrude de Bavy-Pontville est entrée aux Carmélites !
— Sans que le mariage fût consommé ?
— Sans que le mariage fût consommé, bien entendu.
— Et le mari... enfin celui qui devait être son mari, et qui l’est, après tout, devant la loi et devant l’Église, qu’est-ce qu’il a dit de ça, le mari ?
— C’est ce qu’il y a de plus beau, de plus touchant... Il entre aussi dans un couvent, il prononcera les vœux les plus austères... Il paraît que les deux jeunes gens étaient d’accord sur ce point depuis longtemps. La divine lumière de la grâce les a éclairés ensemble.
Mme de Pigenat, déférente, prit la parole un instant pour rappeler que, dans sa famille, deux jeunes mariés, sans pousser si loin l’abnégation, étaient entrés en retraite le soir de leurs noces, chacun de son côté. Le reste du cercle garda un silence respectueux, mais dubitatif.
— ...Eh bien, coupa avec résolution la chanoinesse, je ne comprends rien à cette histoire-là !
— Vous ne comprenez pas ? — interrogea Mme de Masparault qui ne s’attendait guère à rencontrer de contradiction — qu’est-ce que vous ne comprenez pas ?
— Le mariage est aussi un sacrement, je pense, répliqua la chanoinesse. Est-ce que ce n’est pas se moquer du Bon Dieu d’y avoir recours, et puis de dire tout de suite après : « Non, décidément, je ne m’en servirai pas ! » Si l’on veut se faire religieuse ou moine, qu’on se fasse religieuse ou moine, je n’y vois pas d’inconvénients. Mais si l’on se marie, qu’on se marie, ma foi, avec toutes les conséquences que la chose — et le sacrement, je le répète, le sacrement ! — impliquent de façon habituelle — je dirai nécessaire !
— Oui, oui, osa intervenir à son tour Mme de Crucé, dont le mari, je l’ai su plus tard, passait cependant pour la tromper avec des « créatures », et l’eût rendu fort malheureuse si elle n’avait opposé à son infortune une assez souriante égalité d’humeur — oui je trouve que ce n’est pas très bien... Parce que...
— Parce que ?... interroge Mme de Masparault.
— Parce que, fit Mme de Crucé, n’hésitant pas à faire appel à des souvenirs pour elle déjà lointains, les premiers jours du mariage sont si agréables !
— Supportables, en tout cas, admit Mme de Pigenat.
— Il y a encore ça ! dit la chanoinesse. Je n’y avais pas pensé. Il est vrai que je suis demoiselle...
Elle souriait, de façon un peu gourmande, peut-être reprise par certaines rêveries. Et maintenant que je tente de ressusciter cette scène, je crois me rappeler la tendre émotion qui plana un instant sur toutes ces femmes, toutes honnêtes, parfaitement honnêtes, presque toutes d’un âge incertain, ou même certain, à l’exception de ma mère et de la jolie Mme Octave, qui n’avait pas vingt ans alors, et si fraîche ! Elles évoquaient ces premières révélations du plaisir, de la volupté, qui depuis les avaient tant déçues, mais qui leur étaient restées chères, qu’elles avaient serré dans leur cœur, dans leur sensibilité, comme un trésor. Ce dut être une précieuse minute, délicate et subtile. J’étais trop jeune pour en saisir la beauté, la rareté. Pourtant, je concevais de manière confuse et forte qu’il y avait dans l’air quelque chose de triste et de charmant, je ne savais quoi...
Mais c’était ici l’inverse de l’usage dans les conseils de guerre : aux plus jeunes, et surtout aux non titrées, on ne demandait leur avis qu’en dernier lieu.
— Moi, je n’aurais pas fait ça, déclara ma mère. Je suis de l’avis de madame la chanoinesse.
— Et vous, madame ? demanda Mme de Versoris à Mme Octave.
Mme Octave, durant tout ce débat, qui avait pris si singulièrement, dans un tel milieu, l’aspect d’une cause discutée en Cour d’Amour, était demeurée comme plongée dans un rêve pénible. Je le sentais par d’insaisissables effluves, malgré mon âge, éprouvant pour elle une sympathie confiante, le besoin de me rapprocher de son corps léger, d’obtenir une caresse de sa main, un regard de ses yeux. Elle répondit en frissonnant.
— Je... je ne sais pas... Ils ont peut-être bien fait !
Prête, semblait-il, à ajouter autre chose, elle s’arrêta dans un trouble qui l’agitait visiblement.
— A la bonne heure ! proclama la vieille Mme de Masparault, heureuse de cette alliée.
Mais les autres étaient un peu choquées. Certes, toutes n’avaient, pas rencontré, dans leur ménage, le bonheur parfait. Quelques-unes n’y avaient trouvé nulle joie. Elles eussent cependant estimé de mauvais ton de l’avouer ; et, quand on appartient à la confrérie, on se doit de la défendre. La petite Mme Octave, écrasée sous le blâme muet qui pesait sur elle, en ressentait plus que de l’embarras, une sorte de honte, quelque chose comme le sentiment d’une faute. Elle prit congé bientôt, alléguant une course indispensable avant de rentrer chez elle.
— Bizarre opinion chez une jeune mariée ! ne put s’empêcher de souligner, après son départ, la bonne Mme de Sourdonnet elle-même.
— D’autant plus que si une femme peut se vanter d’être bien tombée... remarqua Mme de Pigenat.
— Oui, crut devoir confirmer Mme de Crucé, il n’y a rien à dire contre M. Octave. Pas la plus petite chose. Opinions religieuses et politiques, conduite, tout est irréprochable. On dit qu’il est du tiers-ordre.
— Vous savez, observa gaiement Mme de Versoris, il y a des gens comme ça bien ennuyeux.
— Chère madame, corrigea sévèrement Mme de Masparault, M. Octave Havry est le modèle de tous les hommes, de tous les maris, de tous les chrétiens. Sa réputation là-dessus est bien établie. C’est à cause de lui que j’ai consenti à entretenir des relations avec sa femme, qui n’est pas née, qui n’est pas d’ici, dont j’ignore les tenants, les aboutissants...
— Mon Dieu, moi aussi ! concéda la chanoinesse.
***
Quelques jours plus tard, sous les fenêtres de la pièce qui servait à mon père de bureau et de bibliothèque, je jouais avec les fourmis. Il y en avait un nid logé entre le plâtras de la muraille et les moellons. Je déposais sur le sol, à leur portée, de tout petits morceaux de sucre, qu’elles emportaient précipitamment dans leur retraite. Selon moi, j’avais fait de la sorte alliance avec elles, et elles reviendraient, la nuit, piquer la cuisinière que je n’aimais pas, et même, à l’autre bout de la ville, M. l’abbé Chéramour, le vicaire de la paroisse Saint-Blaise, qui trois fois par semaine me donnait des leçons de latin.
Mon père écrivait ou lisait, je ne me rappelle plus, ou je n’y ai pas fait attention. Les vantaux de la fenêtre qui donnait sur le jardin s’écartaient largement pour laisser passer la tiédeur du vent d’été. La porte du bureau s’ouvrit, je reconnus la longue figure de haquenée, le teint de beurre de cuisine, comme disait Adèle, notre femme de chambre, de Mme Havry, la femme du docteur Havry, la belle-sœur de Mme Octave. Cela ne me surprit point. Depuis trois jours, Mme Havry venait à la maison tous les après-midi, et s’enfermait avec mon père, sans « faire de visite », c’est-à-dire sans demander à voir ma mère, ce qui me surprenait un peu : les petits garçons élevés d’une certaine façon remarquent, dans l’existence quotidienne, tout ce qui sort des usages qu’ils ont accoutumé de voir.
Elle retira ses gants d’un geste machinal ; je crus distinguer que ses mains tremblaient singulièrement. Mais ce fut d’un ton net, glacé, d’un timbre très haut, comme si elle récitait une leçon, qu’elle prononça :
— C’est fini !... Il est mort ! On peut aller voir, maintenant, je suis sûr qu’il est mort !
Je ne distinguai pas la réponse de mon père, dont la voix était plus sourde. Mais il s’était levé en sursaut, son visage était bouleversé. Mme Havry continua de la même voix coupante, décidée :
— ...Eh bien, oui, n’est-ce pas ?... Après ce que vous m’avez dit hier, c’est ce qu’il avait de mieux à faire.
Alors mon père cria — et cette fois j’entendis :
— Comment ! Comment ! Vous lui avez répété ? Vous avez eu la cruauté, vous avez eu l’infamie de lui répéter ?...
Il se dirigea vers la fenêtre pour la fermer ; et, discernant à quelques pas ma petite silhouette mince, fronça les sourcils. Pourtant ce fut assez doucement qu’il ordonna :
— Va jouer plus loin, mon petit Frédéric. Je t’ai déjà dit que je n’aime pas que les enfants fassent du bruit près de moi quand je travaille.
J’avais conscience de n’avoir fait aucun bruit, et que c’était cela, au contraire, qui m’était implicitement reproché. D’ailleurs la plupart de mes jeux étaient d’ordinaire silencieux, intérieurs, presque immobiles. Mais je m’éloignai, avec obéissance. Même, pour avoir l’air d’obéir plus exactement encore, je rentrai dans la maison, passai dans la cour, par le salon et le vestibule, sous prétexte d’aller « causer » avec Diane, la chienne qui y était à l’attache. En réalité, j’étais grandement troublé et dévoré de curiosité. Je ne m’étais jamais connu aucune affection pour cette Mme Havry, qui me semblait dure, laide — méchante, pour employer le mot dans lequel les enfants concentrent une foule d’impressions confuses. Et j’étais absolument convaincu qu’elle avait tué son mari, le médecin, que c’était cela qu’elle était venue confesser. Pourtant je n’éprouvais pas trop d’horreur pour elle, l’idée de la mort étant restée pour moi assez vague et comme littéraire. Je ne pouvais me figurer que les morts fussent tout à fait morts, j’étais disposé à croire qu’ils ne meurent que pour un temps, peuvent toujours ressusciter... C’est peut-être en raison de cette incapacité à concevoir pleinement la réalité implacable et définitive des choses que les impressions des petits d’homme sont si vives au cours de leurs premières lectures ainsi qu’au théâtre, si passagères dans la vie courante. Je voulais donc revoir, ne fût-ce qu’un instant, cette Mme Havry qui portait avec elle un si grand secret, un secret que mon père avait estimé si terrible. Je crois que j’attendis encore près d’une heure. Enfin, elle traversa la cour, la figure tirée, blême dans le jaune maigre de ses joues, mais apparemment impassible, comme si elle avait pris, une fois pour toutes, la résolution de fouler aux pieds tout jugement qu’on pouvait porter sur elle. Mon père, contrairement à toutes ses habitudes, ne l’avait pas reconduite. Ce fut moi qui lui ouvris le battant de la porte cochère. Je ne sais quoi — politesse apprise de petit garçon bien élevé, ou besoin d’échanger au moins une parole avec une personne que je savais chargée d’un mystère tragique — me poussa à lui demander :
— Émile et Jacques vont bien, Madame ?
C’étaient ses deux fils, qui avaient à peu près mon âge. Comme sortant d’un rêve, elle eut un sursaut et répliqua :
— Très bien, mon petit, très bien... oui, oui, très bien, grâce à...
Elle ne finit pas « grâce à Dieu ». Quelque chose avait étranglé dans sa gorge cette formule si banale.
Mon père sortit quelques minutes plus tard. Pour moi, à quatre heures, la femme de chambre me conduisit à la paroisse pour les examens de catéchisme. J’étais absorbé, soucieux, je tenais la main de la bonne. Tout à coup, je murmurai, à demi-voix, mais important :
— Il est mort quelqu’un, tout à l’heure !
Adèle lâcha ma main.
— M. Havry, fit-elle. Comment le sais-tu ?
A cela, je ne répondis pas. Je ne voulais pas avouer que j’avais surpris le début d’une conversation qui avait eu lieu dans le cabinet de mon père. J’interrogeai :
— Comment est-il mort ?
Ce fut au tour d’Adèle de ne rien répondre, sinon que c’étaient des choses qui ne regardent pas les enfants. Mais toute la ville déjà savait la nouvelle ; Adèle même était dévorée du désir d’en parler. Elle s’arrêta chez M. Colombat, l’épicier de la Grand’Rue, récemment rebaptisée rue Thiers, sous couleur de commandes pour la maison. D’abord ce ne furent que des chuchotements. Puis l’épicier, malgré lui, éleva la voix.
— Oui, dit-il, c’est sûr qu’il s’est enfermé dans son cabinet de consultation, en ouvrant tout au large la clef du robinet de sa cheminée à gaz. Même qu’il avait collé du papier autour de la porte et sur la fenêtre, pour que l’asphyxie aille plus vite, et qu’il a envoyé en course les deux domestiques, la bonne et la cuisinière. Les enfants étaient à la pension.
— Mais elle, Mme Havry ? demanda Adèle.
— Oh ! elle savait !... Puisqu’ils avaient décidé ça ensemble, qu’elle l’a conseillé, poussé. Et je sais, moi, je sais qu’elle a raconté à M. le Maire, quand elle a été l’avertir d’envoyer le commissaire et un médecin pour constater le décès, qu’elle allait de temps en temps lui causer à travers la porte. Elle disait : « Souffres-tu ? » Et lui répondait : « Non, pas du tout, je m’endors... » Elle n’a été prévenir que quand elle n’a plus rien entendu, pas même un râle. Et, figurez-vous, pendant qu’il agonisait, elle est remontée au premier pour compter son linge.
— Sans elle, il n’aurait jamais eu le courage de se périr, déclara Adèle.
— Ça, fit l’épicier, c’est aussi certain que voilà des lentilles à la devanture.
— On devrait lui couper la tête, comme aux assassins.
— Si je vous conseillais de vous suicider et que vous le fassiez, raisonna M. Colombat, je ne serais pas un assassin pour ça. Chacun est libre d’accepter une opinion, ou de n’en pas vouloir.
— N’empêche ! affirma énergiquement ma bonne.
— N’empêche, concéda l’épicier. Mais lui, tout de même, il a bien fait, voyez-vous, parce que c’était la Cour d’assises et les travaux forcés. Il n’y coupait pas. Trois familles des enfants qu’il recevait à sa clinique libre avaient déposé une plainte. Et il paraît qu’il y avait d’autres cas, depuis longtemps... Ce qu’on en raconte maintenant !...
Il allait entrer dans les détails. Ses yeux brillaient. Adèle, d’un mouvement de tête, lui rappela ma présence. Il se tût, à regret.
— Tout de même, reprit Adèle, il faudra qu’elle quitte le pays, cette femme-là !
— Croyez-vous ?
— Après ce quelle a fait !...
— Pour un temps, dit sagement l’épicier, pour un temps il faudra qu’elle s’en aille. Mais ses terres sont ici, des terres qui sont amodiées à moitié fruit, qu’il faut surveiller. Des métayers, ça n’est pas comme des fermiers, qui portent leur argent chez le notaire. Il y a le cheptel, il y a le partage des bénéfices... C’est une collaboration, souligna-t-il. Si elle s’en va, elle reviendra. Tout s’oublie, allez, Madame Adèle, tout s’oublie... Et puis quoi ? Elle a protégé comme elle a pu le nom que porteront ses enfants. Il vaut mieux être les descendants d’un suicidé que d’un bagnard.
— Vous croyez que c’est ça ?
— Dame, qu’est-ce que ce serait ?
— En tout cas, c’est bien malheureux pour M. Octave, le frère. Il n’avait pas mérité ça, lui !
— Ni sa femme...
— Oh ! sa femme, elle est ce qu’elle doit être... Les femmes, établit Adèle avec une sincérité naïve, c’est fait pour être bien... Autrement c’est moins que rien... Mais lui, avec un frère pareil, et un père qu’on raconte qu’il valait guère mieux, lui, c’est un saint !
— Un calotin. Un rat d’église... quoique ça, honnête, convenable et tout. Il ne ferait pas tort d’un sou à la poche d’un homme, ni un accroc à la jupe d’une femme...
— Il les regarde même pas...
— Oh ! j’ai idée qu’il les regarde en dessous, des fois, avec ses yeux toujours baissés. On ne peut pas empêcher les sentiments. Enfin, il se tient. C’est tout ce qu’on peut lui demander.
Dans le jugement qu’elle portait sur les causes qui avaient conduit le Dr Havry à se donner la mort, l’imagination de M. Colombat n’allait pas assez loin. Adèle, avec son bon sens grossier, mais féminin, approchait de plus près la vérité. L’épouse avait été plus que la complice du suicide de son mari : l’initiatrice, on pourrait presque dire l’auteur principal. Cela, pour un motif plus serré, plus précis, plus bas — et pourtant ne pourrait-on pas dire d’une certaine manière héroïque, puisqu’elle avait aimé, aimait encore cet homme égaré par son vice ? — que celui de l’honneur du nom. Et mon père avait été, inconsciemment, pour quelque chose dans l’inébranlable férocité de son attitude. Je conservais, à cette époque, à côté de celle de mes parents, la petite chambre où l’on m’avait installé dès que mon berceau ne fut plus au pied même du lit de ma mère. On me couchait de fort bonne heure. Mais je fus réveillé, vers le milieu de la nuit qui suivit ce jour dramatique, par des paroles confuses où il y avait presque des sanglots. Mon père criait : « Si j’avais su ! Si j’avais su ! C’est ce que j’ai dit à cette abominable femme qui a causé la mort de ce malheureux ! » Ma mère lui imposa silence : « Tais-toi ! tu vas réveiller Frédéric ! »
Je n’ai connu que plus tard l’étendue de la responsabilité qu’il n’avait peut-être pas tort de s’attribuer. Ancien président de Cour « épuré » lors de la suspension de l’inamovibilité de la magistrature, alors toute récente, il avait pris sa retraite à L... où l’attendait la vieille demeure qu’y possédait notre famille depuis deux générations. Lorsque éclata ce qui fut appelé dans la petite ville « le scandale Havry », c’est à lui que Mme Havry était allée demander avis. Il connaissait la loi, il donnait volontiers ces sortes de consultations officieuses : « Mon mari n’est pas encore arrêté, il peut gagner l’étranger. »