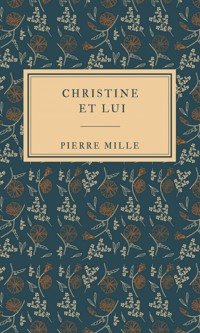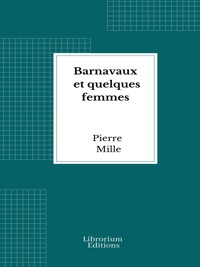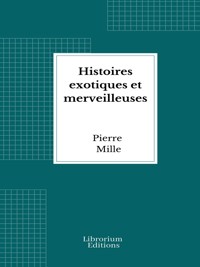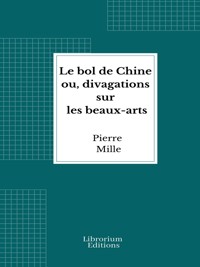1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il y a quelques années, me conta mon excellent ami John Barnard Ashleigh, de Boston, nous avons eu aux États-Unis quelque chose qui ressemblait à votre affaire Landru. Seulement, c’était mieux, plus large et plus original, comme il convient à l’Amérique.
Le Landru américain s’appelait Abraham Plattner. Il était, à Hootanooga (Connecticut), l’un des membres les plus fervents de la chapelle des Darbystes, et passait pour faire honneur, par l’austérité et la profondeur de ses convictions, à cette secte non-conformiste, dont tous les adeptes se distinguent, d’ordinaire, par l’ardeur de leur foi. C’était un homme de taille moyenne, même plutôt petite, mais grave, l’air ferme et doux, avec des yeux d’un éclat singulier qu’il tenait presque toujours baissés, et une belle barbe. En somme, vous le voyez, assez semblable à votre Landru. Il édifiait la congrégation. Les femmes surtout l’écoutaient avec une confiance passionnée, mais il semblait demeurer indifférent à ces hommages muets et brûlants. Du reste, il était marié, père de famille.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
PIERRE MILLE
MONSIEUR BARBE-BLEUE… ET MADAME
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385743284
MONSIEUR BARBE-BLEUE… ET MADAME
MONSIEUR BARBE-BLEUE… ET MADAME
COMMENT M. BOUBAL EN FUT
EN DILIGENCE
L’ÉPOUVANTAIL
LA THÉOLOGIENNE
LES OMBRES REVIENNENT
UNE FEMME D’AFFAIRES
LE RETOUR
LE VERGLAS
UNE ROBE DE SOIE
COMBATS DE BOXE
MOUSTACHE
LA CONSULTATION
EN UNE NUIT…
LA JUSTICE IMMANENTE
RHÉA
LA CHOULETTE
RÉCONCILIATION
LE TESTAMENT
LA HAINE
UN VRAI PÊCHEUR
ALBERT
BOSSEBŒUF, VAGABOND
LA CENTENAIRE
MONSIEUR BARBE-BLEUE… ET MADAME
Il y a quelques années, me conta mon excellent ami John Barnard Ashleigh, de Boston, nous avons eu aux États-Unis quelque chose qui ressemblait à votre affaire Landru. Seulement, c’était mieux, plus large et plus original, comme il convient à l’Amérique.
Le Landru américain s’appelait Abraham Plattner. Il était, à Hootanooga (Connecticut), l’un des membres les plus fervents de la chapelle des Darbystes, et passait pour faire honneur, par l’austérité et la profondeur de ses convictions, à cette secte non-conformiste, dont tous les adeptes se distinguent, d’ordinaire, par l’ardeur de leur foi. C’était un homme de taille moyenne, même plutôt petite, mais grave, l’air ferme et doux, avec des yeux d’un éclat singulier qu’il tenait presque toujours baissés, et une belle barbe. En somme, vous le voyez, assez semblable à votre Landru. Il édifiait la congrégation. Les femmes surtout l’écoutaient avec une confiance passionnée, mais il semblait demeurer indifférent à ces hommages muets et brûlants. Du reste, il était marié, père de famille.
Je n’insisterai pas sur les faits, pourtant essentiels, mais que les détails du procès sur lequel toute la France tient aujourd’hui ses regards vous ont rendus familiers, qui amenèrent son arrestation. Un certain M. Bullock, ne se pouvant consoler qu’une dame Beaumont, âgée d’une cinquantaine d’années, quoique agréable encore, eût brusquement cessé les relations qu’elle entretenait avec lui, révéla qu’elle avait disparu après le dernier séjour fait par elle dans la villa Pick-me-up, louée à son nom, près d’Hootanooga, et où elle s’était rendu en compagnie d’un autre gentleman, appelé Butler. Les recherches de la police dans cette villa, pour l’heure abandonnée, firent découvrir divers objets de toilette appartenant à Mme Beaumont. La cheminée du fourneau de cuisine était imprégnée d’une suie très grasse ; enfin, les fouilles pratiquées dans le jardin révélèrent la présence, au milieu de cendres d’une origine indéterminable, d’une molaire aurifiée qui fut reconnue par un dentiste comme ayant brillé dans la mâchoire de Daisy Beaumont, de plusieurs fragments de crâne, et d’un assez grand nombre de petites vertèbres. Par un hasard exceptionnel, dont la justice put se féliciter, tout en s’en inquiétant, neuf de ces vertèbres étaient identiques, chacune d’elles étant la septième de l’épine dorsale ; il en fallait conclure à l’incinération, donc à la mort, sans doute violente, de neuf personnes différentes.
Le prétendu Butler fut identifié avec Abraham Plattner. Arrêté incontinent, l’on constata qu’il avait pris bien d’autres noms : Coolidge, Wilson, Oakburn, et qu’il avait loué, à vingt milles d’Hootanooga, la jolie villa Resurrectio. Dans cet autre domicile furent trouvés encore un assez grand nombre d’objets de toilette féminine, des lettres et des papiers d’identité ayant appartenu à sept femmes qui n’avaient point reparu ; enfin, comme à Pick-me-up, des ossements calcinés. L’enquête des magistrats parvint d’ailleurs à établir que le vertueux Plattner, presque toujours par voix d’annonces, était entré en communication avec plus de trois cents personnes du sexe faible.
Plattner ne contesta point ses tentatives d’escroquerie au mariage : « Mais la plupart des mariages, dit-il pour sa défense, ne sont-ils pas des escroqueries ? Chacun des deux futurs s’efforce respectivement d’abuser l’autre sur l’étendue de ses ressources, le nombre et la valeur sociale de ses relations, l’éclat de sa famille. Et que le mariage soit consommé, ou rompu, l’escroquerie n’en a pas moins lieu. Elle est même plus complète dans le cas des épousailles. » Par contre, il nia catégoriquement avoir jamais mis à mort qui que ce fût, alors qu’on portait à son compte seize assassinats. Savoir : neuf commis dans la villa Pick-me-up, et sept dans la villa Resurrectio.
J’ignore en ce moment, quel sera le verdict du jury de Versailles. Celui d’Hootanooga fut impitoyable : Plattner fut condamné à mort à l’unanimité. Nos jurés sont peut-être plus sévères que les vôtres : un ensemble de présomptions, si toutes sont concordantes, leur paraît suffire, à défaut d’une preuve absolue, et comme le dit plus tard l’un de ceux d’Hootanooga, il y avait assez de ces présomptions pour faire pendre une demi-douzaine de Plattners.
Mais voici, monsieur, où cette histoire, jusqu’ici assez vulgaire, devient exceptionnelle.
La veille du jour où il devait être exécuté, ce Plattner fit avertir le chapelain et le directeur de la prison qu’il désirait leur parler.
— Je voudrais bien savoir exactement, leur dit-il, pour quelle cause on m’a condamné ?
— Well, répondit le directeur de la prison, ne faites pas l’ignorant. Vous êtes condamné pour seize meurtres.
— Alors, poursuit Plattner, je suis victime d’une horrible erreur judiciaire, car je n’en ai commis que huit. Je demande la revision de mon procès.
— Allons, Plattner, allons, fit le directeur de la prison, cette affirmation est déraisonnable. Il y avait les traces de neuf cadavres à Pick-me-up, et de sept à Resurrectio. Cela fait le compte !
— Cela fait le compte pour les cadavres, mais cela ne fait pas le compte pour leur auteur. Je jure, sur toutes les étoiles du drapeau de l’Union, qu’on n’en doit porter que huit à mon crédit, dont les sept de Resurrectio, et un seul sur neuf à Pick-me-up. Le seul qui soit un cadavre de femme.
— Mais alors, les autres ?
— Des hommes, monsieur le directeur, des hommes ! Voyez un peu quelles sont les abominables méprises de la police, qui n’a même pas su distinguer les sexes dans cette ostéologie !… Il convient ici que je sois parfaitement candide, et que je reconnaisse un certain nombre de faits que j’ai refusé d’admettre devant le jury. J’ai assassiné, dans la villa Resurrectio, sept personnes du sexe qui avaient eu des bontés pour moi, ou ne demandaient pas mieux que d’en avoir, et je les ai incinérées.
— Sept ?… Vous disiez huit, tout à l’heure !
— Attendez ! Je ne vous parle que de Resurrectio. J’arrive tout de suite aux événements de Pick-me-up. Quand je commençai d’avoir des intentions sur Mrs. Daisy Beaumont, mon expérience m’avertit qu’il faudrait employer, pour faire sa conquête — de quelque façon que cette conquête se dût terminer pour elle — des procédés un peu différents de ceux qui m’avaient antérieurement servi. Sans être dépourvue de sentiments, ni même de sensualité, je vis clairement que cette honorable veuve était toutefois calculatrice, voire prudente. Elle s’informa de ce que je pouvais posséder de fortune, faisant montre, avec une certaine ostentation, de la sienne propre ; elle insista pour réunir en un fonds commun les valeurs et les espèces que je pouvais détenir, et celles dont elle était propriétaire. Je ne vis pas d’inconvénients à lui céder sur ce point, puisque, je crois vous l’avoir fait comprendre, le tout ne devait pas tarder à me revenir. Je lui offris donc, comme d’habitude, d’aller passer une lune de miel préliminaire à notre union dans ma villa de Resurrectio ; mais quand elle me proposa de nous installer plutôt à Pick-me-up, où elle serait chez elle, j’acceptai de fort bonne grâce : il n’est pas recommandable de mettre tous ses œufs dans le même panier, et je ne demandais pas mieux que de changer le lieu de mes entreprises un peu délicates. D’ailleurs je connaissais la villa : ses aménagements me paraissaient favorables à mes plans.
« De toutes les femmes à qui j’ai eu affaire Daisy Beaumont, je dois le dire, est celle qui m’a laissé l’impression la plus forte. Ce n’était pas une virago : assez frêle, au contraire, avec de petites mains fines, un joli pied, une jolie taille, des yeux extraordinairement clairs, pas très grands, mais ardents, lumineux, avec des lueurs vertes comme le rayon vert du soleil sur la mer — ce rayon dont on parle toujours et qu’on voit si rarement. Je me plaisais dans sa société. Je m’y plaisais tellement que je résolus de me donner quinze jours avant d’en arriver avec elle à l’inévitable. Le matin du quatorzième jour, m’étant levé un peu avant Daisy et me promenant dans le jardin, j’aperçus une sorte de resserre, fermée à clef. Je suis curieux par nature et par profession. J’essayai de regarder par le trou de la serrure, mais ne distinguai rien. L’ouverture était trop petite. Par bonheur il y avait, à côté de cette resserre, un appentis avec une lucarne qui donnait du jour à celle-ci. J’allai donc chercher une échelle : c’était un magasin, monsieur le directeur, un magasin d’effets disparates, et qui me rappela étrangement celui que j’avais formé à Resurrectio ; seulement tous les objets étaient masculins : des chapeaux, des vêtements d’hommes, des montres, des bijoux qui ne pouvaient avoir appartenu qu’à des hommes. Cela était si imprévu qu’au premier abord, ma parole d’honneur, je ne compris pas ! Je ne compris qu’à l’instant où je me sentis violemment tiré en arrière par Daisy Beaumont elle-même. Elle était toute pâle, toute frémissante, ses yeux clairs étaient devenus farouches — formidables et farouches. Je criai :
« — Comment, toi aussi ! Toi aussi !
« Ce fut à son tour à ne pas comprendre. J’en fus heureux. Je venais de me trahir ! Je dis bien vite :
« — Tu m’avais amené ici pour m’assassiner, n’est-ce pas ? Comme… comme les autres !
« Elle fit « oui » de la tête, d’un air sombre.
« Cela m’inspira une sorte d’admiration. Je demandai :
« — Mais comment pouvais-tu faire : des hommes ! Et tu es si frêle, si délicate. Comment t’y prenais-tu, avec ces petites mains-là…
« Elle haussa les épaules :
« — Les hommes ont le sommeil si lourd ! fit-elle, dédaigneusement.
« Alors une pensée, une pensée terrible me vint :
« — Mais moi aussi, moi aussi, j’ai dormi dans cette maison ! Voilà quatorze nuits que j’y dors ! Pourquoi n’as-tu pas essayé ? Comment suis-je encore en vie ?…
« Elle ouvrit les bras, elle fondit en larmes, et, avec rage, pourtant :
« — Tu ne devines pas ? Tu n’as pas deviné ?… Tu n’as pas deviné que c’est parce que je me suis mise à t’aimer !
« Si vous saviez, monsieur le directeur, ce que je me suis senti fier, à ce moment-là !… Il y aura donc toujours un moment où les femmes, même les plus fortes, laisseront intervenir le sentiment dans les affaires, où elles ne seront plus sérieuses ! Pas moi ! Voilà la différence : la huitième victime de la villa, ce fut Daisy Beaumont. Celle-là aussi vous pouvez la porter à mon compte. Voilà pourquoi cela fait huit. Mais je ne reconnais pas les autres ! Les autres étaient à Daisy Beaumont. Et d’ailleurs c’était des hommes : vous voyez bien qu’il y a erreur ! »
Il y avait erreur, en effet, conclut John Barnard Ashleigh, et le verdict fut cassé : mais ce qui prouve, ainsi que je le disais, que nos jurés américains ne sont pas comme les vôtres, c’est que les jurés d’Hootanooga furent d’accord que Plattner était aussi coupable pour huit femmes que pour seize, et qu’il fut condamné de nouveau à être pendu.
Abraham Plattner fut une seconde fois condamné à mort, continua John Barnard Ashleigh, bien que son avocat eût soutenu éloquemment, en sa faveur, une thèse fort subtile, dont la spéciosité faillit un instant ébranler la conviction du jury :
« Mon client, dit-il, devait être pendu pour avoir commis seize meurtres. Ce verdict ayant été cassé, il ne se présente plus devant vous que présumé coupable de huit, les autres victimes devant être portées au compte d’une certaine Daisy Beaumont, qu’il avoue volontiers avoir fort proprement étranglée, puis incinérée. Mais, ce faisant, il n’a fait que devancer l’œuvre de la justice, qui n’eût certes pas laissé vivre cette criminelle. Il n’a donc plus à répondre que de sept assassinats. Well, chers citoyens et honorables jurés de cette ville d’Hootanooga, je livre ce problème angoissant à vos consciences : un homme a été à tort condamné à la pendaison pour avoir envoyé seize personnes devant leur juge naturel. Il est à cette heure reconnu, de la façon la plus incontestable, qu’il n’a pris cette liberté qu’à l’égard de huit d’entre elles, dont l’une avait mérité son sort. Reste sept. Peut-on légitimement lui appliquer la même peine, alors qu’il n’est pas même à moitié aussi coupable qu’on l’avait cru d’abord ? Il semble bien clair, Messieurs, si l’on s’en tient aux règles de la plus élémentaire arithmétique, qu’on n’a le droit de livrer au bourreau que la moitié de William Plattner, moins un huitième. »
Un argument d’une logique si vigoureuse eût, je crois, troublé des jurés français. Les nôtres, par malheur pour Plattner, sont plus enclins à suivre les impulsions de leurs sentiments, qu’ils appellent le sens commun, que les déductions de la raison pure et de la mathématique : le second verdict, ainsi que je viens de vous le dire, confirma le premier.
Voilà pourquoi, dès les premières lueurs de l’aube, un beau matin, le condamné vit entrer dans sa cellule, avec son avocat, le chapelain et le directeur de la prison, l’attorney général, le chef du jury, et différentes autres personnes. On lui annonça que, son dernier jour étant arrivé, il n’avait plus, tout juste, que le temps nécessaire pour recommander son âme au Seigneur. Plattner accueillit cette nouvelle avec humilité, contrition, mais aussi un sang-froid singulier.
— Je suis prêt ! dit-il. Un homme craignant Dieu, quelles que soient ses fautes, doit toujours se tenir prêt à comparaître devant le tribunal suprême… Mais je demande à faire des révélations !
— Comment, des révélations ? fit l’attorney général.
— Vous avez l’air de ne pas me comprendre : cela est indigne de votre science judiciaire ! Je dis : des révélations… Car vous ne savez absolument rien de mon affaire, en somme. J’ai été condamné sur des présomptions, non sur des preuves. Ce sont ces preuves que je consens à vous fournir, et c’est votre devoir de m’entendre : car, tant que vous ne les posséderez point, avouez qu’il vous restera toujours, monsieur le chef du jury, à vous et à vos collègues, un doute angoissant. Avouez que, de votre côté, monsieur l’attorney général, il ne vous sera point indifférent de savoir si, oui ou non, il est possible d’obtenir l’incinération d’une personne entière à la flamme d’un simple fourneau de cuisine. C’est un point sur lequel la médecine légale n’est point encore fixée, et que les rapports des experts sont loin d’avoir éclairci. Enfin, avouez-le aussi : vous vous devez au public ! Et le public est plus anxieux encore de savoir comment j’ai fait, que d’être sûr, simplement et judiciairement sûr, que j’ai fait !
On dut lui accorder qu’il avait raison : son droit à s’expliquer sur le pourquoi et le comment de ses crimes était de la plus absolue certitude, et confirmé par tous les précédents.
— En avez-vous pour longtemps ? demanda seulement l’attorney général, de mauvaise grâce.
— Je n’en sais rien, monsieur ! répondit Plattner d’un ton choqué. Cela dépendra de la précision de ma mémoire, affaiblie par une longue détention, de l’aide du Seigneur, et des forces de ma misérable guenille humaine. Mais vous n’avez pas le droit de mettre en doute ma bonne volonté… Le greffier est-il présent ?
Le greffier n’était point présent. On n’avait pas cru avoir besoin de ses services : il fallut l’aller chercher, ce qui prit un certain temps.
William Plattner débuta par une longue prière, qui fut écoutée respectueusement. Et enfin :
— Dès l’âge de dix ans… fit-il.
— Pardon ! interrompit l’attorney général. Ce n’est pas à cette date que remontent les faits qui vous ont valu votre condamnation !
— Je le reconnais, admit doucement Plattner, mais je suis maintenant un témoin dans ma propre cause : je dois donc être écouté sans qu’on m’interrompe ni qu’on cherche à me détourner de ce que je vais dire ; et d’ailleurs ne vous intéressez-vous point aux théories de M. Freud : il paraît que nous demeurons de toute notre vie l’enfant de notre enfance…
Il continua donc, et le récit de son enfance, encore qu’il y dénonçât de mauvais instincts, fut harmonieux et poétique. Par moments il s’arrêtait, disant au greffier : « Vous me suivez bien, n’est-ce pas ? J’entends que mes paroles soient enregistrées exactement… Veuillez relire ! » Il suggérait alors des corrections. Il confessa ensuite, abondamment, et avec un grand repentir, quelques erreurs de jeunesse.
— J’arrive enfin, dit-il, au havre où crut pouvoir se réfugier mon âme inquiète et douloureuse : mon mariage !
A ce moment il était une heure et demie. Le chapelain montra des signes de faiblesse ; d’un commun accord, il fut décidé que le reste des communications de Plattner ne perdrait rien à être remis après le luncheon.
Plattner déjeuna lui-même confortablement. Vers trois heures, la séance fut reprise. A huit heures du soir il n’avait pas encore terminé le récit fort touchant de ses fiançailles. L’attorney général rédigea une note pour la presse, afin d’annoncer que, le condamné étant entré dans la voie des aveux, l’exécution avait été ajournée au lendemain.
Et le lendemain, vers midi, Plattner aborda, avec la plus louable franchise, le sujet de ses relations avec sa première victime, Mrs. Fletcher. On respira. Il tint à donner les dernières précisions, il réclama son calepin pour y retrouver certaines indications qui échappaient à ses souvenirs. A mesure que ceux-ci lui revenaient, les larmes coulaient sur son visage.
— Excusez-moi, fit-il, je me sens mal. Qu’on aille chercher un médecin.
Le docteur Haberstein, Américain-Allemand d’origine israélite, déclara qu’en son âme et conscience Plattner ne pourrait résister indéfiniment à la pénible tension qui s’imposait, ce qui était marqué par les désordres visibles de son système circulatoire et la diminution de sa pression artérielle. Il recommanda — de quoi sa qualité d’homme de l’art faisait un ordre — de ne le point laisser déposer plus de trois heures par jour. De plus il ordonna un régime reconstituant, et même un peu d’alcool, interdit à tous par les lois sévères de l’Union, sauf aux malades.
Quelques bouteilles de spirits, venant de l’officine d’un pharmacien, furent donc introduites dans la prison. Fort généreusement Plattner en offrait chaque jour un verre à ses auditeurs : la sympathie qu’on commençait d’éprouver pour lui n’en diminua pas.
Le vingt-neuvième jour depuis la date qui aurait dû être celle de son exécution, il avait entièrement, et avec une admirable probité, achevé le récit du premier de ses crimes. Il n’avait rien caché, il avait dévoilé jusqu’aux moindres détails, et même demandé le concours d’un architecte pour établir avec lui les plans, en coupe et élévation, du dispositif ingénieux qu’il avait imaginé pour l’incinération de ses victimes. Le public était tenu, jour par jour, au courant de sa confession. Il s’y intéressait ardemment. La publication de ces sortes de mémoires rapporta des sommes considérables, et le revenu des droits d’auteur fut partagé, ainsi qu’il se devait, entre Plattner et le greffier. Plattner utilisa la part qui lui en revenait dans des spéculations avantageuses, et sa femme put acheter, sur ses conseils, une fort belle villa, qui prit le nom d’Æternitas.
Au bout de cinq mois, Plattner n’était encore parvenu qu’au récit de ses relations avec sa cinquième victime. Mais personne, en Amérique, ne s’en plaignait, excepté les romanciers de profession, privés de ressources par l’arrêt complet de la vente de leurs ouvrages en librairie. Même la traduction du Bâtard de Gambetta, le dernier roman d’aventures de M. Pierre Benoit, s’était immobilisée contre toute attente aux environs du 250e mille. Mais, en même temps, Plattner s’occupait de désintéresser largement, sur ses bénéfices, les héritiers des dames qu’il avait supprimées, faisant savoir que tout serait intégralement remboursé si on lui donnait le temps de poursuivre ses passionnants mémoires. Tout le monde lui donnait raison.
La sixième des victimes attribuées à Plattner était la plus jeune : miss Onofria Garvin, âgée de vingt-deux ans. Quelle ne fut pas la stupéfaction de ses auditeurs ordinaires, et du greffier lui-même, devenu son collaborateur, quand ils l’entendirent déclarer :
— Pour celle-là, je n’ai rien à dire… Je ne l’ai jamais ni assassinée, ni incinérée par conséquent. Elle m’a quitté, véritablement quitté ! Elle a disparu. Je le regrette encore plus que vous.
— Allons, Plattner, vous plaisantez, lui représenta l’attorney général, scandalisé.
— J’ai avoué les cinq premières, j’avouerais tout aussi bien celle-là, comme je suis prêt à avouer les deux dernières… Mais, cette miss Garvin, en toute sincérité, j’ignore ce qu’elle est devenue.
— Vous parlez sérieusement ?
— Très sérieusement.
— Voyons, Plattner, fit l’attorney général avec des larmes dans la voix, songez à ce que vous dites ! Si vraiment vous ne l’avez pas assassinée, tout est à recommencer une troisième fois, puisque vous avez été condamné pour huit meurtres, et qu’il n’y en aurait que sept.
— Je le regrette beaucoup pour vous. Je comprends vos sentiments, et j’y compatis. Mais que voulez-vous que j’y fasse ?
— Et vous ne pouvez donner aucune indication, suggérer aucune hypothèse sur le lieu de la retraite de miss Garvin ?
— Aucune… Ah ! si, pourtant : Onofria Garvin était une jeune personne très romanesque, affamée d’aventures et de voyages périlleux. Ma conviction — sans que je puisse en avoir la preuve, bien entendu ! — c’est qu’elle s’est embarquée comme mousse sur le navire de Shackleton, en dissimulant son sexe.
— Mais il est au pôle Sud, Shackleton !
— Eh bien, attendez qu’il revienne !…
— Comme Shackleton est toujours au pôle Sud, conclut mon ami John Barnard Ashleigh, et que même il y est mort, Plattner n’est toujours pas exécuté. Mais il poursuit la publication de ses aveux, qui continuent d’avoir un immense succès.
COMMENT M. BOUBAL EN FUT
C’était un petit homme tout blanc, très doux, très triste. Et ces dames, à une minute près, savaient son jour et son heure. Les premières fois, il était arrivé par la porte de la rue, et si palpitant, regardant derrière lui avec une telle inquiétude que « madame », dès qu’elle eut constaté en lui un habitué, s’empressa par charité de lui indiquer l’autre accès de la maison. Il fallait passer par la cour, qui avait un air très convenable, et où habitait du monde très bien. De là, par deux vantaux qui s’ouvraient d’une simple poussée, on entrait dans un jardin d’hiver toujours vide. Il n’y avait plus qu’à presser sur un bouton électrique dissimulé au bas du grand miroir : on venait tout de suite ouvrir, il était enfin au cœur de la place. Et madame lui disait : « Mathilde, n’est-ce pas ? » Il faisait « oui » de la tête, avec un sourire de timidité. Alors Mathilde venait, et il montait derrière Mathilde : et c’était toujours le vendredi, à cinq heures et vingt minutes.
Que ce soit ce jour-là que se réunit l’Académie des sciences historiques, à l’Institut ; que ce soit à cette heure, presque exactement, que se termine la séance, ces dames l’ignoraient, de même qu’elles ignoraient le nom de ce monsieur si poli, discret, mélancolique : ce nom qui est célèbre, celui du grand Boufre de Sauveplane, auteur de tant d’études parfaites sur les femmes du dix-huitième siècle, — livres si voluptueux, si fins, si tendres, qu’il faut être du métier, vraiment du métier, pour s’apercevoir combien la trame en est serrée, l’érudition solide. Les rivaux haussent les épaules, parce que cette gloire les agace, mais ils n’ont rien à critiquer, rien à dire, excepté Boubal, le terrible Boubal, de l’École des Sciences Modernes, l’homme du document tout nu, rude et sec, qui juge que cette manière d’écrire l’histoire « ferait croire que la vérité n’est pas vraie ». Mais les femmes répondent « qu’elles adorent ça ». Elles se disputent Boufre de Sauveplane, il a toutes leurs confidences, il sent comme elles, il pense comme elles. De l’avoir pour ami, pour ami tout à fait intime, beaucoup seraient très fières, malgré la soixantaine qui a neigé sur sa tête. Mais lui n’a jamais eu l’air de comprendre. Et il en est parmi elles qui songent : « Qui est-ce donc, puisque ce n’est pas moi ? » Et d’autres qui ne l’en aiment que davantage, croyant qu’il reste fidèle à un ancien souvenir. Elles ignorent qu’il est timide, tout simplement, timide jusqu’au tremblement, jusqu’aux affres physiques, et qu’il n’a jamais su demander, jamais sentir, même, le moment où l’on s’offrait à lui. S’il comprend si bien les femmes, c’est qu’il a une âme de femme, et la même pudeur au moment du désir : une pudeur rétractile et sauvage.