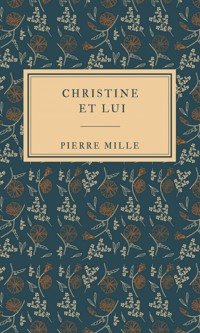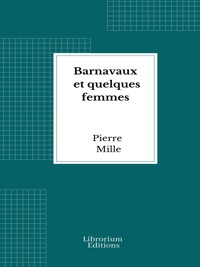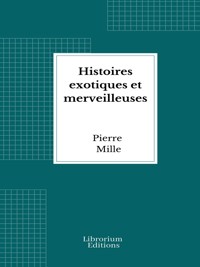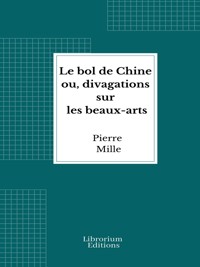1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ceci est encore une histoire, la dernière histoire peut-être, de mon ami Barnavaux, que la guerre m’a tué. Mais, avant de la conter, ne faut-il pas que j’explique ?… Voici deux siècles déjà que Philippe d’Orléans, régent de France, se plaignait d’avoir dépensé vingt mille écus pour voir le diable et de ne l’avoir point vu. Mon regret est pareil. On dirait que, dans cette misérable demeure qui est mon corps, ma sensibilité et ma raison habitent deux étages différents, et qu’il n’y a pas, qu’il n’y aura jamais d’escalier. Je ne sais quoi, tout au fond de moi-même, de fabuleusement antique, venu d’ancêtres oubliés, sauvages, frémissants, intelligents et ignorants, cherchant à comprendre l’immense mystère du monde et ne sachant même pas qu’ils avaient un cerveau — pensant, si je puis dire, comme des bêtes qui auraient une manière de génie — je ne sais quoi de barbare, de rétrograde et d’inquiétant voudrait me persuader que l’univers est peuplé d’ombres, de forces puissantes, conscientes, malicieuses ou bienveillantes ; que les morts vivent, près de moi, d’une autre vie, que mes songes nocturnes sont vrais, d’une vérité magique et magnifique, draguant mes yeux fermés vers un avenir obscur ; que le mal, le bien sont des êtres, des satans ou des dieux, aux mains amicales ou funestes, au visage accueillant ou sinistre…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Pierre Mille
LE DIABLE AU SAHARA
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385743673
LE DIABLE AU SAHARA
LE DIABLE AU SAHARA
LE MAMMOUTH
LE MANTEAU DE PLUMES
L’OMBRE DE BYRON
DU BERGER A LA BERGÈRE
LE PARFUM
LA MER
LA MINE
UN GABIER EXCEPTIONNEL
UN CIMETIÈRE
LES CACHALOTS
CEUX D’EN FACE
ANNA MAC FERGUS, ÉCOSSAISE
LA CONFIDENCE DU TOMMY
L’ESPION
LES CONVERSIONS DE RIVETT
TOM KETTLE, AUSTRALIEN
LE SINGE ET LES ÉCOSSAIS
DEUX MILLE ANS PLUS TARD…
TROIS RÉVÉRENCES…
LE DIABLE AU SAHARA
LE DIABLE AU SAHARA
Ceci est encore une histoire, la dernière histoire peut-être, de mon ami Barnavaux, que la guerre m’a tué. Mais, avant de la conter, ne faut-il pas que j’explique ?…
Voici deux siècles déjà que Philippe d’Orléans, régent de France, se plaignait d’avoir dépensé vingt mille écus pour voir le diable et de ne l’avoir point vu. Mon regret est pareil. On dirait que, dans cette misérable demeure qui est mon corps, ma sensibilité et ma raison habitent deux étages différents, et qu’il n’y a pas, qu’il n’y aura jamais d’escalier. Je ne sais quoi, tout au fond de moi-même, de fabuleusement antique, venu d’ancêtres oubliés, sauvages, frémissants, intelligents et ignorants, cherchant à comprendre l’immense mystère du monde et ne sachant même pas qu’ils avaient un cerveau — pensant, si je puis dire, comme des bêtes qui auraient une manière de génie — je ne sais quoi de barbare, de rétrograde et d’inquiétant voudrait me persuader que l’univers est peuplé d’ombres, de forces puissantes, conscientes, malicieuses ou bienveillantes ; que les morts vivent, près de moi, d’une autre vie, que mes songes nocturnes sont vrais, d’une vérité magique et magnifique, draguant mes yeux fermés vers un avenir obscur ; que le mal, le bien sont des êtres, des satans ou des dieux, aux mains amicales ou funestes, au visage accueillant ou sinistre… Là-dessus, ma raison interroge, suppute, analyse, et ne trouve rien ! Rien que fraude, mensonge, hypothèse, doute, doute, encore doute. Je ne puis plus garder qu’une curiosité, que dis-je, une perversité littéraire, et quelque autre chose qui n’est peut-être qu’un instinct primitif, subitement remonté à la surface de mon désir, comme la jalousie ou le besoin de verser le sang.
Pourtant, pourtant, il y a mes rêves. J’ai lu beaucoup de choses sur les rêves, je sais à peu près tout ce qu’en ont dit ces savants qui prétendent toujours tout expliquer. La dernière hypothèse, et la plus séduisante — la plus séduisante, on ne sait comment, se trouvant toujours la dernière, — est que notre cerveau pensant est composé de cellules qui ne se touchent point, mais jettent les unes vers les autres des tentacules qui se cherchent et peuvent entrer en contact. On appelle ça des neurones. A l’état de veille, ces neurones s’associent d’une façon normale, habituelle : alors on n’a que des pensées et des images normales, habituelles. Dans le sommeil, ils contractent d’autres mariages, étranges et désordonnés : c’est le rêve. Mais alors ils ne peuvent vous donner que ce qu’on y a mis ; ils n’inventent pas, ils ne prévoient pas, ils ne prédisent pas. Tout au plus pourrait-on dire que, par un secret instinct, ils tendent à achever dans le rêve ce qu’on avait laissé incomplet, ou volontairement repoussé, dans la vie diurne ; ou bien qu’ils s’amusent à ressusciter de très vieux souvenirs…
Je les connais, ces rêves-là, je les connais très bien… mais il en est d’autres, et ce sont eux qui me hantent, par quelque chose d’inexplicable et de mystérieux, parce qu’ils ne finissent rien qui fût jamais commencé en moi dans l’espace connu du monde extérieur — et qu’ils reviennent, qu’ils reviennent perpétuellement, toujours aussi mystérieux, inexplicables. Phénomène assez caractéristique, et singulier : alors que, le matin, la mémoire des autres rêves s’efface, quelle qu’ait été leur intensité, quels que soient les efforts qu’on fait pour les ramener à la surface de la conscience, ceux-là demeurent présents, ils ne vous quittent pas, ils vous harcèlent, comme l’introuvable solution d’un problème ; et l’on pense : « Pourquoi, pourquoi ? qu’est-ce que cela peut signifier ? »
Ce qui me revient ainsi, aux heures où je dors, ce sont des paysages et surtout des maisons — des maisons où je suis sûr de n’être jamais allé, que je suis certain de n’avoir jamais vues. Une maison particulièrement. Elle est située dans un parc où il y en a d’autres, dont elle n’est séparée par nulle muraille, nulle clôture d’aucune sorte, et qui, à mes regards, se présentent toujours dans le même ordre, avec le même aspect. Je pourrais tracer la topographie de ces lieux, que rien ne m’autorise, pourtant, à croire réels. Mais la seule où je pénètre, avec l’idée que j’ai quelque chose à y faire, je ne sais quoi, mais important, est toujours la même. Elle a un air d’abandon et d’ennui plutôt que de tristesse, — et la pièce du milieu, le salon probablement, est si vaste que le plafond en paraît bas. Il y a deux colonnes de bois qui soutiennent la poutre qui le traverse, et, sur une table de marqueterie, un vieux châle des Indes qui sert de tapis. Mais je sais que la table est en marqueterie parce qu’on en voit les pieds et une espèce de tréteau contourné qui les unit. Dans un angle, un piano droit, très ordinaire, mais de physionomie vieillotte ; et, sur les murs, des portraits de gens que je ne connais pas, et dont je me souviens, d’ailleurs, plus vaguement. Je suis là comme en visite, j’attends quelqu’un — et ce quelqu’un n’est jamais venu, bien que je retourne là, dans mes rêves, deux ou trois fois par an depuis dix ans, souvent davantage. La saison où je crois accomplir cette visite est régulièrement la même ; c’est à la fin de l’automne, un jour de pluie, lamentable, et, par les fenêtres de la pièce, j’entends pleurer les branches d’un grand cèdre que j’ai déjà vu sur la pelouse, avant d’entrer.
C’est, au contraire, en plein été que je vois — mais plus rarement — deux grandes villes très lointaines. L’une se trouve, selon mon rêve, dans une île très vaste, et je m’y rends en tramway, de la campagne, par une route qui suit la mer. Les avenues sont très larges, les demeures, spacieuses, sont cachées derrière des jardins. Mais il y a aussi de petites rues très populaires, et dans l’une d’elles se trouve une boutique où j’entre pour acheter des cigares très longs, très noirs, déjà coupés en demi-losange à leur extrémité. Il y a un arbre qui passe à travers le toit. L’autre ville a des maisons très hautes, avec des colonnades à tous les étages, et l’entre-deux de ces colonnades est rempli de fleurs ; il y a aussi des parterres de fleurs devant les rez-de-chaussée. Mon idée est que je suis là par méprise, et que je me suis trompé de quartier. Je cherche quelque chose ou quelqu’un qui ne doit pas être là — et pourtant je suis gai, ineffablement gai. Il me semble qu’il doit habiter partout du bonheur dans ces rues, je voudrais rester… J’ignore pour quelle raison je me figure que c’est quelque part dans les États-Unis du Sud, où je ne suis jamais allé.
Le plus étrange, c’est que je ne rencontre jamais personne : personne dans la ville exotique aux beaux jardins, sauf la négresse qui me vend des cigares ; personne, pas une âme, dans la ville somptueuse aux colonnades de marbre, aux parterres de fleurs : c’est un silence illimité, sous un soleil qui n’accable pas, illumine tout ; personne dans la maison triste, incompréhensiblement triste, que je ne hante jamais qu’en automne et sous la pluie. Je passe dans tout cela, éperdu de solitude, avec la conviction qu’il va m’arriver, dans les deux premiers cas, quelque chose de délicieux ; dans le dernier, je ne sais quoi d’angoissant, mais que je voudrais savoir — Et il n’arrive jamais rien ! Je me réveille…
Et puis, quelques mois après, ça recommence.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Je mène une vie très active, je ne fume pas l’opium, je ne me suis adonné à nul poison, je ne bois guère que de l’eau, je mange à peine le soir. Je n’ai aucune tare, héréditaire ou acquise. Et deux ou trois fois l’an au moins, je le répète, il me semble que je suis sur le seuil d’une autre vie, avec le désir de franchir ce seuil — et puis, plus rien !…
Une seule fois, au cours de mon existence, j’ai cru découvrir une raison à ces mystères. J’étais alors tout enfant. Je rêvais fréquemment que ma bonne me conduisait à travers un corridor jusqu’à une porte qui me causait une horreur indicible : pesante, méchante, peinte d’un jaune hideux, avec une énorme serrure et de gros verrous ; et je tirais sur le tablier de cette fille pour qu’elle m’emmenât.
Cette porte n’existait pas dans la maison. Mais, après la guerre de 1870, on termina une aile qui était en voie de construction avant l’arrivée des Allemands. Et, quand je voulus pénétrer dans cette bâtisse neuve, au sommet de trois marches qui donnaient sur l’ancienne lingerie, je vis la porte. C’était elle ! Et j’eus la même impression d’effroi, j’éprouvai le même besoin de fuir. Éveillé, je tirai sur le tablier de ma bonne comme je l’avais fait dans mes rêves, un an auparavant : et c’était une aile neuve, je le répète, un passage où aucun souvenir ne pouvait être attaché !
Ce fait contribua beaucoup à me guérir de mes terreurs puériles. Ce ne fut que beaucoup plus tard, quand je fus devenu presque un homme, que je demandai par hasard à ma mère pourquoi on avait mis à l’entrée de ce bâtiment neuf une porte si laide, et qui ne paraissait pas être du même style que celui-ci.
— … Une économie, me répondit ma mère. On avait retrouvé cette porte dans le grenier, en faisant des rangements, après le départ des Prussiens. Elle y avait dormi plus de cinquante ans… Jadis, c’était elle qui fermait l’escalier, du temps de Mme de Normond.
— Du temps de Mme de Normond !
… Mme de Normond était l’une des anciennes propriétaires de la maison, au début du XIXe siècle. Elle avait pour mari un homme qui voulait l’assassiner et qui, du reste, finit par passer en cour d’assises. Quand M. de Normond parvenait à s’introduire au rez-de-chaussée, sa femme, folle de terreur, se réfugiait au premier étage. Et elle avait fait barrer l’escalier d’une porte — cette lourde porte-là, avec son énorme serrure et ses gros verrous.
… Mais comment ai-je rêvé cette porte avant de l’avoir jamais vue, pourquoi me faisait-elle peur avant de la connaître ? Pourquoi, d’avance, ai-je revécu les épouvantes de cette femme harcelée par la haine ? Mais puis-je jurer, d’autre part que, tout enfant, je n’avais pas entendu conter l’histoire de Mme de Normond, n’en gardant qu’une impression d’effroi, non le souvenir, qui ne me revenait, imprécis, diffus, qu’au cours de mon sommeil ?… Je suis ainsi ; tout homme est ainsi ; il y a en nous un primitif pour lequel la seule explication est l’explication mystique — et un sceptique contemporain qui veut trouver à toutes forces autre chose — qui trouve, n’importe comment.
Tout homme, je vous dis ! Même Barnavaux, qui a presque vu le Diable, et n’y a pas cru. Il ne me l’avoua que par hasard ; c’est pour cette cause que j’ai lieu de croire à sa sincérité.
Comme nous remontions, lui et moi, la rue Saint-Jacques, un prêtre dont la soutane un peu usée luisait aux épaules, nous croisa, venant en sens inverse. Je ne le vis qu’un instant ; c’est inconsciemment, sans doute, que ma mémoire recueillit le regard encore très jeune de son visage vieilli avant l’âge, tanné de ce hâle rouge des peaux blondes qui longtemps ont recuit au soleil : le regard pur, enthousiaste, ingénu, d’un enfant qui pense à son jeu.
Barnavaux — mon Barnavaux, en uniforme de la « coloniale », avec le passepoil jaune et l’ancre au képi — rectifia tout de suite la position ; il salua. Le prêtre rendit le salut en levant son chapeau, d’un geste doux et poli, puis, obliquant par la rue des Écoles, gravit les degrés qui montent au Collège de France.
Barnavaux témoigne d’ordinaire moins de respect pour le costume ecclésiastique. Ce n’est pas qu’il soit anticlérical : sur ces choses-là, il n’a pas d’opinion ; il n’y pense que rarement, ou pas du tout. Mais il a sa superstition, comme la plupart des hommes dont la vie est livrée aux risques et aux périls ; sans se l’avouer peut-être à lui-même, il demeure persuadé que les curés, ça porte malheur. Association d’idées assez fréquente chez les âmes simples : de ne rencontrer les ecclésiastiques, d’habitude, qu’au chevet des mourants, les catholiques attiédis ou indifférents qui ont oublié le chemin des églises induisent que ceux-ci ont conclu un pacte avec la mort, et la provoquent. Barnavaux crut devoir excuser sa faiblesse :
— C’est le père d’Ardigeant…
— D’Ardigeant, le spécialiste des langues touareg et berbères, l’explorateur du Sahara, correspondant de l’Institut ?
— Oui, fit Barnavaux, dont les idées sur la philologie sont un peu vagues. Un interprète, quoi ! C’est commode, les missionnaires, pour faire interprète : ils restent tout le temps dans les pays, ils finissent par savoir la langue, les usages, et tout. Ça n’est pas malin : ils n’ont rien à faire !
Cette définition me parut manquer légèrement d’exactitude. Toutefois je ne songeai pas à la discuter. Moi aussi, aux yeux de Barnavaux, je suis un homme qui n’a rien à faire : du moment qu’on ne fait pas les mêmes choses que lui, il ne comprend pas. C’est naturel. Mais il ajouta :
— Ça n’empêche pas que celui-là, il m’a rendu tout de même service, une fois !
— Il vous a soigné ?
— Soigné ? fit-il en haussant les épaules. Si on est malade, il y a l’ipéca, la quinine, et des fois les majors. Si on est blessé, il y a le pansement individuel, et des fois aussi les majors. Soigné ! Celui-là, il aurait pu qu’il n’y aurait pas pensé. Il n’est pas porté à faire infirmier, ça n’est pas son genre. Il veut toujours rester tout seul. C’est pour ça qu’il s’est mis explorateur. Quand il arrive du monde dans un endroit, que les militaires y créent un poste, il va plus loin, ailleurs… Il m’a expliqué un jour que c’était plus économique d’être tout seul, et que, dans le désert, quand il n’y a plus de civilisation, qu’il n’y a plus rien, on peut vivre avec trente francs par mois, plus dix francs au boy qui vous sert la messe. C’est un drôle de type ; je crois qu’il est un peu marteau. Je me souviens qu’un jour il était avec des officiers, à Igli. Et les officiers disaient : « Comme la vie va plus vite, à mesure qu’on vieillit ; les années, c’est comme des mois ; les mois, comme des semaines. Surtout ici, où on fait tout le temps la même chose, et où on ne voit rien ! » Tout à coup, j’entends le père d’Ardigeant qui crie : « On dit ça !… oui, oui, on dit ça, Mais pourtant, ça dure ! Ça dure toujours, malheureusement ! »
Et il avait l’air si désolé, si désolé ! J’ai senti qu’il souhaitait la mort tous les soirs, cet homme, que la mort lui ferait plaisir. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il n’a jamais rien fait de mal, même quand il était lieutenant de chasseurs avant d’être curé. Car il était lieutenant de chasseurs, pour commencer. Je me suis renseigné… Enfin, c’est son opinion, il croit qu’il ne sera parfaitement heureux que dans l’autre monde. C’est curieux, n’est-ce pas ? Moi, voilà quinze ans que je risque ma peau pour pas cher et j’ai toujours désiré vivre. Celui-là quand les officiers parlaient devant lui — ça peut arriver, on ne faisait pas toujours attention qu’il était là — d’un tas de choses qui auraient pu le scandaliser, et qu’ils lui disaient tout à coup : « Pardon, père d’Ardigeant, il faut nous excuser ! » il répondait, comme s’il sortait d’un rêve : « Vous excuser ? Ce n’est pas la peine. Mais pourquoi faire ? Toutes ces choses-là, pourquoi faire ? A quoi ça sert-il ? »
Je pourrais encore longtemps vous en conter sur lui : quand on l’a vu une seule fois, on ne l’oublie plus ; il n’était fait comme personne ; ses mots les plus simples n’avaient pas l’air de signifier ce qu’ils auraient voulu dire dans la bouche d’un autre. Mais ce n’est pas ça qui vous intéresse. Vous voulez savoir le service qu’il m’a rendu ? Ça n’est pas grand’chose, si l’on veut, et ce n’est peut-être pas vrai ! Quand j’y pense avec mon bon sens, je ne veux plus y croire : mais quand je me rappelle ma peur, à ce moment-là !…
Et faut vous dire d’abord qu’on était parti d’Amguid, en plein Sahara, pour conduire à In-Zize, où se trouvait le colonel Laperrine, des chameaux qui venaient du Touat ; et on n’était qu’une toute petite troupe, commandée par l’adjudant Tassart. Pas un véritable officier parmi nous : vous savez comment il travaillait, le colonel : le moins de frais possible, le moins d’Européens possible, et le plus de gens du désert possible, Arabes ou Berbères, sachant soigner les chameaux que les Européens laissent crever. Nous étions en tout six Français : l’adjudant Tassart, déjà nommé, Muller, que vous avez déjà vu avec moi, et qui est à Paris en ce moment — il pourra vous dire si je vous ai dit la vérité — Barnavaux, ici présent, Malterre, Coldru, simples soldats, et le père d’Ardigeant, qui ne devait faire caravane avec nous que pendant la moitié de la route. Un peu plus loin que Telloust — pas le Telloust de l’Aïr, un autre, qui est dans les collines de l’Ahnet — il devait obliquer à l’Est pour aller tout seul dans l’Ahaggar, tandis que nous continuerions au Sud, pour arriver à In-Zize.
L’adjudant Tassart n’était pas un vieux pied-de-banc comme il y en a en France, embêtant les hommes pour le service, et parlant toujours de les f… dedans. Il n’en faut pas au désert, de ceux-là ! C’était un type assez jeune, qui avait de l’éducation, en passe de devenir officier, mais peut-être un peu loufoc. Tout le monde a sa marotte, au Sahara : pour les uns, c’est la photographie, pour les autres l’histoire naturelle, la botanique ou la géologie ; mais pour lui, c’était ce qu’il appelait les « sciences occultes ». Il recevait de France des tas de revues et de bouquins sur le spiritisme, les fantômes des vivants et des morts, les phénomènes de médiumnité, qu’il appelait : et toutes ces machines-là, ça faisait comme sa religion à lui ; il était tout le temps à faire de la propagande.