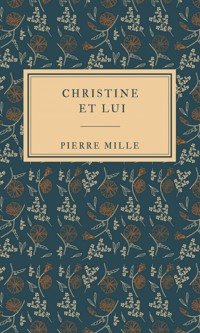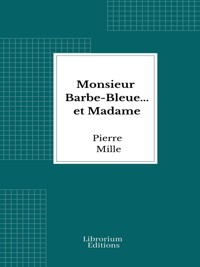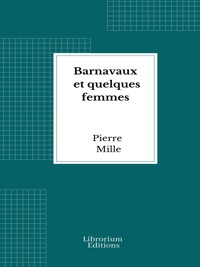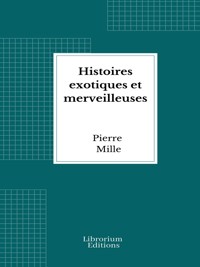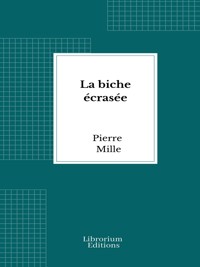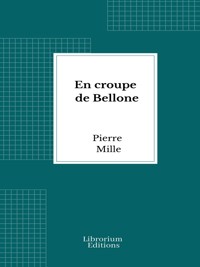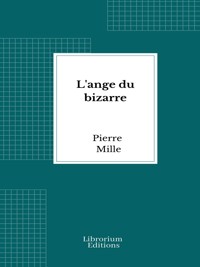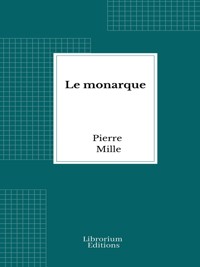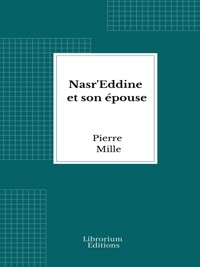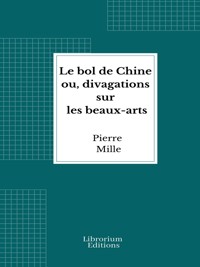
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce n’est rien qu’un bol, une simple écuelle à riz, que modela jadis un artisan de la vieille Chine, pour la jeter ensuite aux grands feux qui font la matière solide, cristalline, comme intérieurement gemmée, égalent enfin l’œuvre des hommes à ces minéraux cristallins qu’a recuits l’ardeur des volcans. Pas d’ornements, nul décor, rien qu’un émail épais, d’un vert cérulé ; galuchat ou peau de serpent. Mais prenez-le, maniez-le, touchez-le : quelle étrange, quelle nouvelle impression de beauté ! Et d’où vient-elle ?… Voici maintenant un buste de bronze. La sévérité même de sa teinte monotone fait que je n’en perçois que la silhouette générale et les traits principaux. Je clos mes paupières, j’abolis mon regard, je palpe, je tâte en aveugle ; et ce sont des muscles, une charpente, une pulpe vivante, des accents qui se révèlent. Oh ! la joie, le pouvoir, la « connaissance » qui se cachaient dans mes mains, et que j’ignorais ! Mais alors que j’ai des mots qui attribuent des causes aux voluptés de mes yeux, qui « nomment » des détails, définissent des caractères, motivent des sensations, ici je ne puis aller plus loin — je n’ai plus de langage parce que je n’ai plus d’idées : seules des impressions infiniment profondes, infiniment vagues, indéfinissables, obscures.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
PIERRE MILLE
LE BOL DE CHINE
OUDIVAGATIONSSUR LESBEAUX-ARTS
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385743253
LE BOL DE CHINE
LE BOL DE CHINE
LE CHEF-D’ŒUVRE
CELUI QUI RESSUSCITA
CELUI QUI NE RÉALISAIT PAS
HENRI ROUSSEAU, PEINTRE ET DOUANIER
A FIXIN
ISADORA DUNCAN
M. RAYMOND DUNCAN
ERREUR DANS LE VOCABULAIRE
LE BAS-RELIEF
POUR UNE NOUVELLE LIGUE
LES DEUX TRIBUS
JEAN-LOUIS, ENSEMBLIER
SIMULTANÉISTES
LA SINGULIÈRE HISTOIRE DU PORTRAIT
BARNAVAUX ET LES BEAUX-ARTS
L’IDÉAL
LE BOL DE CHINE
… Ce n’est rien qu’un bol, une simple écuelle à riz, que modela jadis un artisan de la vieille Chine, pour la jeter ensuite aux grands feux qui font la matière solide, cristalline, comme intérieurement gemmée, égalent enfin l’œuvre des hommes à ces minéraux cristallins qu’a recuits l’ardeur des volcans. Pas d’ornements, nul décor, rien qu’un émail épais, d’un vert cérulé ; galuchat ou peau de serpent. Mais prenez-le, maniez-le, touchez-le : quelle étrange, quelle nouvelle impression de beauté ! Et d’où vient-elle ?… Voici maintenant un buste de bronze. La sévérité même de sa teinte monotone fait que je n’en perçois que la silhouette générale et les traits principaux. Je clos mes paupières, j’abolis mon regard, je palpe, je tâte en aveugle ; et ce sont des muscles, une charpente, une pulpe vivante, des accents qui se révèlent. Oh ! la joie, le pouvoir, la « connaissance » qui se cachaient dans mes mains, et que j’ignorais ! Mais alors que j’ai des mots qui attribuent des causes aux voluptés de mes yeux, qui « nomment » des détails, définissent des caractères, motivent des sensations, ici je ne puis aller plus loin — je n’ai plus de langage parce que je n’ai plus d’idées : seules des impressions infiniment profondes, infiniment vagues, indéfinissables, obscures.
Que m’importent le son, la forme, la couleur,
La beauté qui me cache, en dansant, les abîmes !
Je ne perçois l’objet que dans sa pesanteur.
vient d’écrire Georges Chennevière dans des vers qui marquent une façon neuve de sentir. Toute neuve, oui ! Mais c’est pourquoi ce poète ne précise guère davantage, c’est pourquoi nul ne saurait préciser davantage : émotion mystique du toucher, en laquelle n’est pas encore descendue l’analyse.
Je suis né, nous sommes tous nés ne connaissant d’abord l’univers que par nos mains tremblantes, ardentes, indécises, toujours tendues : des combinaisons de poids, de volume, de toucher et de forme, puis le mariage de ces combinaisons avec des impressions de couleur et des calculs de distance, tels furent nos débuts dans la vie sensitive. De tous nos sens le tact fut celui qui s’éveilla le premier ; mais notre bouche n’exhalait encore que des vagissements inutiles, et quand nous sûmes parler, nos yeux seuls restèrent conscients, avec nos oreilles, notre goût, notre odorat : eux seuls apprirent à s’exprimer, alors que les sensations du toucher s’enfonçaient dans les profondeurs de notre inconscient : elles y demeurent larvaires, avortées, indéveloppées, parce qu’elles sont muettes et sourdes. Comptez le nombre des mots, des métaphores, des images qui dans notre langue et dans toutes les langues se rattachent au toucher : que la tribu vous en va sembler misérable ! On dirait même qu’elle est sur le point de disparaître, qu’elle s’appauvrit, dégénère. C’est que jamais nous n’enrichissons nos impressions de tact par elles-mêmes, en les analysant, en les creusant, en les définissant dans leurs qualités essentielles ou particulières, mais par des emprunts au vocabulaire des autres sens, par une mosaïque de cailloux volés dans d’autres carrières, et sous laquelle ces impressions restent écrasées. Dites-moi s’il est un amant, à moins qu’il ne soit aveugle — ou peut-être sculpteur, — qui, dans l’obscurité d’une nuit sans astres, puisse reconnaître, au seul savoir de ses mains, le visage de sa maîtresse ?
Et pourtant… pourtant ce sens négligé reste à la base, c’est lui qui supporte tous les autres, qui « cause » tous les autres ; sans lui tous les autres ressemblent à un homme sans squelette. Mais si c’était pour ce motif même qu’on le néglige, qu’on le tait, par une sorte d’involontaire pudeur, comme s’il portait en lui quelque chose de si solennel, intime, profond, qu’il en devient obscène, et qu’il paraisse qu’il faille n’en point parler ? Il est l’émanation la plus directe de nos corps, il est comme nos corps mêmes, il participe à leur nudité, il est nu — peut-être fait-il peur ! Et alors il est proscrit. Proscriptions dont n’osèrent point appeler les plus hardis poètes, les plus furieux contempteurs des plus antiques lois morales, ceux enfin qui se vantèrent de glorifier les sens, tous les sens, et d’évoquer les échos pour lesquels il s’assemblent, s’unissent et se complètent :
Les parfums, les odeurs et les sons se répondent.
Il n’est pas question du toucher ! Il est caractéristique même qu’à aucune autre époque de notre littérature le toucher n’ait été plus dédaigné qu’à celle du sensualisme romantique. A tous autres égards et dans tous les autres domaines, si le romantisme n’a point apporté beaucoup d’idées, il a du moins enrichi la langue des sensations — sauf pour le toucher, encore une fois ! Racine là-dessus en savait plus long, ou du moins cela paraissait tel parce que l’équilibre, dans son vocabulaire, s’était maintenu entre les cinq sens. Aujourd’hui notre vocabulaire n’est plus que d’orateur et de peintre, surtout de peintre, de peintre en surface : le volume, le poids, les richesses du tact en sont absents. Aussi, sans la littérature romantique, est-il possible que la peinture impressionniste ne fût jamais née : nous sommes un peuple d’écrivains, d’abord ; les autres arts emboîtent le pas, et comme c’est dans les autres arts que nous sommes le moins sérieux, parce qu’ils nous intéressent moins, c’est chez eux que les excès se font sentir davantage. On va jusqu’au bout de la théorie, et l’on soutient la théorie par de la littérature, encore ! Tandis que les écrivains qui ne sont qu’écrivains sont généralement retenus par le besoin qu’ils gardent toujours de la réalité concrète. Qu’on me pardonne le calembour : ce n’est plus qu’en littérature que les Français ont le sens du volume.
… Je me souviens d’un jeune impressionniste qui reproduisait patiemment, à coups de pastilles colorées, les traits d’un modèle féminin placé devant lui. Ces temps sont déjà périmés : on n’en était pas encore à ces effigies plates et déformées, imageries puériles qui n’ont même pas le mérite d’être innocentes et qui outragent la vérité du dessin par ignorance, pour commencer, ensuite par parti pris. Ce jeune impressionniste voulait modeler et n’y parvenait point, parce que sa technique même lui interdisait la profondeur. Un littérateur vint, qui mit le doigt sur sa toile : « Votre figure est à contre-jour, je le sais bien, dit-il, mais dans la réalité elle ne s’en arrondit pas moins ; cette joue, elle tourne, et je ne saurais l’oublier… Je voudrais que l’amant de cette femme conservât le désir de caresser son portrait : hélas ! il n’en sera rien. »
Toutes les légitimes revendications du toucher contre la vue, toutes les exigences de l’harmonie qui doit subsister entre le toucher et les yeux étaient dans cette seule phrase. Mais le peintre ne comprit point, et avait le droit de ne pas comprendre. Ni ce littérateur lui-même, ni personne au monde ne lui avait appris à sentir, à jouir des sensations du toucher. On ne sait plus…
O mon cher petit bol chinois, viens donc à mon secours ! Enseigne-moi ce qu’on n’enseigne plus. Je suis comme les autres, vois-tu, j’ignore tout, je ne suis qu’un débutant. Dis-moi lentement, doucement, tandis que je ferme les yeux, les causes intimes de ta voluptueuse et simple beauté, révèle-moi les mots par quoi s’exprimeront cette invisible et tactile beauté : car tout vient chez nous des mots…
LE CHEF-D’ŒUVRE
En 1927, l’illustre sculpteur Cailleterre était parvenu aux suprêmes limites de l’âge, mais aussi du génie. Il avait commencé, dès longtemps, à laisser voir sur les bronzes et les plâtres qui sortaient de son atelier les marques puissantes qu’avaient imprimées sur la glaise originaire, ses doigts inspirés et fiévreux. Et les critiques crièrent : « Œuvres définitives, œuvres sans pareilles qui conservent, dans leur achèvement, tout le charme, toute la saveur, toute la spontanéité d’une ébauche ! » Puis un jour, alors qu’il se préparait à envoyer au Salon, où on lui réservait toujours la place d’honneur, sa dernière statue, un goujat imprudent fit un faux mouvement, trébucha, rattrapa un bras, qui fut brisé. Ses camarades en ramassèrent les débris. Ils étaient tout pâles. Mais Cailleterre, dont pourtant les fureurs étaient aussi célèbres que le talent, cligna de l’œil :
— Cela est bien mieux ainsi, dit-il, paisiblement. Enlevez !
On enleva, on exposa, et ce fut un triomphe. Quelques personnes soupçonnaient déjà qu’en Cailleterre était ressuscitée l’âme des statuaires antiques : mais cette opinion était discutée. Dès qu’il eut montré une statue brisée, telle un antique, elle ne fit plus aucun doute. Dès lors Cailleterre entrait dans une voie nouvelle, bordée de trophées. Il la parcourut à grands pas, cueillant à chaque nouveau geste des palmes nouvelles. L’année suivante il cassa les deux bras à son « morceau ». Et après tout, puisque tel est le vocable usité, n’est-ce pas un devoir sacré de le justifier ? L’année suivante, il se contenta de ramasser les bras : ces bras eurent le succès le plus vif et le plus mérité. Et il fut enfin le grand cassiste iconoclaste. Il cassa des jambes, des têtes, des mains, des derrières, des devants, il cassa tout : et chaque fois qu’il cassait, sa gloire augmentait encore. Elle rayonna sur toute la terre, elle monta jusqu’aux astres ; et il eut, comme il convient, des imitateurs. Les Salons s’emplirent de débris épars et disjoints, puis les places publiques, les rues et les jardins. Les cités contemporaines prirent l’aspect de Pompéi et d’Herculanum, et même quelques architectes enthousiastes édifièrent des maisons déjà en ruines. Beau rêve romantique où les yeux s’égaraient avec une radieuse mélancolie. Cependant c’était toujours Cailleterre qui cassait le mieux, qui cassait le plus, qui cassait autrement. On fit des cours sur le cassement d’après ses ouvrages ; et tous les sculpteurs, devenus tous casseurs, nourrissaient à son égard autant de jalousie que d’admiration.
Beaucoup se découragèrent. D’autres, héroïquement, se mirent à tailler des pavés, et ils exposèrent des pavés, quelques-uns même en bois, ce qui fut considéré comme une grande originalité. Et c’est pourquoi ils furent appelés « cubistes ». Cette qualification leur fut imposée par le gouvernement, qui craignait une grève de véritables paveurs, lésés dans leur profession. Telle est l’origine de ce nom, que beaucoup ont oubliée, tant l’histoire de ces événements s’enfonce déjà dans l’ombre du passé.