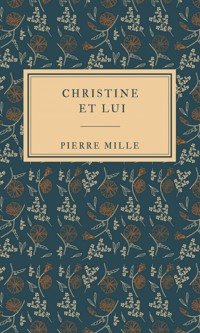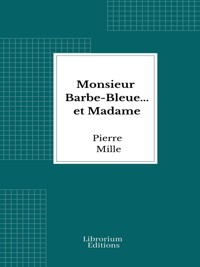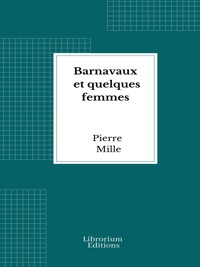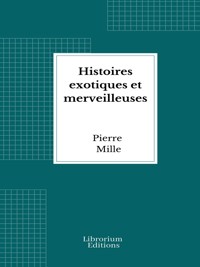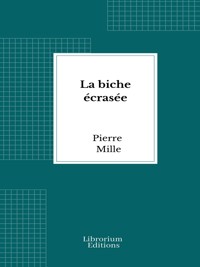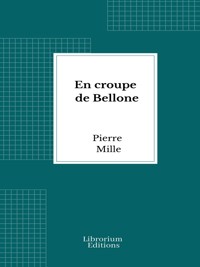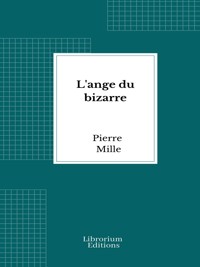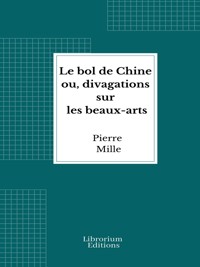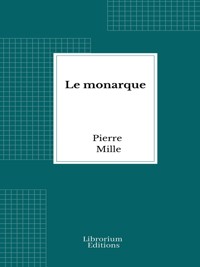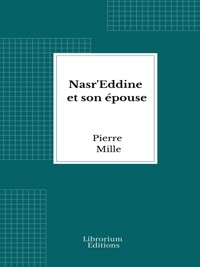1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La mère de Pamphile est chez moi. Encore qu’elle ait pris son air le plus sérieux, je lui dis qu’elle est charmante.
« Vous pouvez, dit-elle, vous dispenser de ces compliments, adressés à une femme qui a un fils de vingt ans.
— Cela ne fait que quarante…
— Trente-huit ! corrige-t-elle précipitamment… Mais il s’agit bien de ça ! C’est de mon fils, non pas de moi, que je viens vous parler.
— Pamphile a fait des bêtises ? Il veut en faire ?
— Non. Du moins, je ne crois pas : il prétend écrire.
— Écrire ? A qui ? A une dame ? Au Président de la République ?
— Ne feignez pas l’incompréhension. Il veut écrire. Devenir écrivain, homme de lettres, enfin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
L’ÉCRIVAIN
PARPIERRE MILLE
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385745059
L’ÉCRIVAIN
CHAPITRE II LES DÉBUTS DE PAMPHILE
CHAPITRE IV LA PROFESSION « SECONDE »
CHAPITRE V PREMIERS ESSAIS, PREMIERS ÉCHECS
CHAPITRE VI EXPÉRIENCES PERSONNELLES
CHAPITRE VIII DU JOURNALISME
CHAPITRE IX TYPES DE JOURNALISTES
CHAPITRE X POLÉMIQUES LITTÉRAIRES CONTEMPORAINES
CHAPITRE XI UNE OPINION POLITIQUE POUR L’ÉCRIVAIN ?
CHAPITRE XII ESPOIRS ET REGRETS
CHAPITRE XIII VACHES GRASSES ET VACHES MAIGRES
CHAPITRE XIV PUBLICITÉ LITTÉRAIRE
CHAPITRE XV LA CRITIQUE
CHAPITRE XVI PRIX LITTÉRAIRES
CHAPITRE XVII L’ÉCRIVAIN ET L’ARGENT
CHAPITRE XVIII LE MARIAGE DE L’ÉCRIVAIN. L’ÉCRIVAINE
CHAPITRE XIX SALONS LITTÉRAIRES
CHAPITRE XX L’ÉCRIVAIN ET L’ACADÉMIE
L’ÉCRIVAIN
CHAPITRE PREMIER CONSULTATION
La mère de Pamphile est chez moi. Encore qu’elle ait pris son air le plus sérieux, je lui dis qu’elle est charmante.
« Vous pouvez, dit-elle, vous dispenser de ces compliments, adressés à une femme qui a un fils de vingt ans.
— Cela ne fait que quarante…
— Trente-huit ! corrige-t-elle précipitamment… Mais il s’agit bien de ça ! C’est de mon fils, non pas de moi, que je viens vous parler.
— Pamphile a fait des bêtises ? Il veut en faire ?
— Non. Du moins, je ne crois pas : il prétend écrire.
— Écrire ? A qui ? A une dame ? Au Président de la République ?
— Ne feignez pas l’incompréhension. Il veut écrire. Devenir écrivain, homme de lettres, enfin.
— Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Et son père ?
— Cela ne nous déplaît pas… Mais à vous ?
— A moi non plus…
— C’est que vous avez toujours l’air de rire… On a bien tort de vous demander conseil !
— Je ne ris pas, je souris. Je souris de satisfaction. J’admire comme la bourgeoisie se réconcilie successivement avec toutes les forces qui sortent d’elle, mais dont pourtant, durant bien longtemps, elle s’est méfiée, qu’elle considérait comme en révolte ou en dissidence. Ah ! tout est bien changé, depuis seulement la fin du second Empire ! Au temps du second Empire jamais une famille bourgeoise, ayant la prétention de se respecter, n’aurait donné à sa fille un officier. On estimait que tous les officiers étaient « des piliers de café ». Ils devaient rester célibataires, ou se marier dans des familles militaires. La guerre de 1870 a changé cela. Tout le monde étant obligé de servir, on a pris l’habitude de l’uniforme, il n’a plus épouvanté.
« En second lieu la bourgeoisie s’est annexé les peintres. On s’est aperçu que Cabrion pouvait se faire de confortables revenus. Le prix de ses tableaux montait, il devenait un beau parti ; il a été reçu dans les salons. Mais les poètes et les romanciers ont attendu plus longtemps à la porte. Le poète, surtout, paraissait un animal particulièrement inquiétant, une malédiction pour ses géniteurs. Baudelaire écrivit là-dessus des vers magnifiques.
— En vérité ?
— En vérité. Je vous les lirai un autre jour…
« Trente ans au moins encore après que les peintres étaient entrés, ou pouvaient entrer, pour peu que cela leur convînt, dans le bercail bourgeois, les poètes, les romanciers, les journalistes ne fréquentaient guère que le café, comme jadis les militaires. C’est au café qu’a vécu la littérature, que s’est faite la littérature, jusqu’à la fin du symbolisme. A cette heure elle l’a déserté. Elle a conquis sa place dans le monde, elle en profite largement.
— Vous vous en plaignez ?
— Moi ? Non. J’estime même que ce n’est point uniquement par considération, par respect des sommes qu’il est permis d’attendre de leur profession — le métier de poète me semble condamné, sauf exception, à demeurer peu lucratif — que le monde accueille les écrivains. C’est d’abord pour s’en orner, pour s’excuser, par une parure intellectuelle, d’autres ostracismes, et de la vénération qu’il continue d’avoir pour l’argent. C’est aussi parce que la société contemporaine, se sentant ou se croyant plus menacée qu’auparavant dans ses assises organiques, éprouve le besoin de s’appuyer sur tout ce qui peut, le cas échéant, lui prêter son concours, tout ce qui a, en somme, la même origine qu’elle. Or, en France, il ne saurait y avoir d’écrivains, et depuis longtemps en fait il n’y en a presque pas, qui ne soient issus des classes supérieures ou moyennes, ou bien qui n’aient, ce qui revient au même, bénéficié de la formation intellectuelle réservée à ces classes : je veux dire celle de l’Enseignement secondaire.
— Expliquez-vous plus clairement. Il y a dans ce que vous dites tant de mots abstraits !…
— J’y vais tâcher. Je ne vous demande pas si Pamphile a été reçu à son bachot. Ceci n’a aucune importance. Mais il a passé par le lycée, n’est-ce pas ?
— Il sort de chez les Pères…
— C’est la même chose. On lui a appris mal le latin, pas du tout le grec, et, quoi qu’on en dise, à peu près le français et l’orthographe. Le français un peu mieux que l’orthographe et la ponctuation pour lesquelles les jeunes générations, je ne sais pourquoi, affectent un singulier mépris : mais on les exige de moins en moins dans la carrière littéraire. Par surcroît, sans même qu’il s’en soit douté, il s’est pénétré d’un ensemble de conceptions, d’idées, de principes sur quoi repose notre art depuis quatre siècles, et qui lui donne ses lois.
« Si Pamphile était le plus remarquable, même le plus génial des primaires, je vous dirais : « S’il n’a le diable au corps, qu’il ne se risque pas à devenir un écrivain. Notre langue est un outil merveilleux, mais de formation classique, j’oserai presque dire artificielle. Elle est une langue de société, une langue de gens du monde, une langue de collège où les murs sont encore tout imprégnés de latin, même quand on n’y enseigne plus le latin. Il n’en est pas ainsi en Russie, en Allemagne et dans les pays anglo-saxons. La littérature y est plus populaire et davantage le patrimoine de tout le monde. Gorki a été débardeur et cuisinier. Vingt romanciers américains ont fait leur éducation à l’école primaire, dans la rue et à l’atelier. Chez nous un Murger ou un Pierre Hamp resteront des exceptions… » Mais Pamphile a usé ses culottes sur les bancs d’un lycée : par une sorte de grâce d’état — je vous assure que je parle sérieusement — cela suffit. S’il a quelque chose dans le ventre il pourra le sortir sans trop de peine.
— Je vous remercie.
— Il n’y a pas de quoi… Et, dites-moi, ce jeune homme a-t-il des dispositions ?
— C’est-à-dire qu’il n’est bon à rien. J’entends à rien autre. Il ferait ça avec un peu plus de goût, comprenez-vous ? Ou plutôt moins de dégoût.
— On ne saurait mieux définir la vocation. Nos pères ont proféré des choses excessives sur la vocation, et le terme même, je le reconnais, y engage. Il suggère un appel irrésistible et secret, un démon furieux, un dieu sublime, ailé, qui vous emporte… que sais-je encore ! La vérité est que la vocation est un autre nom pour le principe du moindre effort qui régit de l’univers entier jusqu’aux plantes, jusqu’aux minéraux. La vocation consiste à faire ce qui vous donne le moins de mal, qui vous est le moins désagréable. Toutefois l’on peut admettre qu’elle se confond, dans certains cas, avec l’instinct du jeu, c’est-à-dire la recherche d’un plaisir qu’on se donne gratuitement. Un philosophe distingué, au début du siècle dernier, était conducteur d’omnibus pour gagner sa vie, et faisait de la philosophie pour se reposer. Mais ce sont là des exceptions. Le principe du moindre effort, la recherche de ce qui vous est le plus facile, suffit. Pamphile préfère écrire à tricoter des bas, ou à l’administration des contributions indirectes : il n’y a pas autre chose à lui demander.
— Mais croyez-vous qu’il réussira ?
— Je ne dis pas cela. Cette profession d’écrivain est l’une de celles — il y en a d’autres, quand ce ne serait que le commerce et l’industrie — où nul avancement ne se peut prévoir à l’ancienneté, où il n’y a pas de retraite. Tant pis pour lui s’il échoue. Il doit le prévoir et s’y résigner.
« Et il peut rester en route parce qu’il sera trop personnel, ou bien au contraire trop banal. S’il est trop personnel, qu’il se contente de l’estime d’un petit nombre. Il la trouvera toujours. Cela ne fera pas bouillir sa marmite, mais ceci est une autre affaire. S’il est seulement « ordinaire », son sort ne sera pas trop misérable dans la société contemporaine. Le journalisme, et même la littérature courante, exigent un personnel de plus en plus considérable. Il a des chances de se faire une petite carrière, un petit nom.
— Mais que doit-il écrire, pour commencer, comment publier ?
— Ah ! ça, par exemple, je n’en sais rien. C’est un des mystères les plus insondables de la profession et le secret est pratiquement incommunicable… Du reste, envoyez-moi le candidat… »
CHAPITRE II LES DÉBUTS DE PAMPHILE
Sur la recommandation de sa mère, Pamphile est venu me voir. Sa mise était d’une élégance raffinée, ce qui ne m’a point déplu : j’estime qu’un jeune homme doit être de son époque. Il y a trente ans, je me fusse méfié d’un candidat à la carrière des lettres habillé comme un homme du monde : la mode, dans la corporation, exigeait soit une certaine négligence, soit ce qu’on appelait de l’originalité : un gilet rouge, ou bien un jabot et des manchettes de dentelles. C’est que les gens de lettres vivaient au café, et loin des femmes. Aujourd’hui, vers cinq heures, ils sont dans un salon, où l’on en voit, et de charmantes. Le soir, ils se retrouvent dans un bar qui est en même temps un dancing, et où il en est d’autres — également charmantes, et, par l’apparence du moins, presque les mêmes.
Il est à noter du reste que, aux âges reculés où le petit univers littéraire vivait presque totalement à l’écart du grand univers féminin, il faisait profession de célébrer l’amour et d’adorer la femme. A cette heure que la communication est rétablie, la jeune littérature affecte volontiers de dédaigner l’amour et de remettre la femme à sa place. Ceci doit être encore affaire de mode.
« … Ainsi, dis-je à Pamphile, vous voulez devenir mon confrère. Vous m’en voyez très honoré… Quel genre comptez-vous aborder ? »
Pamphile me regarda gentiment. La jeunesse d’à présent a perdu sa timidité devant les ancêtres. Cela tient à ce que ceux qui sont revenus de la guerre ont vu en face des choses plus intimidantes ; ils ont conscience aussi de parler au nom de ceux qui sont morts. Enfin je soupçonne que la fréquentation et la conversation habituelle des femmes, plus commune de nos jours qu’autrefois, y est également pour quelque chose. Je ne m’étonnai donc point de l’assurance de Pamphile, bien qu’il demeurât muet ; il ne me répondait rien.
« La prose, les vers ? » fis-je pour l’encourager un peu, généralisant de façon si banale que cela me faisait rougir.
Son regard, qu’il conserve ingénu, malgré la possession qu’il a de lui, se chargea de quelque commisération :
« Vous savez bien (j’entendis qu’il signifiait : Vous devriez savoir…) qu’il n’y a plus de différence…
— Comment ?…
— Il ne s’agit plus de vers libre. C’est fini du vers libre… Mais les tendances actuelles intègrent la poésie, les images qui sont le propre de la poésie, dans la prose. Et la prose à son tour… »
Si l’on s’embarque dans la théorie, surtout avec les jeunes gens, on en a pour longtemps ; j’abrégeai :
« Pamphile, vous m’avez sûrement apporté quelque chose… Montrez !… »
Il ne se fit pas prier. Il était, j’imagine, venu surtout pour ça. Je lus d’un trait, parce qu’il n’y avait pas de ponctuation :
Contraction des pupilles Voronof — cocktail il y a trop longtemps que nous sommes là intense vie par en bas visages morts tournoi d’âmes dans le tournoiement éternité momentanée du désir.
« Ah ! Ah ! fis-je.
— N’est-ce pas ? acquiesça-t-il.
— Pamphile, je vais être franc. J’ai besoin que vous m’éclairiez un peu ce texte.
— Il est pourtant d’une limpidité suffisante… « Contraction des pupilles », ça veut dire que j’entre, venant de la rue obscure, dans un bar férocement illuminé. Je prends un cocktail très violent… Voronof, vous comprenez… « Il y a trop longtemps que nous sommes là », c’est ce que je dis au bout de cinq minutes. Au bout de cinq minutes on en a toujours assez, on n’est pas encore adapté. « Intense vie par en bas, visages morts », ce sont les pieds des danseurs, qui s’agitent, et leurs figures inertes. « Tournois d’âmes dans ce tournoiement » : qu’est-ce qui se passe, de danseur à danseuse, pendant qu’ils tournent ? Et alors : « Éternité momentanée du désir » se comprend tout seul. C’est le phare au bout de la strophe… Il n’y a pas de ponctuation parce que tout ça se plaque au même instant sur l’appareil cérébral.
— Excellent ! » déclarai-je.
Pamphile daigna paraître assez satisfait de mon approbation.
« Maintenant, dites-moi, poursuivis-je, si vous avez l’intention d’écrire comme ça toute votre vie ? »
Pamphile sourit doucement :