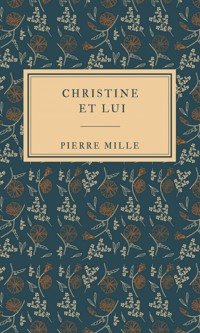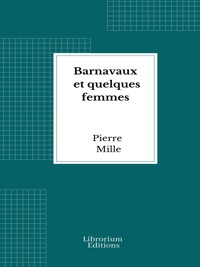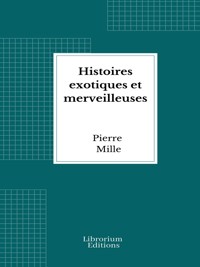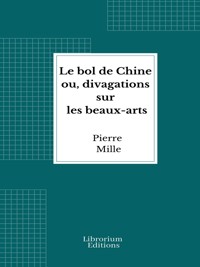1,29 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
— Mon père est là ? demanda Berthe Wilden, quand elle vit la porte s’ouvrir devant elle.
— Monsieur Fauli ? répondit la servante. Bien sûr, il n’est pas sorti de toute la journée.
« C’est vrai, songea Berthe. Je n’avais pas pensé que c’est aujourd’hui samedi. Père sort le moins possible ce jour-là. » Par un retour sur elle-même, elle éprouva un remords d’avoir oublié si vite, depuis son mariage, les habitudes religieuses de son enfance.
Elle ouvrit elle-même la porte du cabinet de travail. Le vieux Fauli était assis, inoccupé en apparence, devant son bureau. Le jour, tout près de mourir à cette heure, montrait, fortement accusé par la lumière qui tombait de la fenêtre, le profil ferme et net d’un vieux patriarche : des sourcils touffus, une lèvre épaisse sous la grande barbe blanche, un nez fort et busqué, élargi aux narines :
— Simcha, dit-il, ma Simcha !
Il lui donnait son nom secret, le nom oriental et réservé que les gentils ne connaissent pas, gardé précieusement pour la famille, et que Berthe n’entendait jamais prononcer sans un certain malaise, comme s’il eût contrarié son désir d’oublier des traditions pour lesquelles il lui semblait avoir perdu toute sympathie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
PIERRE MILLE
TROIS FEMMES
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385743246
TROIS FEMMES
UN DIVORCE
LA PASSION D’AMANDA MANGIN
LE PORTRAIT
UN DIVORCE
— Mon père est là ? demanda Berthe Wilden, quand elle vit la porte s’ouvrir devant elle.
— Monsieur Fauli ? répondit la servante. Bien sûr, il n’est pas sorti de toute la journée.
« C’est vrai, songea Berthe. Je n’avais pas pensé que c’est aujourd’hui samedi. Père sort le moins possible ce jour-là. » Par un retour sur elle-même, elle éprouva un remords d’avoir oublié si vite, depuis son mariage, les habitudes religieuses de son enfance.
Elle ouvrit elle-même la porte du cabinet de travail. Le vieux Fauli était assis, inoccupé en apparence, devant son bureau. Le jour, tout près de mourir à cette heure, montrait, fortement accusé par la lumière qui tombait de la fenêtre, le profil ferme et net d’un vieux patriarche : des sourcils touffus, une lèvre épaisse sous la grande barbe blanche, un nez fort et busqué, élargi aux narines :
— Simcha, dit-il, ma Simcha !
Il lui donnait son nom secret, le nom oriental et réservé que les gentils ne connaissent pas, gardé précieusement pour la famille, et que Berthe n’entendait jamais prononcer sans un certain malaise, comme s’il eût contrarié son désir d’oublier des traditions pour lesquelles il lui semblait avoir perdu toute sympathie.
— Père, dit-elle nettement, je viens te parler de mon mari.
Il fronça les sourcils. Jacques Wilden n’était pas un gendre selon son cœur. Berthe précipita ses paroles.
— C’est parce que les Américains n’achètent plus, dit-elle. On ne pouvait pas prévoir ça, le commerce des tableaux allait si bien ! Mais, pour soutenir les prix, il faut acheter, acheter toujours, et depuis six mois on ne vend plus rien.
Elle s’arrêta, n’osant encore dire le reste. Le vieux Fauli haussa les épaules. Des siècles de négoce, de spéculation, de persécution, ont habitué sa race à supporter la mauvaise fortune avec une sorte d’indifférence paisible. A manier héréditairement l’argent de façon régulière on apprend ce qu’ignorent les hommes issus, comme presque tous les Français de sang, de souche paysanne : que cet argent n’est qu’un signe, un symbole qui n’a pas de valeur par soi-même, mais par les possibilités d’échange et de combinaison qu’il permet. Et si l’on n’a pas toujours dans l’esprit ce principe fondamental : « Toutes les affaires sont mauvaises, quelques-unes deviennent bonnes », on perd courage à la première mauvaise affaire ! Mais aujourd’hui la vie est trop facile en France. Quand on compte déjà trois ou quatre générations d’aïeux qui n’ont pas connu l’âpreté de la lutte pour la vie chez les barbares méchants de Russie et de Pologne, ou, ce qui vaut mieux encore, les simples et gaies populations d’Alsace, on n’est plus bon vraiment qu’à se laisser fondre dans la masse nationale, à devenir un fonctionnaire sans responsabilité ou un politicien si on est d’intelligence moyenne ; un homme de lettres, un savant, un artiste quand on a le cerveau bien fait et une sensibilité suffisante. Mais, pour le commerce, c’est fini : on ne peut plus, on n’est plus digne !
Jacques Wilden n’était plus digne. C’était le jugement sans appel du vieux Fauli. Il prononça sentencieusement :
— Les commerces de luxe, ce sont ceux où on gagne ce qu’on veut sur la marchandise, petite fille, et aussi ceux qui s’engorgent le plus vite. On a toujours besoin de farine ou de coton. En temps de crise, les gens en achètent moins, mais ils en achètent tout de même, tandis qu’on ne peut plus leur vendre de tableaux. C’est le contraire, à ce moment : il faut avoir pris ses précautions, garnir ses poches, et acheter !
Il est peut-être bon de faire observer ici que, quelques années plus tard, pendant et après la guerre, les maximes de M. Fauli recevaient le plus éclatant démenti : les commerces de luxe bénéficièrent de la gêne universelle. Ceci tend à prouver qu’il n’y a pas plus de principes sans exception dans les affaires que dans les arts et la morale.
Berthe fondit en larmes.
— Ce n’est pas un conseil que je te demande, père. Il est trop tard : Jacques va être mis en faillite !
— Eh bien ?
Il allait ajouter, avec sa précision d’homme d’affaires : « Qu’importe ! C’est une solution. » Mais il rencontra le regard désespéré de sa fille, il eut pitié. Et puis, il ne fallait pas qu’elle eût porté jamais le nom d’un failli. Il demanda d’une voix lente, parce qu’il regardait déjà plus loin que l’immédiate question d’argent, et réfléchissait à des conséquences plus lointaines, à des combinaisons définitives :
— Combien…
— 170.000, dit Berthe, à voix basse.
Fauli eut un petit choc intérieur et haleta. C’était une somme ! Puis son regard se dirigea vers un calendrier accroché à la muraille, et qui cachait le tableau enluminé destiné à indiquer aux fidèles l’endroit vers lequel ils doivent se tourner pour la prière ; car il observait rigoureusement, malgré d’innombrables difficultés, à Paris comme jadis en Alsace, les rites de sa religion. Il songeait : « C’est une mitzvah, il faut obéir. » Ce mot signifie à la fois un commandement et une bonne action, car la religion juive, dans son rude formalisme, ne fait guère de différence. Il attira Berthe vers lui, l’assit sur ses genoux, comme lorsqu’elle était petite fille, et l’embrassa.
— Ma petite Simcha ! dit-il.
Elle lui rendit son baiser passionnément.
— O père, murmura-t-elle, que tu es bon !
Il répondit gravement :
— Je paierai, oui. Mais crois-tu que je sois si riche ? Il faut du temps, je prendrai des arrangements, j’étagerai les échéances. Seulement, c’est à une condition.
— Ah ! dit Berthe, qu’importent les conditions ! Tout ce que tu voudras.
Elle s’attendait à voir son père exiger que Jacques lui laissât surveiller ses affaires, contrôler ses opérations, et considérait déjà, en femme énergique et raisonnable, les avantages de la combinaison. Mais Fauli continua :
— Mon enfant, je vais te faire beaucoup de peine ; il faudra divorcer.
— Divorcer ! mais j’aime Jacques, père, je l’aime plus que jamais.
— Réfléchis, insista le vieillard. Tu es de mon sang, tu dois comprendre. Je paierai pour que ma fille ne porte pas le nom d’un failli, c’est entendu. Mais si tu ne divorces pas, ton mari aura fait dans six mois d’autres sottises que je ne pourrai plus payer, et que je ne paierai pas ! Wilden manque de chuzbah !
La chuzbah, c’est l’esprit d’entreprise, l’audace, ou même l’aplomb, tout ce qui sert à réussir. Le vieux Fauli ne voulait plus d’un gendre qui n’avait pas cette qualité, aussi nécessaire à un homme de nos jours que le courage militaire ou les muscles à un chevalier du moyen âge. Le divorce n’était pas non plus pour lui une institution neuve, peut-être antisociale, en tout cas de réputation douteuse : sa loi ne l’a jamais entouré de difficultés légales, elle n’y a jamais vu que la rupture naturelle d’un contrat naturel. Enfin, il se considérait comme un homme juste et confondait habituellement la justice avec la théorie des compensations et, pour ainsi dire, de l’expiation. Quand il avait monté la première marche d’un escalier du pied droit, il redescendait cet escalier en partant du pied gauche. Cette attention à mettre de l’équilibre dans les plus petites choses est recommandée dans les livres des vieux écrivains fromm, c’est-à-dire pieux, comme une excellente méthode pour parvenir à ne former que des résolutions d’une absolue sagesse. Il paierait donc les dettes de son gendre parce qu’il aimait sa fille, et obligerait sa fille à divorcer parce qu’il n’aimait pas son gendre. Les choses lui semblaient ainsi parfaitement arrangées.
Mais Berthe, maintenant, pleurait à chaudes larmes. Fauli, pour quelques instants, se sentit attendri. Il avait raison, il était sûr d’avoir raison : la prudence humaine imposait le divorce. Pourtant, causer une peine si rude à son enfant unique, à cette grande fille qui était sa seule affection au monde ! Et puis, il savait qu’on ne convertit pas un blessé, du premier coup, à l’idée d’une amputation. Il affecta d’hésiter :
— Enfin, nous verrons. Je t’ai dit de réfléchir, de parler à Jacques. Qu’il vienne me voir, qu’il m’apporte ses livres, nous causerons. Du reste, demain je lui enverrai une note, cela vaudra mieux.
Il répugnait à prendre une plume le jour du sabbat. La nuit, durant cette conversation, était presque entièrement venue. Sa fille, pour lui donner de la lumière, allongea la main vers le commutateur électrique. Subitement, comme paralysée par une injonction venue des profondeurs de son inconscient, elle la laissa retomber. Fauli eut dans les yeux un éclair de satisfaction.
— Sonne la goyé, petite, dit-il doucement.
On ne doit pas allumer de feu un samedi, et c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des serviteurs appartenant à une autre religion, qui puissent rendre aux fidèles l’indispensable service de frotter une allumette ou d’appuyer sur le bouton d’un commutateur. Berthe s’était rappelée à temps, devant son père, l’antique interdiction rituelle. La joie de Fauli en fut si grande que, malgré l’embarras d’argent qu’il allait s’imposer, il se prit à sourire.
— O père, dit Berthe, espérant profiter de cet instant de faiblesse, attends un peu pour le divorce : nous nous aimons tant ! Si tu savais…
La figure de Fauli se raidit de nouveau.
— Simcha, dit-il, ce que j’ai dit est dit. Va, petite.
Certaines volontés s’imposent si puissamment qu’elles suppriment toute réflexion, toute résistance immédiate chez ceux qu’elles violentent. Ce ne fut qu’en voiture, comme elle rentrait chez elle, que Berthe sentit l’horreur du dilemme où l’enfermait son père. Jacques, énervé par l’attente, avec cette figure froide et fermée qu’ont les hommes dans l’inquiétude, lui cria :
— Eh bien ?
— Nous sommes perdus, mon ami, perdus, dit-elle.
Et tandis qu’elle lui répétait la conversation qu’elle venait d’avoir, de ses yeux pleins de larmes elle regardait son mari, elle admirait sur son visage et dans les mouvements de son corps tout ce qui le lui avait fait aimer : une grâce un peu frêle, des cheveux châtains, des traits où les caractères orientaux s’étaient atténués presque au point de disparaître. Son nom même trahissait ce lent travail d’assimilation qui s’était exercé sur les siens, avant lui. Un siècle auparavant, il se fût appelé Jacob Wildenberg. Il était maintenant Jacques Wilden, un Parisien pareil aux meilleurs Parisiens, élégant, voluptueux, très intelligent et amolli. Oui, son père avait raison, il n’était plus taillé pour la lutte. Mais de cela même qu’elle était fière, c’était pour tout cela qu’elle l’avait voulu, qu’elle l’avait pris. Elle cria :
— Mon chéri, je ne puis pas te perdre. Je ne veux pas.
A mesure qu’elle avait parlé, les traits de Jacques Wilden avaient repris une telle insouciance, un air d’ironie si détachée qu’elle eut peur.
— Tu consentirais ? fit-elle.
— Évidemment, dit-il, c’est embêtant, c’est tyrannique… Il se mêle de ce qui ne le regarde pas… Mais enfin, s’il n’y a pas moyen de faire autrement…
— Oh ! cria-t-elle, épouvantée.
— Qu’est-ce qui nous empêche de divorcer, et de se remarier une fois l’affaire faite, continua-t-il. C’est une opération à terme. Elle est excellente.
C’était un plan de souplesse, d’astuce et presque de traîtrise, l’idée de malice d’un homme qui, des lois, d’où qu’elles viennent, ne prend plus rien au sérieux. Mais Berthe aimait. Elle réfléchit seulement :
— Jusqu’au terme, mon aimé, comment ferons-nous ?
— Bête ! fit légèrement son mari.
C’est ainsi que s’engagea la lutte entre M. Fauli et son gendre. Toutefois elle eut des suites imprévues.
Le lendemain Fauli s’en fut dîner, comme tous les dimanches, rue Denfert-Rochereau, chez son beau-frère Fischer, l’astronome. Il lui dit en entrant — c’était une petite manifestation qu’il manquait rarement :
— Bonjour, Jacob !
Non seulement pour les feuilles qui mentionnent quelquefois ses travaux, et pour ses confrères du monde entier qui lisent ses communications, mais pour sa femme et ses enfants, le prénom de Fischer est James. Il n’importe : pour le vieux Fauli, ce sera toujours Jacob. Il y tient : James, selon lui, est une concession assez plate faite au Goïm, et il ne saurait l’approuver, pas plus que bien d’autres choses dans la maison. Son beau-frère et sa sœur ne pratiquent plus depuis longtemps. Leurs garçons, toutefois, ont été circoncis, mais par un médecin, et qui même était un gentil ; et ainsi, pensait Fauli, cela ne compte point : car les cérémonies du rituel et le caractère religieux de celui qui les accomplit, autant que l’acte même, sont indispensables pour faire de la circoncision une chose qui vaille, qui consacre la progéniture des fils d’Israël à Jéhovah ; à défaut de ces formules solennelles il n’y a plus là qu’une simple opération chirurgicale. Et, bien entendu, le ménage Fischer ne se souciait nullement de respecter à sa table les prescriptions du Deutéronome et du Lévitique, précisées, aggravées par le Talmud. Pour que Fauli n’en fût pas réduit à jeûner presque complètement quand il venait chez elle, madame Fischer lui faisait régulièrement la grâce d’un rôti de bœuf provenant de l’étal d’un boucher de la rue d’Hauteville, réputé pour ne donner à sa clientèle que de la viande saignée selon les règles, les entrailles de l’animal ayant été inspectées par le rabbin sacrificateur. Mais, sans doute pour affirmer leur parfaite libération religieuse, le plat d’entrée chez les Fischer était, de fondation, chaque dimanche, des nouilles au jambon. C’est alors que l’on pouvait distinguer par quels progressifs degrés la vieille foi s’évanouit dans les familles israélites transplantées dans notre sceptique Occident. Fauli repoussait d’un signe ce mets impur, et pour se donner une contenance en même temps que pour apaiser son appétit, attirait vers lui un ravier de hors-d’œuvre orthodoxes, placé tout exprès à sa portée. La cousine Gonzalès-Herrera — encore une sœur de Fauli — plus désaffectée, mais non pas entièrement, écartait avec soin, du bout de sa fourchette, les petits carrés de la viande interdite, et, croyant de la sorte rendre un suffisant hommage aux principes, portait sans remords à sa bouche ces longs filaments de pâte, imprégnés de la graisse abominable. C’était elle qui choquait le plus son frère. Il préférait encore la calleuse indifférence de son gendre Wildenberg, dit Wilden, de son beau-frère Fischer et de madame Fischer, qui, sans souci des injonctions mosaïques, engloutissaient impavidement les nouilles, le jambon, et la graisse.
Mais il était reconnaissant à sa fille Berthe — dans ce milieu elle était Berthe, et non plus Simcha — de s’abstenir en sa présence (il savait bien, hélas, que loin de ses yeux elle se comportait différemment) de toute infraction à ces antiques lois qui contribuèrent si longtemps, et selon lui salutairement, à séparer des chrétiens les fils de Juda, les empêchèrent, malgré leur petit nombre, d’être absorbés par eux, préservèrent la pureté de la race, firent leurs familles fortes et unies. Fauli croyait fermement à la mission des juifs sur la terre. Et, au bout du compte, tous ceux qui étaient là, sauf les chrétiens, — il y en avait un ou deux — y croyaient également, bien qu’ils ne s’entendissent point sur ce qu’est cette mission.
Chose étrange, Fauli, bien qu’il souffrît parfois de l’antisémitisme des chrétiens et qu’il leur en voulût de cet antisémitisme, n’éprouvait nulle antipathie à l’égard du christianisme. « En quoi cette religion nous gêne-t-elle, pensait-il, puisque, seule de toutes les autres religions au monde peut-être, la vieille foi de Moïse se refuse depuis des centaines d’années à toute propagande parmi les gentils, puisqu’elle est arrivée pratiquement à considérer que pour faire un juif il ne suffit pas d’obéir à l’ancien testament et au Talmud, et qu’il faut encore être juif de race ? » Homme d’affaires avant tout, il résumait ainsi son opinion : « Il faut des juifs et il faut des chrétiens. Ils se complètent ; et je consens même à admettre qu’il faut plus de chrétiens que de juifs. C’est le malheur de la Pologne de compter trop de fils d’Israël : ils se nuisent les uns aux autres, et ils nuisent aux chrétiens. Mais, si je reconnais bien volontiers que tout juif doit avoir ses chrétiens, pourquoi les chrétiens ne comprennent-ils pas que chacun d’eux devrait avoir son juif ? Si nous étions restés en Espagne, s’il y avait des juifs au Canada, ces pays-là ne seraient pas où ils en sont. Nous sommes comme le sel dans la soupe. »
Il y avait une autre raison que Fauli ne se donnait point : c’est que, resté profondément religieux, il respectait dans le christianisme, dans le catholicisme surtout, une religion dont l’enseignement, les dogmes, tout un ensemble enfin de réactions sentimentales chez ses fidèles, en présence des problèmes de la vie et de la mort, rapprochaient ceux-ci de sa propre attitude. Il ne se le disait point parce qu’il n’y réfléchissait pas. Mais c’était là l’opinion nettement exprimée d’un homme mal fait, laid et brun comme un Maure, aux beaux yeux limpides d’illuminé, qui s’appelait Lévy, tout simplement, le docteur Abraham Lévy, et tomba, en cure-dents, après le dîner. Ce petit praticien, médecin dans le quartier du Cherche-Midi, encore plus fromm, plus pieux que Fauli lui-même, ne niait point que la stricte observance des rites, qu’il persistait à s’imposer, avait nui à sa carrière, l’avait laissé, à la fin de ses jours, un pauvre homme. Comment se faire connaître, se créer des relations indispensables, lorsqu’on ne peut manger à la table d’un chrétien, entrer même dans un restaurant qui n’est pas kosher ? Et cependant il recrutait presque toute sa clientèle dans les congrégations religieuses — surtout les couvents de femmes qui se trouvent en si grand nombre entre la rue du Cherche-Midi et la rue de Babylone. Ces pieuses filles n’avaient confiance qu’en lui, et le vénéraient. A quelque chose de commun et d’indicible elles et lui s’étaient reconnus. « Elles sont si bonnes ! disait-il. Voici quelques mois, comme j’allais partir en voyage, je passe chez les sœurs du Saint-Sacrement. J’avais mis dans la poche de mon veston mes phylactères, les bandelettes dont il convient de se couvrir pour la prière du matin. Quand j’ai tiré mon carnet pour écrire une ordonnance, ces phylactères sont tombées sans que je m’en pusse apercevoir. Elles m’ont bien manqué : par bonheur j’ai pu m’en procurer d’autres à Carpentras… Et cela fait que, maintenant, j’en ai trois ; celles-ci, celles que j’avais perdues, et que les bonnes sœurs m’ont rendues, et d’autres encore, et si belles ! Ce sont les sœurs qui les ont brodées en mon absence, sur le même modèle, avec les lettres hébraïques, toutes les formules sacrées ; elles me les ont données en disant : « Il y avait si longtemps que nous cherchions ce qui pourrait vous faire plaisir, docteur !… » Ah ! comme je m’entends bien avec elles, comme on se comprend ! Ce serait dommage, si elles n’existaient pas, et je soupçonne qu’elles pensent que ce serait dommage, si je n’étais pas ce que je suis. »
Par contre, James Fischer et sa femme se déclaraient violemment anticléricaux, ce qui choquait Jacques Wilden et sa femme, aux yeux de qui cette attitude paraissait un regrettable défaut de correction mondaine. C’était là un point sur lequel le mari et la femme marquaient le plus complet accord. Ils se seraient crus amoindris s’ils n’eussent pénétré dans la société des Français, des vrais Français, qui sont nés catholiques et le sont restés, en somme, beaucoup plus qu’ils ne s’en doutent, même quand ils se figurent être devenus indifférents. Les Wilden se sentaient bien plus fiers de recevoir un chrétien que de leurs plus belles relations et de leurs plus brillantes alliances dans le monde juif. C’est pourquoi ils fréquentaient, le plus qu’il se peut, des journalistes, des artistes et des gens de lettres, en évitant toutefois ceux qui appartiennent à leur confession : car cette espèce d’hommes va partout, et ils espéraient un jour, par l’entremise de leur amitié, atteindre jusqu’à la vraie société française, la seule qu’ils estimassent digne de ce nom, l’aristocratie titrée, conservatrice et catholique.