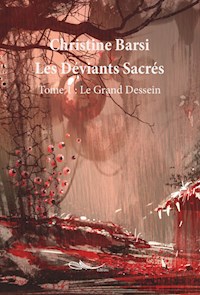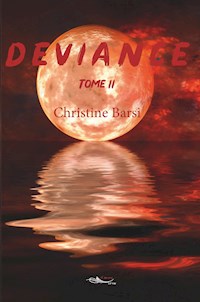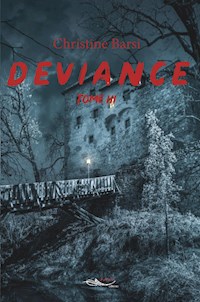
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Déviance
- Sprache: Französisch
Crois en moi ! Les mots l’atteignaient jusque dans ses rêves. Que signifiaient-ils pour s’imposer à elle tels des leitmotivs qui n’en finissaient plus de dérouler leur trame inepte. Tel un mot-clé l’incitant à se reprendre en main. Le rappel d’un évènement dont elle savait qu’il existait, mais dont elle n’avait plus aucune réminiscence. Elle avait peint une scène s’y rapportant, sur une esquisse toilée mise de côté, une nuit qu’elle ne parvenait pas à dormir alors que l’expression ultime et désespérée lui hurlait de se souvenir. Parfois, même l’époque dans laquelle elle vivait se mêlait à d’autres censées n’avoir jamais été. Mais chaque fois, l’antique castel sur les berges de la Water of Leith y apparaissait.
Pour une raison obscure, la vieille demeure sur son socle rocheux la fascinait. Elle n’osait plus franchir les grilles rouillées de son parc en dormance ni l’approcher plus près que le second coude de la rivière après les chutes. Ce n’était pas tant son abandon ou l’état de dégradation de ses hauts murs et dépendances qui l’intriguaient, qu’une espèce d’aura qui repoussait naturellement ceux qui s’efforçaient de l’aborder et d’enfreindre la menace implicite des ombres et de la brume qui la cernaient. Son futur était là, elle le savait. Un jour ou l’autre, il la rattraperait. Une légende courait à ce sujet, une légende qui parlait d’un vampire et de sa proie.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Christine Barsi est une scientifique et une artiste qui a fait des études en biologie et science de la nature et de la vie, cherchant à comprendre ce qui anime le genre humain. Elle travaille dans les ressources humaines, l’informatique et l’ingénierie, écrivant en parallèle depuis 1998 des romans de science-fiction et de fantastique, avec à son actif six romans publiés à compte d’éditeur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christine Barsi
Déviance
Tome 3
Les Aulnes Jumaux
Du même auteur
– Déviance, roman
5 Sens Éditions, 2017
– Teralhen (tome 1 du Cycle des Trois Marches), roman
5 Sens Éditions, 2017
– Mutagenèse (tome 2 du Cycle des Trois Marches), roman
5 Sens Éditions, 2018
– L’éveil du Dieu Serpent, roman
5 Sens Éditions, 2018
– Solas, roman
5 Sens Éditions, 2019
– Déviance 2 (Renaissance), roman
5 Sens Éditions, 2019
À tous mes lecteurs et lectrices qui m’ont vivement encouragée à poursuivre l’histoire de Déviance.
Notamment mes amies, Félicie Gantois et Patricia Graal, ainsi que ma sœur Agnès Larby.
À mon mari, enfin, qui m’accompagne continûment dans tous les chapitres de notre existence commune, afin que je puisse me consacrer à la réécriture.
À tous mes amis des réseaux sociaux qui ont été présents, pour moi, ces deux dernières années, et ont donné du sens à mon acharnement.
À mes écrivains fétiches qui m’ont inspirée dans ce domaine du fantasque et du merveilleux.
Prologue
Extrait du tome II de Déviance : Renaissance, par Stefan Henry et Peter Mackrey :
« Mon esprit vagabondait ainsi qu’un adolescent en mal d’aventures. Je le laissais courir devant, puis le rattrapais en le raisonnant. »
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore1 des Mackrey :
« Crois en moi ! Les mots l’atteignaient encore, jusque dans ses rêves. Que signifiaient-ils pour s’imposer à elle chaque nuit, puis à chacun de ses réveils. C’était comme des leitmotivs qui n’en finissaient plus de dérouler leur trame inepte. C’était comme un mot-clef qui devait l’inciter à se réveiller et se reprendre en main, mais dont l’opérationnalité n’avait plus de fonctionnel que le concept. Le rappel d’un évènement dont elle savait qu’il existait, mais dont elle n’avait plus aucune réminiscence. Fallait-il donc s’y appesantir, encore et encore, ou bien abandonner cette quête effrénée d’un sens qui lui échappait, lui échapperait toujours ? Elle avait peint une scène s’y rapportant, sur une esquisse toilée mise de côté, une nuit qu’elle ne parvenait pas à dormir alors que l’expression ultime et désespérée lui hurlait de se souvenir. »
La jeune femme cheminait le long de la Leith River, posant son regard sur les berges envahies de ronces et de bois mort. Elle s’était échappée de la demeure ancestrale, pour quelques instants de solitude lénifiante. Le printemps renaissait timidement. Quelques bourgeons pointaient des branches des arbres dénudés. Sur la Water of Leith2, la glace avait fondu et l’eau et les algues reprenaient vie progressivement en une chorégraphie fluide et libérée sans cesse redéfinie.
Au centre de la rivière, cernant des amas de roches ou de bois flottant, les tournoiements sans fin donnaient le vertige à force de les fixer en une tentative pour comprendre leur dynamique subtile. L’empire liquide se brouillait avidement dans le courant, tandis que les chevelures végétales se mouvaient souplement sous les ondes pulsantes. Des bribes de scories non identifiées renaissaient dans leur sillage, vagabondant sans repos en se mêlant aux couches cristallines sans parvenir à freiner le flot impétueux, irrésistible.
Vers quels lieux inconnus ? songeait l’observatrice en frissonnant.
Aurait-ce été agréable de se laisser ainsi guider, en sachant que sa propre vie ne lui appartenait plus ? Ses lèvres ébauchèrent une moue craintive avant même qu’elle ne relève la tête en direction des habitations en surplomb de la berge, de ce côté-ci de la rivière.
Il était tôt, ce matin. Là-bas, au Vieil Aulne, la maison de famille des Cameron, le petit déjeuner avait été servi aux pensionnaires qui ne tarderaient plus à vaquer, chacun, à ses occupations de la journée.
Sa tante Moira devait achever de nettoyer la vaisselle. Une brève seconde, la promeneuse eut un remords en songeant qu’elle aurait dû être auprès de celle-là afin de l’aider dans les tâches domestiques de la maison. Seulement parfois, comme ce matin, le poids de la communauté qu’ils constituaient lui pesait, et elle ne souhaitait rien tant que de leur échapper. La musique claire de la Water of Leith la fit émerger de ses pensées ; son regard attiré par la sauvage beauté des lieux se perdit sur l’autre berge pour revenir presque malgré elle de ce côté-ci, vers le manoir solitaire, là-bas, loin en amont.
Pour une raison obscure, la belle demeure sur son socle rocheux la fascinait depuis toujours. Mais alors que son esprit audacieux l’entraînait régulièrement aux découvertes, la jeune femme n’avait jamais tenté jusque-là – du moins pas depuis qu’elle avait atteint le seuil de l’âge adulte – de franchir les grilles rouillées de la propriété en dormance ni l’approcher plus près que le second coude de la rivière après les chutes, au-delà desquelles se trouvaient les fondations de la mystérieuse demeure. Ce n’était pas tant son abandon ou l’état de dégradation de ses hauts murs et dépendances qui l’intriguaient, qu’une espèce d’aura qui repoussait naturellement ceux qui s’efforçaient de l’aborder et d’enfreindre la menace implicite des ombres et de la brume qui la cernaient.
De formidables remous agitaient le lit fluvial, à une centaine de mètres, et quelques vieux poissons, des truites brunes en quête de souris ou de grenouilles, et quelques ombres3 gris argent, jaillissaient des eaux comme s’ils étaient montés sur ressorts. Une danse de la faune, en ce tout début de printemps.
Aucune des tribus d’enfants ou d’adolescents qui grouillaient dans le coin, à la recherche de quelques équipées, ne s’y aventurait non plus, préférant envahir les moulins déchus alentour. Il y en avait quelques-uns le long des bords de la Water of Leith, mais uniquement deux dont la grande roue à aubes tournait sans discontinuer, frappée par les eaux vives. Ceux-là fournissaient leurs charges de farine pour quelques passionnés des anciens façonnages.
De nouveau perdue dans ses pensées volatiles, de nouveau attirée par l’antique demeure et son parc en friche qui descendait jusqu’à la rive en détours sinueux, Manille redéployait son regard.
Un volet battait contre la façade, laissant deviner un coin de fenêtre maculé par la saleté accumulée depuis des années. Dans le parc, un vieil aulne se dressait à proximité de l’entrée. Comme pour leur propre logis. C’était curieux que de tous les cottages sur la Water of Leith, seules leurs deux maisons possédaient cette même essence d’arbre. D’une certaine manière, la présence de l’Ancien les reliait étrangement, songea la promeneuse qui percevait les pulsations de son cœur redoubler singulièrement dans sa poitrine.
Après un dernier coup d’œil suspicieux, frissonnant d’une crainte futile, la jeune femme finit par faire demi-tour en se convainquant de son courage, se convainquant qu’elle ne s’éloignait de l’endroit que par raison et non par cette peur insidieuse qui l’envahissait parfois.
D’autres maisons se succédaient le long de la berge ; de jolies propriétés bien vivantes, aux jardins endormis qui n’attendaient plus que le renouveau de l’éveil printanier.
Manille pouvait mettre un nom sur chacune d’entre elles, depuis le temps qu’elle avait rejoint la région et retrouvé sa tante.
Un instant, les rires de nombreuses générations d’enfants ayant joué le long de ces bords hospitaliers éclatèrent dans sa tête comme un rappel inconscient de quelques scènes de son esprit fécond. Elle se tourna, comme happée par ces rires imaginaires, puis secoua la tête en reconnaissant cette propension qu’elle avait de plonger dans un passé qu’elle n’appréhendait pas, mais qui s’imposait à elle à intervalle. Un passé qui aurait eu ses portes dans une tranche du futur. Peut-être, devrait-elle abandonner la peinture au profit de l’écriture ? Sa créativité l’envoyait parfois beaucoup trop loin dans les concepts, pour les gens des patelins alentour. Moira avait raison. Elle ferait mieux de dormir davantage, plutôt que de rêvasser à longueur de journée en se nourrissant de perceptions qu’elle seule touchait presque du doigt. Manille avait des amis, par ici : la maison, là-bas, avec son jardinet bordé d’une clôture de bois noueux ; une autre, à quelques mètres, avec ses étages lumineux et sa cour envahie des mauvaises herbes non coupées d’avant l’hiver. De simples relations aussi, des voisins de sa tante amoureux de la paix imprégnant les abords de la Water of Leith.
Quand elle approcha du vieux moulin à la retraite, Manille l’observa en coin, tentée de pénétrer ses murs courbes et décatis menaçant de s’écrouler, de sentir la paille et les relents humides de farine rancie. Mais elle n’avait plus le temps pour s’attarder ainsi.
Avec un regret étouffé, prenant soin de placer les pieds entre les éboulis coulants au bord de la rivière, elle enjamba un monticule de terre puis emprunta l’un des escaliers vermoulus montant au niveau de la passe amenant à la rangée d’habitations désuètes de ce secteur.
Bientôt, elle parvenait à la grande maison ancestrale que Moira avait transformée en pension de famille pour quelques couples de gens tranquilles, au cœur du quartier de Dean.
Chapitre I : La crypte
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « La mort n’a sur moi aucune emprise réelle, hormis le poids des années qui pèsent sur ma conscience ainsi qu’un leitmotiv qui jamais ne s’achève. Mais plus que tout, me pèse cette détention qui me tient éloigné de la lumière, de toutes les lumières qui sont synonymes de la moindre parcelle de vie en dehors de la mienne. »
Il dormait, profondément enveloppé d’une obscurité immanente, immergé dans le bain insondable de ses pensées qui cognaient à l’arrière de son crâne sans lui concéder la paix à laquelle il aspirait. Les ombres et les pierres de l’antique demeure se refermaient sur lui comme un embaumement naturel auquel il ne parvenait pas à s’arracher.
Jamais.
Même alors qu’il sentait peser au-dessus de lui, comme en cet instant, le poids urgent de pensées vaguement familières bien que divergentes des siennes. Les ombres toujours, et cette volonté inconsciente de rester accrocher au tombeau qui l’isolait et dont les parois le cernaient chaque jour davantage. Il aurait souhaité qu’elles se dissolvent, au contraire.
Comme ce matin.
Une vague de frustration infinie le traversa de manière fugitive. L’impulsion de ses membres pour faire cesser cette immobilité-prison ne fut pas suffisante, néanmoins, pour l’amener à transgresser la loi qui le tenait dans ses serres. Depuis combien de temps ?
Depuis combien de temps, cet enterrement morbide au sein de la roche de son caveau ? Si seulement, il pouvait se convaincre de sa mort. Quand il s’éveillait du cauchemar et réalisait cette sensation dans son corps, ces tiraillements, cette rigidité de ses organes qui l’effrayait, il vagissait silencieusement, pris dans la nasse de cette peur immonde et insensée.
L’unique interrogation qui s’imposait, chaque fois, et de plus en plus puissante : était-il mort ou vivant ? Quel était cet état insolite et morbide qui le retenait entre les deux mondes ? Il ne comprenait pas.
Parfois, un mouvement lascif agitait les ombres de sa demeure, les îlots fluctuants de la poussière, faisait frémir ses paupières tandis que ses pensées surgissaient de leur gangue d’éternité. Lui indiquant que peut-être, il n’était pas seul dans ce soupirail ou cette cave oubliée de tous comme du temps. Pourrait-il jamais s’arracher à ce tourment des spéculations, à cette épreuve des doutes et de l’expectative ? De cet état de non-vie qu’il soupçonnait ?
Il éprouvait le sentiment détestable que l’existence, au dehors, poursuivait le cycle des saisons en déphasage total avec la sienne, qu’il se tenait aux portes d’un monde qui ne le reconnaissait pas et le rejetterait à la moindre tentative d’intrusion, et qu’un autre de ces mondes n’aurait rien tant aimé que l’accueillir à jamais, mais dont il ne savait par quel mécanisme ou quel obscur objectif, lui-même se soustrayait délibérément.
Son corps eut un soubresaut de protestation lorsque l’élément de vie qui l’avait préalablement éveillé sortit de son champ de perception ; comme chaque fois. Un fil subsistait cependant. Un fil ténu dont il ne dépendait que de lui de le maintenir et de le remonter, jusqu’à parvenir enfin à la chose ou l’être ou l’état qu’il captait depuis sa tombe avec une énergie désespérante. L’être ou l’état ou la chose aurait dû savoir qu’il était là, lui-même, soumis à sa volonté et à son influence surnaturelle. Oui, l’autre aurait dû savoir, quelle que forme il ait empruntée pour le percevoir, et l’éveiller de cette façon douloureuse et mortelle.
Chapitre II : Moira Denisson
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « Quand l’art nourrit l’être plus que de raison, c’est qu’il se place au-delà des contingences terrestres qui n’ont plus guère de rôle que le subsidiaire. »
Moira Denisson songeait à sa nièce avec un sentiment de sérénité tranquille. Son apparition quelques mois seulement après la mort de son mari, voici onze années, avait été un miracle dans son existence bien ordinaire. La voir surgir dans l’univers feutré de la pension qu’elle avait ouverte afin de gagner sa vie avait été un véritable soulagement. La petite avait neuf ans alors, et avait déboulé dans la maison tel un chaton esseulé et amaigri qu’il avait fallu nourrir et réconforter.
Aujourd’hui, Moira se doutait que les charges de la pension pesaient sur la jeune femme, parfois beaucoup trop lourdement ; en dépit de ses encouragements à ce qu’elle s’oriente vers sa propre voie, Moira n’était pas parvenue à convaincre sa nièce de quitter le Vieil Aulne, se marier et fonder sa propre famille. Manille prétextait ne pas vouloir de cette voie pour elle, et ne pas souhaiter abandonner sa tante alors que cette dernière constituait son unique parenté désormais. L’aider à la pension résumait ce qu’elle ambitionnait par-dessus tout.
Heureusement que son école d’art apportait à la jeune femme ce qu’elle ne trouvait, évidemment pas, dans cette maison des courants d’air que se partageait un certain nombre de célibataires ou de familles en fonction des mois et des années.
Moira avait inscrit sa nièce à cette école, le lendemain du jour où elle l’avait découverte en train de peindre une aquarelle dans le secret du grenier solitaire, là-haut, au-dessus des chambres des pensionnaires, avec quelques parcelles de teinture récupérées elle ne savait où et de pinceaux écorchés. La sensibilité que traduisait l’aquarelle ébauchée sur une toile jaunie l’avait persuadée des dons particuliers de sa nièce. Quelques semaines plus tard, Moira l’emmenait dans la Old Town4, et lui faisait pénétrer l’antre d’une école privée d’art et de littérature prisée des amateurs de la vieille cité. Depuis, sa nièce partageait son temps entre les tâches inévitables et prenantes de la pension, ses cours de peinture et de littérature et ses promenades avec ses camarades.
Moira Denisson ressassait ses souvenirs, quand elle entendit la porte de l’entrée s’ouvrir sur le pas dynamique et reconnaissable de sa nièce.
Chapitre III : Grassmarket
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « Les toiles des peintres notoires sont autant un luxe qu’une nécessité pour le fervent admirateur de cet art en plein essor. Ces toiles sont les ferments qui l’incitent à se surpasser toujours. On les trouve, de fait, sur les marchés populaires comme dans les musées. »
Levées très tôt, ce matin-là, Manille et sa tante montaient vers le quartier de Grassmarket, dans la Old Town, afin de se réapprovisionner. Le jour s’ébauchait à peine, la brume imprégnait encore la ville de ses nuées de voiles opaques. Après avoir pris par Queensferry street, selon leur habitude, elles empruntèrent un tronçon de la Lothian Rd puis King’s Stables Road5 et ses écuries royales, heureuses de la vue sur le château. Certains jours, au gré de leur humeur, en dépit du détour, il leur arrivait de préférer West Port et ses augustes demeures.
Manille goûtait particulièrement l’activité conviviale des écuries avec leurs odeurs de paille, de crottin, les ébrouements bruyants des chevaux. Le heurt des sabots sur les pavés et celui des roues des attelages. Les sons parvenaient d’abord atténués avant de se faire plus proches et plus présents avec la distance qui s’amenuisait ; puis à l’inverse, les sons s’assourdissaient progressivement jusqu’à décroître avec l’éloignement, alors qu’elles longeaient Castle Roc, par la gauche, pour finalement atteindre Grassmarket au sud, un peu plus tard ; le pouls de la cité et son foisonnement industrieux dans le quartier.
Manille appréciait toujours autant l’effervescence des jours de marché au cœur de la ville historique. Ses étals et sa foule, les badauds curieux et nonchalants, les marchands affairés et les artisans. Son œil d’artiste captait des scènes que beaucoup d’autres ne voyaient plus depuis longtemps. Dominée par le château, enclos sur ses quatre côtés par les habitations caractéristiques du vieux centre, la large place était bondée. Du côté des portes ouest et est, par une brèche du mur de Flodden6, les passages des bestiaux que les paysans parquaient ensuite du mieux qu’ils pouvaient, accroissaient cette atmosphère de vie exubérante mal contenue. Des charrettes regorgeant de foins empêchaient, par endroits, les allées et venues de la foule qui déviait en masse vers un espace plus dégagé.
Par-dessus les cris des marchands, les meuglements des vaches et de leurs veaux, le grognement des cochons et le hennissement des chevaux de cavaliers téméraires qui tentaient de traverser la place. Les chalands sinuaient dans cette pagaille bon enfant, à l’instar des chiens errants à l’affût de quelques repas inopinés.
Un panier dans chaque bras, les deux femmes guettaient les occasions, goûtant parfois un fruit mûr ou explorant l’étal d’un marchand d’herbes. Manille aperçut deux vagabonds en loques qui quémandaient d’un œil miséreux, leur pitance près de l’échoppe d’un antiquaire. Des immigrants irlandais. Prétextant quelques achats personnels, elle s’éloigna de sa tante pour aller à leur rencontre et laisser tomber dans leur escarcelle quelques piécettes qui cliquetèrent une brève seconde. Les deux indigents la remercièrent chaleureusement ; Manille se sentit soulagée d’un poids soudain. Elle détestait la pauvreté sous toutes ses formes. Un regard discret au travers du carreau de l’antiquaire lui ramena le sourire. Elle entra dans l’antre sombre de la boutique. Le propriétaire des lieux lui tournait le dos ; elle inspecta l’endroit et les divers objets engrangés dernièrement. Son œil discerna la toile avant qu’elle ne réalise le thème de l’artiste.
– Qu’est-ce que vous cherchez, Demoiselle ?
La voix enjouée du boutiquier la fit se retourner. Elle lui sourit. La face burinée du commerçant lui était familière.
– Cette huile, là-bas, est-elle bien de McCulloch7 ?
– Vous connaissez l’homme ?
Manille acquiesça d’un signe de tête, en examinant la peinture.
– Cet artiste ira loin. Il a exposé sur Glasgow, et tout dernièrement sur Londres.
– Que fait cette œuvre, chez un antiquaire ? J’ai vu cette toile récemment, ici même, à l’Académie des Beaux-Arts8.
– Un ami me l’a ramenée de Glasgow, à la suite d’un service rendu.
La jeune femme se pencha pour lire le nom de l’œuvre et la signature de l’artiste.
– Les Highlands, lui confirma le boutiquier. Beau paysage. Il y a des clients potentiels…
– Combien en demandez-vous ?
– Dix shillings, pour vous.
– C’est beaucoup.
Elle étudia les ombres du tableau. Quelque chose l’attirait dans le contraste des teintes étalées entre les eaux du loch ponctuées de brun rouge, et le ciel assombri illuminé de quelques touches de bleu cobalt et d’indigo, et de quelques autres nuances plus appuyées, plus profondes qu’elle ne parvint pas à déterminer, suggérant l’astre à son déclin. Elle se ressaisit, et précisa :
– En fait, je cherche une toile de Raeburn9.
– J’ai peut-être ça. Attendez voir.
Pensif, il s’éloigna dans l’arrière-boutique. Manille l’entendit maugréer, quelque temps, avant qu’il ne revienne avec une toile à la main.
– C’est la seule que j’ai en ce moment. Ce n’est pas le peintre que je préfère, mais au moins il est écossais et expose dans l’pays.
– C’est sa technique que j’aime ; il peint sans dessin préparatoire.
Elle admirait le réalisme un peu rigide du tableau et ses effets de lumière qui imprégnaient l’atmosphère du portrait d’un drame latent.
– Je vous fais celui-là à six shillings, s’il vous intéresse.
– Cinq, le corrigea Manille. Douze avec l’autre.
– Pas question, jeune fille. Pas à moins de quinze.
– Treize shillings, lança-t-elle, sachant que l’homme avait l’habitude de négocier les œuvres qui échouaient dans sa boutique.
– Quatorze shillings, et le lot est à vous.
Manille grimaça, hésita, puis au final, absorbée par les couleurs de la première toile qui lui attiraient l’œil, elle acquiesça.
– Ma tante sera fâchée, mais je ne peux résister, MacDuff. Je vous les prends.
– C’est un bon achat que vous ne regretterez pas, demoiselle. Je vous les emballe ?
– Oui, merci.
Quand elle sortit de l’échoppe obscure, dans la lumière matinale, elle ferma à demi les yeux, éprouvant des difficultés à affronter la clarté du jour. La brume s’était levée, cédant la place au fragile éclat d’un soleil de printemps. Elle frissonna sous la fraîcheur de l’air, en dépit de la saison nouvelle.
Les bras chargés de volailles, Moira bavardait avec une connaissance devant un étal de légumes. Il était près de dix heures, et le marché agricole battait son plein. Manille eut quelques regrets tardifs en réalisant qu’elle avait passé plus de temps que prévu dans la boutique de l’antiquaire. À cette heure, les tavernes commençaient à se remplir.
Chapitre IV : L’école d’art et de littérature
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « La peinture et la littérature sont plénitudes à celui dont l’âme se rapproche de ces arts dans sa manière d’appréhender l’existence. Il n’est qu’à observer les grands maîtres et leurs alliés. »
Manille jaugeait l’huile sur laquelle elle s’échinait depuis deux heures. Le temps passait si rapidement dans l’atelier de peinture de Swinden, leur école d’art et de littérature, qu’elle avait l’impression d’y mener une seconde vie. Un œil sur son modèle, une œuvre toute récente de McCulloch – plutôt une première esquisse en fait, car il existait plusieurs œuvres plus achevées sur ce thème –, elle s’était appliquée à reproduire les nuances différenciées du paysage, le port de Leith au coucher, une véritable merveille à ses yeux encore non aguerris.
Leur Maître peintre ne se lassait pas de leur répéter que le secret d’une réussite résidait dans la capacité du peintre à instiller de la vie dans les couleurs. Il était un fervent admirateur de Wilkie et de Nasmyth, à leur apogée dans l’univers en pleine expansion de la peinture. Les écoles d’art d’Édimbourg exposaient orgueilleusement leurs dernières toiles. Le Maître leur avait promis de les amener à l’une des prochaines expositions. Mais la jeune femme avait ses peintres fétiches. Ainsi Van Goethe et son cercle chromatique de jaune, de bleu et de pourpre la fascinait pour la qualité de son approche et sa pratique toute personnelle sur les couleurs ; néanmoins, et contre l’avis de son Maître d’art, les huiles et les aquarelles de Turner avaient sa prédilection. La luminosité et les contrastes de ses toiles éveillaient chez elle cette inspiration non seulement pour marquer ses propres toiles de ses tentatives d’empreintes colorées encore bien maladroites, mais aussi en développant ses aptitudes insoupçonnées pour la littérature et la poésie.
Pour l’heure, il était temps de ranger ses godets, ses teintes et ses matériaux, et de reprendre le chemin du Vieil Aulne. Leur maître qui approchait de son plan de travail étudia la toile sur le chevalet, avec une concentration qui la faisait sourire chaque fois. Comme si elle incarnait un élément précieux de son atelier.
– C’est pas mal, ma fille. Un peu plus de lumière sur cette eau, ici et là, et le rendu aura du chien. Tu t’améliores.
Elle bredouilla :
– Mer… merci, Maître Easton.
L’homme, un long tablier protecteur sur son corps maigrelet, prit un air satisfait.
– Tu emprunteras, en partant, le « Traité des couleurs » que j’ai récemment acheté dans l’une des échoppes du Mile10. Je l’ai posé quelque part sur les étagères, dans l’arrière pièce. Je sais que tu t’y intéressais.
Surprise, Manille ouvrit la bouche sans qu’aucun son n’en fuse. L’attention de leur mentor la touchait profondément. Elle avait longtemps convoité ce traité de Van Goethe, et comptait se le procurer d’une façon ou d’une autre depuis plusieurs mois. Sans succès jusqu’à ce jour.
– Merci, Maître Easton !
Eilidh qui avait déjà rangé sa toile l’attendait, près de la sortie de l’atelier. Elle était jolie et gracieuse, mince, beaucoup plus mince qu’elle ne le serait jamais elle-même. Deux étudiants de l’école d’art s’attardaient à ses côtés. Manille le déplora. Eilidh et elle étaient en âge d’avoir des soupirants, mais la jeune femme détestait ces niaiseries que les jeunes gens en général se croyaient obligés de perpétuer pour paraître intéressants. Eilidh, elle, appréciait ces attentions incessantes. Elles étaient très différentes, mais s’entendaient relativement bien dans l’ensemble. Le précieux livre sous le bras, Manille la rejoignit.
Escortées de leurs admirateurs, elles quittèrent l’atelier d’art main dans la main, enchantées de cette liberté après les longues heures studieuses dans l’atelier.
Elles émergèrent de la voûte souterraine au fond de laquelle se cloîtraient l’école d’art et son atelier, et s’immergèrent, dès la sortie de la ruelle, dans le brouhaha habituel des passants et la luminosité plus naturelle.
– Qu’est-ce que tu lui trouves de si exaltant, à ce vieux bouquin ? interrogea Eilidh, véritablement curieuse.
– Il n’est pas si vieux que ça, Eilidh, et l’on en exhume les embryons de nos théories modernes sur la peinture expressive. Il n’y a pas meilleure référence dans le domaine des couleurs et de leur empreinte sur la toile ; leurs accords…, des gammes infinies autant que riches et complexes pour le non-initié.
– Que viennent faire les gammes musicales, ici, Manille ?
Le sourire amusé et légèrement facétieux de sa compagne, ainsi que les rires assourdis des garçons arrêtèrent Manille dans son élan. Eilidh, même si elle n’était pas volage dans ses choix profonds, flirtait cependant avec une superficialité ingénue qu’elle ne pouvait lui reprocher. En dépit de son tempérament un brin puéril et frivole, la jeune femme se révélait honnête et fidèle quant à ses relations. Ses œuvres à l’école de peinture s’avéraient suffisamment accomplies pour avoir attiré également l’intérêt de l’artiste peintre, toujours exigeant sur le soin des réalisations des élèves de son académie.
James Campbell et Liam Fraser attendaient patiemment que les deux jeunes femmes se décident à leur accorder quelque attention. Ils n’étaient pas aussi acharnés qu’elles en ce qui concernait la peinture et son univers. Inscrits depuis peu de temps dans cette école, ils demeuraient dans l’expectative d’une progression de leur art sur la palette et d’un choix quant au support et à la technique. Côtoyer Manille et Eilidh qui fréquentaient l’école depuis pas mal d’années, leur permettait de se pénétrer de leur expérience et d’allier le travail à l’agréable. Quand James suggéra une bière dans l’une des tavernes du coin, Manille le détrompa aussitôt sur ses intentions :
– Pas pour moi, les garçons. Je dois faire quelques achats de baptiste, sur Lawnmarket, pour ma tante. On se retrouve pour le prochain cours. Je vous laisse avec Eilidh.
Chapitre V : Les pensionnaires
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « La communauté se pare de tous les attributs de la socialisation lorsqu’elle intègre dans sa manière d’opérer, le plus grand intérêt pour chacun de ses membres. »
Manille considérait les pensionnaires réunis autour de la table imposante de la salle à manger. Ann, leur cuisinière, venait d’apporter le dessert : un cake aux fruits avec son coulis de framboises. Il y avait toujours un bourdonnement de sons continus, tout au long de ces repas pris en commun. Des conversations à bâtons rompus qui se mêlaient et se brassaient dans tous les sens. Les gens troquaient les derniers potins de la ville, parfois c’était des discours généralisés où tous participaient, se renvoyaient des boutades, se gorgeaient d’informations, s’estimaient fiers d’émettre quelques idées personnelles qui ne reflétaient, somme toute, que les pensées de la populace d’Édimbourg et de ses environs. Mais ces moments d’échanges de leur communauté nourrissaient le noyau dur des pensionnaires de la maison.
Manille observait les membres de la tablée avec un sentiment de sécurité paisible et rassurant : une dizaine en permanence, dont certains logeaient à l’année. Parmi ceux-là, deux vieux messieurs hébergés depuis bientôt trois ans et qui se sentaient chez eux, presque autant que Manille et sa tante. La cuisine de Madame Denisson leur plaisait et Manille, quand son emploi du temps le lui permettait, s’enquérait de leur bien-être et leur proposait quelques activités aussi bien intérieures qu’extérieures. Résidaient également au Vieil Aulne, un couple de Français, les Fuller, avec leur fille, Sarah, suspendue aux basques de la jeune femme dès qu’elle la croisait. Ces derniers fréquentaient la pension depuis quelques mois, dans l’expectative de se porter acquéreur d’un cottage dans la région. Lui, était représentant et rencontrait des difficultés à faire vivre sa famille. Mary, quant à elle, attendait un bébé pour l’automne suivant.
Parmi les locataires, il y avait Martha Beans, une femme corpulente dont Manille n’appréciait guère les minauderies de mauvais goût dont celle-là les serinait dès qu’un spécimen de la gent masculine rôdait dans les parages. Une autre jeune femme partageait leur existence, Myriam Ravenhurt, du même âge que Manille, débarquée de sa campagne, seule pour subvenir à ses besoins. Elle travaillait comme serveuse dans un bar du centre-ville, mais aidait également Madame Denisson et sa nièce en échange du gîte et du souper. Au fil des semaines, tout naturellement, Manille et elle s’étaient liées d’amitié.
Ce soir, placée à la gauche de Manille, Myriam coulait subrepticement un œil doux du côté d’un anglais un peu plus âgé. Ces derniers éprouvaient un faible l’un pour l’autre, mais Tom Baker, intimidé et trop récemment intégré au sein de leur communauté, ne s’était pas encore déclaré. C’était un sujet de conversation agréable entre elles.
Manille fut interrompue dans son étude par Jack Elliot, l’un des célibataires d’âge mûr qu’elle avait peu d’occasions de rencontrer.
– Oui, Jack ?
– Avez-vous lu The Scotsman11, Mademoiselle ?
Du coin de l’œil, Manille capta l’intérêt d’Henri Morton, un Australien et célibataire de surcroît, qui se tournait vers eux.
– Pas dernièrement, je crois. Quelles sont les nouvelles ?
– Anderson12 cherche à automatiser une vieille carriole à moitié rongée par la rouille… avec une sorte de moteur électrique…
Il ricana avant de s’adresser à Morton, et l’interroger :
– Vous avez entendu ça, Henri ?
– Oui, mon cher ; c’était également dans The Herald, ce matin. Ils y annoncent qu’Anderson s’apprête à nous révéler son premier prototype. On ne parle plus que de cela dans les cercles privés de la New Town.
– Vous y croyez, vous ?
– Allez savoir ! De nos jours, il semble que le monde s’affole autour de nous. Nous ne serons bientôt plus que de vieux croûtons que celui-là rejette en accélérant.
– Allons, Messieurs, les tança Colin MacPharlan, la quarantaine, célibataire également, plutôt bel homme, nous devrions tenter de nous mettre au diapason. Nos savants n’ont-ils pas, il n’y a pas si longtemps, conçu le moteur à vapeur ? Et que penser de cette invention, ce chemin de fer dont on nous rebat les oreilles ? Qui aurait pu y croire avant que les médias officiels captent notre intérêt sur cette affaire ? Les choses vont changer.
– Elles changent déjà, MacPharlan, rectifia Manille. Notre commerce prend de l’essor, depuis quelque temps.
– Elles changent peut-être, mais pas forcément dans le bon sens ! aboya Jack sans méchanceté. Nos scientifiques deviennent fous, et la cadence de leurs créations débridées va mettre sur le cul nos ingénieurs.
– Jack ! Il y a des dames à cette table, le tança Henri.
L’autre maugréa, puis relança :
– Demandez à Scot, si je me fourvoie. Lui, il sait ce que c’est que de s’exténuer à l’usine de concassage.
Tous les regards dévièrent vers l’ingénieur silencieux qui avalait une bouchée du cake. Manille l’étudia, un instant. En tenue de travail, l’homme paraissait solide et intelligent. Sous l’attention générale, il finit par lever la tête et les affronter.
– Parle-leur de l’usine, William.
William Scot soupira.Elliot était un impulsif, mais il appréciait la ténacité avec laquelle le vieil homme défendait les anciennes traditions.
– On y concasse les pierres qui vont servir pour le macadam, murmura-t-il. Mes gars n’arrêtent plus de couvrir la chaussée des routes, au sud d’Édimbourg. Le nouveau procédé permet un revêtement particulièrement solide. Mais les équipes s’éreintent vite à la tâche. Les techniques de concassage ne sont pas encore tout à fait à la hauteur des besoins qui se multiplient. Les usines sont bruyantes ; on y avale de la poussière de roche, à longueur de temps. Mais nos routes n’auront bientôt plus rien à envier à celles des autres capitales du continent. Un de ces jours, elles iront jusque dans le Nord.
– J’espère que vous faites erreur, Scot, répliqua leur hôtesse. Que feraient nos chers poètes et écrivains, alors ? Ils ont besoin de nos Highlands, de leurs pâturages et de leurs faunes. Inutile de tracer davantage de routes, là-bas.
– Que le seigneur vous écoute, Madame Denisson !
Chapitre VI : Le culte
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « Les batailles entre les grands de ce monde ne sont jamais que des intérêts malmenés d’un bord ou d’un autre. Il n’est jamais aisé d’en conjecturer ceux qui les remporteront. Dans tous les cas, les populations seront toujours celles qui y perdront le plus. »
Manille assistait au culte du Pasteur O’Neill, au côté de sa tante et de Myriam Ravenhurt. Le sermon de l’homme s’avérait éloquent comme à son habitude. La salle était comble. La jeune femme aperçut deux de leurs pensionnaires à trois rangées de leur travée, élégants dans leurs vêtements. De vieux messieurs endimanchés. Près d’eux, les Fuller se recueillaient, la petite Sarah entre eux. La grossesse de Mary commençait à se révéler pour les regards avertis, et la rendait maladroite. Manille la considéra, compatissante. Elle ne se voyait pas dans cet état particulier, et n’était certes pas pressée de s’y trouver.
Parmi les paroissiens présents, toutes les générations étaient représentées, toutes les classes également. Manille appréciait ces bains de foules pieuses, comme elle les surnommait. Au sein de cette atmosphère religieuse si différente du vécu ordinaire, les gens s’élevaient presque malgré eux en dépit des querelles coutumières qui n’avaient pas lieu d’être en ce lieu de prières. La beauté intérieure de chacun paraissait se transcender naturellement.
Et pourtant, même au sein de l’Église, les disparités engendraient leurs lots de désaccords en ces temps de conflits qui s’intensifiaient avec les années. Les pasteurs s’entredéchiraient pour des controverses sur l’indépendance de l’Église d’Écosse. Manille ne savait que penser de ces problématiques qui la dépassaient ; qui les dépassaient tous. Néanmoins, si on lui avait demandé son avis, elle aurait statué pour la non-intervention des autorités publiques dans les affaires religieuses, et notamment la nomination des pasteurs. Après tout, pourquoi les organes civils auraient dû s’impliquer dans ces décisions qui ne concernaient que l’Église ? Est-ce que celle-ci se mêlait des affaires de l’État ? Modérés contre évangéliques, une séparation qui se confortait avec les mois écoulés. Qu’allaient-ils tous devenir si les fidèles de l’Église elle-même se désolidarisaient, leur offraient un champ divergeant d’incompréhension du divin ?
Manille se recentra sur le discours de leur pasteur. Celui-ci prônait la tolérance et le pardon ; un discours classique, mais le charisme de l’homme la portait dans les nues ; oublieuse du quotidien. L’art lui faisait le même effet de recentrage de ses besoins patents qui étaient tout, sauf ce qu’on tentait de leur inculquer et de leur entrer dans le crâne, dès l’enfance, par des méthodes d’éducation qui les dépossédaient progressivement de leurs rêves et de la véritable mission qu’ils avaient à accomplir sur cette Terre. Quelle était sa mission à elle ? Sa véritable mission ? L’art était-il le support qui l’amènerait à se concrétiser ? Ou celui-ci n’était-il qu’un outil pour l’amener à se réaliser dans les sphères infinies d’un univers très éloigné de leur matérialité ?
Chapitre VII : Balade dans la New Town
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « Le rôle des femmes dans une société se trouve la plupart du temps mal défini et pourtant, ce sont celles-là qui entraînent les civilisations à s’ériger en dépit des actes malveillants de la plupart des hommes. Elles n’ont pour seul repère que la survie de l’espèce, et heureusement. »
En ce début d’après-midi prometteur, Manille se promenait au cœur de la New Town, au côté de Logan, un ami d’enfance et le frère cadet de Keïr MacLean.
La pension ne requérant pas sa présence en ces heures de faible activité – Les courses avaient été effectuées la veille, et le matin même, Manille et sa tante avaient préparé le repas en vue du dîner –, Moira l’avait gentiment houspillée pour qu’elle sorte du milieu accaparant du Vieil Aulne. La jeune femme ne le regrettait pas.
Après avoir passé l’Académie des Beaux-Arts d’Écosse, Manille et Logan erraient plus loin dans Princes Street avec pour simple intention de flâner au gré de leur humeur et de laisser le temps s’écouler avant leur prochain rendez-vous.
Manille jeta un dernier coup d’œil sur l’illustre bâtiment de l’Académie qui l’avait toujours fait rêver. Les femmes n’y étaient pourtant pas admises. Chaque fois, Manille bronchait intérieurement. À l’exception de quelques mouvements isolés de protestation qui émergeaient, de temps à autre, pour prôner la liberté des femmes et leur statut dans l’administration et l’éducation, la vie publique, les femmes ne jouaient décidément aucun rôle prépondérant en dehors de celui qu’on leur attribuait « généreusement » tel un leitmotiv : un mari, des enfants, la tenue du foyer.
Manille n’était pas prête à se plier à cette mascarade ridicule si l’on y réfléchissait bien. Elle aurait souhaité suivre des cours au sein de cette académie officielle. Cependant, quand elle comparait la magnificence du bâtiment national avec son école d’art et de littérature au fond de sa close13 dans la Old Town, elle ne désavouait pas le contexte qui le lui avait fait intégrer.
En dépit de son manque de luminosité et cette sensation d’oppression décalée qui prenait la jeune femme à la gorge dès qu’elle mettait le pied hors de l’atelier de peinture exigu, pour se plonger au sein de la ruche vivante et de ses incessantes activités, Manille ne regrettait pas la notoriété et les rues évasées de la New Town dont les réfections étaient en cours d’achèvement. Peut-être y avait-il en elle, une part intime qui s’intéressait davantage au sordide et aux romances gothiques qu’à tout ce modernisme regorgeant d’opportunités bien trop aisément accessibles. Elle ne savait pas, au fond.
Son compagnon ne semblait pas deviner le cours hurlant de ses pensées. Pour lui, sans doute n’était-elle qu’un petit animal social qu’il fallait apprivoiser et ramener aux justes proportions d’un monde dans lequel elle devait s’intégrer sagement pour ne plus concevoir que les normes structurées et aveugles dont ledit monde tentait d’imprégner ses partisans tout autant que ses opposants.
Ils avaient quitté le secteur de Princes Street pour se retrouver dans celui de Charlotte Square et les rues alentour. Face au romantisme moderne des lieux, Manille oublia l’école d’art pour se perdre dans le raffinement artistique de la place et des jardins. Les élégantes façades et les moulures impeccables des maisons des rues qu’ils venaient de traverser avaient égayé son esprit d’images plus plaisantes. Elle s’ébroua de la tête, fit se mouvoir ses longs cheveux et se mit à rire. Logan se tourna vers elle avec un sourire flamboyant. Sans doute, croyait-il que cette exubérance soudaine était de son fait. À cette pensée frivole, la jeune femme rit de plus belle, une moue moqueuse sur les lèvres.
– J’aime bien cet endroit, Logan. On y respire.
Elle regarda brièvement son compagnon, plus jeune qu’elle, mais plus grand et un peu gauche dans son corps trop vite poussé. Son frère aîné, Keïr, ne lui ressemblait pas tellement avec son physique d’athlète et sa taille plus modeste.
– Je croyais que tu souhaitais admirer l’Académie des Beaux-Arts ?
– Oui, oui, bien sûr.
Le sourire de Manille disparut. Logan s’avérait peu psychologue. Mais finalement, trop peu des jeunes gens qu’elle côtoyait l’étaient vraiment. Était-ce une caractéristique de la gent masculine ? Son sourire réapparut, lui indiquant silencieusement qu’elle était très certainement dans le vrai ; ou en tout cas, qu’elle y croyait fermement.
– Keïr doit nous attendre, quelque part par-là, avança-t-elle. Ne tardons plus. Tu sais comme il s’impatiente.
Le jeune homme pâlit. Certes, Keïr était plutôt d’humeur instable ces derniers temps. Logan n’aimait pas l’idée de le rejoindre. Mais son frère se révélait très possessif, quand il s’agissait de Manille. Celui-là jalousait tous ceux qui l’approchaient ; jusqu’à lui, son frère. Logan s’étonnait qu’entre Manille et l’autre, l’amourette d’enfance ait perduré jusqu’à maintenant. Le naturel sombre de Keïr contrastait trop franchement avec le tempérament plus souple et subtil de la jeune femme. Était-ce que dans ce cas, les opposés s’attiraient ? Lui n’en était pas convaincu.
Chapitre VIII : Les détrousseurs
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « Nos morts doivent-ils subir les outrages d’une humanité avide de matérialité, alors qu’ils sont en partance pour l’au-delà ? »
Manille descendait de l’étage, après avoir quitté sa chambre où elle s’était rafraîchie avant le dîner.
Keïr, Logan et elle avaient passé un moment avec les chevaux de l’écurie d’Ainsley Fleming. Logan travaillait pour celui-ci, aux soins des chevaux. En l’absence de Fleming, il leur avait proposé de monter une jolie jument et deux alezans, arguant qu’on lui laissait toute latitude de faire trotter les chevaux dans le paddock afin de les maintenir en forme. Manille n’excellait pas dans cette activité, mais se débrouillait suffisamment pour ne pas déclencher d’incident. Ils s’étaient amusés. Keïr avait été particulièrement enjoué. Au retour dans les stalles, ils avaient entrepris de panser et étriller leur monture, nettoyer les litières et rajouter de la paille fraîche avant d’apporter la ration d’avoine et de luzerne aux chevaux qui hennissaient d’impatience, l’œil gourmand. Bien que passionnante, l’activité avait épuisé la jeune femme qui n’avait plus songé qu’à rentrer à la pension.
Moira portait la soupière de scotch broth14, et précédait la cuisinière qui amenait le pain d’avoine encore chaud jusqu’à la table des convives. Manille leur emboîta le pas, et pénétra à leur suite dans la salle à manger.
– Tu as lu la Gazette, aujourd’hui, Manille ?
– Non, ma tante ; il y avait tellement de monde, cet après-midi, dans les rues de la Old Town, que je me suis éclipsée dès que je l’ai pu. Ensuite, j’étais avec les MacLean à visiter l’écurie de Fleming.
Puis, s’adressant à son amie qui prenait place autour de la table :
– Ça va, Myriam ? Tu es libre, après dîner ?
– La taverne est fermée. L’inventaire de printemps ou quelque chose dans le genre. Pourquoi ?
– Je pensais à une virée sur le port…
Moira intervint, abruptement :
– Je préférerais que vous restiez avec nous, ce soir, les filles.
Interrogatives, les deux jeunes femmes se tournèrent vers la maîtresse de maison. Il n’était pas dans ses habitudes de leur interdire quoi que ce soit. Cette dernière leur tendit le journal qu’elle venait de sortir d’une poche de son tablier.
– Un homme a été retrouvé mort, dans Cowgate.
Manille s’empara de la gazette. Myriamlisait par-dessus son épaule ; elle frémit.
– Il a été traîné sur plusieurs mètres, à ce qu’ils écrivent.
– Les détrousseurs… ? souffla Myriam.
Manille argua :
– Rien ne le prouve, mais…
Myriam demanda :
– C’est arrivé quand ? Je ne parviens pas à…
– Cette nuit, précisa Moira Denisson. Un gamin l’a trouvé, ce matin.
– Le pauvre !
Manille souhaita le bonsoir aux pensionnaires présents en nombre restreint autour de la table. Martha Beansles apostropha bruyamment :
– Vous avez appris la nouvelle sur le meurtre ?
– Tout juste, Madame Beans. Savez-vous où en est l’enquête ?
– Non, nos agents de police n’ont rien décelé à l’exception d’une toile de jute, jetée plus loin, à la sortie de la ruelle. Celui qui a perpétré cette folie comptait, sans doute, emporter le corps. Peut-être, étaient-ils plusieurs. Ils ont dû être surpris en pleine action.
– Aujourd’hui c’est monnaie courante, lança à l’autre bout de la table, MacPharlan. Il ne faut pas traîner dehors, passé les heures de jour.
Manille acquiesça, et allégua :
– La police est trop laxiste, et ne prend pas suffisamment la mesure de la situation. S’ils interviennent, c’est de manière trop aléatoire.
Ce que Manille ne dit pas, c’est qu’elle appartenait, elle-même, à un groupe privé qui luttait contre le mouvement résurrectionniste15 qui se développait en dépit des protestations de plus en plus véhémentes de la population.
Pour le moment, les pétitions et les appels en jugement ne freinaient pas l’augmentation du nombre de cas rapportés. Les dépouilles disparaissaient des cimetières, même les mieux surveillés, et l’on murmurait dans les chaumières que les malfrats allaient jusqu’à tuer pour alimenter en corps frais les chirurgiens en mal d’expérimentations anatomiques. Les voleurs de cadavres profanaient les corps, jusque dans les tombes les plus sécurisées, les déterrant au profit d’étudiants universitaires pour quelques argents substantiels.
Manille et ceux de son groupe distribuaient des pamphlets sur le sujet, afin d’alerter l’opinion et dénoncer la pratique et les juges trop indulgents. Certains soirs, ils devaient s’éparpiller à la sauvette lorsqu’on les découvrait à cette activité réprouvée alors même qu’elle et ses amis participaient à une remise en cause qui aurait dû être assurée par les forces de l’ordre de leur ville.
Il semblait que les meurtres commis deux années auparavant par Burke et Hare, notamment, ne suffisaient pas pour que la problématique soit prise au sérieux. Pourtant, l’un des deux immigrants irlandais avait été pendu et son corps donné à une école d’anatomie et exposé par la suite à l’Université de Médecine. Manille supposait le trafic de contrebande trop lucratif pour cesser rapidement.
Chapitre IX : À l’atelier
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « Les odeurs de pigments, de lin et de térébenthine, ainsi que de l’apprêt et du bois du châssis à partir desquels se confectionnaient les toiles des peintres, m’étaient aussi familières que le tabac pour un fumeur invétéré. Je ne pouvais m’en passer. »
Manille admirait le tableau de maître, un paysage romantique de David Wilkie, suspendu à l’unique mur susceptible d’en recevoir dans cet antre de la peinture, blindé par ailleurs d’étagères couvertes de livres d’art. Du fait de sa situation au fond d’un passage voûté, l’atelier manquait de luminosité. Sa façade en verre cathédrale accentuait encore l’effet du manque de lumière solaire. Bien sûr, ils compensaient en badigeonnant leurs toiles de teintes outrancières en intérieur, et de nuances moins contrastées lorsque maître et élèves sortaient pour l’une de leurs expéditions régulières en périphérie de la capitale : un parc particulièrement bien exposé de la New Town, sur l’esplanade de Castle Roc, ou Grassmarket prôné par les artistes en tout genre pour son côté pittoresque ; à l’écart de la foule si tant est que ce soit possible, ou bien au cœur même du splendide parc de Holyrood.
Ce matin, ils se contentaient des odeurs de pigments, d’huile de lin et de térébenthine, de la salle étriquée de l’atelier. Ils étaient une vingtaine à suivre les cours du maître des lieux, généralement par groupe de trois ou quatre comme en cet instant.
La jeune fille lorgna du côté de Calum, un étudiant tout comme elle, qui peignait à coups de pinceau révoltés quelque scène de chasse… Elle n’appréciait guère la manière de peindre de son camarade, mais devait reconnaître qu’il possédait un certain talent pour concrétiser ses intentions, alors qu’elle-même devait se chercher longuement et étaler diverses couches méthodiques autant que laborieuses avant de parvenir à un résultat qui la satisfasse au moins partiellement. Ses touches devaient être progressives ; patiente, elle répugnait à précipiter son sujet, le déployer trop rapidement. Elle aimait esquisser son œuvre par strates parcimonieuses, qui, dans le même temps, lui révélaient certaines facettes de sa propre personnalité. Parfois, c’était magique et l’analyse de son sujet l’analysait elle-même en profondeur, exposant quelques fragilités jusque-là dissimulées. Manille n’était pas une extravertie. Pas non plus introvertie, cependant. Juste elle-même, sans faste ni exagération. Elle se savait un certain pouvoir d’équilibre sur les autres, ses compagnons de tous les jours. Elle incarnait, peut-être, la sagesse discrète d’une personnalité romanesque. Elle sourit devant sa toile, et devant l’évidence des soubresauts chaotiques de son esprit fantasque. Elle devait dessiner et peindre sur la toile, cette empreinte particulière de cette sorte de folie intérieure avant de l’oublier tout à fait. À l’instar des lignes d’un roman de Walter Scott. Manille se mit à l’ouvrage.
Les heures s’étaient écoulées sans qu’elle s’en rende compte. Ce fut le timbre métallisé de l’un des artistes de sa promotion qui l’éveilla de cette transe qui la prenait, parfois, alors qu’elle s’adonnait à la peinture. En dépit des jours qui s’allongeaient, il faisait déjà sombre au-dehors. La jeune artiste capta les raclements des lames en acier des couteaux qui ramassaient les couleurs sur les palettes que l’on nettoyait. En ce qui la concernait, Manille conservait les couches successives des mélanges continus sur ses palettes. Elle avait le sentiment, ainsi, de ne rien transgresser de ses nombreuses ébauches, de ne rien trahir des efforts passés à capturer une nuance ou une impulsion. Une teinte… Tout était là, fixé à la palette devenue instrument du souvenir, et de l’enregistrement de ses mouvements intimes – non pas du pinceau ou du concept sur la toile, mais de son propre corps – de l’enregistrement, également, de ses tentatives pour traduire l’ombre et la lumière, la signification et l’action. Enfermée dans son univers dont elle éprouvait, chaque fois, des difficultés à s’extirper, elle discerna plus qu’elle ne l’entendit vraiment la voix de leur mentor qui les exhortait à achever rapidement leur travail du jour et à filer avant la nuit. Calum s’approchait de son coin d’atelier ; il chuchota :
– Je te raccompagne, ce soir.
Comme elle tournait la tête dans sa direction, le jeune homme précisa :
– Tu as dû être informée des nouvelles du meurtre de la nuit précédente. Il est déjà très tard. Tu ne peux pas rentrer seule.
Manille ne chercha pas à le dissuader. Le Royal Mile et ses closes mystérieuses étaient autant de pièges, la nuit venue. D’un signe, elle remercia silencieusement son camarade, et se dépêcha de protéger sa toile et de ranger son matériel.
Chapitre X : Le moulin
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « Quand le regard se porte sur une évocation qui éveille en vous les démons d’un passé en déroute, déviez-le promptement avant que d’être piégé par la signification qui l’imprègne et de plonger irrémédiablement dans son monde ésotérique. Vous n’y survivriez pas. »
Le mois de mai s’amorçait. L’existence se poursuivait à l’instar d’un train sur des rails infinis, dont on ne peut arrêter la dynamique. Ainsi en allaient les pensées de Manille qui songeait à ses mondes au-delà de celui-ci, à ses mondes tant de peinture ou de lecture que d’écriture qui l’entraînaient vers de curieux rivages qu’elle ne reconnaissait pas, ou du moins qu’elle n’habitait que dans des rêves qui la tyrannisaient de plus en plus régulièrement. De drôles de rêves prégnants, et dans un autre temps dont elle n’osait pas parler. Pas même à sa tante, pourtant si compréhensive.
Accompagnée d’un domestique, Manille cheminait le long de la Water of Leith afin d’aller chercher de la farine au moulin du coin toujours en activité. Ils atteignaient le premier coude de la rivière, le dépassaient. La jeune femme n’aurait pas dû ressentir cette peur qui la paralysait, enflant en elle à partir d’un point tapi dans les tréfonds de son être et dont elle ne décelait pas l’origine. L’aura de la demeure solitaire parvenait jusqu’à elle à son insu, alors même qu’ils en étaient encore éloignés. Dans son imagination fertile, celle-ci les surplombait de son œil toxique dardant sur elle, en particulier, des effluves infernaux dont Manille ne pourrait pas se dépêtrer si elle avait le malheur de l’observer. L’impression s’avérait si forte, qu’elle pesait sur la jeune femme ainsi qu’un linceul pour la marquer de ses stigmates de mort. En dépit de sa volonté rétive, Manille ne pouvait que lever le regard dans sa direction au risque de se retrouver captive d’un maléfice qu’elle était seule à appréhender. À ses côtés, le domestique ne bronchait pas ; son visage serein révélait, par-dessus tout, l’évidente folie qui envahissait la jeune femme. Un frisson d’angoisse la traversa.
– Vous avez froid, Mademoiselle ? En dépit du printemps avancé, l’humidité monte de la Water of Leith et pénètre les vêtements.
– Ça va, Thomas.
– Nous n’aurons pas à patienter très longtemps chez le meunier ; il nous attend avec le chargement.
– Merci, Thomas.
Son regard se rivait vers le surplomb et la demeure dont les détails lui parvenaient, plus précis. Dans sa tête, un appel. Et la peur… Et l’appel… Une supplique. Elle porta la main à son front. En dépit de la fraîcheur montant de la rivière, elle avait chaud tout à coup.
L’homme la considéra un instant, inquiet de son état, songeant qu’elle couvait peut-être quelque chose. La tuberculose faisait de nombreuses victimes dans le vieil Embra16 ; les miasmes de la ville et ceux de la rivière s’avéraient à l’origine de beaucoup plus d’épidémies naissantes qu’on voulait bien le leur faire croire.
Il accéléra le pas et, attentif, guetta la progression de la jeune femme. Il la savait intimidée par la bicoque abandonnée.
– Ce n’est qu’une de ces ruines sans importance, Miss.
– Elle est imposante, Thomas, et… très impressionnante.
Il se renfrogna. Il n’avait jamais compris ce que la jeune Cameron trouvait à cette maison d’une autre époque.
Ils pénétrèrent à l’intérieur du moulin. Le meunier les attendait effectivement. Deux sacs de belle farine bise s’entassaient près de l’entrée.
– La Water of Leith est agitée ces temps-ci, Thomas.
– Ton moulin n’en tourne que mieux, vieux bougre.
– C’est sûr, et mes os s’épuisent à la tâche. Un de ces jours, je fermerais le moulin.
– Tes fils… ?
– Ils refusent dorénavant d’y travailler. Z’ont préféré s’échiner à l’usine. C’est pas plus facile, pourtant.
– Les temps changent, meunier.
– Sûr.
Manille écoutait l’échange d’une oreille distraite. Elle avait entendu maints discours de la sorte, mais avait le sentiment que le moulin serait toujours là, à moudre la farine, broyer le grain, à battre les eaux de la rivière. Un jour, néanmoins, le meunier s’en irait à son tour, comme tous les autres avant lui. On lui avait raconté des centaines d’histoires sur les meuniers de la Water of Leith et sur leur farine qu’on s’arrachait à des miles à la ronde. C’était avant. Aujourd’hui, le quartier se vidait peu à peu de son âme. Cependant, son charme et sa magie marquaient encore les esprits des vieils gens de l’endroit, comme il les avait marqués eux, les enfants des environs ; comme il la marquait, elle, encore maintenant.
Chapitre XI : Le pasteur
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « La religion n’a jamais été une fin en soi. Votre croyance personnelle est tout autant sacrée que les normes éculées des bien-pensants qui se veulent ésotériques. Ne reniez pas votre croyance, au profit d’une autre qui vous serait imposée ou offerte sur l’autel d’un dieu qui ne serait pas le vôtre. »
Installé à son bureau, Darren O’Neill parachevait le texte dont il se servirait lors de la prochaine messe.
Un pasteur se devait de préparer ses interventions, afin de les appréhender à sa manière, avec cette sincérité du cœur qui emportait les plus sceptiques. Un texte aussi bien écrit soit-il n’était qu’un support. Sans l’âme pour le porter, il ne valait que le coût des pages qui le constituaient. Rien de plus.
Darren regrettait que son physique ne représente pas suffisamment l’être qu’il aspirait à transparaître lors de ses sermons à ses fidèles. Doté d’un léger embonpoint, il aurait souhaité gommer celui-ci pour ne plus montrer de sa personne qu’une lame empreinte de détermination exemptée de sa bonhomie coutumière. Heureusement, sa haute taille et son maintien rectifiaient l’impression d’ensemble en améliorant, de son point de vue, l’image qu’il reflétait dans le regard de ses paroissiens.
Il n’était pas de ceux qui, par leurs discours, fustigeaient et condamnaient les plus timides dans le culte chrétien, mais il aspirait par cette posture et une certaine réserve naturelle à provoquer un respect franc et une loyauté inconditionnelle. Lors de ses offices, Darren imprégnait ses prédications d’empathie et de chaleur humaine d’une sincérité qui lui attirait l’admiration de sa communauté.
Par les temps qui couraient, il n’était pas si aisé de convaincre et d’accompagner ses paroissiens, alors même que l’Église d’Écosse se délitait dans des controverses absurdes. L’État s’était immiscé à tort dans la gestion et la nomination de ses pasteurs. Celui-là n’avait rien à voir avec les ministres du Culte, du moment que l’Église assumait sa part du travail qui lui incombait. Mais la société civile ne songeait qu’à tout contrôler afin d’obtenir la mainmise et le pouvoir, un pouvoir qui grossissait à vue d’œil ainsi qu’un Léviathan s’abattant sur le peuple écossais.
Darren manifestait sur le sujet un froid déterminisme qu’il tentait de contenir dans le cadre de ses offices aux populations ; mais au sein de son prieuré, il organisait régulièrement des réunions plus ou moins clandestines entre pasteurs afin de lutter contre la suprématie d’un État qui ne leur voulait pas du bien.
Ce soir, sa gouvernante s’est absentée. Il observe le carré de lumière qui vacille avec le vent. Juin démarrait à peine. Le jardin embaumait de ses floraisons printanières ; la profusion des bruyères jetait des éclats colorés, tandis que la lavande et la menthe sauvage parfumaient jusqu’aux pièces du prieuré. Au-delà de l’enceinte pierreuse qui clôturait le jardin, les ifs et les pins sylvestres du cimetière procuraient une touche plus sombre à cette heure. Darren se souvenait de son enfance ; son père assumait la tâche de pasteur dans le secteur. L’enfant qu’il était cavalait dans les travées à la poursuite des phalènes et des lucioles qui lui traçaient son chemin entre les tombes, les cryptes et les chapelles érigées pour les plus fortunés et les nobles. Darren adorait ces débuts de nuit, alors que le halo de la lune se dessine dans un ciel qui n’en est plus un.
Tandis que son regard se portait vers les ombres du cimetière, Darren y discerna des silhouettes furtives. Il s’interrogea sur leur présence à cette heure, revêtit un manteau en tweed, se munit d’une lanterne et appela son chien, Tornade, un dogue et un colosse de la taille d’un loup qui grondait déjà.
La porte de la chapelle était entrouverte. Il l’avait fermée, un peu plus tôt.
– Qui est là ?
Des mouvements subreptices malaisés à cerner. Un vacarme soudain alerta Darren, tandis que Tornade filait dans l’obscurité. Hors du périmètre du pasteur, une lutte s’engagea alors que son dogue aboyait et grondait de plus belle.
– Oh ! Là !
Un juron, puis un cri étouffé.
Tornade avait dû happer la jambe ou le bras de l’un des malfrats. Dans les ombres profondes, près de la porte de la chapelle, Darren distingua deux silhouettes coursées par son chien. Le pasteur avança prudemment. Quand il atteignit l’entrée de la chapelle, il ne put éviter une exclamation de dépit, et, pénétrant dans l’édifice, se pencha sur la chose inerte que l’on avait traînée sur le marbre. Les monstres avaient recommencé leur œuvre de profanation impie.
Chapitre XII : Les closes
Extrait du tome III de Déviance : Les Aulnes Jumeaux, par l’égrégore des Mackrey : « J’ai cru retrouver mon amour, un jour, sous les voies d’outres-mondes. Hélas ce n’était qu’un démon claustré pour quelques causes ignorées. À moins qu’il ne fût beaucoup plus… »
Un soir de début d’été, une impulsion subite embringua Manille le long de la Water of Leith vers un endroit précis près duquel débouchait l’une des closes les plus longues de la ville et à partir de laquelle démarraient, de part et d’autre de son axe, plusieurs ruelles qui serpentaient entre des blocs de roche, des rus puis des immeubles de plus en plus hauts jusqu’au château.
Avec des incitations encourageantes, elle entraînait Eilidh à la suivre en dépit des véhémentes protestations de cette dernière. Tout à son objectif, Manille ne l’écoutait pas, scandant leur progression de coups d’œil en arrière et de mots rassurants.
Elle finit par s’arrêter au niveau d’une sorte de carrefour ouvrant sur un lacis d’autres venelles étroites et ténébreuses, et réfléchit silencieusement, cherchant à s’orienter par rapport à la Water of Leith et aux demeures sur ses berges dont les fondations devaient se situer non loin de là.
– Bon sang, Manille, qu’est-ce que tu fais ? Tu sais que je n’aime pas que nous traînions dans ce genre d’endroit.
La jeune femme ne releva pas, mais demanda :
– Tu te souviens de notre balade de l’autre jour, du côté du moulin abandonné ?
– Oui, et alors ?
– Je souhaite découvrir un accès à cette demeure, en surplomb du cours d’eau.
– Celle que tu voulais visiter ?
Manille acquiesce d’un air songeur.
– Elle est cadenassée. Nous n’allons quand même pas tenter de pénétrer à l’intérieur ! C’est impossible. Et si on nous surprenait…
Manille haussa les épaules. Dans le coin, qui s’intéresserait à elles ou encore à ces sortes de traverses aveugles et insalubres menant à la rivière, alors qu’il y en avait tant d’autres au cœur même de la vieille ville ? En fouillant les ombres à la recherche d’un signe reconnaissable, son regard tomba sur le petit rongeur qui fuyait à ses pieds. Manille espéra qu’Eilidh ne le verrait pas. Captivée, elle suivit discrètement la course du rat qui trottinait sur le sol inégal puis repéra le renfoncement du mur qui se creusait sous les infiltrations et le poids des siècles. Elles devaient passer par la venelle de gauche. La jeune femme se tourna vers sa compagne, et marmonna :
– Je veux juste vérifier une hypothèse, Eilidh. Viens ! On ne doit plus être très loin.