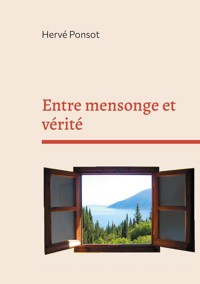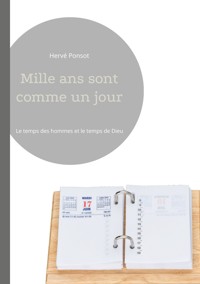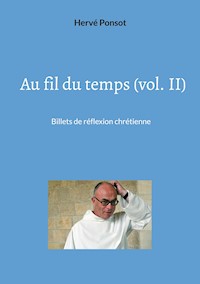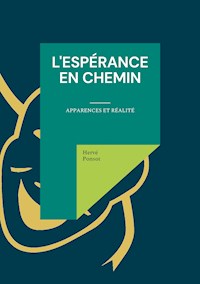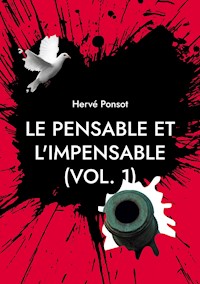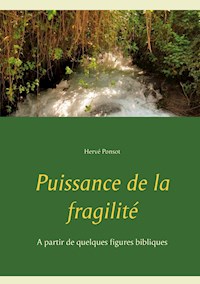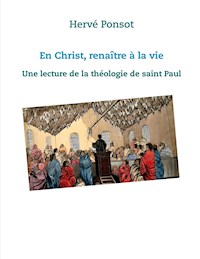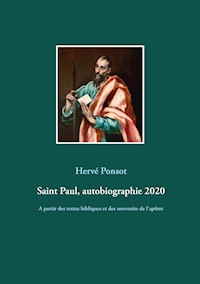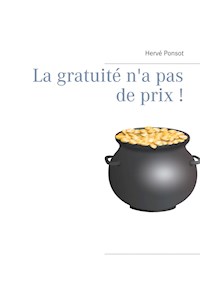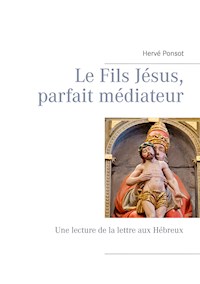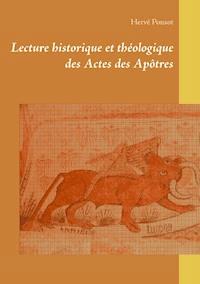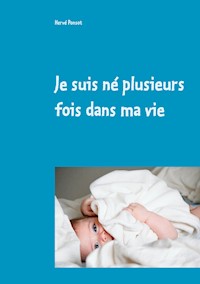
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Après 69 ans de vie et de multiples responsabilités qui l'ont fait voyager dans le monde entier, le frère Hervé Ponsot, Dominicain, a jugé qu'il était l'heure de se poser et de faire un bilan : retour sur le passé et le présent pour mieux aller de l'avant. Il souligne comment, à 4 reprises qu'il appelle ses naissances, le Dieu de Jésus-Christ a pris un soin particulier de lui pour l'orienter sur le chemin. Voici un livre de vie, très personnel et très général à la fois, qui suscite reconnaissance et espérance.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Nihil Obstat
Jean-Miguel GARRIGUES, o.p.
Denys SIBRE, o.p.
Imprimi Potest
Toulouse le 31 mai 2020
Olivier de SAINT-MARTIN, o.p.
Prieur provincial
Table des matières
Introduction
Fédala (Maroc)
Première naissance
Bordeaux
Le Vésinet, pour une deuxième naissance
Installation
Études à Saint-Érembert et au lycée Marcel-Roby
Bac 1968
La vie quotidienne et les vacances
Paris, une nouvelle étape de ma vie étudiante
HEC, Jouy-en-Josas
Paris à nouveau, et pour une troisième naissance
Novice à Toulouse, puis étudiant à Montpellier, Strasbourg, Toulouse
Le noviciat à Toulouse
Le temps des études : Montpellier, Strasbourg, Toulouse
Jérusalem, École biblique et archéologique française
Bordeaux, comme thésard et formateur
Toulouse
Maître des novices
Syndic conventuel et « geek informatique »
Secrétaire du SIDR
Maître des étudiants et syndic intermittent
Secrétaire interprovincial, co-fondateur de DOMUNI
Haïti et Montpellier
Haïti
Montpellier à nouveau
Toulouse
Jérusalem, bis
Lille
Montpellier, et une quatrième naissance
Gaspard
L’effet Gaspard
Montpellier toujours, et un avenir que je confie au Seigneur
Annexe : Photos
Famille
Le Vésinet, Saint Germain-en-Laye
Des lieux : Jérusalem, Lille, Montpellier
Gaspard Clermont
L’effet Gaspard
Introduction
Est-on vieux à 69 ans ? Certains disent que oui, d’autres que non : cela dépend largement sans doute de celui qui parle. Pour ma part, puisque je vais atteindre cet âge très bientôt, je ne me crois pas encore vieux. Ni non plus très jeune, mais quelque peu diminué sur certains points, par exemple celui de la mémoire et de la santé.
Il paraît que la vieillesse s’apprécie surtout à partir de la qualité des artères, ou de l’agilité des neurones : sur ces deux points, tout n’est pas perdu. Et c’est sans doute ce qui m’a permis de sortir deux livres au début de cette année 2019, ou d’écrire régulièrement sur l’un ou l’autre de mes deux blogs. Comme aussi, sur un tout autre plan, de mener avec une certaine fidélité, la vie commune, trait caractéristique de la vie religieuse.
Alors pourquoi écrire maintenant sur ce qu’a été ma vie ? N’ai-je pas encore tout le temps de le faire ? Bien malin qui peut l’assurer. Il suffit de se remémorer la parabole du « riche insensé » en Luc 12,16-21, dont voici un extrait :
« Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?»
Mais là n’est sans doute pas pour moi l’unique raison, ni même peut-être l’essentielle. Un peu comme Pablo Neruda, mais avec moins de lustre, « j’avoue que j’ai vécu ». Plusieurs vies1 parce que… je suis né plusieurs fois. Et comme j’ai la plume, ou plutôt le clavier, facile, je vais raconter.
Si cela peut être utile de quelque manière à quelqu’un un jour, tant mieux ! Sinon, cela restera quand même pour moi un projet stimulant commencé en temps de confinement.
1 Il est vrai que j’ai publié tout récemment un livre sous le titre « Nous n’avons qu’une seule vie », mais le propos n’est pas contradictoire comme on le verra.
Fédala (Maroc)
Première naissance
Je suis né une première fois le 23 octobre 1951 à 23 h 45. Cette heure tardive est-elle déterminante dans mon signe astral (Scorpion) ? Peu importe : j’ai toujours pensé, au moins depuis que je pense, être gouverné par d’autres signes que ceux du Zodiaque.
Cette naissance eut lieu à Fédala, aujourd’hui Mohammedia, au Maroc : c’était la banlieue de Casablanca où mon père travaillait dans une agence des Forges de Strasbourg. Rien à voir avec un travail dans les mines ou dans une forge : cette société fabriquait du mobilier de bureau métallique (à l’époque !), et mon père y a fait toute sa longue carrière, dans le secteur administratif et commercial. Ce qui lui a permis, gros travail aidant, de monter des échelons, d’entretenir une famille nombreuse, et… de meubler nos chambres de quelques horreurs. Ma mère, de huit ans plus jeune que son époux, l’a toujours merveilleusement accompagné, et l’on peut dire qu’ils ont formé un couple très uni.
La famille comptait trois enfants à mon arrivée, un garçon situé entre deux filles : un autre garçon nous rejoindra deux ans plus tard, né lui en Savoie. Mes aînés ont toujours gardé un souvenir très heureux de leurs deux années passées au Maroc, qui était encore un protectorat et où la présence française était bien acceptée : nous étions loin d’être des français isolés. Nous avons conservé longtemps dans ma chambre, qui était aussi celle de mon jeune frère, une grande carte de ce protectorat, marquée en bas à droite « Sidi Mohammed ben Youssef » : il était le sultan de l’époque, avant de devenir le roi du Maroc sous le nom de Mohammed V.
Cette carte reste pour moi l’un des rares souvenirs de ce séjour idyllique : nous avons quitté le Maroc pour Bordeaux en janvier 1952, trois mois environ après ma naissance. Ah ! nous avons conservé aussi, pendant de longues années, un film noir et blanc 8mm, aujourd’hui disparu. C’est ce film, dont quelques images saccadées persistent dans ma tête, qui dit pour moi « le Maroc ». On n’y voit pas grand-chose, des sourires, des orangers, une rue claire…
Je prétends parfois, pour m’amuser, avoir eu le temps d’apprendre l’arabe, en supposant que Areu ! Areu ! se dit de la même manière en français et en arabe : mais ce n’est pas vraiment sûr ! En fait, les très rares expressions arabes que je connais encore aujourd’hui sont celles que l’on m’a rapportées et apprises plus tard, telles « ferme la porte » ou « apporte le café ».
En repassant rapidement à Casablanca en 1974, avec quelques amis étudiants, j’ai trouvé une grande ville industrielle, sans charme particulier. Il existe heureusement d’autres lieux au Maroc, tels Taroudant, Tafraout, Marrakech ou Fez, et surtout des paysages, tels ceux de l’Atlas, qui permettent aux touristes de garder de très bons souvenirs. Mais, en toute franchise, pour avoir, dans le même voyage, « enchaîné » avec l’Algérie, et connu l’Oranais, la Kabylie ou Alger, j’ai été plus marqué encore par les paysages et l’accueil reçu dans ce dernier pays.
Parlons de Bordeaux.
Bordeaux
Mes souvenirs de Bordeaux ne datent pas du début de notre résidence là-bas, à moins qu’ils ne soient ceux de mon frère aîné et de mes sœurs. En remontant dans ma propre mémoire, je vois une maison bourgeoise située au 123 rue Mondenard, qui ne fut pas notre premier point de chute, et une école où se passèrent mes tout premiers apprentissages, Dutreuil. Plus tout un tas d’éléments épars.
Pourquoi le souvenir de la maison m’est-il resté ? Pour une part sans doute parce que ce fut mon premier « chez moi » ; mais sans doute aussi parce que ma famille a gardé, et conserve encore, plusieurs photos du salon où nous posions en famille. Sur ces photos, figure mon jeune frère, né en juillet 1953, et qui marche déjà : elles ne datent donc pas du début du séjour. Et puis, et je ne sais pourquoi, je me souviens surtout du jardin, dans lequel un abricotier donnait ses fruits de manière erratique, selon les années.
Je sais très bien par contre pourquoi j’ai gardé un certain souvenir de l’école Dutreuil. J’y fus inscrit dès l’âge de quatre ans, je crois, ce qui n’est plus la norme actuelle, et reconnu bon élève : l’apprentissage de la lecture fut facile et rapide. Oui, mais il faut savoir que les « châtiments corporels », un grand mot, étaient encore en usage : j’ai dû plusieurs fois présenter les doigts pour recevoir un petit coup de règle, et surtout accepter une fois, comme beaucoup d’autres de mes camarades de classe, une tape sur les fesses avec une « déculottée ».
Horreur, penseront certains, marquage à vie puisque je m’en souviens encore. Je ne nie pas la blessure, qui fut de honte beaucoup plus que de mal. Pourtant, je ne crois pas, jusqu’à ce qu’une improbable analyse me manifeste le contraire, en avoir subi un traumatisme durable tout au long de ma vie. C’était assez banal pour l’époque. Et il n’est pas sûr que mes parents, s’ils l’avaient su, mais je ne crois pas que ce fut le cas, eussent vigoureusement protesté. Quoi qu’il en soit, il n’était certainement pas besoin d’en passer par là.
Quels autres souvenirs rappeler ? Le fameux hiver 19562 ? Je n’en ai pas un souvenir personnel, sinon celui que m’a laissé un autre film familial 8mm : y apparaissaient une épaisseur de neige incroyable, dont témoignent encore de nombreuses photos d’époque, et un bonhomme que nous avions façonné devant la maison. Rien d’autre sur ce point.
Pour un enfant, les souvenirs « sucrés » restent souvent bien présents. De fait, je repense aux « religieuses » achetées et consommées le dimanche après la messe3, ou encore aux « Mistrals gagnants », une sorte de poudre fruitée que l’on achetait en boulangerie et que l’on aspirait avec une paille. Qui s’en souvient encore aujourd’hui en écoutant la chanson de Renaud qui porte ce titre, et illumine le film du même nom, très émouvant, réalisé par Anne-Dauphine Julliand ?
Souvenir épars encore que celui d’un moment familial de vacances à Arsac, je crois. Notre maison se trouvait à mi-chemin d’une grande montée, ou d’une grande descente, c’est selon, prolongée en son point le plus bas par une trouée forestière semée d’aiguilles de pin, et sur lequel il était courant que l’on s’élance avec des skis en plein été. Cela se pratique peut-être encore. Avec mon jeune frère, nous avions trouvé la portière de notre voiture ouverte, et n’avions rien imaginé de mieux que de desserrer le frein à main ! La voiture s’est retrouvée très vite en bas, sans aucun dommage pour l’environnement, ni pour nous, sinon une grande peur et l’assurance donnée à nos parents que nous ne recommencerions pas.
Ce sont de ces bêtises que l’on fait enfant, et que nous n’avons ni mon frère, ni moi, jamais recommencées. Et puisque j’ai commencé de parler de mon jeune frère, je vais continuer. Nous avions donc deux ans d’écart, et très vite, pour des raisons de commodités vestimentaires peut-être, nos parents ont choisi de nous habiller comme des jumeaux. Et cela peut-être jusqu’à mes dix ans, ou même plus.
Du coup, beaucoup de gens nous prenaient pour de vrais jumeaux. Nous ne nous ressemblions pas vraiment, mais nous vivions, et nous avons toujours vécu, une forte complémentarité, et une très grande complicité. Quelques années plus tard, alors que nous avions quitté Bordeaux et que nous passions nos vacances estivales à Carnac, auprès de nombreux oncles, tantes, cousins, il était d’usage pour eux de nous voir toujours ensemble et, comme nous étions encore de modeste constitution physique, de nous appeler « les quinze grammes ». Très reconnaissables : tee-shirts rayés et bobs blancs sur le crâne. Comme si l’on craignait le soleil dans un tel endroit !
Comme aîné, j’aurais pu en vouloir à mes parents de m’avoir « assimilé » à mon frère plus jeune, mais c’est là un sentiment que je n’ai jamais connu. Je viens de parler de complémentarité : j’ai de fait trouvé en mon frère un tempérament très ouvert, très relationnel, quand je suis resté longtemps quelque peu « confiné » dans mes livres (bibliothèque verte et rose, essentiellement) et mon moi intérieur. Du coup, mes amis étaient ceux de mon jeune frère, et je ne m’en suis jamais plaint.
2 Et non pas l’hiver 1954, terrible lui aussi, mais qui doit largement sa notoriété à l’abbé Pierre et à l’appel qu’il a lancé.
3 Je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu’il s’agit en fait de délicieux choux à la crème.
Le Vésinet, pour une deuxième naissance
Installation
Au cours de l’année 1957, grand changement, nous quittons Bordeaux pour la banlieue « chic » de Paris, Le Vésinet. Les rois Louis XV et Louis XVI en avaient fait un lieu de chasse très apprécié, et l’existence statufiée d’un grand cerf sur l’un des ronds-points de la ville doit en marquer le souvenir. Si les forêts en ont disparu pour se réfugier sur les hauteurs de saint Germain-en-Laye, Le Vésinet restait et reste encore, en dehors de son banal centre-ville, un ensemble résidentiel magnifique combinant lacs, pelouses, et maisons bourgeoises avec jardins.
Pourquoi cette mutation ? Pour une part pour des raisons professionnelles tenant à la carrière de mon père, bien sûr, mais qui ne signifiaient nullement un changement considérable de statut financier. Mais aussi parce que, du côté de ma grand-mère paternelle, on avait connu, à travers l’édition musicale et le papier d’Arménie (le signe d’authenticité reste la signature Auguste Ponsot), une certaine aisance : si bien qu’un grand oncle William était devenu l’heureux possesseur d’une maison au Vésinet, haute plutôt que grande, à la façade avant étrangement rose. Très anglaise disons4. La maison était inoccupée et se situait en bordure immédiate de la ligne de chemin de fer Paris-Saint-Germain, à quelques centaines de mètres de la gare du Pecq : on va voir plus loin que ce n’était pas sans importance.
Ah ! oui, j’oublie de préciser que ma grand-mère paternelle, et donc l’oncle en question, étaient d’origine anglaise. En outre, on avait beau s’appeler Smyth, avec un Y qui fait tout le charme de ce nom banal, on n’en prétendait pas moins être quelque peu cousin de la reine d’Angleterre. Par les femmes…
Je n’ai pas personnellement connu cet oncle, pas plus que je n’ai connu mon grand-père paternel, décédés respectivement en 1951 et 1950. Par contre, j’ai de beaux souvenirs de ma grand-mère Martha, décédée elle en 1964 à Paris : belle femme, très accueillante et digne, célèbre dans la famille pour ses dons reconnus de portraitiste.
Puisque j’en suis aux grands-parents, évoquons le côté maternel, qui est un peu un autre monde. Pas très loin de Paris, certes, puisque nous sommes en Seine-et-Marne, à Rebais, mais très loin aussi par certains côtés : c’est déjà la