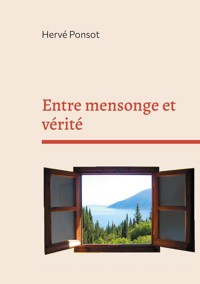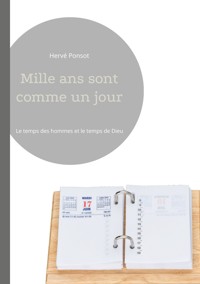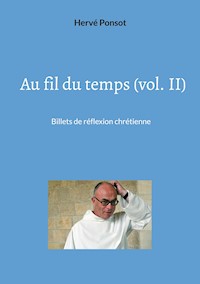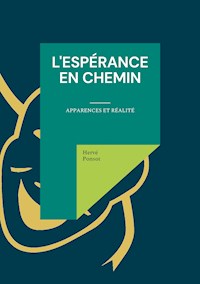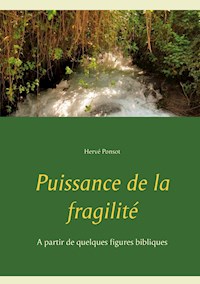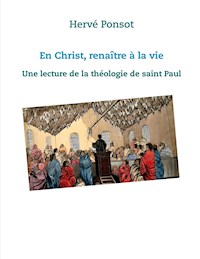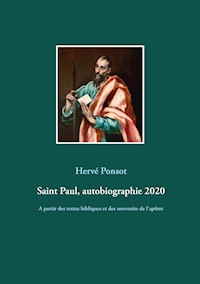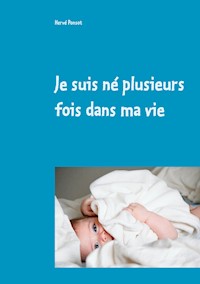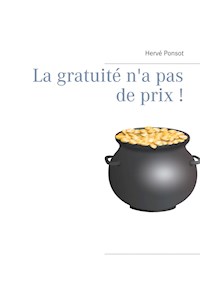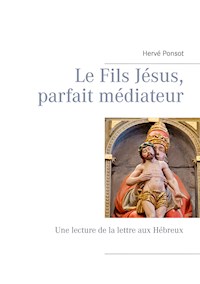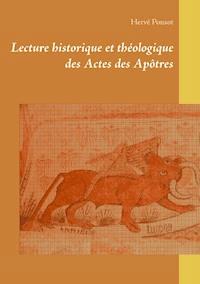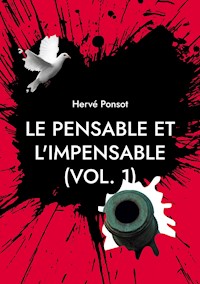
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Les chroniques proposées dans ce livre reprennent une cinquantaine de billets publiés entre 2000 et 2016 sur mon blog Proveritate (https://proveritate.fr). Parmi 587. J'y aborde les sujets les plus divers en lien avec l'actualité du moment : sacrements, questions politiques ou économiques, théologie, faits divers, spiritualité etc.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Introduction
Chroniques du temps qui passe
Dieu de miséricorde : au sujet du divorce
Les risques de la vie
Voici qu’il vient : sur l’espérance
La confiance faite aux disciples
Marie, la croyante, l’orante, la résistante
En Jésus, le monde est autre que ce que nous en voyons
Amour et Trinité sainte
D’une seule voix
Les Amish auraient-ils raison ?
La meilleure façon de marcher
Jacques Ellul (1912-1994) et l’invasion technologique
Les États-Unis en point de mire
Le premier meurtre : Caïn et Abel
La violence des psaumes
Les guerres par morceaux
L’homme est un loup pour l’homme
La parole des victimes et celle des prédateurs
Joie du retour : à propos de l’accueil aux sacrements des divorcés-remariés
Émotion
Vive la décroissance !
Koz toujours
L’étrange étranger
La mort à tout bout de champ
Aujourd’hui, tout est accompli
Le silence des agneaux
Au diable, l’exégèse réductrice
Compassion manquée ?
Le patrimoine chrétien
Entendu et vu
La lecture d’un événement a ses exigences
La charité n’a pas de bornes
Vive la charité !
Le vide peut-il remplacer le plein ?
Les dérives du pouvoir
Le temps des vanités
Le rêve et la réalité
De la vie éternelle
Victoire pour Jeanne d’Arc ?
Aimer ses ennemis
Le règne de la confusion
Violence primordiale
Assurance et audace de la foi chrétienne
L’Autre Dieu
Plus jamais ça, vraiment ?
Satan, prince des ténèbres
Dieu merci !
Le miracle de Lourdes et du Rosaire
Facebook pour le meilleur ou pour le pire !
La grande peur du vide !
Tendre la main au fils prodigue
Lutter contre la dévalorisation du clergé de France
Le compte n’est jamais bon
Ousmane Sow est mort
Éloge de la fragilité
Gaspard, joie et paix de Noël
Du temps a passé !
La règle ou la recommandation
Index thématique
Introduction
En ce début d’année 2022, alors que je viens de publier en coécriture avec Florian Mantione « Le management selon Jésus », je suis surtout connu d’un modeste public par mes livres publiés aux Editions du Cerf ou à compte d’auteur chez Books on Demand. Mais en me penchant sur mon blog Proveritate, tenu depuis l’an 2000 sous différents noms avant d’en venir à celui qui le désigne aujourd’hui, je me dis que là se trouve aussi l’essentiel de mes réflexions. Proveritate compte actuellement 587 billets : beaucoup de prédications, surtout au départ, mais aussi des articles en lien avec l’actualité, qu’elle soit politique, théologique, économique, spirituelle etc. Le tout souvent repris sur ma page Facebook.
Cet élan épistolaire, qui a grandi au fur et à mesure du développement d’Internet, tient d’abord à un souci de rencontre et d’évangélisation, bien naturel chez un frère prêcheur. Mais elle procède aussi du souci très égoïste de mettre au clair mes idées : l’écriture oblige à la précision et à la concision. Surtout dans le cadre d’un blog où l’espace est mesuré.
Pourquoi vouloir en faire un livre ? Le blog ne suffit-il pas ? Les pensées ne risquent-elles pas d’avoir perdu leur intérêt au fil du temps, d’être « datées » comme l’on dit ? Ce fut longtemps ma conviction avant qu’une interlocutrice ne me provoque récemment et me dise estimer que plusieurs de mes billets gardaient une réelle actualité : ils pouvaient donc aider des lecteurs, et justifiaient une présentation plus durable, sur un support moins volatile. Etonné, j’ai commencé à les relire, en partant des plus anciens… Et vanité ou réalité, le lecteur en jugera, je me suis convaincu que mon interlocutrice avait raison, à condition de faire un tri sur les 587 !
J’ai donné à ce livre le titre « Le pensable et l’impensable ». Les pensées que je propose habituellement sur mon blog, en les mettant en ligne sous le regard de tous, sont plutôt courtes, conformes à ce qu’exige un blog. Elles essaient de dépasser l’émotion, de donner des outils d’appréciation négligés, d’apporter un point de vue, et elles le font de manière assez irénique : c’est « le pensable ». Mais d’autres font référence à « l’impensable », autrement dit pour moi le terrorisme, la violence, le silence coupable etc. Là, le lecteur comprendra que je sois plus virulent.
J’ai commencé en 2000 et me suis arrêté à la fin de l’année 2016, avec une exception que l’on comprendra. S’il faut aller au-delà, selon la demande des lecteurs, je constituerai un deuxième volume. Dans l’attente, on peut se reporter à mon blog Proveritate.
Chroniques du temps qui passe
Dieu de miséricorde : au sujet du divorce
8 octobre 2000 Marc 10,2-16
Frères et sœurs, comme le note un commentateur, « aborder la question du mariage par celle du divorce n'est pas la plus noble façon, mais, de tous temps, la plus cruciale » : cruciale au premier chef pour ceux qui, de différentes manières, subissent les effets d'un tel divorce ; mais cruciale aussi, disons-le, pour le prédicateur de ce jour que l'on risque bien d'attendre au tournant... Un de mes frères dominicains disait volontiers que Dieu ne nous attend pas au tournant, mais qu'il le prend avec nous : je souhaiterais que l'Église et chacun d'entre nous fassent de même dans la question qui nous occupe.
Frères et sœurs, laissez-moi d'abord confesser la foi de l'Église : oui, le mariage est un mystère de grande portée, et il est indissoluble. « Dieu n'a pas créé l'homme », affirme dans un titre provocateur la psychanalyste Marie Balmary : de fait, le premier récit biblique de la création, lu au plus près, affirme que Dieu a créé le terrien indifférencié, mâle et femelle ; et le deuxième récit, celui que nous venons d'entendre, montre que l'homme et la femme ne surgissent eux plus tard que dans la rencontre. Autrement dit, l'homme et la femme ne deviennent vraiment sujets que dans cette relation qui les unit, à l'image de ce que Dieu est en lui-même. En ce sens, pour cette raison et pour bien d'autres, le mariage qui met en relation, par la volonté même de Dieu, deux êtres qui se correspondent est une réalité créatrice, merveilleuse, unique : « ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Le conseiller d'équipe Notre-Dame, et même le célibataire que je suis, ne trouvera jamais de mots assez justes, assez forts pour dire la grandeur du mariage.
Je sais parfaitement et reconnais que Dieu donne sa grâce, toute sa grâce, aux époux qui s'unissent sacramentellement : je suis sans cesse le témoin émerveillé des effets de cette grâce dans de très nombreux couples. Mais je constate aussi que l'accueil de cette grâce est exigeant, difficile, d'autant plus difficile qu'il doit être le fait de l'un et de l'autre, ensemble sinon en même temps, et je vois que de nombreux couples y échouent. Cet échec ne dissuade pas certains d'entre eux de vouloir tenter un nouvel essai, que l'église catholique refuse pour sa part de bénir. Elle a ses raisons, meilleures peut-être que certains ne le disent, mais elles ne me feront jamais oublier que Dieu est venu non pour les bien-portants, mais pour les malades et les pécheurs.
A la souffrance de l'échec, à la souffrance de la séparation, à la souffrance de la solitude et de l'incompréhension, comment ajouter encore la souffrance de la condamnation ou du rejet, voire même de la simple réaffirmation d'une loi connue et justifiée ? Jésus ne rappelle pas la loi devant les intéressés : il vient à leur rencontre, au-devant de la femme aux cinq maris comme de celle convaincue d'adultère. Pourtant me direz-vous, aujourd'hui, dans notre évangile, il rappelle bien la loi : mais constatez qu'il ne le fait pas devant les personnes concernées, mais face à tous ceux qui veulent biaiser avec cette loi et le mettre en difficulté ; et précisément parce qu'ils savent combien Jésus est porté à accommoder cette loi, à faire passer l'homme avant le sabbat : si Jésus réaffirme la loi, c'est parce qu'on cherche à le piéger sur sa miséricorde dont on sait qu'elle prévaudra toujours sur cette loi.
Dans quelques temps, je vais me rendre à Paris. J'y rencontrerai un couple : lui est divorcé après 20 ans de mariage, elle n'a jamais été mariée. Il a retrouvé la foi auprès de sa nouvelle compagne. Il sait tout comme elle que leur nouvelle union ne peut trouver de consécration ecclésiale officielle, et aucun d'eux ne demande d'ailleurs une telle chose. Mais je leur ai proposé de prier chez eux et avec eux, en présence de quelques amis, pour confier leur couple au Seigneur, et cette proposition a constitué pour eux une délivrance : elle les a illuminés car ils n'avaient pas osé me l'adresser, et elle leur a redonné l'image d'un Dieu de miséricorde. Frères et sœurs, quel Dieu voulonsnous faire connaître à ceux qui nous entourent, en particulier aux divorcés ?
[Note du rédacteur : sur le même sujet, voir d’abord le billet du 25 octobre 2015 et, en fin de volume, hors cadre chronologique de ce livre et donc dans le chapitre Du temps a passé, le billet du 8 septembre 2018, au sujet de la communion eucharistique des divorcés-remariés. Préparation d‘un volume II ?]
Les risques de la vie
12 novembre 2006 Marc 12,38-44
La sécurité est à l’ordre du jour : sécurité sociale, sécurité dans les transports, dans les banlieues, dans les investissements, dans les carrières professionnelles, dans les opérations chirurgicales, et j’en oublie. Elle n’a sans doute jamais été autant demandée, voire exigée, au point que l’aléa, le manque, l’imprévu, ou a fortiori l’échec, sont des réalités non seulement angoissantes, comme elles l’ont toujours été, mais choquantes et que l’on voudrait dépassées. Ceci suscite en moi une question, un peu provocatrice : cet accent démesuré mis sur la sécurité n’est-il pas proportionnel au désintérêt que notre société manifeste pour Dieu et sa présence ?
Comprenez-moi bien : je ne viens pas vous dire qu’il faille oublier toute recherche de sécurité, par exemple qu’il faille mettre fin à la sécurité sociale, excellent système de redistribution lorsqu’il est respecté, ou prendre n’importe quel risque sous n’importe quelle condition, mais je me dis que la volonté d’éliminer ou de maîtriser tous les risques procède du désir d’une toute puissance que seul Dieu possède en vérité. Autrement dit, à trop vouloir la sécurité que l’on se forge, on en oublie celle que Dieu donne. Les deux veuves dont il vient d’être question dans nos lectures ne l’ont pas oubliée : si elles n’avaient eu d’autre souci que leur sécurité, la veuve de Sarepta n’aurait pas donné au prophète Élie en ce temps de famine le peu de farine qui lui restait, pas plus que la veuve présente au Temple n’aurait mis dans le tronc deux piécettes, autrement dit « tout ce qu’elle avait pour vivre » aux dires de Jésus. Ces deux veuves étaient convaincues de trouver en Dieu leur vraie sécurité.
Considérez Jésus lui-même : si lui aussi n’avait eu en vue qu’une sécurité toute humaine, il n’aurait pas pris le chemin qu’il a pris, il n’aurait pas nettoyé le temple de ses vendeurs, il n’aurait pas affronté les grands prêtres et les scribes, il n’aurait pas guéri des malades le jour du sabbat, bref, il n’aurait pas fait tout ce qui ne pouvait que le conduire à la mort. Et à Gethsémani, lorsque ses disciples l’ont abandonné, lorsqu’il est vraiment seul, il ne fait pas le calcul des pertes et profits que peut faire naître le don de sa vie, non, il prend seulement, en toute confiance, le chemin que lui indique son Père. Il fait le choix de la volonté du Père, d’espérer contre toute espérance, et il se manifeste alors pleinement homme et Dieu.
Notre vie à nous aussi, frères et sœurs, est pleine de risques, à tout instant : il est normal que nous essayions de les diminuer ou de les minimiser, mais il est tout aussi important de se souvenir sans cesse que cette vie repose ultimement dans la main de notre Père des cieux. Le Seigneur, par les voix de tout un tas d’anges, nous parle et nous appelle plusieurs fois par jour à son service : pour le prier, pour pardonner, pour le suivre dans une vie consacrée ou dans le mariage, pour venir en aide à nos frères, peut-être même pour lui donner notre vie. Ne cherchons pas d’abord à savoir de quelles assurances nous disposons pour répondre à son appel. Lorsque les amis sont loin, lorsque toutes nos béquilles humaines nous sont enlevées, lorsqu’il faut faire à Dieu le don de quelque chose de sa vie, ou même de sa vie entière, au prix d’un grand saut de la foi, souvenons-nous que Dieu lui est encore là, plus présent que jamais dans nos vies.
Rappelons-nous l’exemple de ces veuves : je ne sais pas, il est vrai, ce qu’il est advenu de celle qui s’est rendue au temple, mais je sais que celle de Sarepta a eu ensuite de la farine à profusion pour elle et son enfant. Ces deux veuves, à l’exemple de Jésus à Gethsémani, avaient une assurance et une seule : celle de la présence du Seigneur avec elles, l’Emmanuel, et elles l’ont justement préférée à toutes les assurances de la terre.
Voici qu’il vient : sur l’espérance
16 décembre 2007 Matthieu 11,2-11
Frères et sœurs, depuis le début de l’Avent, dans les chants comme dans les lectures, on ne cesse de nous le répéter : le Seigneur vient, il est venu, il reviendra ! Tant mieux, mais je me demande si quelques-uns d’entre nous, et beaucoup plus encore autour de nous, ne vont pas dire : montrez-le nous ! Comment dire aux inondés du Bangladesh, aux chômeurs de longue durée, aux mal ou non-logés de chez nous, à la suite du prophète Isaïe : « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver » ? Ou bien, avec Jacques : patience, un mot qui revient à trois reprises chez l’apôtre, cela va venir ? N’y a-t-il pas déjà deux mille ans qu’on attend ?
Face à de tels soupçons, je vois au moins deux réponses. La première vient d’une certaine lecture de l’évangile : savons-nous voir le Seigneur qui vient ? A Jean-Baptiste qui lui pose la question : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? », Jésus répond : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Jésus n’emploie pas de futurs, notez-le bien, mais des présents, invitant les disciples de Jean, et nous invitant nousmêmes à regarder le monde autrement, dans la foi, avec l’universalité du regard qui s’impose en christianisme.
Aujourd’hui, en ce moment même, c’est vrai, des enfants meurent de faim, des hommes et des femmes souffrent de violences, de guerres, de maladies, et c’est insupportable, et nous devons prendre tous les moyens de leur venir en aide ; mais aujourd’hui aussi, en ce moment même, des enfants naissent, des hommes et des femmes se réconcilient ou sont guéris, Dieu donne sa grâce, et l’on oublie trop souvent de le dire et de l’en remercier. Vous le savez, il est des publications et revues qui aiment parler des seuls chiens écrasés, et d’autres qui savent évoquer tout ce qu’il y a de beau dans notre monde : ce n’est pas de l’inconscience, mais un équilibre nécessaire du regard.
Cette réponse ne suffira pas, bien sûr, à ceux qui, en ce moment même, souffrent, peinent, attendent. Et je crois qu’il faut oser une autre réponse, peut-être provocatrice, qui m’est suggérée par la magnifique réflexion que le pape Benoît XVI vient de consacrer à l’espérance. Le pape y explique entre autres choses que la crise de foi de notre humanité est d’abord et avant tout une crise de l’espérance, que nous réduisons trop souvent à des attentes mondaines, souhaitables ou grandioses comme on voudra, mais trop mondaines. Benoît XVI prend l’exemple de l’espérance du progrès, qui engendre toujours plus de déceptions et dans laquelle la foi ne joue finalement qu’un rôle mineur ou nul. Nous avons donc l’espérance d’un « mieux » humain, mais, pour reprendre les termes de notre pape, « la vraie, la grande espérance de l’homme, qui résiste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu – le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime ».
Concrètement, cela veut dire que la venue du Seigneur doit certes nous conduire à manifester plus de charité, plus d’humanité, mais que ces progrès ne sont pas la mesure de la venue du Seigneur. D’une certaine manière, le Christ nous a prévenus lorsqu’il a dit à ses disciples : « les pauvres, vous les aurez toujours avec vous » (Mt 26,11). Ce n’est donc pas parce que l’humanité est plus joyeuse, plus solidaire, plus paisible, que le Seigneur vient, mais parce qu’il vient que l’humanité peut être ou devenir tout cela. Notre espérance est plus haute, elle va plus loin et c’est elle qui nous pousse à dire : comme tu es déjà venu, viens encore, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, dans nos célébrations, dans nos vies, sur toute notre terre. Règne sur nous : alors, oui, le monde sera profondément renouvelé, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront et les muets crieront.
La confiance faite aux disciples
12 juillet 2009 Marc 6,7-13
Frères et sœurs, s’il y a parmi vous des femmes et des hommes d’affaires, ou simplement des entrepreneurs au sens le plus large de ce terme, ils ne me contrediront pas : au XXIe siècle, pour lancer une affaire, et pour lui assurer le succès, mieux vaut disposer d’un bon produit et d’une bonne équipe, que l’on aura pris le soin de bien former. Aussi, lorsqu’on regarde la manière dont Jésus agit, on peut se demander à quel entrepreneur nous avons à faire : il envoie sur les routes douze personnes très ordinaires, avec un programme très vague de maîtrise des esprits mauvais, sans leur avoir donné la moindre formation à ce sujet. Et le plus extraordinaire, c’est que cela semble produire du fruit, à la plus grande surprise peut-être des disciples eux-mêmes et pas seulement à la nôtre. Quel est donc le secret de cette réussite ?
Je ne suis pas sûr qu’il faille faire des méthodes de Jésus l’enjeu d’un séminaire de réflexion, mais il semble d’abord que Jésus pourrait bien en remontrer à n’importe quel manager sur le plan de la confiance faite aux hommes. Bien sûr, il y a derrière tout cela une dimension spirituelle sur laquelle je vais revenir, mais il y a aussi une confiance accordée aux capacités humaines, quelles que soient les personnes. Au fil de l’évangile, on voit les Douze poser les questions les plus naïves, se disputer les premières places, paniquer à la moindre tempête : on ne peut pas dire qu’ils forment une société exemplaire, de gros calibre ! Mais Jésus leur fait confiance, les reprend, ils apprennent, et ce sont les mêmes qui sauront plus tard se dresser face à tous les pouvoirs, et porter l’évangile aux extrémités de la terre.
Ce qui veut dire, frères et sœurs, qu’il n’y a pas de grandes et de petites personnalités, il y a des hommes et des femmes qui, selon la confiance qu’on leur accorde, sont capables du meilleur ou du pire. Il est bien vrai que l’élan que l’évangile évoque pour nous aujourd’hui n’a pas la même ampleur que celui qui aura lieu plus tard, après la Pentecôte, grâce au don de l’Esprit : car ce seront alors la vie et la force de Jésus ressuscité qui passeront par les apôtres. Mais aujourd’hui, les voilà quand même qui chassent les démons, guérissent des hommes et des femmes. Oui, ils n’ont pour l’heure que la parole de Jésus, qui leur fait confiance et auquel ils font confiance, mais cela suffit déjà à leur faire faire des merveilles.
Mais vous le savez bien, la confiance peut être trahie, et celle que Jésus a mise en Judas le sera : pas encore aujourd’hui, puisqu’il semble bien d’après l’évangile que tous les apôtres sans exception aient été partie prenante de cette fructueuse mission ; mais plus tard, lorsque les temps seront devenus plus difficiles, que des questions concernant ce Jésus en qui ils ont mis leur foi viendront à se poser.
Aujourd’hui, compte tenu de ce qui adviendra plus tard, Jésus nous donne une autre leçon : la confiance ne se monnaye pas. Comme moi sans doute, vous avez entendu plusieurs fois des phrases du genre : « il faut que tu prouves quelque chose », ou « je te fais confiance si… ». Le « si » vient tout gâcher, et mettre en doute la confiance. Comme Jésus le manifeste dans notre évangile, la confiance se donne d’emblée et s’éprouve ensuite, parfois aux dépens de celui qui la donne : cela fait partie des risques de la confiance. Jésus a fait confiance à Judas, aujourd’hui, si je peux m’exprimer ainsi, cela marche et demain, cela ne marchera plus.
Je ne pense pas que nous soyons des Judas, mais la question n’est pas là : en nous appelant aujourd’hui à son eucharistie, en nous renvoyant ensuite dans nos foyers, Jésus manifeste à notre égard cette même confiance qu’il a manifestée à ses disciples. En plus, comme il le fera plus tard avec eux, il nous a donné son Esprit. Nous sommes donc parfaitement équipés pour chasser les démons, guérir ceux qui nous sont confiés, annoncer l’évangile du salut en tout temps et en tous lieux : montrons-nous dignes de la confiance qui nous est faite, et accordons-la largement à ceux qui nous entourent.
[Note du rédacteur : retrouvant ce vieux billet, je me rends compte qu’il annonce largement l’ouvrage « Le management… selon Jésus », écrit à l’initiative de Florian Mantione et co-écrit avec lui, publié en novembre 2021]
Marie, la croyante, l’orante, la résistante
25 octobre 2009
En ce dernier dimanche d’octobre, l’église de Terre Sainte fête Notre-Dame de Palestine, tout spécialement au sanctuaire de Deir Rafat. A la différence de nombreux sanctuaires mariaux, celui-ci ne commémore pas une quelconque apparition : construit en 1927, il marque simplement la consécration de cette Terre à la Vierge Marie. La Vierge n’y est donc pas représentée de manière particulière, avec tels vêtements ou un message spécifique : elle est présente par la volonté des hommes plus que par une intervention divine, et chacun se trouve libre de mettre l’accent qu’il veut pour cette fête.