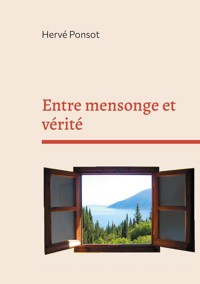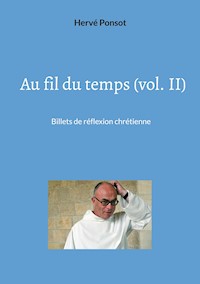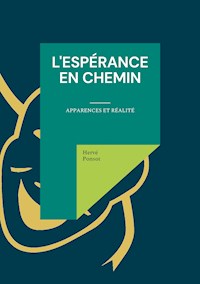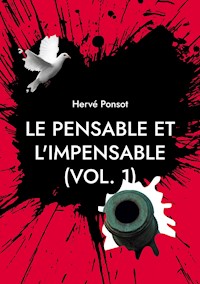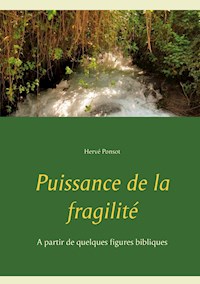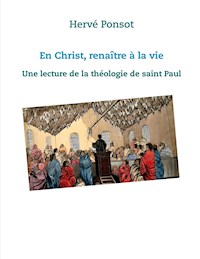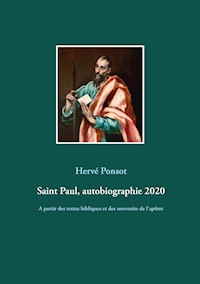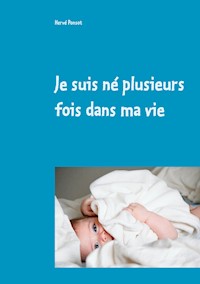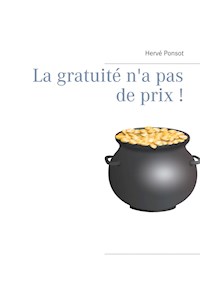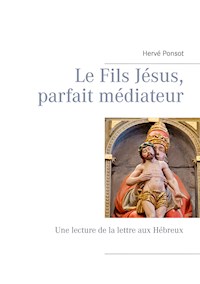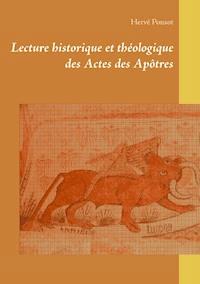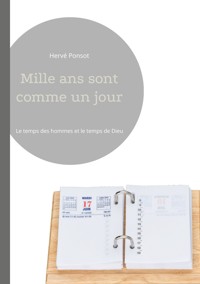
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Nous nous posons rarement la question du temps comme tel, nous l'accueillons, nous le vivons. Nous l'évoquons surtout lorsqu'il se présente comme une pression : "je n'ai pas le temps de faire tout cela", "la promotion s'achèvera dans trois jours". Tout cela concerne le temps des hommes, mais il est une autre manière de parler du temps et et de le vivre, celle dont il est question dans la Bible, du côté de Dieu. Accueillir le temps des hommes comme don et temps de Dieu, voilà qui en allège le poids et trace une autre manière de vivre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 50
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introduction
Lors d’une rencontre d’un groupe catholique d’aumônerie, la question fut posée de l’attitude à avoir face à une éventuelle demande de suicide assisté. Aucune réponse générale n’allait évidemment de soi, tant les circonstances peuvent être diverses et surtout personnelles. Après réflexion, j’ai suggéré, dans la mesure où cela apparaissait possible, de proposer un délai, quand bien même la décision de la personne serait déjà prise.
En effet, souvent, dans le domaine médical et ailleurs, la pression vient largement de l’échéance en noyant les possibilités de recours et de retour en arrière : il faut choisir et vite ! « Si vous persistez dans votre demande de suicide assisté, elle sera mise en application demain matin, ou dans quelques heures ».
Je viens d’écrire que la pression du temps existait en dehors du domaine médical. En effet, nous y sommes sans cesse confrontés pour prendre par exemple une décision d’achat, infiniment plus banale quand même dans ses conséquences : « la promotion s’achèvera dans trois jours » ou bien « vous avez de multiples concurrents sur le même projet d’investissement immobilier, etc. »
La question du temps est donc cruciale, et cela ne « date » pas d’aujourd’hui : elle a toujours existé depuis que le temps existe, autrement dit depuis l’origine du monde. Pourtant, sans aucunement prétendre révolutionner la thématique, je me propose d’y réfléchir encore, en confrontant la perception que l’homme ordinaire a du temps, avec celle que Dieu lui propose. À partir de ce que la Bible peut en dire.
Le temps des hommes
Réflexions communes sur le temps
Combien de fois, quotidiennement, sous des formes diverses, nous évoquons le temps et le rapport que nous avons ou croyons avoir avec lui ! Voici quelques échantillons.
1. Je n’ai pas le temps / Je perds mon temps
Voilà sans doute les deux réflexions les plus communes, que l’on peut entendre ou dire plusieurs fois par jour. Elles supposent que le temps est une donnée possédée en propre (mon temps), mais finie et donc mesurée, et qu’il faut donc gérer au mieux, en se protégeant des « pertes de temps ».
2. Il essaie de rattraper le temps perdu
Heureusement, il semblerait selon certains que l’on puisse rattraper le temps perdu. À l’inverse de ce qu’affirmait la chanteuse Barbara dans une magnifique et célèbre chanson :
« Dis, quand reviendras-tu, Dis, au moins le sais-tu, Que tout le temps qui passe, Ne se rattrape guère,Que tout le temps perdu, Ne se rattrape plus ».
Mais la chanteuse a évidemment raison : lorsqu’on dit de quelqu’un qu’il a rattrapé le temps perdu, on veut simplement affirmer qu’il a commencé un temps autre, sur de nouvelles bases. Le temps perdu reste perdu.
3. Il prend son temps / Il joue la montre
Si l’on ne rattrape pas le temps perdu, d’aucuns affirment qu’on peut le prendre comme son bien propre. Ainsi a-t-on souvent dit d’un tennisman célèbre « qu’il prenait son temps au moment de servir ». Et comme il a été fait la remarque aux arbitres et organisateurs que ce temps entre les échanges pouvait être déstabilisant pour l’adversaire, il est maintenant limité. Alors que notre tennisman cherchait peut-être simplement à le maîtriser.
Certes, le temps est mesuré, et de mieux en mieux : du sablier à l’horloge atomique, que de progrès pour l’appréhender de plus en plus finement ! Jusqu’à supprimer son existence lorsque l’on invoque l’urgence.
4. C’est urgent !
Chacun le sait aujourd’hui, les « urgences hospitalières » en France sont souvent des lieux d’attentes très longues. Sans que les médecins ne soient aucunement en cause : ils sont tout simplement débordés, et échelonnent leurs patients selon le « degré d’urgence ».
L’urgence varie donc « au fil du temps ». Il y a quelques dizaines d’années, l’injonction « Peux-tu m’envoyer telle lettre ou tel colis en urgence ? » exigeait quand même plusieurs heures pu jours avant que le destinataire ne la/le reçoive. Les choses ont pas mal changé avec l’apparition d’Internet : mais si la messagerie remplace de plus en plus le courrier classique et peut prétendre à l’urgence, le colis n’a pas la même souplesse !
Non, l’urgence ne supprime pas le temps, elle le raccourcit.
5. Le temps de cerveau disponible / Le temps, c’est de l’argent
En 2004, Patrick Le Lay, alors président de TF1, lance dans l’ouvrage « Les dirigeants face au changement » (Éditions du Huitième jour) une affirmation qui fera largement polémique et qu’il faut citer sans la tronquer :
«Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective business, soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu ’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ».
Dans une société largement mercantile, cette affirmation est un nouvel exemple du fait que « le temps, c’est de l’argent ».
Il serait possible d’allonger la liste, mais cela ne ferait que renforcer ce qui se dégage déjà. Le temps est le plus souvent conçu comme une réalité qui appartient en propre à l’homme, une sorte de bien personnel qu’il partage ou qu’il garde jalousement, et qu’il lui incombe de gérer à sa convenance.
Avec quels mots parler du temps ?
Comme il vient d’être rappelé, le temps est souvent compté, surtout s’il est de l’argent. On parlera de moment, instant, durée, éternité, patience, chronologie, demain, semaine, mois et année, etc. Notons que ces mots sont souvent rattachés à une préposition, ce qui indique que l’on en a une certaine maîtrise : dans un moment, dans un instant, pour une longue durée, au mois ou à l’année.
Les trois termes les plus connus et utilisés sont d’une part le moment ou l’instant, qui correspond au grec kairos, et d’autre part, le temps au sens de durée, qui correspond soit au grec chronos, soit au grec aiôn, que l’on traduit souvent en français par éon. Ce dernier est peu connu, et la différence avec chronos