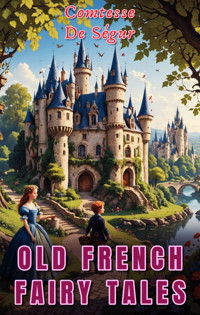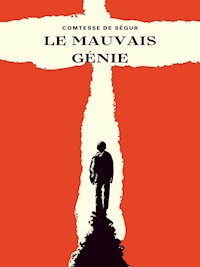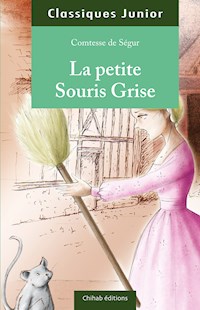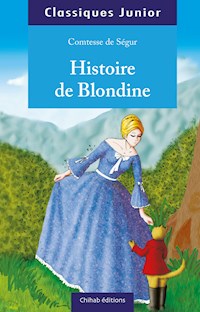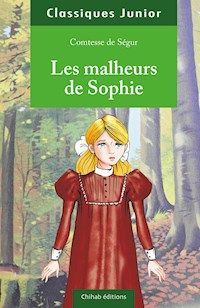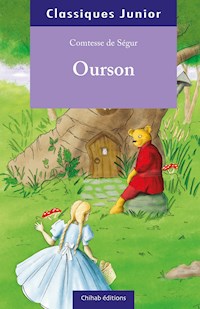comtesse de Ségur
Les petites filles modèles
Illustrations de
Ghalia Tonkin
CHIHAB EDITIONS
© Editions Chihab, 2016.
ISBN : 978-9947-39-198-3
Dépôt légal : 2e semestre 2016.
Avant-propos
Lire est du meilleur profit à tout âge. Il ressort notamment que la lecture, outre son caractère ludique et divertissant, est le meilleur moyen pour l’apprentissage et la maîtrise d’une langue et l’éveil de l’esprit critique.
Partant du constat fait par les pédagogues et chercheurs sur les bienfaits de la lecture perçue comme base première des apprentissages à venir pour les jeunes et les étudiants, les Editions Chihab se proposent de mettre à la portée de tous, notamment les jeunes apprenants de l’Education nationale et les étudiants, une collection de livres classiques.
Cette collection se veut une réponse appropriée aux demandes exprimées par les enseignants de français des différents cycles de formation à savoir favoriser la pratique de la lecture, en dehors du temps scolaire, et en faire un outil indispensable pour progresser dans l’apprentissage de la langue française.
L’objectif de cette collection est de faire connaître les chefs-d’œuvre de la littérature classique dans une version intégrale.
Nous espérons voir cette jeune « collection de livres classiques » s’enrichir au profit de tous.
Bonne lecture.
Préface
Mes Petites filles modèles ne sont pas une création ; elles existent bien réellement : ce sont des portraits ; la preuve en est dans leurs imperfections mêmes. Elles ont des défauts, des ombres légères qui font ressortir le charme du portrait et attestent l’existence du modèle. Camille et Madeleine sont une réalité dont peut s’assurer toute personne qui connaît l’auteur.
Comtesse de Ségur,
née Rostopchine.
1. Camille et Madeleine
Mme de Fleurville était la mère de deux petites filles, bonnes, gentilles, aimables, et qui avaient l’une pour l’autre le plus tendre attachement. On voit souvent des frères et des sœurs se quereller, se contredire et venir se plaindre à leurs parents après s’être disputés de manière qu’il soit impossible de démêler de quel côté vient le premier tort. Jamais on n’entendait une discussion entre Camille et Madeleine. Tantôt l’une, tantôt l’autre cédait au désir exprimé par sa sœur.
Pourtant leurs goûts n’étaient pas exactement les mêmes. Camille, plus âgée d’un an que Madeleine, avait huit ans. Plus vive, plus étourdie, préférant les jeux bruyants aux jeux tranquilles, elle aimait à courir, à faire et à entendre du tapage. Jamais elle ne s’amusait autant que lorsqu’il y avait une grande réunion d’enfants, qui lui permettait de se livrer sans réserve à ses jeux favoris.
Madeleine préférait au contraire à tout ce joyeux tapage les soins qu’elle donnait à sa poupée et à celle de Camille, qui, sans Madeleine, eût risqué souvent de passer la nuit sur une chaise et de ne changer de linge et de robe que tous les trois ou quatre jours.
Mais la différence de leurs goûts n’empêchait pas leur parfaite union. Madeleine abandonnait avec plaisir son livre ou sa poupée dès que sa sœur exprimait le désir de se promener ou de courir ; Camille, de son côté, sacrifiait son amour pour la promenade et pour la chasse aux papillons dès que Madeleine témoignait l’envie de se livrer à des amusements plus calmes.
Elles étaient parfaitement heureuses, ces bonnes petites sœurs, et leur maman les aimait tendrement ; toutes les personnes qui les connaissaient les aimaient aussi et cherchaient à leur faire plaisir.
2. La promenade, l’accident
Un jour, Madeleine peignait sa poupée ; Camille lui présentait les peignes, rangeait les robes, les souliers, changeait de place les lits de poupée, transportait les armoires, les commodes, les chaises, les tables. Elle voulait, disait-elle, faire leur déménagement : car ces dames (les poupées) avaient changé de maison.
Madeleine. – Je t’assure, Camille, que les poupées étaient mieux logées dans leur ancienne maison ; il y avait bien plus de place pour leurs meubles.
Camille. – Oui, c’est vrai, Madeleine ; mais elles étaient ennuyées de leur vieille maison. Elles trouvent d’ailleurs qu’ayant une plus petite chambre elles y auront plus chaud.
Madeleine. – Oh ! quant à cela, elles se trompent bien, car elles sont près de la porte, qui leur donnera du vent, et leurs lits sont tout contre la fenêtre, qui ne leur donnera pas de chaleur non plus.
Camille. – Eh bien ! quand elles auront demeuré quelque temps dans cette nouvelle maison, nous tâcherons de leur en trouver une plus commode. Du reste, cela ne te contrarie pas, Madeleine ?
Madeleine. – Oh ! pas du tout, Camille, surtout si cela te fait plaisir. »
Camille, ayant achevé le déménagement des poupées, proposa à Madeleine, qui avait fini de son côté de les coiffer et de les habiller, d’aller chercher leur bonne pour faire une longue promenade. Madeleine y consentit avec plaisir ; elles appelèrent donc Élisa.
« Ma bonne, lui dit Camille, voulez-vous venir promener avec nous ?
Élisa. – Je ne demande pas mieux, mes petites ; de quel côté irons-nous ?
Camille. – Du côté de la grande route, pour voir passer les voitures ; veux-tu, Madeleine ?
Madeleine. – Certainement ; et si nous voyons de pauvres femmes et de pauvres enfants, nous leur donnerons de l’argent. Je vais emporter cinq sous.
Camille. – Oh ! oui, tu as raison, Madeleine ; moi, j’emporterai dix sous. »
Voilà les petites filles bien contentes ; elles courent devant leur bonne, et arrivent à la barrière qui les séparait de la route ; en attendant le passage des voitures, elles s’amusent à cueillir des fleurs pour en faire des couronnes à leurs poupées.
« Ah ! j’entends une voiture, s’écrie Madeleine.
– Oui. Comme elle va vite ! nous allons bientôt la voir.
– Écoute donc, Camille ; n’entends-tu pas crier ?
– Non, je n’entends que la voiture qui roule. »
Madeleine ne s’était pas trompée : car, au moment où Camille achevait de parler, on entendit bien distinctement des cris perçants, et, l’instant d’après, les petites filles et la bonne, qui étaient restées immobiles de frayeur, virent arriver une voiture attelée de trois chevaux de poste lancés ventre à terre, et que le postillon cherchait vainement à retenir.
Une dame et une petite fille de quatre ans, qui étaient dans la voiture, poussaient les cris qui avaient alarmé Camille et Madeleine.
À cent pas de la barrière, le postillon fut renversé de son siège, et la voiture lui passa sur le corps ; les chevaux, ne se sentant plus retenus ni dirigés, redoublèrent de vitesse et s’élancèrent vers un fossé très profond, qui séparait la route d’un champ labouré. Arrivée en face de la barrière où étaient Camille, Madeleine et leur bonne, toutes trois pâles d’effroi, la voiture versa dans le fossé ; les chevaux furent entraînés dans la chute ; on entendit un cri perçant, un gémissement plaintif, puis plus rien.
Quelques instants se passèrent avant que la bonne fût assez revenue de sa frayeur pour songer à secourir cette malheureuse dame et cette pauvre enfant, qui probablement avaient été tuées par la violence de la chute. Aucun cri ne se faisait plus entendre.Et le malheureux postillon, écrasé par la voiture, ne fallait-il pas aussi lui porter secours ?
Enfin, elle se hasarda à s’approcher de la voiture culbutée dans le fossé. Camille et Madeleine la suivirent en tremblant.
Un des chevaux avait été tué ; un autre avait la cuisse cassée et faisait des efforts impuissants pour se relever ; le troisième, étourdi et effrayé de sa chute, était haletant et ne bougeait pas.
« Je vais essayer d’ouvrir la portière, dit la bonne ; mais n’approchez pas, mes petites : si les chevaux se relevaient, ils pourraient vous tuer. »
Elle ouvre, et voit la dame et l’enfant sans mouvement et couvertes de sang.
« Ah ! mon Dieu ! la pauvre dame et la petite fille sont mortes ou grièvement blessées. »
Camille et Madeleine pleuraient. Élisa, espérant encore que la mère et l’enfant n’étaient qu’évanouies, essaya de détacher la petite fille des bras de sa mère, qui la tenait fortement serrée contre sa poitrine ; après quelques efforts, elle parvient à dégager l’enfant, qu’elle retire pâle et sanglante. Ne voulant pas la poser sur la terre humide, elle demande aux deux sœurs si elles auront la force et le courage d’emporter la pauvre petite jusqu’au banc qui est de l’autre côté de la barrière.
« Oh ! oui, ma bonne, dit Camille ; donnez-la-nous, nous pourrons la porter, nous la porterons. Pauvre petite, elle est couverte de sang ; mais elle n’est pas morte, j’en suis sûre. Oh non ! non, elle ne l’est pas. Donnez, donnez, ma bonne. Madeleine, aide-moi.
– Je ne peux pas, Camille, répondit Madeleine d’une voix faible et tremblante. Ce sang, cette pauvre mère morte, cette pauvre petite morte aussi, je crois, m’ôtent la force nécessaire pour t’aider. Je ne puis… que pleurer.
– Je l’emporterai donc seule, dit Camille. J’en aurai la force, car il le faut, le bon Dieu m’aidera. »
En disant ces mots elle relève la petite, la prend dans ses bras, et malgré ce poids trop lourd pour ses forces et son âge, elle cherche à gravir le fossé ; mais son pied glisse, ses bras vont laisser échapper son fardeau, lorsque Madeleine, surmontant sa frayeur et sa répugnance, s’élance au secours de sa sœur et l’aide à porter l’enfant ; elles arrivent au haut du fossé, traversent la route, et vont tomber épuisées sur le banc que leur avait indiqué Élisa.
Camille étend la petite fille sur ses genoux ; Madeleine apporte de l’eau qu’elle a été chercher dans un fossé ; Camille lave et essuie avec son mouchoir le sang qui inonde le visage de l’enfant, et ne peut retenir un cri de joie lorsqu’elle voit que la pauvre petite n’a pas de blessure.
« Madeleine, ma bonne, venez vite ; la petite fille n’est pas blessée… elle vit ! elle vit… elle vient de pousser un soupir… Oui, elle respire, elle ouvre les yeux. »
Madeleine accourt ; l’enfant venait en effet de reprendre connaissance. Elle regarde autour d’elle d’un air effrayé.
« Maman ! dit-elle, maman ! je veux voir maman !
– Ta maman va venir, ma bonne petite, répond Camille en l’embrassant. Ne pleure pas ; reste avec moi et avec ma sœur Madeleine.
– Non, non, je veux voir maman ; ces méchants chevaux ont emporté maman.
– Les méchants chevaux sont tombés dans un grand trou ; ils n’ont pas emporté ta maman, je t’assure. Tiens, vois-tu ? Voilà ma bonne Élisa ; elle apporte ta maman qui dort. »
La bonne, aidée de deux hommes qui passaient sur la route, avait retiré de la voiture la mère de la petite fille. Elle ne donnait aucun signe de vie ; elle avait à la tête une large blessure ; son visage, son cou, ses bras étaient inondés de sang. Pourtant son cœur battait encore ; elle n’était pas morte.
La bonne envoya l’un des hommes qui l’avaient aidée avertir bien vite Mme de Fleurville d’envoyer du monde pour transporter au château la dame et l’enfant, relever le postillon, qui restait étendu sur la route, et dételer les chevaux qui continuaient à se débattre et à ruer contre la voiture.
L’homme part. Un quart d’heure après, Mme de Fleurville arrive elle-même avec plusieurs domestiques et une voiture, dans laquelle on dépose la dame. On secourt le postillon, on relève la voiture versée dans le fossé.
La petite fille, pendant ce temps, s’était entièrement remise : elle n’avait aucune blessure ; son évanouissement n’avait été causé que par la peur et la secousse de la chute.
De crainte qu’elle ne s’effrayât à la vue du sang qui coulait toujours de la blessure de sa mère, Camille et Madeleine demandèrent à leur maman de la ramener à pied avec elles. La petite, habituée déjà aux deux sœurs, qui la comblaient de caresses, croyant sa mère endormie, consentit avec plaisir à faire la course à pied.
Tout en marchant, Camille et Madeleine causaient avec elle.
Madeleine. – Comment t’appelles-tu, ma chère petite ?
Marguerite. – Je m’appelle Marguerite.
Camille. – Et comment s’appelle ta maman ?
Marguerite. – Ma maman s’appelle maman.
Camille. – Mais son nom ? Elle a un nom, ta maman ?
Marguerite. – Oh oui ! elle s’appelle maman.
Camille, riant. – Mais les domestiques ne l’appellent pas maman ?
Marguerite. – Ils l’appellent madame.
Madeleine. – Mais, madame qui ?
Marguerite. – Non, non. Pas madame qui ; seulement madame.
Camille. – Laisse-la, Madeleine ; tu vois bien qu’elle est trop petite ; elle ne sait pas. Dis-moi, Marguerite, où allais-tu avec ces méchants chevaux qui t’ont fait tomber dans le trou ?
Marguerite. – J’allais voir ma tante ; je n’aime pas ma tante ; elle est méchante, elle gronde toujours. J’aime mieux rester avec maman… et avec vous, ajouta-t-elle en baisant la main de Camille et de Madeleine.
Camille et Madeleine embrassèrent la petite Marguerite.
Marguerite. – Comment vous appelle-t-on ?
Camille. – Moi, je m’appelle Camille, et ma sœur s’appelle Madeleine.
Marguerite. – Eh bien ! vous serez mes petites mamans. Maman Camille et maman Madeleine.
Tout en causant, elles étaient arrivées au château. Mme de Fleurville s’était empressée d’envoyer chercher un médecin et avait fait coucher Mme de Rosbourg dans un bon lit. Son nom était gravé sur une cassette qui se trouvait dans sa voiture, et sur les malles attachées derrière. On avait bandé sa blessure pour arrêter le sang, et elle reprenait connaissance par degrés. Au bout d’une demi-heure, elle demanda sa fille, qu’on lui amena.
Marguerite entra bien doucement, car on lui avait dit que sa maman était malade. Camille et Madeleine l’accompagnaient.
« Pauvre maman, dit-elle en entrant, vous avez mal à la tête ?
– Oui, mon enfant, bien mal.
– Je veux rester avec vous, maman.
– Non, ma chère petite ; embrasse-moi seulement, et puis tu t’en iras avec ces bonnes petites filles ; je vois à leur physionomie qu’elles sont bien bonnes.
– Oh oui ! maman, bien bonnes ; Camille m’a donné sa poupée ; une bien jolie poupée !… et Madeleine m’a fait manger une tartine de confiture. »
Mme de Rosbourg sourit de la joie de la petite Marguerite, qui allait parler encore, lorsque Mme de Fleurville, trouvant que la malade s’était déjà trop agitée, conseilla à Marguerite d’aller jouer avec ses deux petites mamans, pour que sa grande maman pût dormir.
Marguerite, après avoir encore embrassé Mme de Rosbourg, sortit avec Camille et Madeleine.
3. Marguerite
Madeleine. – Prends tout ce que tu voudras, ma chère Marguerite ; amuse-toi avec nos joujoux.
Marguerite. – Oh ! les belles poupées ! En voilà une aussi grande que moi… En voilà encore deux bien jolies !… Ah ! cette grande qui est couchée dans un beau petit lit ! elle est malade comme pauvre maman… Oh ! le beau petit chien ! comme il a de beaux cheveux ! on dirait qu’il est vivant. Et le joli petit âne… Oh ! les belles petites assiettes ! des tasses, des cuillers, des fourchettes ! et des couteaux aussi ! Un petit huilier, des salières ! Ah ! la jolie petite diligence !… Et cette petite commode pleine de robes, de bonnets, de bas, de chemises aux poupées !… Comme c’est bien rangé !… Les jolis petits livres ! Quelle quantité d’images ! il y en a plein l’armoire ! »
Camille et Madeleine riaient de voir Marguerite courir d’un jouet à l’autre, ne sachant lequel prendre, ne pouvant tout tenir ni tout regarder à la fois, en poser un, puis le reprendre, puis le laisser encore, et, dans son indécision, rester au milieu de la chambre, se tournant à droite, à gauche, sautant, battant des mains de joie et d’admiration. Enfin, elle prit la petite diligence attelée de quatre chevaux, et elle demanda à Camille et à Madeleine de sortir avec elle pour mener la voiture dans le jardin.
Elles se mirent toutes trois à courir dans les allées et sur l’herbe ; après quelques tours, la diligence versa. Tous les voyageurs qui étaient dedans se trouvèrent culbutés les uns sur les autres ; une glace de la portière était cassée.
« Ah ! mon Dieu, mon Dieu ! s’écria Marguerite en pleurant, j’ai cassé votre voiture, Camille. J’en suis bien fâchée ; bien sûr, je ne le ferai plus.
Camille. – Ne pleure pas, ma petite Marguerite, ce ne sera rien. Nous allons ouvrir la portière, rasseoir les voyageurs à leurs places, et je demanderai à maman de faire mettre une autre glace.
Marguerite. – Mais si les voyageurs ont mal à la tête, comme maman ?
Madeleine. – Non, non, ils ont la tête trop dure. Tiens, vois-tu, les voilà tous remis, et ils se portent à merveille.
Marguerite. – Tant mieux ! J’avais peur de vous faire de la peine. »
La diligence relevée, Marguerite continua à la traîner, mais avec plus de précaution, car elle avait un très bon cœur, et elle aurait été bien fâchée de faire de la peine à ses petites amies.
Elles rentrèrent au bout d’une heure pour dîner, et couchèrent ensuite la petite Marguerite, qui était très fatiguée.
4. Réunion sans séparation
Pendant que les enfants jouaient, le médecin était venu voir Mme de Rosbourg : il ne trouva pas la blessure dangereuse, et il jugea que la quantité de sang qu’elle avait perdu rendait une saignée inutile et empêcherait l’inflammation. Il mit sur la blessure un certain onguent de colimaçons, recouvrit le tout de feuilles de laitue qu’on devait changer toutes les heures, recommanda la plus grande tranquillité, et promit de revenir le lendemain.
Marguerite venait voir sa mère plusieurs fois par jour ; mais elle ne restait pas longtemps dans la chambre, car sa vivacité et son babillage agitaient Mme de Rosbourg tout en l’amusant. Sur un coup d’œil de Mme de Fleurville, qui ne quittait presque pas le chevet de la malade, les deux sœurs emmenaient leur petite protégée.
Les soins attentifs de Mme de Fleurville remplirent de reconnaissance et de tendresse le cœur de Mme de Rosbourg ; pendant sa convalescence elle exprimait souvent le regret de quitter une personne qui l’avait traitée avec tant d’amitié.
« Et pourquoi donc me quitteriez-vous, chère amie ? dit un jour Mme de Fleurville. Pourquoi ne vivrions-nous pas ensemble ? Notre petite Marguerite est parfaitement heureuse avec Camille et Madeleine, qui seraient désolées, je vous assure, d’être séparées de Marguerite ; je serai enchantée si vous me promettez de ne pas me quitter. »
Madame De Rosbourg. – Mais ne serait-ce pas bien indiscret aux yeux de votre famille ?
Madame De Fleurville. – Nullement. Je vis dans un grand isolement depuis la mort de mon mari. Je vous ai raconté sa fin cruelle dans un combat contre les Arabes, il y a six ans. Depuis j’ai toujours vécu à la campagne. Vous n’avez pas de mari non plus, puisque vous n’avez reçu aucune nouvelle du vôtre depuis le naufrage du vaisseau sur lequel il s’était embarqué.
Madame De Rosbourg. – Hélas ! oui ; il a sans doute péri avec ce fatal vaisseau : car depuis deux ans, malgré toutes les recherches de mon frère, le marin qui a presque fait le tour du monde, nous n’avons pu découvrir aucune trace de mon pauvre mari, ni d’aucune des personnes qui l’accompagnaient. Eh bien, puisque vous me pressez si amicalement de rester ici, je consens volontiers à ne faire qu’un ménage avec vous et à laisser ma petite Marguerite sous la garde de ses deux bonnes et aimables amies.
Madame De Fleurville. – Ainsi donc, chère amie, c’est une chose décidée ?
Madame De Rosbourg. – Oui, puisque vous le voulez bien ; nous demeurerons ensemble.
Madame De Fleurville. – Que vous êtes bonne d’avoir cédé si promptement à mes désirs, chère amie ! je vais porter cette heureuse nouvelle à mes filles ; elles en seront enchantées.
Mme de Fleurville entra dans la chambre où Camille et Madeleine prenaient leurs leçons bien attentivement, pendant que Marguerite s’amusait avec les poupées et leur racontait des histoires tout bas, pour ne pas empêcher ses deux amies de bien s’appliquer.
Madame De Fleurville. – Mes petites filles, je viens vous annoncer une nouvelle qui vous fera grand plaisir. Mme de Rosbourg et Marguerite ne nous quitteront pas, comme nous le craignions.
Camille. – Comment ! maman, elles resteront toujours avec nous ?
Madame De Fleurville. – Oui, toujours, ma fille, Mme de Rosbourg me l’a promis.
– Oh ! quel bonheur ! dirent les trois enfants à la fois. Marguerite courut embrasser Mme de Fleurville, qui, après lui avoir rendu ses caresses, dit à Camille et à Madeleine : « Mes chères enfants, si vous voulez me rendre toujours heureuse comme vous l’avez fait jusqu’ici, il faut redoubler encore d’application au travail, d’obéissance à mes ordres et de complaisance entre vous. Marguerite est plus jeune que vous. C’est vous qui serez chargées de son éducation, sous la direction de sa maman et de moi. Pour la rendre bonne et sage, il faut lui donner toujours de bons conseils et surtout de bons exemples. »
Camille. – Oh ! ma chère maman, soyez tranquille ; nous élèverons Marguerite aussi bien que vous nous élevez. Je lui montrerai à lire, à écrire ; et Madeleine lui apprendra à travailler, à tout ranger, à tout mettre en ordre ; n’est-ce pas, Madeleine ?
Madeleine. – Oui, certainement ; d’ailleurs elle est si gentille, si douce, qu’elle ne nous donnera pas beaucoup de peine.
– Je serai toujours bien sage, reprit Marguerite en embrassant tantôt Camille, tantôt Madeleine. Je vous écouterai, et je chercherai toujours à vous faire plaisir.
Camille. – Eh bien, ma petite Marguerite, puisque tu veux être bien sage, fais-moi l’amitié d’aller te promener pendant une heure, comme je te l’ai déjà dit. Depuis que nous avons commencé nos leçons, tu n’es pas sortie ; si tu restes toujours assise, tu perdras tes couleurs et tu deviendras malade.
Marguerite. – Oh ! Camille, je t’en prie, laisse-moi avec toi ! Je t’aime tant !
Camille allait céder, mais Madeleine pressentit la faiblesse de sa sœur : elle prévit tout de suite qu’en cédant une fois à Marguerite il faudrait lui céder toujours et qu’elle finirait par ne faire jamais que ses volontés. Elle prit donc Marguerite par la main, et, ouvrant la porte, elle lui dit :
« Ma chère Marguerite, Camille t’a déjà dit deux fois d’aller te promener, tu demandes toujours à rester encore un instant. Camille a la bonté de t’écouter ; mais cette fois nous voulons que tu sortes. Ainsi, pour être sage, comme tu nous le promettais tout à l’heure, il faut te montrer obéissante. Va, ma petite ; dans une heure tu reviendras. »
Marguerite regarda Camille d’un air suppliant ; mais Camille, qui sentait bien que sa sœur avait raison, n’osa pas lever les yeux, de crainte de se laisser attendrir. Marguerite, voyant qu’il fallait se soumettre, sortit lentement et descendit dans le jardin.
Mme de Fleurville avait écouté, sans mot dire, cette petite scène ; elle s’approcha de Madeleine et l’embrassa tendrement. « Bien ! Madeleine, lui dit-elle. Et toi, Camille, courage ; fais comme ta sœur. » Puis elle sortit.
5. Les fleurs cueillies et remplacées
« Mon Dieu ! mon Dieu ! que je m’ennuie toute seule ! pensa Marguerite après avoir marché un quart d’heure. Pourquoi donc Madeleine m’a-t-elle forcée de sortir ?… Camille voulait bien me garder, je l’ai bien vu !… Quand je suis seule avec Camille, elle me laisse faire tout ce que je veux… Comme je l’aime, Camille !… J’aime beaucoup Madeleine aussi ; mais… je m’amuse davantage avec Camille. Qu’est-ce que je vais faire pour m’amuser ?… Ah ! j’ai une bonne idée : je vais nettoyer et balayer leur petit jardin. »
Elle courut vers le jardin de Camille et de Madeleine, le nettoya, balaya les feuilles tombées, et se mit ensuite à examiner toutes les fleurs. Tout à coup l’idée lui vint de cueillir un beau bouquet pour Camille et pour Madeleine.
« Comme elles seront contentes ! se dit-elle. Je vais prendre toutes les fleurs, j’en ferai un magnifique bouquet : elles le mettront dans leur chambre, qui sentira bien bon ! »
Voilà Marguerite enchantée de son idée ; elle cueille œillets, giroflées, marguerites, roses, dahlias, réséda, jasmin, enfin tout ce qui se trouvait dans le jardin. Elle jetait les fleurs à mesure dans son tablier dont elle avait relevé les coins, les entassait tant qu’elle pouvait et ne leur laissait presque pas de queue.
Quand elle eut tout cueilli, elle courut à la maison, entra précipitamment dans la chambre où travaillaient encore Camille et Madeleine, et, courant à elles d’un air radieux :
« Tenez, Camille, tenez, Madeleine, regardez ce que je vous apporte, comme c’est beau ! »
Et, ouvrant son tablier, elle leur fit voir toutes ces fleurs fripées, fanées, écrasées.
« J’ai cueilli tout cela pour vous, leur dit-elle : nous les mettrons dans notre chambre, pour qu’elle sente bon ! »
Camille et Madeleine se regardèrent en souriant. La gaieté les gagna à la vue de ces paquets de fleurs flétries et de l’air triomphant de Marguerite ; enfin elles se mirent à rire aux éclats en voyant la figure rouge, déconcertée et mortifiée de Marguerite. La pauvre petite avait laissé tomber les fleurs par terre ; elle restait immobile, la bouche ouverte, et regardait rire Camille et Madeleine.
Enfin Camille put parler.
« Où as-tu cueilli ces belles fleurs, Marguerite ?
– Dans votre jardin.
– Dans notre jardin ! s’écrièrent à la fois les deux sœurs, qui n’avaient plus envie de rire. Comment ! tout cela dans notre jardin ?
– Tout, tout, même les boutons. » Camille et Madeleine se regardèrent d’un air consterné et douloureux. Marguerite, sans le vouloir, leur causait un grand chagrin. Elles réservaient toutes ces fleurs pour offrir un bouquet à leur maman le jour de sa fête, qui avait lieu le surlendemain, et voilà qu’il n’en restait plus une seule ! Pourtant ni l’une ni l’autre n’eurent le courage de gronder la pauvre Marguerite, qui arrivait si joyeuse et qui avait cru leur causer une si agréable surprise. Marguerite, étonnée de ne pas recevoir les remerciements et les baisers auxquels elle s’attendait, regarda attentivement les deux sœurs, et, lisant leur chagrin sur leurs figures consternées, elle comprit vaguement qu’elle avait fait quelque chose de mal, et se mit à pleurer.
Madeleine rompit enfin le silence.
« Ma petite Marguerite, nous t’avons dit bien des fois de ne toucher à rien sans en demander la permission. Tu as cueilli nos fleurs et tu nous as fait de la peine. Nous voulions donner après-demain à maman, pour sa fête, un beau bouquet de fleurs plantées et arrosées par nous. Maintenant, par ta faute, nous n’avons plus rien à lui donner. »
Les pleurs de Marguerite redoublèrent. « Nous ne te grondons pas, reprit Camille, parce que nous savons que tu ne l’as pas fait par méchanceté ; mais tu vois comme c’est vilain de ne pas nous écouter. » Marguerite sanglotait.
« Console-toi, ma petite Marguerite, dit Madeleine en l’embrassant ; tu vois bien que nous ne sommes pas fâchées contre toi.
– Parce que… vous… êtes… trop bonnes, … dit Marguerite, qui suffoquait ; mais… vous… êtes… tristes… Cela… me… fait de la… peine… Pardon… pardon, … Camille… Madeleine… Je ne… le… ferai plus… bien sûr. »
Camille et Madeleine, touchées du chagrin de Marguerite, l’embrassèrent et la consolèrent de leur mieux. À ce moment, Mme de Rosbourg entra ; elle s’arrêta, étonnée en voyant les yeux rouges et la figure gonflée de sa fille.
« Marguerite ! qu’as-tu, mon enfant ? Serais-tu méchante, par hasard ?
– Oh non ! madame, répondit Madeleine ; nous la consolons. »
Madame De Rosbourg. – De quoi la consolez-vous, chères petites ?
Madeleine. – De…, de… Madeleine rougit et s’arrêta. « Madame, reprit Camille, nous la consolons, nous… nous… l’embrassons… parce que…, parce que… » Elle rougit et se tut à son tour. La surprise de Mme de Rosbourg augmentait.
Madame De Rosbourg. – Marguerite, dis-moi toi-même pourquoi tu pleures et pourquoi tes amies te consolent.
– Oh ! maman, chère maman, s’écria Marguerite en se jetant dans les bras de sa mère, j’ai été bien méchante ; j’ai fait de la peine à mes amies, mais c’était sans le vouloir. J’ai cueilli toutes les fleurs de leur jardin ; elles n’ont plus rien à donner à leur maman pour sa fête, et, au lieu de me gronder, elles m’embrassent. Mon Dieu ! mon Dieu ! que j’ai du chagrin !
– Tu fais bien de m’avouer tes sottises, ma chère enfant, je tâcherai de les réparer. Tes petites amies sont bien bonnes de ne pas t’en vouloir. Sois indulgente et douce comme elles, chère petite, tu seras aimée comme elles et tu seras bénie de Dieu et de ta maman.
Mme de Rosbourg embrassa Camille, Madeleine et Marguerite d’un air attendri, quitta la chambre, sonna son domestique, et demanda immédiatement sa voiture.
Une demi-heure après, la calèche de Mme de Rosbourg était prête. Elle y monta et se fit conduire à la ville de Moulins, qui n’était qu’à cinq kilomètres de la maison de campagne de Mme de Fleurville.
Elle descendit chez un marchand de fleurs, et choisit les plus belles et les plus jolies.
« Ayez la complaisance, monsieur, dit-elle au marchand, de m’apporter vous-mêmes tous ces pots de fleurs chez Mme de Fleurville. Je vous ferai indiquer la place où ils doivent être plantés, et vous surveillerez ce travail. Je désire que ce soit fait la nuit, pour ménager une surprise aux petites de Fleurville.
– Madame peut être tranquille ; tout sera fait selon ses ordres. Au soleil couchant, je chargerai sur une charrette les fleurs que madame a choisies, et je me conformerai aux ordres de madame.
– Combien vous devrai-je, monsieur, pour les fleurs et la plantation ?
– Ce sera quarante francs, madame ; il y a soixante plantes avec leurs pots, et de plus le travail. Madame ne trouve pas que ce soit trop cher ?
– Non, non, c’est très bien ; les quarante francs vous seront remis aussitôt votre ouvrage terminé. »
Mme de Rosbourg remonta en voiture et retourna au château de Fleurville. (C’était le nom de la terre de Mme de Fleurville.) Elle donna ordre à son domestique d’attendre le marchand à l’entrée de la nuit et de lui faire planter les fleurs dans le petit jardin de Camille et de Madeleine. Son absence avait été si courte que ni Mme de Fleurville ni les enfants ne s’en étaient aperçues.
À peine Mme de Rosbourg avait-elle quitté les petites, que toutes trois se dirigèrent vers leur jardin.
« Peut-être, pensait Camille, restait-il encore quelques fleurs oubliées, seulement de quoi faire un tout petit bouquet. »
Hélas ! il n’y avait rien : tout était cueilli. Camille et Madeleine regardaient tristement et en silence leur jardin vide. Marguerite avait bien envie de pleurer.
« C’est fait, dit enfin Madeleine ; il n’y a pas de remède. Nous tâcherons d’avoir quelques plantes nouvelles, qui fleuriront plus tard. »
Marguerite. – Prenez tout mon argent pour en acheter, Madeleine ; j’ai quatre francs !
Madeleine. – Merci, ma chère petite, il vaut mieux garder ton argent pour les pauvres.
Marguerite. – Mais si vous n’avez pas assez d’argent, Madeleine, vous prendrez le mien, n’est-ce pas ?
Madeleine. – Oui, oui, ma bonne petite, sois sans inquiétude, ne pensons plus à tout cela, et préparons notre jardin pour y replanter de nouvelles fleurs.
Les trois petites se mirent à l’ouvrage ; Marguerite fut chargée d’arracher les vieilles tiges et de les brouetter dans le bois. Camille et Madeleine bêchèrent avec ardeur ; elles suaient à grosses gouttes toutes les trois quand Mme de Rosbourg, revenue de sa course, les rejoignit au jardin.
« Oh ! les bonnes ouvrières ! s’écria-t-elle. Voilà un jardin bien bêché ! Les fleurs y pousseront toutes seules, j’en suis sûre.
– Nous en aurons bientôt, madame, vous verrez.
– Je n’en doute pas, car le bon Dieu récompensera toujours les bonnes petites filles comme vous. »
La besogne était finie ; Camille, Madeleine et Marguerite eurent soin de ranger leurs outils, et jouèrent pendant une heure dans l’herbe et dans le bois. Alors la cloche sonna le dîner, et chacun rentra.
Le lendemain, après déjeuner, les enfants allèrent à leur petit jardin pour achever de le nettoyer.
Camille courait en avant. Le jardin lui apparut plein de fleurs mille fois plus belles et plus nombreuses que celles qui y étaient la veille. Elle s’arrêta stupéfaite, elle ne comprenait pas.
Madeleine et Marguerite arrivèrent à leur tour, et toutes trois restèrent muettes de surprise et de joie devant ces fleurs si fraîches, si variées, si jolies.
Enfin, un cri général témoigna de leur bonheur ; elles se précipitèrent dans le jardin, sentant une fleur, en caressant une autre, les admirant toutes, folles de joie, mais ne comprenant toujours pas comment ces fleurs avaient poussé et fleuri en une nuit, et ne devinant pas qui les avait apportées.
« C’est le bon Dieu, dit Camille.
– Non, c’est plutôt la sainte Vierge, dit Madeleine.
– Je crois que ce sont nos petits anges », reprit Marguerite. Mme de Fleurville arrivait avec Mme de Rosbourg.
« Voici l’ange qui a fait pousser vos fleurs, dit Mme de Fleurville en montrant Mme de Rosbourg. Votre douceur et votre bonté l’ont touchée ; elle a été acheter tout cela à Moulins, pendant que vous vous mettiez en nage pour réparer le mal causé par Marguerite. »