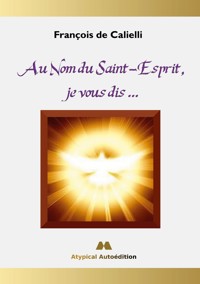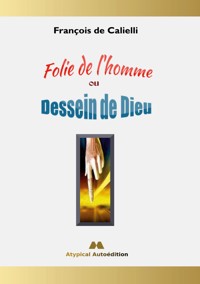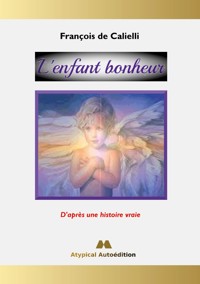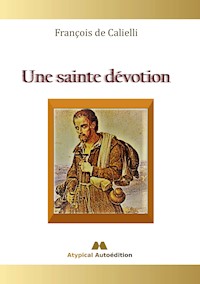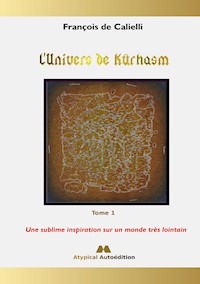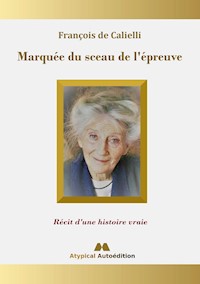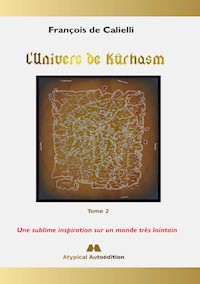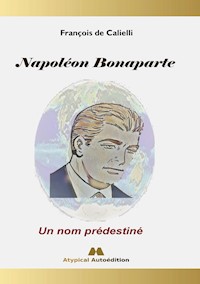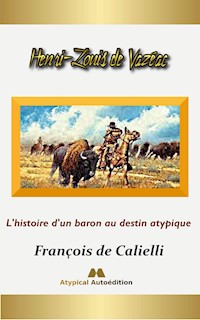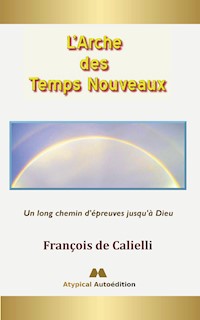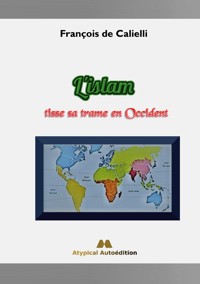
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Dans leur majorité, les occidentaux ont une regrettable méconnaissance des intentions secrètes de l'islam. Partant, les islamistes en profitent pour élaborer tranquillement et méthodiquement leur trame. S'ils n'en viennent pas à prendre conscience de ce danger en train de menacer leur chère démocratie, ils se réveilleront un jour sous le joug de l'ordre islamique. Lorsque la communauté musulmane y dominera, il sera trop tard pour barrer la route à ce bouleversement social. Cet ouvrage n'est en rien une thèse haineuse, voire une diatribe contre les musulmans, mais un exposé d'éveil spirituel en vue d'empêcher l'avènement du pire. Car, au même titre que les non-musulmans, les musulmans modérés sont menacés par le progrès de l'islamisme. Je ne m'en tiens pas à avertir sur ce danger, puisque j'évoque la possibilité de l'éviter grâce à l'instauration du modèle apte à poser les bases d'un monde nouveau. Fort de celui-ci, l'humanité vivrait dans une belle concorde et n'aurait plus à craindre les dérives intégristes ou totalitaristes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur
Romans
Au nom du Saint-Esprit, je vous dis …
L'Arche des Temps Nouveaux
Folie de l'Homme ou Dessein de Dieu
Le Tiraillement
L'enfant bonheur
Suis-moi (tomes 1 et 2)
L'inflexible loi du destin (tomes 1 et 2)
À la croisée des destins
L'Univers de Kûrhasm (tomes 1 et 2)
Le chevalier de la Lumière
Quand le doigt de Dieu ...
La légende de Thâram (tomes 1 et 2)
Henri-Louis de Vazéac
Il la regarda et...
Essais
La destinée de l'homme ...
L'islam tisse sa trame en Occident
Poésies
Murmures de mon âme
Envolée métaphysique
Scénario de film
Magnesia
Je me consacre à l'écriture depuis 2002, après avoir rédigé plusieurs ouvrages entre 1990 et cette date. Mes écrits ont un même fil conducteur spirituel, reflet de l'inaltérable foi en Dieu animant mon cœur. Ce qui m’a conduit à écrire, parfois, des histoires insolites et à devenir un auteur difficile à classer dans un genre.
L'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule :
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
Table des matières
Introduction
Chapitre 1
Pour une bonne compréhension de l'islam
Chapitre 2
Le livre de la doctrine islamique
Chapitre 3
Une mise au point indispensable
Chapitre 4
La consubstantialité du Dieu d'Amour et du Christ
Chapitre 5
Un panislamisme souterrain
Chapitre 6
Une « oumma » mondiale en constitution
Chapitre 7
L'islamisme : une inéluctabilité ?
Chapitre 8
Un laxisme pro-islam
Chapitre 9
La nécessité d'un vrai débat sur l'islam
Chapitre 10
Œuvrons pour la naissance d'un autre monde !
Chapitre 11
Le modèle d'une belle évolution humaine
Conclusion
Ce livre est-il islamophobe ?
Introduction
Nombreux sont les Occidentaux qui méconnaissent les intentions secrètes de l'islam. Cela laisse la voie libre aux islamistes pour élaborer tranquillement et méthodiquement leur trame. Si les pays d'Occident n'en viennent pas à prendre conscience de ce danger en train de menacer leur chère démocratie, ils se réveilleront un jour sous le joug de l'ordre islamique. La majorité musulmane écrasera alors la minorité chrétienne ou juive et il sera trop tard pour barrer la route à ce bouleversement social.
Certes, les musulmans m'accuseront de faire du catastrophisme primaire. Ils me qualifieront d'islamophobe, de raciste et d'extrême-droitiste. Les défenseurs des droits de l'homme s'alarmeront, de même, de cette critique de l'islam qu'ils jugeront antidémocrate. Or il ne s'agit pas ici d'une thèse haineuse, d'une diatribe contre les musulmans, mais d'un exposé d'éveil spirituel en vue d'empêcher l'avènement du pire et d'amener mes semblables à évoluer vers un monde où n'existe plus le spectre de comportements archaïques.
L'Occident n'évitera l'avènement d'un ordre islamique qu'en se dotant d'un modèle apte à poser les bases d'un monde nouveau. Grâce à lui, l'humanité vivrait dans une belle concorde et n'aurait plus à craindre les dérives intégristes ou totalitaristes.
Chapitre 1
Pour une bonne compréhension de l'islam
Son fondateur : Mahomet
Les premiers écrits sur la vie de Mahomet sont le fait, principalement, d'hagiographes et d'historiens musulmans. Datant des neuvième et dixième siècles, ils répondaient à des questionnements religieux, politiques, juridiques ou sociaux de l'époque. En tout état de cause, la relative historicité des sources traditionnelles rend difficile l'écriture d'une biographie fiable sur Mahomet. Plusieurs chercheurs critiquent la crédibilité des « hadiths » (biographie de Mahomet). Selon Jacqueline Chabbi1, Mahomet n'a laissé aucun écrit ni trace archéologique de son passage sur Terre. Alors que la tradition musulmane, postérieure au Coran, précise que ce dernier dicta ses révélations à un scribe – transcrites sur des morceaux de cuir ou de poteries, des tessons, des nervures de palmes et autres omoplates de chameau – son témoignage n'aurait pas été transmis, selon elle, par ses contemporains. De surcroît, il vivait dans une société de tradition orale. Aussi nul n'exhumera jamais des tablettes à l'instar de celles, nombreuses, relatives à l'empire Byzantin. En définitive, la première biographie de Mahomet ou « sira »2, ne fut rédigée que 150 à 200 ans après sa mort.
Certes, cette historienne a brossé un portrait de Mahomet qui s'éloigne des biographies écrites jusque-là tout en ne tombant pas dans le travers de l'insolence ou du dogmatisme. Je précise, d'ailleurs, que les dignitaires musulmans n'acceptent guère les critiques, même fondées, sur l'islam et leur Prophète. Contrairement aux théologiens chrétiens ou juifs qui sont accoutumés aux jugements des rationalistes depuis des siècles.
Ainsi la tradition musulmane fixe la naissance de Mahomet à La Mecque en 570 après Jésus-Christ à partir de calculs, certes, très douteux. Nombre de légendes ont été écrites sur sa vie et ses voyages. L'indication d'une naissance du vivant de l'empereur Khosrô Ier, soit en 579 après Jésus-Christ, serait plus exacte. Cette année, dite de l'éléphant, fut celle de l'anéantissement d'Abrahah d'Abyssinie et de son troupeau d'éléphants par Allah avant leur entrée à La Mecque avec l'intention d'y détruire la « kaaba »3, un sanctuaire vénéré par les Arabes. Dans la sourate 105, aux versets 1 à 5, le Coran rapporte :
« N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'Éléphant ?
N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine
et envoyé sur eux des oiseaux par volées
qui leur lançaient des pierres d'argile ?
Et il les a rendus semblables à une paille mâchée ».
À l'époque de Mahomet, l'Arabie était constituée de Bédouins païens se déplaçant à dos de chameau. Il y était, quant à lui, un homme ambitieux et désireux d'imposer un nouvel ordre. Toujours du point de vue de Jacqueline Chabbi, il fut banni par les Qoraychites – sa tribu de naissance –, qui le pensaient possédé par les djinns.4
« Muhammad » (Mahomet en français) signifie « le loué », « digne d'éloges », un nom jugé plutôt vaniteux par nombre d'historiens. Il y a lieu de noter l'inexistence du nom arabe « Muḥammad » (participe passé du verbe « louer ») avant la vie de Mahomet et, donc, que celui-ci ne put être donné comme tel ; puisqu'il n'était en rien un prénom. Hichem Djaït (historien, islamologue et penseur tunisien) précise que le premier nom du Prophète n'est pas mentionné par les sources de l'islam. Pour lui, Mahomet devait probablement s'appeler Qathem Ibn Al-Mutalib, en référence à son oncle décédé. Par conséquent, l'apparition et le changement du nom en Muhammad, « Le loué » seraient liés à la prédication.
Les écrits islamiques narrent : « Mahomet gardait un petit troupeau de bêtes quand son frère de lait aperçut deux hommes vêtus de blanc en train de le coucher sur le sol pour lui ouvrir la poitrine. Alertée, sa nourrice Halima accourut sur les lieux. Mahomet demeura silencieux, et le visage très pâle, confirmant ainsi la version de son frère de lait. En fait, ces deux anges furent envoyés vers le jeune Mahomet pour purifier son cœur et apposer le sceau de la prophétie entre ses épaules. Halima ramena donc l'adolescent vers sa mère. Celle-ci mourut, de même que son père, lorsqu'il avait six ans (un fait qui reste invérifiable). Ainsi il fut recueilli par son grand-père qui chargea, peu avant son décès, l'aîné de ses enfants, du nom d'Abu Tâlib, de le prendre dans sa maison. Commerçant aisé, ce dernier l'amena dans ses voyages d'affaires et, notamment, en Syrie. Le jeune Mahomet passait ainsi beaucoup de temps dans le désert. Un moine aurait alors perçu son destin de prophète lors d'un de ces déplacements ».
Au dire de la tradition :
Mahomet habitait La Mecque, une cité caravanière située dans une vallée aride impropre à l'agriculture dont les deux ressources économiques étaient le commerce de marchandises avec l'Occident, via l'Inde, et le pèlerinage vers le temple local. Effectivement, l'afflux de pèlerins venant vénérer la pierre noire5 permettait les échanges en tous genres.
Après avoir été gardien de moutons, Mahomet travailla pour le compte d'une riche commerçante, du nom de Khadidja, laquelle organisait des caravanes à l'instar de la plupart des Mecquois. Elle en fit son homme de confiance, puis son mari. Il était alors âgé de vingt-cinq ans et, elle, de quarante. Ils eurent ensemble quatre filles et des garçons, mais ces derniers ne survécurent pas. Grâce à Khadidja, il accéda au statut d'homme aisé, voire de notable considéré. Il adopta son cousin Ali ainsi qu'une esclave de la tribu arabe des Kalb, majoritairement chrétienne.
En 590, Les Qoraychites déclarèrent la guerre aux tribus de Kénan et d'Hawazan. Sous les ordres d'Abu Tâlib, Mahomet montra une belle intrépidité et participa ainsi à leur dispersion.
La littérature musulmane stipule : « C'était un homme simple, honnête, bon père de famille aimant aller se recueillir, une fois par an, dans une caverne du mont Hira pour s'y consacrer à des exercices de dévotion plusieurs nuits durant. C'est à l'occasion de l'une de ces retraites, un jour de l'an 610, que l'archange Gabriel le tira de son sommeil pour lui faire une révélation. Il avait alors quarante ans. Une vision qui l'effraya et qu'il rejeta jusqu'à vouloir se tuer. Or quand il entreprenait de se précipiter, du haut de la montagne, l'archange Gabriel lui rappelait sa mission de prophète d'Allah. Il courait se réfugier auprès de Khadidja qui le gratifiait invariablement de son soutien. À sa demande, elle le recouvrait d'un drap ; ce qui donna lieu à la sourate « Al-Muzzammil » (l'enveloppé). Le cousin de Khadidja, un chrétien nestorien, confirma à cette dernière que son époux était un prophète de Dieu et que l'apparition de la grotte était bien l'archange Gabriel ».
Mahomet s'habitua à ces révélations qu'il répétait à son entourage et dictait à un secrétaire. Cela aurait duré vingt années et constitué les prémices du Coran.
Mahomet instruisit des proches – un petit cercle comprenant Abou Bakr, son cousin Ali, son fils adoptif Zayd et des mecquois de condition modeste, parmi lesquels des jeunes en révolte contre leur milieu – sur ces versets soufflés par Allah en arabe par le canal de l'Archange Gabriel. Ce premier noyau de fidèles prendra le nom de musulmans (de muslim : celui qui se soumet à Allah). Des gens qui gardaient secrète leur foi, vu que les mecquois, attachés à leurs pratiques ancestrales, voyaient d'un mauvais œil le monothéisme de Mahomet ainsi que son dénigrement des divinités traditionnelles. Ainsi, au début, ce petit groupe autour de lui suscita l'ironie, voire le mépris. Il fit alors en sorte de gagner l'estime de ses concitoyens en louant des divinités locales à côté d'Allah, un dieu parmi d'autres pour les Arabes de l'époque. Lorsqu'il en vint à diffuser ses convictions à l'ensemble des habitants de La Mecque, les notables craignirent que cette croyance monothéiste ne mît en péril leur prospérité ; en effet, celle-ci dépendait principalement des nombreux pèlerins venus rendre un culte aux nombreuses divinités.
Après sa déclaration de guerre au polythéisme, il dut sa survie à la protection de son clan. Il imposait à ses adeptes de prier cinq fois par jour en se prosternant et en invoquant Allah.
En 619, son oncle Abu Talib et sa femme Khadidja décédèrent. Après la mort de cette dernière, il épousa Sawda, une veuve, ainsi que la petite Aïcha, âgée seulement de six ans et fille de son oncle Abu Bakr. Un mariage consommé quand celle-ci atteignit l'âge de neuf ans. Les rédacteurs de sa biographie attribuèrent quinze épouses à Mahomet. Quant à l'historien médiéval Tabari (839-923), il signala dans son ouvrage « Histoire des prophètes et des rois » que le nombre de femmes de Mahomet était de onze et qu'il laissa neuf veuves à sa mort. Puis le même Tabari précisa, plus loin, qu'il épousa vingt femmes et qu'il en convoita cinq qu'il n'épousa pas.
Si le Coran n'interdit pas la polygamie, il restreint le mariage à quatre femmes, comme spécifié dans la sourate 4 au verset 3. Mahomet justifia donc cette violation en énonçant une révélation personnelle d'Allah (sourate 33, verset 50).
« Ô Prophète ! Nous avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui avaient émigré en ta compagnie, - ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle : c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux ».
Nouveau chef de la tribu, son oncle Abou Lahab le chassa de cette dernière. Ce qui le contraignit à chercher de nouveaux soutiens. Par conséquent, il conclut un accord avec les notables de Yathrib6 où plusieurs de ses disciples avaient émigré. Selon la « sunna » (loi immuable d'Allah selon le coran), ces derniers le chargèrent de faire taire les conflits entre les deux principaux clans. Une entreprise qu'il mena avec beaucoup de succès et qui l'établit ensuite dans son autorité. Cette émigration à Yathrib (24 septembre 622) prit le nom d'hégire (de hidjra : émigration) et devint le point de départ de l'islam ainsi que du calendrier musulman.
Médine (ex-Yathrib) était alors occupée par onze tribus : trois Arabes et trois juives. Par conviction ou par opportunisme, quelques juifs avaient adopté l'islam. Quant à la majorité des juifs médinois, ils furent condamnés suite à leur refus de rallier la cause mahométane et à leur critique du Coran ; lequel déformait, selon eux, les récits bibliques. Dès lors, Mahomet décida que l'orientation de la prière ne serait plus Jérusalem. Il proclama aussi la nécessité d'un jeûne qu'il fixa au mois de « ramadân » (celui de la victoire de Badr7. Les membres devaient observer ces rituels sous peine de représailles. Quant aux réfractaires, ils étaient écartés, voire tués. Progressivement, les actes, les exigences et les positions de Mahomet suscitèrent l'opposition des païens, des juifs, mais aussi de fidèles médinois. Ceux qu'il appelait les « Douteurs » ou les « Hypocrites » critiquèrent, à la fois, son pouvoir grandissant et les émigrés mecquois musulmans. Il fit assassiner plusieurs poètes médinois païens et renvoyer de Médine, en 625, des Banu Qaynuqa et des Banu Nadir8 qu'il soupçonnait de mauvais desseins. Afin d'asseoir son pouvoir, il ordonna ensuite l'élimination systématique des derniers juifs médinois.
Les membres de la tribu, divisée en clans, se devaient une solidarité économique et juridique. Mahomet eut l'idée de proposer un système fondé sur l'appartenance religieuse et ne privilégiant plus la parenté. Il créa donc le concept de « oumma » ou communauté de croyants. Conçue sur un mode égalitaire, celle-ci accueillait les gens de tous horizons. Mahomet devint un chef, à la fois, religieux, politique et militaire qui se devait de subvenir aux besoins de ce petit État théocratique constitué de partisans mecquois et médinois. Ainsi il commanda à ses fidèles d'attaquer, par petits groupes, les caravanes mecquoises ; des razzias qui lui rapportaient un riche butin. Ce fut la naissance du concept de « djihad » auquel tout bon musulman se trouvait forcé d'adhérer. Mahomet participa à de nombreuses batailles, que la tradition prétend défensives, mais qui s'avéraient être en réalité des combats destinés à convertir les Arabes et à faire triompher l'islam. Dans ce but, il marcha vers La Mecque avec une armée de dix mille soldats en janvier 630 et en promettant l'amnistie aux habitants qui accepteraient de se rendre. Partant, ils furent une majorité à se convertir à l'islam. Après avoir investi la ville, il fit détruire les statuettes autour de la « kaaba » (bâtisse cubique située au centre du sanctuaire mecquois). Un geste symbolique qui visait à mettre fin au culte des idoles et à prohiber le polythéisme.
Pour donner une certaine authenticité à sa religion, il rattacha l'islam à Abraham qu'il déclara être l'ancêtre des Arabes et un pur monothéiste comme lui. De fait, Ismaël et son père devinrent les fondateurs de la « kabaa ».
Ayant le statut de « dhimmis »9, les populations des régions islamisées devaient payer une taxe (ou jizia), par laquelle ils bénéficiaient de la protection de l'État islamique. Neuf ans après l'hégire, toute l'Arabie se trouvait donc soumise au système instauré par Mahomet. Dès lors, celui-ci ordonna l'arrêt des razzias et déclara à l'occasion de son Sermon d'Adieu en 632 : « Le musulman est intégralement sacré pour le musulman, son sang est sacré, ses biens sont sacrés, son honneur est sacré ». Selon les historiens musulmans, il aurait envoyé huit émissaires vers les rois d'Égypte, de Syrie, d'Oman, du Yémen, de Bahreïn, d'Abyssinie, de Perse ainsi que vers l'empereur byzantin Héraclius pour les appeler à se convertir à l'islam. Son message disait : « Au nom d'Allah clément et miséricordieux. Dis : Ô humain, je suis l'apôtre d'Allah, envoyé vers vous tous, de celui qui possède les cieux et la terre. Il n'y a pas de dieu en dehors de Lui, qui donne la vie et fait mourir. Salut à celui qui suit la droite voie. Mets-toi à l'abri du châtiment de Dieu si tu ne le fais pas, eh bien, moi je t'ai fait parvenir ce message ! ».
Un fait que les islamologues actuels ne corroborent pas.
Les « hadiths » consignent les divers miracles que la légende islamique attribue à Mahomet. Ainsi celui où il divise la lune en deux, qu'Allah rassemble ensuite, pour répondre aux Mecquois qui lui demandent une preuve de son statut de prophète. Ou cet autre dans lequel il fait jaillir de l'eau entre ses doigts en vue de permettre les ablutions de mille cinq cents hommes. La tradition conte également l'histoire du surgissement de la source de Tabuk et du puits de « al Hudhaybiyya » grâce à son invocation.
Parmi les plus fantasques, il y a celui de la prouesse de l'arbre censé avoir emboîté son pas alors qu'il le tenait par une branche comme il le ferait d'un chameau par la bride. Bien d'autres ressemblent étrangement à ceux de Jésus, comme la multiplication de la nourriture ou la guérison des malades.
Mahomet demeura à Médine tout en continuant de guerroyer pour la domination du Hedjaz (partie ouest de l'Arabie Saoudite actuelle). Les tribus conquises devaient se convertir à l'islam et payer un tribut, une allégeance ayant surtout un sens politique. En juin 632, il expira à l'âge de soixante-trois ans dans les bras de son épouse favorite Aïcha après plusieurs semaines de maladie. Sa dépouille fut enterrée dans sa « maison-mosquée », un lieu de pèlerinage où reposent, de même, ses deux successeurs Abû Bakr et Umar.
Selon des textes juifs, chrétiens ou samaritains datant du septième siècle, Mahomet était vivant lors de la conquête musulmane du Proche-Orient. Par conséquent, le professeur Stephen J. Shoemaker10 propose de situer la date de sa mort plutôt vers 634 ou 635. La tradition musulmane a probablement fixé sa mort en 632, afin de la calquer sur celle de Moïse ; en effet, ce dernier mourut avant d'entrer en Terre promise, laissant son successeur Josué mener la conquête du pays de Canaan. Ici, c'est Abou Bakr, le successeur de Mahomet, qui aurait eu la charge de lancer ses troupes à la conquête des pays du Cham (Syrie et Palestine).
Les disciples du Prophète continuèrent de transmettre les sourates sous formes orale et écrite. La première compilation en un livre, appelé Coran, par le troisième calife Uthman eut lieu environ vingt ans après la disparition de Mahomet.
Fidèle dans ses exagérations, la tradition islamique présente Mahomet sous le jour d'un modèle de perfection physique, intellectuelle et morale (al-insan al-kamil en arabe). Elle le prétend donc énergique, fidèle, honnête et d'un excellent jugement. Or, il était, très certainement, d'une nature plutôt tourmentée. Car, au sein d'une société largement polygame, la période de sa vie conjugale avec une seule femme, et plus âgée que lui de surcroît, n'avait dû guère concourir à sa sérénité.
D'autant qu'il n'avait eu aucune descendance mâle … une réalité jugée honteuse en ce temps-là. Les garçons enfantés par Khadidja étaient en effet tous décédés.
Concernant la cruauté de ses actes, elle correspondait aux mœurs de l'époque en Arabie. L'ambition politique et la raison d'État primèrent donc sur le religieux.
Après son décès, Mahomet devint le symbole de la nouvelle foi. Un culte autour de sa personne qui entraîna une vénération de ses reliques. Ce fut aussi une façon de placer l'islam au-dessus des autres religions. Aujourd'hui, quiconque manque de respect à celui que la tradition musulmane élève au statut de prophète risque l'anathème ou, pire, la mort.