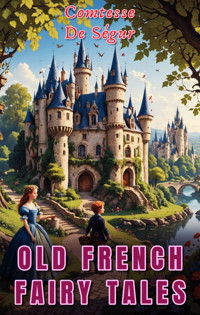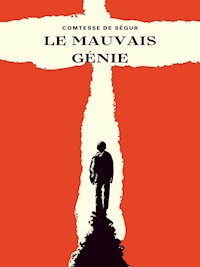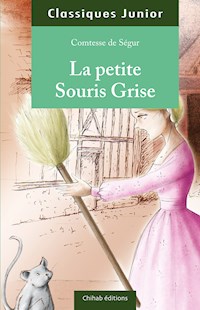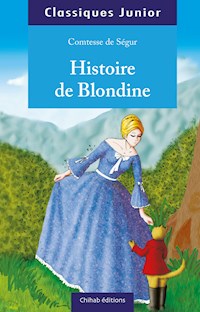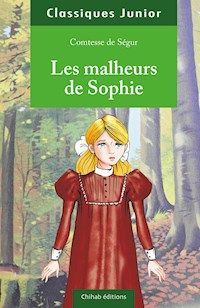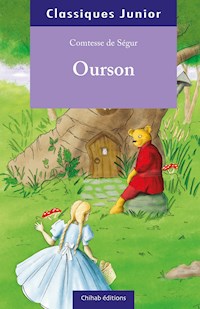2,99 €
2,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Grand coeur mais petite tête, Gribouille parle à tort et à travers. Pour réparer les bêtises de son nigaud de frère, Caroline a vraiment besoin de tout son courage et de toute son affection. Mais il n'est pas dit que Gribouille ait forcément tort, ni qu'il comprenne toujours tout de travers...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2018
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
La Soeur de Gribouille (Illustré)
Page de titreDédicacePRÉFACE.I - Gribouille.II - Promesse de Caroline.III - Mort de la femme Thibaut.IV - Obéissance de Gribouille.V - Vengeance de Rose.VI - Explications.VII - Vaisselle brisée.VIII - Les bonnes amies.IX - Rencontre inattendue.X - Premières gaucheries.XI - Le beau dessert.XII - Les serins.XIII - La cage.XIV - La cage (suite).XV - Pauvre Jacquot.XVI - La découverte.XVII - Un nouvel ami.XVIII - Combat de Gribouille.XIX - Les bonnes langues.XX - Les adieux.XXI - Le vol.XXII - L’arrestationXXIII - Retour à la maison.XXIV - Visite à la prison.XXV - La servante du curé.XXVI - Le pressentiment.XXVII - Dévouement.XXVIII - Mort de Gribouille et consolation.XXIX - L’enterrement et le mariage.À propos de cette édition numériqueebpt6k6512264x_ftn01ebpt6k6512264x_cov01ebpt6k6512264x_fm01Page de copyrightPage de titre
Dédicace
A MA PETITE-FILLE
VALENTINE DE SÉGUR-LAMOIGNON.
Chère enfant, je t’offre à toi, charmante, aimée et entourée,
l’histoire d’un pauvre garçon un peu imbécile, peu aimé, pauvre et
dénué de tout. Compare sa vie à la tienne, et remercie Dieu de la
différence.
Comtesse DE SÉGUR,
Née ROSTOPCHINE.
PRÉFACE.
PRÉFACE.
L’idée première de ce livre m’a été donnée par un ancien souvenir
d’une des plus charmantes et spirituelles bêtises qui aient été
jouées sur la scène : la Sœur de Jocrisse1. Je me suis permis d’y
emprunter deux ou trois paroles ou situations plaisantes que j’ai
développées au profit de mes jeunes lecteurs ; la plus
importante est l’inimitié de Gribouille contre le perroquet.
J’espère que les auteurs me pardonneront ce demi-plagiat ;
Gribouille et Jocrisse étant jumeaux, mon Gribouille a imité
presque involontairement son plaisant et inimitable prédécesseur.
Comtesse DE SÉGUR,
Née ROSTOPCHINE.
I - Gribouille.
I
Gribouille.
La femme Thibaut était étendue sur son lit ; elle regardait
tristement sa fille Caroline, qui travaillait avec ardeur à
terminer une robe qu’elle devait porter le soir même à Mme Delmis,
la femme du maire. Près du lit de la femme Thibaut, Gribouille,
jeune garçon de quinze à seize ans, cherchait à recoller des
feuilles détachées d’un livre bien vieux et bien sale. Il
reprenait, sans se lasser, ce travail, qui ne pouvait réussir,
parce qu’aussitôt qu’une feuille était collée, il la tirait pour
voir si elle tenait bien ; la feuille, n’ayant pas eu le temps
de sécher, se détachait toujours, et Gribouille recommençait
toujours sans humeur et sans colère.
« Mon pauvre Gribouille, lui dit sa mère, tes feuilles ne
tiendront jamais si tu tires dessus comme tu fais.
GRIBOUILLE.
Il faudra bien qu’elles tiennent, et que je puisse tirer sans
qu’elles me viennent dans la main ; je tire bien sur les
autres feuilles ; pourquoi ne pourrais-je pas tirer sur
celles-ci ?
LA MÈRE.
Parce qu’elles sont déchirées, mon ami....
GRIBOUILLE.
C’est parce qu’elles sont déchirées que je veux les raccommoder. Il
me faut un catéchisme, n’y a pas à dire : M. le curé l’a
dit ; Mme Delmis l’a dit. Caroline m’a donné le sien, qui
n’est pas neuf, et je veux le remettre en bon état.
LA MÈRE.
Laisse sécher les feuilles que tu recolles, si tu veux qu’elles
tiennent.
GRIBOUILLE.
Qu’est-ce que ça y fera ?
LA MÈRE.
Ça fera qu’elles ne se détacheront plus.
GRIBOUILLE.
Vrai ? Ah bien ! je vais les laisser jusqu’à demain, et
puis nous verrons. »
Gribouille colla toutes les feuilles détachées, et alla poser le
livre sur la table où Caroline mettait son ouvrage et ses papiers.
Caroline travaillait avec ardeur.
GRIBOUILLE.
Auras-tu bientôt fini, Caroline ? J’ai bien faim ; il est
l’heure de souper.
CAROLINE.
Dans cinq minutes ; je n’ai plus que deux boutons à coudre....
Là ! C’est fini. Je vais aller porter la robe et je
reviendrai ensuite tout préparer. Toi, tu vas rester près de maman
pour lui donner ce qu’elle te demandera.
GRIBOUILLE.
Et si elle ne me demande rien ?
CAROLINE, riant.
Alors tu ne lui donneras rien.
GRIBOUILLE.
Alors, j’aimerais mieux aller avec toi ; il y a si longtemps
que je suis enfermé !
CAROLINE.
Mais... maman ne peut pas rester seule.,.. malade comme elle
l’est.... Attends.... je pense que tu pourrais porter cette robe
tout seul chez Mme Delmis.... Je vais la bien arranger en
paquet ; tu la prendras sous ton bras, tu la porteras chez Mme
Delmis, tu demanderas la bonne et tu la lui donneras de ma part.
As-tu bien compris ?
GRIBOUILLE.
Parfaitement. Je prendrai le paquet sous mon bras, je le porterai
chez Mme Delmis, je demanderai la bonne et je le lui donnerai de ta
part,
CAROLINE.
Très-bien. Va vite et reviens vite ; tu trouveras au retour
ton souper servi.
Gribouille saisit le paquet, partit comme un trait, arriva chez Mme
Delmis et demanda la bonne.
« A la cuisine, mon garçon ; première porte à
gauche, » répondit un facteur qui sortait.
Gribouille connaissait le chemin de la cuisine ; il fit un
salut en entrant et présenta le paquet à Mlle Rose.
GRIBOUILLE.
Ma sœur vous envoie un petit présent, mademoiselle Rose ; une
robe qu’elle vous a faite elle-même, tout entière ; elle s’est
joliment dépêchée, allez, pour l’avoir finie ce soir.
MADEMOISELLE ROSE.
Une robe ? à moi ? Oh ! mais que c’est donc aimable
à Caroline ! Voyons, comment est-elle ?
Mlle Rose défit le paquet et déroula une jolie robe en jaconas rose
et blanc. Elle poussa un cri d’admiration, remercia Gribouille, et,
dans l’excès de sa joie, elle lui donna un gros morceau de galette
et un gros baiser ; puis elle courut bien vite dans sa chambre
pour essayer la robe, qui se trouva aller parfaitement.
Gribouille, très-fier de son succès, revint à la maison en courant.
« J’ai fait ta commission, ma sœur. Mlle Rose est bien
contente ; elle m’a embrassé et m’a donné un gros morceau de
galette ; j’aurais bien voulu le manger, mais j’ai mieux aimé
le garder pour t’en donner une part et une autre à maman.
CAROLINE..
C’est très-aimable à toi, Gribouille ; je t’en remercie. Voilà
tout juste le souper servi : mettons-nous à table.
GRIBOUILLE.
Qu’avons-nous pour souper ?
CAROLINE.
Une soupe aux choux et au lard, et une salade.
GRIBOUILLE.
Bon ! j’aime bien la soupe aux choux, et la salade
aussi ; nous mangerons la galette après. »
Caroline et Gribouille se mirent à table. Avant de se servir
elle-même, Caroline eut soin de servir sa mère, qui ne pouvait
quitter son lit par suite d’une paralysie générale. Gribouille
mangeait en affamé, personne ne disait mot. Quand arriva le tour de
la galette, Caroline demanda à Gribouille si c’était Mme Delmis qui
la lui avait donnée.
GRIBOUILLE.
Non, je n’ai pas vu Mme Delmis. Tu m’avais dit de demander la
bonne, et j’ai demandé la bonne.
CAROLINE.
Et tu ne sais pas si Mme Delmis a été contente de la robe ?
GRIBOUILLE.
Ma foi, non ; je ne m’en suis pas inquiété ; et puis,
qu’importe qu’elle soit contente ou non ? C’est Mlle Rose qui
a reçu la robe, et c’est elle qui l’a trouvée jolie et qui riait,
et qui disait que tu étais bien aimable.
CAROLINE, avec surprise.
Que j’étais aimable ! Il n’y avait rien d’aimable à renvoyer
cette robe.
GRIBOUILLE.
Je n’en sais rien ; je te répète ce que m’a dit Mlle Rose.
Caroline resta un peu étonnée de la joie de Mlle Rose, et le fut
bien davantage quand le petit Colas, filleul de Mme Delmis, vint
tout essoufflé demander la robe qui avait été promise pour le soir.
CAROLINE.
Je l’ai envoyée il y a une heure ; c’est Gribouille qui l’a
portée.
COLAS.
Mme Delmis la demande pourtant ; faut croire qu’elle ne l’a
pas reçue.
CAROLINE, à Gribouille.
Ne l’as-tu pas donnée à Mlle Rose ?
GRIBOUILLE.
Oui, je l’ai donnée de ta part, comme tu me l’avais dit.
CAROLINE.
C’est donc Mlle Rose qui aura oublié de la remettre. Cours vite,
Colas : dis à Mme Delmis que la robe est depuis une heure chez
Mlle Rose.
Colas repartit encourant. Caroline était inquiète ; elle
craignait, sans pouvoir se l’expliquer, une maladresse ou une
erreur de Gribouille ; mais à toutes ses interrogations,
Gribouille répondit invariablement :
« J’ai donné le paquet à Mlle Rose, comme tu me l’as
dit. »
Caroline se mit à tout préparer pour le coucher de la famille. Sa
pauvre mère ne quittait pas son lit depuis cinq ans, et ne pouvait
aider sa fille dans les soins du ménage ; mais Caroline
suffisait à tout : active, laborieuse et rangée, elle tenait
la maison dans un état de propreté qui donnait du relief aux vieux
meubles qui s’y trouvaient. Elle suppléait par son travail à ce qui
pouvait manquer aux besoins de la famille, et surtout à sa mère.
Gribouille l‘aidait de son mieux ; mais le pauvre garçon avait
une intelligence si bornée, que Caroline ne pouvait lui confier
d’autre travail que celui qu’il faisait avec elle. Son vrai nom
était Babylas ; un jour, il imagina de mettre un bel habit
neuf à l’abri de la pluie en entrant jusqu’aux genoux dans un
ruisseau abrité par des saules pleureurs. Ses camarades se
moquèrent de lui et s’écrièrent qu’il faisait comme Gribouille, qui
se mettait dans l’eau pour ne pas être mouillé. Depuis ce jour, on
ne l’appela plus que Gribouille, et dans sa famille même le nom lui
en resta. Sa figure douce, régulière, sa physionomie un peu niaise,
sa bouche légèrement entr’ouverte, sa taille élancée et sa tournure
dégingandée, attiraient l’attention et indiquaient un léger
dérangement dans l’esprit, tout en inspirant l’intérêt et la
sympathie. Il aidait sa sœur à tout ranger, tout nettoyer,
lorsqu’un coup vigoureux frappé à la porte fit tressaillir
Caroline : « Entrez ! » cria-t-elle un peu
émue.
Mlle Rose poussa vivement la porte et entra le visage enflammé de
colère. S’adressant à Caroline :
« Je vous prie, mademoiselle, de vous dispenser à l’avenir de
vos mauvaises plaisanteries, et de ne pas chercher à me brouiller
avec ma maîtresse, pour prendre ma place probablement.
CAROLINE.
Que voulez-vous dire, mademoiselle Rose ? Je ne comprends pas
vos reproches ; je n’ai jamais cherché à vous brouiller avec
Mme Delmis.
MADEMOISELLE ROSE.
C’était peut-être pour la contenter que vous m’envoyez une robe
comme pour moi, quand vous savez que la robe est à elle, qu’elle
vous l’a donnée à faire, qu’elle l’attend ? Je la mets
très-innocemment, cette robe, croyant à une amabilité de votre
part, et voilà-t-il pas que Mme Delmis, qui regardait je ne sais
quoi à sa fenêtre, me voit passer, reconnaît ma robe qui était à
elle, me fait une avanie en pleine rue et me fait rentrer pour me
déshabiller et lui rendre la robe que vous m’aviez envoyée en
présent ! Et encore que j’ai eu la bêtise de donner une
galette à votre imbécile de frère, qui s’est fait le complice de
votre méchanceté
CAROLINE.
Ce que vous me dites me surprend beaucoup, mademoiselle Rose.
J’avais dit à mon frère de vous porter la robe, je pensais que vous
la remettriez à Mme Delmis ; comment pouvais-je croire que
vous la recevriez comme un présent de moi, pauvre fille, qui ai de
la peine à faire vivre ma famille ? Et quant à mon frère, il
s’est acquitté de la commission que je lui ai donnée, et je ne
pense pas qu’il mérite aucunement vos injures.
MADEMOISELLE ROSE.
C’est bon, c’est bon, mademoiselle ! excusez-vous comme vous
pouvez ; mais je vous préviens que, si vous voulez me faire
renvoyer de chez Mme Delmis pour prendre ma place, vous n’y
resterez pas. Madame est capricieuse et avare ; elle paye peu
et regarde à tout ; elle gronde à tort et à travers ;
elle vous compte les bûches et la chandelle ; elle enferme le
sucre, le café, les confitures, le vin, tout enfin ; c’est une
maison de rien, une vraie baraque ; avec ça, des enfants qui
vont et viennent, qui vous arrivent les uns suivant les autres. Ce
n’est pas tenable, et je vous le dis d’avance pour que vous sachiez
ce qui en est.
CAROLINE.
Je n’ai aucune envie d’entrer chez Mme Delmis, je vous
assure ; vous savez bien que j’ai ma mère et mon frère que je
ne puis quitter. Mais si la maison est si mauvaise, pourquoi y
êtes-vous depuis un an, et pourquoi paraissez-vous si fâchée à la
pensée que j’ai voulu vous en faire sortir ? J’ai toujours vu
Mme Delmis bonne pour tout le monde et surtout pour vous,
mademoiselle Rose ; dans votre maladie d’il y a trois mois,
elle vous a bien soignée, ce me semble ; elle vous a fait
veiller trois nuits, et elle ne vous refusait rien de ce qui
pouvait vous être bon et agréable. Vous devriez lui en avoir de la
reconnaissance et ne pas parler d’elle comme vous venez de le
faire,
MADEMOISELLE ROSE.
Je n’ai pas besoin de vos leçons, mademoiselle ; je sais ce
que j’ai à dire ou à ne pas dire. Je vois d’après vos paroles que
vous savez flatter Mme Delmis pour en tirer de l’argent ; mais
je saurai vous déjouer, et vos robes n’iront plus si bien à
l’avenir. Votre réputation de bonne couturière va souffrir, allez.
CAROLINE.
Pourquoi mes robes n’iraient-elles plus comme avant, si je les
soigne tout autant ? Je fais de mon mieux ; le bon Dieu a
protégé mon travail ; il ne me retirera pas son appui.
MADEMOISELLE ROSE.
Oui, oui, ma belle, comptez là-dessus ; je vous donnerai un
coup de main à l’occasion : le ciseau par-ci, un pli par-là,
et vous verrez ce que deviendra votre beau talent en robes et
manteaux.
CAROLINE.
Pas possible, mademoiselle Rose, vous ne feriez pas une méchanceté
pareille ?
GRIBOUILLE.
Que veut-elle te faire, ma sœur ? Dis, je saurai bien l’en
empêcher.
MADEMOISELLE ROSE.
Toi, imbécile, tu m’empêcheras d’arranger les robes à mon idée pour
qu’elles aillent comme je l’entends ? Je t’en défie,
idiot !
GRIBOUILLE.
Il n’y a pas que Mme Delmis dans le pays, méchante vieille fille,
et je vous ferai votre réputation, moi aussi, si vous faites du mal
à ma sœur.
MADEMOISELLE ROSE, avec colère.
Vieille fille ! Qu’est ce à dire, vieille fille ? J’ai
refusé plus de vingt maris et....
GRIBOUILLE.
Je demande les noms, mademoiselle. Un seul, si vous pouvez.
MADEMOISELLE ROSE.
Les noms ! les noms ! Comme si on pouvait se souvenir de
tout ça ?
GRIBOUILLE.
Un seul ! voyons, un seul !
MADEMOISELLE ROSE.
D’abord, il y a Taillochon, du moulin.
GRIBOUILLE.
Un bossu ? Ha, ha, ha ! Une bosse plus grosse que lui,
les jambes torses, un museau de singe ! Ha, ha, ha !
Voilà-t-il un beau mari ?... Mme Taillochon ! Ha, ha,
ha ! Il vous va à la hanche !
MADEMOISELLE ROSE.
Aussi n’en ai-je pas voulu, imbécile. Et puis Boursiflo l’épicier.
GRIBOUILLE.
Épicier de quatre sous, avec le nez de travers ; la joue
droite grosse comme une tête, ivre du matin au soir, et du soir au
matin ! En voilà encore un fameux mari ! S’ils sont tous
de ce numéro, vous ferez bien de ne pas vous en vanter....
Boursiflo ! Vraiment ! Et Taillochon ! Ha, ha,
ha !... En voilà-t-il une bonne !... Il y a du choix tout
de même. »
Mlle Rose, irritée au plus haut degré des observations de
Gribouille, s’élança vers lui pour lui faire sentir la force de son
poing ; mais Gribouille, devinant Pattaque et leste comme on
l’est à quinze ans, saisit une chaise qu’il éleva entre lui et son
ennemie au moment où, le bras lancé, elle allait lui appliquer le
plus vigoureux soufflet qui ait jamais été donné ; le blessé
ne fut pas Gribouille, ce fut le bras de Mlle Rose, qui rencontra
la chaise et qui retomba sans mouvement. Mlle Rose poussa un cri de
douleur, en même temps que Gribouille poussait un cri de triomphe.
Caroline le saisit par sa jaquette et, le tirant en arrière, se
plaça entre les deux combattants. Mais Rose était vaincue ; la
douleur l’emportait sur la colère ; elle soutenait du bras
gauche son bras droit contusionné, et laissait échapper des
gémissements contenus. Elle permit à Caroline d’examiner la
blessure et de lui frotter la partie meurtrie avec de l’huile de
mille-pertuis ; après quoi, elle partit sans ajouter une
parole et en jetant la porte avec violence.
Le bras de Mlle Rose retomba sans mouvement.
II - Promesse de Caroline.
II
Promesse de Caroline.
La femme Thibaut était restée immobile pendant toute cette scène
qui l’avait visiblement agitée ; quand Mlle Rose fut partie,
elle appela Gribouille.
« Gribouille, comment se fait-il que Mlle Rose ait pu croire
que ta sœur lui faisait présent de la robe de Mme Delmis ?
GRIBOUILLE.
Est-ce que je le savais, moi, que la robe était à Mme Delmis ?
J’ai répété à Mlle Rose ce que Caroline m’avait ordonné de lui
dire.
LA MÈRE THIBAUT.
Mais qu’as-tu dit ? répète-moi tes paroles.
GRIBOUILLE.
Je ne me souviens plus bien à présent. Je crois que j’ai dit :
« Mademoiselle Rose, voici une robe que « ma sœur a faite
pour vous, et qu’elle vous envoie. »
LA MÈRE THIBAUT.
Et Mlle Rose a cru que c’était pour elle ?
GRIBOUILLE.
Bien sûr, puisque je l’ai cru moi-même ; et si je l’ai cru,
pourquoi ne l’aurait-elle pas cru aussi ?
CAROLINE.
Je comprends maintenant sa colère ; elle a pensé que j’avais
voulu me moquer d’elle et la faire gronder.
LA MÈRE THIBAUT.
Aussi, pourquoi donnes-tu des commissions à Gribouille ? Tu
sais que le pauvre garçon est....
CAROLINE, vivement.
Bien complaisant, et fait tout ce qu’il peut pour bien faire ;
je le sais, maman ; il est si content quand il me rend
service !
GRIBOUILLE.
Bonne Caroline ! Oui, je voudrais te rendre toujours service,
mais je ne sais comment il arrive que les choses tournent contre
moi, et qu’au lieu de t’aider je te fais du mal. C’est bien sans le
vouloir, va.
LA MÈRE THIBAUT.
Alors pourquoi te mêles-tu de ses affaires, mon ami, puisque tu
sais que tu n’as pas l’intelligence de les bien faire ?
CAROLINE.
Oh ! maman, il m’est souvent très-utile....
GRIBOUILLE, avec tristesse.
Laisse, laisse, ma bonne Caroline, tu as déjà arrêté maman tout à
l’heure, quand elle a voulu dire que j’étais bête. Je sais que je
le suis, mais pas tant qu’on le croit. Je trouverai de l’esprit
pour te venger de Mlle Rose, sois-en sûre.
CAROLINE.
Gribouille, je te le défends ; pas de vengeance, mon
ami ; sois bon et charitable ; pardonne à ceux qui nous
offensent....
GRIBOUILLE.
Je veux bien pardonner à ceux qui m’offensent, moi ; mais
jamais à ceux qui t’offensent, toi ! Toi si bonne, et qui ne
fais de mal à personne !
CAROLINE.
Je t’en prie, Gribouille, n’y pense pas davantage ;
défends-moi, je le veux bien, comme tu l’as fait si vaillamment
tout à l’heure, mais ne me venge jamais. Tiens, ajouta-t-elle en
lui présentant un livre, lis ce passage de la Vie de N. S.
Jésus-Christ, tu verras comme il pardonne tout et toujours ;
et tâche de faire comme lui.
Gribouille prit le livre, qu’il se mit à lire attentivement, La
mère Thibaut appela Caroline et lui parla bas.
« Ma fille, lui dit-elle, que deviendra ce pauvre garçon quand
je n’y serai plus ? Tant que je vis, nous avons la rente de
six cents francs que me fait mon cousin Lérot, pour le débit de
tabac que je lui ai cédé, mais je n’en ai pas pour longtemps ;
je sens tous les jours mes forces s’affaiblir ; mes mains
commencent à se paralyser comme les jambes ; ma tète se prend
quelquefois ; la scène de tout à l’heure m’a fait bien mal. Et
que deviendras-tu, ma pauvre enfant, avec Gribouille, qui est
incapable de gagner sa vie et qui t’empêchera de te placer ?
Pauvre Gribouille !
— Ne vous inquiétez pas de moi, chère maman, dit Caroline en
l’embrassant tendrement ; je travaille bien, vous savez ;
je ne manquerai pas d’ouvrage ; je gagnerai facilement de quoi
vivre avec Gribouille, qui fera le ménage et les commissions, et
qui m’aidera de son mieux. D’ailleurs, vous n’êtes pas si mal que
vous croyez ; vous vivrez longtemps encore ; et d’ici à
quelques années, mon frère va devenir bon ouvrier et aussi capable
qu’un autre.
LA MÈRE THIBAUT.
J’en doute, ma fille. Mon pauvre Gribouille sera toujours ce qu’il
est, et il te sera toujours une gêne et un ennui.
CAROLINE.
Un ennui, jamais, maman. Une gêne.... peut-être ; mais je
compte sur la protection du bon Dieu et je vous promets de ne
jamais abandonner mon pauvre frère, quoi qu’il arrive.
LA MÈRE THIBAUT.
Merci, ma fille ; ma bonne Caroline, merci. Mais si tu vois
qu’il t’empêche de gagner ta vie, tâche de le placer chez de braves
gens, bien pieux, bien charitables, qui le garderont pour l’amour
du bon Dieu. Consulte M. le curé ; il t’aidera ; il est
bon.... tu sais.
CAROLINE.
Jamais je n’abandonnerai mon frère, maman, soyez-en certaine..
LA MÈRE THIBAUT.
Jamais.... jamais.... Merci.... Jamais... Oh ! mon Dieu !
je ne sais plus.... je ne peux plus penser.... Ma tête.... Tout
s’en va.... M. le curé.... Ha !.,.
— Gribouille, Gribouille, va vite chercher M. le curé !
s’écria Caroline en se jetant sur sa mère, qui venait de perdre
connaissance.
GRIBOUILLE, se levant.
Et si je le trouve, que faudra-t-il faire ?
CAROLINE.
L’amener ici ; vite, vite ; dis-lui que maman se
meurt. »
Gribouille sortit précipitamment et courut chez M. le curé, qu’il
trouva faisant une partie de dominos avec le pharmacien du bourg.
« Tiens ! Gribouille ! dit le curé avec son sourire
bienveillant. Par quel hasard, mon garçon ? As-tu besoin de
moi ?
GRIBOUILLE.
Vite, vite, monsieur le curé ! maman se meurt ; il faut
que je vous amène ; Caroline l’a dit. »
Le curé se leva, prit son chapeau, son bâton, et suivit Gribouille
sans mot dire. Ils arrivèrent en peu d’instants à la porte de la
mère Thibaut ; le curé entra le premier ; Caroline, à
genoux près du lit de sa mère, priait avec ferveur ; au bruit
que lit le curé en ouvrant la porte, elle se releva et lui fit
signe d’approcher.
La femme Thibaut ouvrit les yeux, essaya de parler, mais ne put
articuler que des mots entrecoupés : « Ma fille....
pauvre Gribouille.,.. le bon Dieu.... n’abandonnera pas.... Je
meurs.... Pauvres enfants.... Merci.... Pardon.... »
Le curé fit éloigner Caroline et Gribouille, se mit à genoux près
du lit de la mère Thibaut, et lui parla bas ; elle comprit,
sans doute, car son visage redevint calme ; elle essaya de
faire le signe de la croix et joignit les mains en portant ses
regards sur le crucifix qui était en face d’elle. Le curé continua
à parler et à prier ; elle lui répondait par des mots
entrecoupés et par signes, et prolongea assez longtemps cet
entretien dont elle paraissait retirer une grande consolation. Le
curé, craignant pourtant de fatiguer la pauvre femme, voulut
s’éloigner ; le regard suppliant qu’elle lui jeta le retint
près du lit ; il appela Caroline, qui pleurait avec Gribouille
dans un cabinet attenant à la chambre.
« Votre mère est bien mal, ma chère enfant ; elle a eu
une nouvelle attaque. Quelle est l’ordonnance du médecin en pareil
cas ?
CAROLINE.
Il y a bien des années que nous n’avons vu le médecin, monsieur le
curé, Lorsque ma mère a eu la première attaque qui l’a paralysée,
il a dit qu’il n’y avait rien à faire, qu’il était inutile de
l’appeler s’il survenait un nouvel accident ; que la seule
chose à faire était de vous envoyer chercher, et c’est ce que j’ai
fait.
LE CURÉ.
Je crains, ma pauvre enfant, que le médecin n’ait eu raison. Je ne
vois en effet aucun remède qui puisse la soulager. Elle est comme
toujours, bien calme, bien résignée à la volonté du bon Dieu ;
je lui ai promis de ne pas vous abandonner, de vous consoler, de
vous aider dans la gêne qui va être votre partage. Je connais votre
courage et votre piété, mon enfant ; le bon Dieu ne vous
abandonnera ni vous ni votre frère, parce que vous avez toujours eu
confiance en lui. »
Caroline ne répondit que par ses sanglots ; elle se jeta à
genoux près du bon curé, qui lui donna une bénédiction toute
paternelle et pleura avec elle.
Gribouille sanglotait toujours dans le cabinet où il s’était
réfugié ; mais ses larmes coulaient plutôt par le chagrin
qu’il ressentait de voir pleurer sa sœur que par l’inquiétude que
lui donnait l’état de sa mère, dont il ne comprenait pas la
gravité. Le curé alla à lui, et lui passant affectueusement la main
sur la tête :
« Ne pleure pas, mon brave garçon ; tu augmentes le
chagrin de ta sœur.
GRIBOUILLE.
Je pleure parce qu’elle pleure, monsieur le curé ; si je la
voyais contente, je ne pleurerais pas ; je n’ai pas d’autre
raison de pleurer, moi. Seulement je voudrais savoir pourquoi nous
pleurons,
LE CURÉ.
Ta sœur pleure parce que ta mère est très-malade.
GRIBOUILLE.
Elle est comme à l’ordinaire ; elle est toujours dans son lit.
LE CURÉ.
Mais ce soir elle croit qu’elle va mourir, et c’es ce qui chagrine
ta sœur.
GRIBOUILLE.
Il n’y a pas de quoi se chagriner. Maman dit toujours :
« Mon Dieu, si je pouvais mourir ! Je serais bien
heureuse si j’étais morte ! Je ne souffrirais
plus ! » Et puis maman m’a dit que, lorsqu’elle serait
morte, elle irait avec le bon Dieu, la sainte Vierge, les anges....
Je voudrais bien y aller aussi, moi ; je m’ennuie quand
Caroline travaille, et maman dit qu’on ne s’ennuie jamais avec le
bon Dieu. Dites à Caroline de ne pas pleurer ; je vous en
prie, monsieur le curé, dites-le-lui ; elle vous obéit
toujours. »
Le curé sourit avec tristesse, et s’approchant de Caroline, il lui
redit les paroles de Gribouille et lui demanda de contenir ses
larmes tant que le pauvre garçon ne serait pas couché.
Caroline regarda sa mère, le crucifix, pressa ses mains croisées
sur son cœur comme pour en comprimer les sentiments, et se
dirigeant vers Gribouille avec un visage calme, elle l’embrassa
avec tendresse.
CAROLINE.
C’est donc moi qui te fais pleurer, mon pauvre frère ?
Pardonne-moi, je ne recommencerai pas. Tiens, vois-tu comme je suis
tranquille à présent.... Vois.... je ne pleure plus.
Gribouille la regarda attentivement.
GRIBOUILLE.
C’est vrai ; alors moi aussi je suis content. Je ne puis
m’empêcher de pleurer quand lu pleures, de rire quand tu ris. C’est
plus fort que moi, je t’assure. C’est que je t’aime tant ! tu
es si bonne !
CAROLINE.
Merci, mon ami, merci. Mais sais-tu qu’il est bien tard ? tu
es fatigué ; il est temps que tu te couches.
GRIBOUILLE.
Et toi ?
CAROLINE.
Moi je vais préparer quelque chose pour maman, et je me coucherai
après.
GRIBOUILLE.
Bien sûr ? Tu ne vas pas veiller ? tu ne vas pas
pleurer ?
CAROLINE.
Certainement non ; je vais dormir jusqu’à demain cinq heures,
comme d’habitude. Va, Gribouille, va, mon ami ; fais ta prière
et couche-toi. Prie pour maman, ajouta-t-elle en l’embrassant.
Gribouille, rassuré pour sa sœur, fatigué de sa journée, ne résista
pas et fit comme lui avait dit Caroline. Quelques minutes après, il
dormait profondément.
III - Mort de la femme Thibaut.
III
Mort de la femme Thibaut.
Lorsque Caroline rentra dans la chambre de sa mère, elle trouva le
curé priant pour le repos de cette âme, qui venait de comparaître
devant Dieu et qui recevait la récompense de sa piété, de sa longue
patience, de sa résignation. Ses peines n’avaient duré que quelques
années, son bonheur devait durer toujours.
En voyant sa mère sans mouvement et sans vie, Caroline étouffa un
cri qui s’échappait de sa poitrine, et se jetant à genoux, elle
donna un libre cours à ses larmes. Le curé la laissa quelque temps
à sa douleur ; quand il vit que ses sanglots commençaient à se
calmer, il lui prit la main, et la faisant agenouiller devant le
crucifix qui avait reçu le dernier regard de sa mère, il lui dit de
sa voix pleine d’onction et de piété :
« Ma pauvre enfant, remerciez le bon Dieu d’avoir terminé les
souffrances de votre mère ; demandez-lui du courage pour
lutter contre l’isolement et les privations. Souvenez-vous que ce
Dieu si bon est toujours avec vous ; que s’il vous envoie des
peines, c’est pour effacer vos fautes et pour mieux récompenser
votre obéissance, votre résignation, votre dévouement.
CAROLINE.
Je le sais, monsieur le curé, je le sais ! Mais ma mère, ma
pauvre mère ! Je reste seule....
LE CURÉ.
Non, pas seule, mon enfant. Il vous reste un devoir, un grand
devoir à remplir : celui que vous a légué votre mère. Vous
êtes le seul soutien, le seul appui de votre frère.... Dieu vous
aidera, car la tâche est difficile.
CAROLINE.
Hélas ! oui ; il me reste mon frère !... Mon
frère !... Que le bon Dieu me protège, car je sens mon courage
faiblir.
LE CURÉ.
Il vous protégera, mon enfant. Ne doutez pas de sa bonté, et quoi,
qu’il vous envoie, remerciez et acceptez.
CAROLINE.
Je tâcherai, monsieur le curé, je tâcherai....Que sa sainte volonté
soit faite et non la mienne. »
Après avoir cherché à consoler et remonter Caroline, le bon curé
lui dit :
« Ma chère enfant, vous ne pouvez rester seule avec le corps
inanimé de votre mère ; je vais rentrer chez moi et vous
envoyer la vieille Nanon, qui a l’habitude d’ensevelir et de
veiller les morts. Je reviendrai vous voir demain de bonne heure et
je me charge de tout ce qui a rapport aux funérailles. Ne vous
inquiétez de rien ; priez pour elle, priez pour vous ;
confiez-vous en la bonté de votre Père tout-puissant. Adieu, mon
enfant, au revoir, et que la bénédiction de Dieu repose sur vous et
sur votre maison. »
Le curé la laissa quelque temps à_sa douleur.
Le curé donna une dernière bénédiction à la mère et à la fille, et
sortit. Lorsque Caroline se trouva seule, elle ne chercha plus à se
contraindre, et malgré sa résignation à la volonté de Dieu, elle se
laissa aller à toute la violence de sa douleur. Ses gémissements et
ses sanglots éveillèrent Gribouille, quoiqu’elle eût eu la
précaution de fermer la porte.
Entendant pleurer sa sœur, il se leva, passa à la hâte ses
vêtements, entr’ouvrit doucement la porte et aperçut Caroline
affaissée sur ses genoux, le visage baigné de larmes, les yeux
levés vers le crucifix, les mains jointes retombées sur ses genoux.
« Caroline ! » dit-il d’un air de reproche.
Caroline essuya ses yeux à la hâte, mais ne se releva pas.
« Caroline ! tu m’as trompé ! Je dormais parce que
j’ai cru à ta parole.... Caroline ! tu as du chagrin !
Pourquoi pleures-tu ? »
Caroline montra du doigt le corps inanimé de sa mère. « Elle
est morte ! » dit-elle d’une voix étouffée.
Gribouille approcha du lit de sa mère et la considéra
attentivement.
« Elle ne souffre plus, dit-il ; non, elle ne souffre
pas.... vois comme son visage est calme.... Elle disait vrai....
« Quand je serai morte, m’a-t-elle dit,
« je serai bien heureuse ; je serai avec le bon
Dieu,
« la sainte Vierge et les anges.... » C’est vrai qu’elle
est heureuse.... Tiens, je crois qu’elle sourit. »
Et Gribouille répondit à ce sourire qu’il croyait voir ; et se
retournant vers sa sœur :
« Pourquoi pleures-tu, puisqu’elle est heureuse ? Tu n’es
donc pas contente qu’elle soit heureuse ?
CAROLINE.
Oh ! mon frère, pense donc que nous ne la verrons plus, que
nous n’entendrons plus sa voix, que nous ne pouvons plus rien pour
elle.
GRIBOUILLE.
Nous pouvons prier, M. le curé l’a dit l’autre jour. Nous ne
l’entendrons plus gémir et se plaindre, nous ne la verrons plus
souffrir ; tu aimes donc mieux avoir le plaisir de la soigner
que de la savoir heureuse ?... C’est singulier !... Je
croyais que tu l’aimais beaucoup.
CAROLINE.
C’est parce que je l’aimais que je la pleure.
GRIBOUILLE.
C’est drôle d’aimer comme ça ! Pleurer parce que maman est
heureuse sans toi ! Pleurer parce qu’elle ne souffre plus près
de toi !
CAROLINE.
Ce n’est pas cela, Gribouille, ce n’est pas cela. Si je venais à
mourir, même pour être très-heureuse prés du bon Dieu, est-ce que
tu ne pleurerais pas ? »
Gribouille réfléchit un instant.
« Je pleurerais un peu.... peut-être.... mais je serais si
content de te savoir heureuse, et je serais si sûr de te rejoindre
un jour, que je me consolerais tout de suite, et que j’attendrais
patiemment que le bon Dieu me fasse mourir à mon tour.
— Ce garçon a plus de bon sens que nous tous, ma pauvre
tille, » dit une voix forte qui fit retourner Caroline et
Gribouille.
C’était Nanon, qui était entrée depuis quelques instants, et qui
écoutait la conversation de Gribouille avec sa sœur.
« Tu as raison, mon garçon ; c’est-à-dire au fond tu as
raison ; mais c’est tout de même triste de ne plus voir ceux
qu’on a aimés. Vois-tu, c’est comme une médecine ; c’est
mauvais à avaler, mais ça fait du bien. Et à présent, va te
coucher, mon garçon ; nous n’avons que faire de toi ; tu
nous gênerais au lieu de nous aider.
GRIBOUILLE.
Mais Caroline ?
NANON.
J’aurai soin de Caroline ; sois tranquille.
GRIBOUILLE.
Vous l’empêcherez de pleurer ?
NANON.
Ah ! je crois bien ! Je voudrais bien voir qu’elle
pleurât après tout ce que tu lui as dit ! »
Gribouille, entièrement rassuré par les paroles et l’air décidé de
Nanon, et par le calme momentané de sa sœur, l’embrassa à plusieurs
reprises et retourna dans sa chambrette. Il pria le bon Dieu de
rendre sa mère bien heureuse.
« Et moi aussi, mon bon Dieu, ajouta-t-il, rendez-moi bien
heureux, et Caroline aussi ; et M. le curé qui est si bon.
Comme ça nous serons tous heureux et Caroline ne pleurera
plus. »
Il se recoucha et se rendormit paisiblement.
Quand il se réveilla le lendemain, et qu’il alla chercher Caroline,
il trouva la chambre pleine de monde ; le bruit de ta mort de
la femme Thibaut s’était répandu ; les voisines étaient
accourues, les unes par compassion, les autres par curiosité, peu
par charité. Caroline avait passé la nuit en prières près de sa
mère, que Nanon avait ensevelie dans un linceul bien blanc ;
Caroline, pâle, défaite, triste et abattue, recevait avec
reconnaissance, mais sans y répondre, les témoignages de sympathie
vraie ou fausse qu’elle recevait des voisines ; les unes
parlaient avec volubilité, les autres donnaient de ces consolations
qui choquent et qui irritent.
« Qu’allez-vous faire de votre frère ? dit une de ces
femmes. Il va vous gêner pour gagner votre vie Si vous le faisiez
entrer dans un hospice ?
— Jamais ! dit Caroline en se levant debout près de lit de sa
mère, sur lequel elle était appuyée. Jamais ! j’ai promis à
maman de ne jamais abandonner mon pauvre frère ; je ne
manquerai pas à ma promesse.