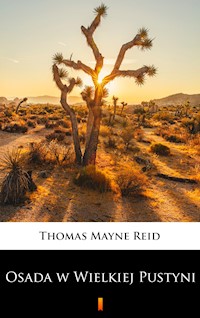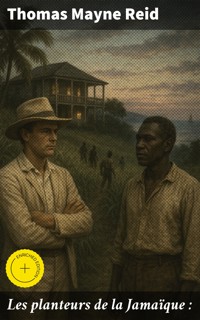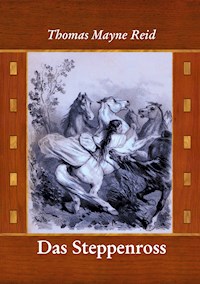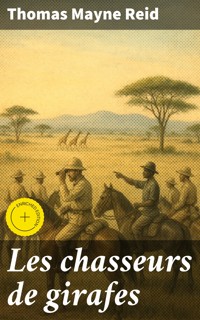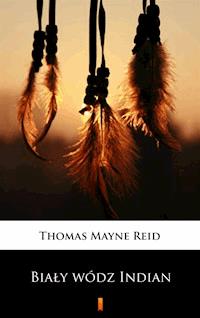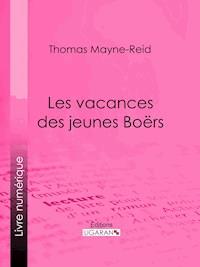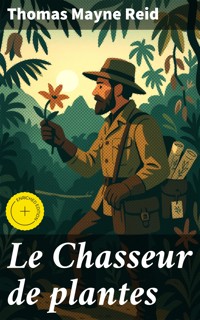
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Le Chasseur de plantes est un roman qui plonge le lecteur dans les aventures d'un botaniste explorant des contrées lointaines à la recherche de nouvelles espèces végétales. Reid, avec son style narratif riche et évocateur, utilise une prosaïque descriptive qui illustre avec brio la magnificence de la nature ainsi que les périls de l'aventure. Le livre, écrit à une époque où l'exploration scientifique était en plein essor, s'inscrit dans le courant du roman d'aventure du XIXe siècle, reflétant à la fois la fascination pour l'exotisme et la quête de connaissances qui caractérisent cette période. Thomas Mayne Reid, un écrivain irlandais célébré pour ses œuvres d'aventure, a vécu à une époque où les expéditions scientifiques étaient à la mode. Influencé par ses propres explorations et par les récits d'autres aventuriers, Reid a été motivé à écrire des histoires qui mettent en lumière les grandes découvertes et les enjeux écologiques de son temps. Son amour pour la nature et sa passion pour la botanique, couplés à une forte conviction que l'aventure peut éduquer, ont imprégné son œuvre de profondeur et de sens. Je recommande avec enthousiasme Le Chasseur de plantes à tous les amoureux de la nature et de l'aventure. Ce livre offre non seulement une évasion dans des mondes fascinants, mais suscite également une réflexion sur la relation entre l'homme et la nature. Par son articulation dynamique entre le récit d'aventure et l'observation botanique, ce roman captive et instruit, rendant la lecture à la fois agréable et enrichissante. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction succincte situe l'attrait intemporel de l'œuvre et en expose les thèmes. - Le Synopsis présente l'intrigue centrale, en soulignant les développements clés sans révéler les rebondissements critiques. - Un Contexte historique détaillé vous plonge dans les événements et les influences de l'époque qui ont façonné l'écriture. - Une Analyse approfondie examine symboles, motifs et arcs des personnages afin de révéler les significations sous-jacentes. - Des questions de réflexion vous invitent à vous engager personnellement dans les messages de l'œuvre, en les reliant à la vie moderne. - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Le Chasseur de plantes
Table des matières
Introduction
Entre la soif de connaître et l’appétit de conquérir, l’aventure botanique condense l’ivresse de la découverte, la rugosité du terrain et l’éthique vacillante de mains qui cueillent pour sauver, classer ou posséder, et c’est précisément dans cette tension — où la carte s’ouvre plus vite que la conscience, où un calice minuscule peut valoir une vie entière d’efforts — que Le Chasseur de plantes trouve son nerf, suivant des explorateurs prêts à risquer le froid, la fièvre, la faim et l’inconnu pour arracher aux lointains leur secret vert et le ramener au regard de tous.
Roman d’aventures à visée didactique, Le Chasseur de plantes appartient à la production de Thomas Mayne Reid, auteur irlando-américain connu au XIXe siècle pour ses récits de voyages imaginaires et d’apprentissage. Publié au milieu du XIXe siècle, dans le contexte victorien friand d’explorations scientifiques et de vulgarisation naturaliste, le livre met en scène des collecteurs de plantes engagés dans une expédition lointaine. Destiné d’abord à un lectorat jeunesse mais lisible par tous, il conjugue suspense, observation de la faune et de la flore, et curiosité encyclopédique, tout en reflétant les sensibilités et les limites d’une époque fascinée par les promesses du savoir.
L’intrigue, sans se perdre dans les détails techniques, suit un petit groupe décidé à parcourir des territoires difficiles afin de réunir des spécimens rares, utiles ou simplement étonnants, pour la science, les jardins et les collections. Guidés par l’expérience naturaliste, les protagonistes avancent de camp en bivouac, franchissant cours d’eau, forêts épaisses et reliefs accidentés, tout en apprenant à lire le paysage et à déjouer les risques ordinaires de la vie en plein air. Le récit installe ainsi une dynamique d’initiation: observation patiente, gestes précis, débrouillardise et audace, qui nourrissent à la fois l’action et l’émerveillement du lecteur.
Reid privilégie une narration claire qui alterne descriptions concrètes et explications accessibles, de manière à transformer chaque halte en petite leçon de choses. Le discours, souvent focalisé sur les gestes et les perceptions, garde une tonalité franche et stimulante, propice à l’identification comme à l’apprentissage. Les passages explicatifs ne rompent pas l’élan: ils éclairent les usages d’une plante, un comportement animal, un procédé de survie, puis laissent place à l’imprévu. Cette voix, à la fois instructive et romanesque, tient l’équilibre entre précision naturaliste et souffle d’aventure. La topographie, le climat, les textures et les odeurs participent constamment à la scénographie du danger et de l’émerveillement.
Au-delà du périple, le roman travaille des thèmes qui le dépassent: la curiosité scientifique comme moteur de formation, la frontière mouvante entre étude et appropriation, la coopération et l’amitié comme ressources face au risque, la ténacité raisonnée contre l’audace aveugle. Il interroge implicitement les circuits par lesquels un spécimen quitte son milieu pour rejoindre herbiers, jardins et savoirs, et rappelle que nommer n’est pas tout comprendre. En montrant des paysages vivants plutôt que de simples décors, il fait sentir la dépendance humaine à l’égard du végétal, renversant le regard de plante de fond vers protagoniste discret.
Pour des lecteurs d’aujourd’hui, l’intérêt est double: historique et écologique. Historique, car le roman témoigne d’une culture où la science populaire, la pédagogie et le voyage se nourrissent mutuellement, révélant aspirations et angles morts d’un siècle d’inventaires. Écologique, parce qu’il rend sensibles l’ingéniosité des adaptations végétales, la fragilité des milieux et l’importance de prêter attention à ce qui pousse, nourrit, soigne et structure nos vies. En suivant l’expédition, on redevient attentif aux formes, aux rythmes et aux interdépendances, attitude précieuse à l’heure où la biodiversité décline et où l’enthousiasme peut s’allier à la responsabilité.
Lire Le Chasseur de plantes, c’est accepter un pacte romanesque où l’action ouvre la voie au savoir, et où la curiosité sert de boussole. On y entre pour l’attrait de l’aventure et l’on y demeure pour la précision des observations, la générosité pédagogique et la construction patiente d’un regard. Aborder le livre avec une conscience critique de son époque enrichit l’expérience: l’on goûte l’énergie narrative tout en questionnant les cadres qui l’ont rendue possible. Cette double posture, attentive et exigeante, révèle une œuvre toujours vive, capable de transmettre le sens du réel et l’allégresse de chercher.
Synopsis
Le Chasseur de plantes, de Thomas Mayne Reid, publié en 1858 (The Plant Hunters), est un roman d’aventures pour la jeunesse qui mêle voyage, savoir naturaliste et péripéties. L’intrigue suit de jeunes collecteurs mandatés pour réunir des spécimens vivants et des graines destinés aux jardins européens, dans le contexte du XIXe siècle où la botanique nourrit science et commerce. La situation initiale présente un motif économique et familial qui pousse les protagonistes à partir. Le récit installe un horizon d’attente clair: atteindre des régions peu connues, identifier des espèces convoitées et revenir avec des plantes intactes, malgré des risques matériels et humains.
Le début expose les contraintes d’une mission commanditée: un employeur exige des résultats, des délais et des listes de plantes recherchées, tandis que l’équipée doit rester autonome loin des centres urbains. Reid détaille les préparatifs, de l’acquisition d’outils de collecte à l’organisation des moyens de conservation en route, et fonde la dynamique d’équipe autour de compétences complémentaires. Des appuis locaux, des jeunes naturalistes curieux et un soutien logistique à distance forment l’ossature du projet. Les enjeux se précisent: convertir la curiosité scientifique en gains concrets, préserver la santé et le matériel, et composer avec une géographie incertaine qui ne cède guère aux cartes.
Les premières étapes décrivent l’apprentissage du terrain: climat capricieux, cours d’eau à franchir, insectes et fièvres, logistique des campements. Les protagonistes s’initient à l’identification des familles végétales, à la récolte des graines au bon stade et à la conservation des mottes, autant d’occasions pour un volet pédagogique sur la morphologie et l’usage des plantes. Quelques trouvailles prometteuses rassurent l’employeur et cimentent l’esprit d’équipe. Un jalon décisif survient lorsqu’un indice fiable signale l’existence d’une espèce rare, potentiellement décisive pour l’avenir de l’expédition. Son habitat, difficile d’accès, oblige à repenser l’itinéraire et à arbitrer entre prudence, calendrier serré et ambition scientifique.
Le cœur du voyage met en scène l’ascension vers des zones plus isolées, où s’imposent des choix tactiques et éthiques. Les collecteurs négocient passages et échanges avec des communautés rencontrées en route, apprennent de savoirs locaux et confrontent leurs méthodes à des pratiques vernaculaires. La complémentarité entre expérience du terrain et curiosité des jeunes naturalistes devient moteur narratif. Une rumeur de milieu propice attire l’expédition sur un itinéraire risqué, jalonné d’obstacles naturels. La rareté des ressources impose des rationnements, les intempéries perturbent le calendrier, et la carte se transforme en hypothèses successives, au rythme d’observations botaniques qui orientent la progression.
Un événement brutal redistribue les cartes: accident, perte de matériel, séparation temporaire ou maladie imposent un ralentissement et des solutions de fortune. Le roman met alors en avant la valeur pratique des connaissances botaniques pour se soigner, s’alimenter, filtrer l’eau, fabriquer cordages et abris. Les itinéraires sont recalculés à partir d’indices écologiques, et l’équipe identifie des espèces indicatrices révélant un microclimat favorable. Un site attendu se confirme, mais l’accès aux plantes visées s’avère périlleux, contraint par la saison et l’altitude. Le dilemme entre sécurité, délais contractuels et réussite scientifique s’exacerbe, préparant les décisions qui définiront la suite de l’expédition.
À mesure que la collecte s’intensifie, le récit insiste sur la fragilité des milieux et la difficulté de transporter des sujets vivants sur de longues distances. Les personnages expérimentent des caisses, des matériaux amortissants et des procédés d’aération sommaires pour limiter pertes et contaminations, tout en luttant contre la chaleur, le froid et les chocs. Des contraintes pratiques et des considérations morales s’invitent: ce qui se prélève ici alimentera ailleurs des collections et des marchés. Les divergences entre l’urgence commerciale et la prudence naturaliste nourrissent la tension dramatique, jusqu’aux derniers obstacles logistiques qui conditionnent la suite et la perspective du retour.
Au-delà de l’attrait de l’aventure, Le Chasseur de plantes s’inscrit dans la veine de vulgarisation naturaliste de son époque: observation, classification, usages économiques, et récit de formation. Reid met en scène l’apprentissage de jeunes lecteurs face à une nature à la fois ressource et mystère, tout en reflétant les présupposés du XIXe siècle sur l’exploration et l’échange. Le roman interroge les rapports entre savoir et profit, risque et précaution, solitude et coopération. Par sa description des circulations botaniques et des métiers de la collecte, il a laissé une résonance durable, inspirant curiosité et prudence, sans dépendre d’un dénouement spectaculaire.
Contexte historique
Le Chasseur de plantes, traduction d’un roman d’aventures de Thomas Mayne Reid, paraît au milieu des années 1850, pendant l’apogée victorien. Reid (1818–1883), écrivain irlando-américain, s’inscrit dans une littérature destinée à la jeunesse qui popularise l’exploration scientifique. Le cadre général du livre rejoint un moment où la Grande-Bretagne, via l’Empire des Indes, consolide son emprise sur l’Asie du Sud. L’imprimé bon marché, la presse illustrée et les collections de cabinet alimentent un public avide de récits géographiques. Dans ce contexte, l’expédition botanique devient un ressort narratif majeur, mêlant instruction naturaliste et exotisme, sans dissocier science, commerce et empire.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la « chasse aux plantes » associe savants, horticulteurs et administrateurs coloniaux. Des institutions comme le Royal Botanic Gardens, Kew (réformé à partir de 1841 par William J. Hooker), le Muséum national d’Histoire naturelle à Paris et la Compagnie des Indes orientales britannique organisent collectes, herbiers et échanges de graines. L’invention des caisses de Ward (années 1830) facilite le transport d’espèces vivantes par mer. Les motivations sont scientifiques (taxonomie, acclimatation) et économiques: thé, épices, fibres, colorants. Ce vaste réseau logistique et bureaucratique fournit les modèles et les enjeux qui sous-tendent les péripéties du roman.
L’Himalaya, cadre de nombreux épisodes du roman, est alors au cœur des explorations britanniques. La Compagnie des Indes orientales patronne la Great Trigonometrical Survey (1802–1871), qui cartographie sommets et vallées. Entre 1848 et 1850, Joseph Dalton Hooker parcourt le Sikkim et le nord-est indien; détenu brièvement par les autorités sikkimaises en 1849, il publie ses Himalayan Journals en 1854, très diffusés dans le monde anglophone. Ses collectes fixent des milliers d’espèces et popularisent les paysages, les climats et les difficultés logistiques de la région. Ce corpus documentaire fournit un horizon réaliste auquel se mesure l’imaginaire d’aventure de Reid.
En Inde britannique, des jardins botaniques servent de pivots scientifiques et économiques. Le Calcutta Botanic Garden (fondé en 1787, dirigé par William Roxburgh puis Nathaniel Wallich) et le jardin de Saharanpur structurent la collecte, l’étiquetage et l’expédition des plants. L’Assam devient dans les années 1830–1840 une zone clé pour la culture du thé, après l’identification d’une variété locale de Camellia sinensis et la mise en place de plantations sous supervision coloniale. Ces circulations de semences, d’herbiers et de savoirs, relayées par des correspondances avec Kew, encadrent les trajectoires des « chasseurs » et donnent sens aux dangers et aux triomphes botaniques évoqués par le livre.
Les expéditions reposent sur des réseaux locaux: guides Lepchas, porteurs, chasseurs, interprètes et artisans qui connaissent passes, plantes et saisons. Hooker cite explicitement ses collecteurs lepchas et bhoutias, soulignant l’apport des nomenclatures vernaculaires et des itinéraires indigènes. Politiquement, la frontière himalayenne est régulée par des traités (comme Sugauli, 1816, entre la Compagnie et le Népal) qui limitent ou conditionnent l’accès des Européens. Les permissions, tributs et tensions diplomatiques déterminent les routes possibles. L’œuvre reprend cet arrière-plan de dépendance concrète à l’expertise locale et à la bonne volonté des autorités montagnardes, rendant crédible la progression d’un récit centré sur la collecte.
Le XIXe siècle himalayen expose voyageurs et collecteurs à des risques bien documentés: pluies de mousson, crues, avalanches, mal aigu des montagnes, gel et maladies endémiques des piémonts comme la malaria. Les infrastructures sont limitées en altitude; les ponts de lianes, les sentiers à flanc de ravin et les cols enneigés compliquent le transport. Scientifiquement, il faut sécher et presser les spécimens, ou maintenir vivantes des plantes fragiles jusqu’aux jardins d’accueil, sous peine de pourriture. Ces contraintes techniques et climatiques, décrites dans les journaux d’exploration, fournissent la matière concrète des épisodes de danger et de débrouillardise mis en avant par Reid.
La vogue éditoriale des récits géographiques pour la jeunesse façonne la réception de Reid. Installé aux États-Unis puis à Londres, vétéran de la guerre américano-mexicaine (1846–1848), il écrit des romans d’aventures didactiques destinés à instruire autant qu’à divertir. Ses ouvrages popularisent notions de géographie, d’histoire naturelle et de technologies simples, en insistant sur l’observation et l’ingéniosité. Dans d’autres titres, il critique l’esclavage, attestant un intérêt pour les enjeux moraux de son temps. Cette combinaison de pédagogie scientifique et de préoccupations éthiques informe la manière dont Le Chasseur de plantes présente la collecte comme un apprentissage discipliné et un idéal de curiosité.
À la lumière de ce contexte, l’ouvrage reflète la fascination victorienne pour la classification, la mesure et l’appropriation de la nature, portées par des réseaux impériaux et des institutions savantes. En mettant en avant herbiers, nomenclatures et transplantations, il illustre l’idéologie de l’« amélioration » qui justifie les circulations de ressources. Dans le même temps, l’intrigue reconnaît la dépendance pratique à l’expertise et à l’hospitalité locales, ce qui nuance l’image d’une maîtrise européenne sans faille. Sans s’attarder sur la politique, le livre immortalise les gestes de la collecte et, ce faisant, expose les logiques de la science impériale qui structurent son époque.
Le Chasseur de plantes
PAR
LE CAPITAINE MAYNE-REID
TRADUIT DE L’ANGLAIS
PAR Mme HENRIETTE LOREAU
ET ILLUSTRÉ DE12VIGNETTES
PARIS
LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, No77
1868
Droits de propriété et de traduction réservés.
LECHASSEUR DE PLANTES[1]
IUN CHASSEUR DE PLANTES.
«Qu’est-ce qu’un chasseur de plantes? Nous avons[2q] bien entendu parler des chasseurs de lions, d’ours[3q], de renards, de buffles, de chasseurs d’enfants, mais[4q] jamais d’un chasseur de plantes.
–Attendez-donc! j’y suis: les truffes[2] sont des végétaux, on emploie des chiens pour les trouver, et celui qui les recueille prend le nom de chasseur de truffes; c’est peut-être cela que veut dire le capitaine.
— Non, cher enfant, vous n’y êtes pas ; mon chasseur de plantes n’a rien de commun avec celui qui fouille la terre pour y chercher des truffes. Sa mission est plus noble que celle de contribuer simplement à flatter les caprices de la gourmandise[5q]. Toutes les nations civilisées tiennent du chasseur de plantes des richesses et des bienfaits sans nombre; vous-mêmes, enfants, vous lui devez bien des jouissances, et il a droit aux élans de votre gratitude. C’est grâce à lui que vos jardins offrent un aspect si brillant et[6q] si varié; la pivoine[3] éclatante, les dahlias aux vives couleurs qui composent les massifs, l’élégant camélia[4] que vous admirez dans la serre, les rhododendrons, les géraniums, les kalmias, les jasmins, les azalées, et mille autres fleurs qui décorent vos parterres, vous ont été données par le chasseur de plantes[1q]. C’est grâce à son courage et à sa persévérance que la froide et brumeuse Albion possède aujourd’hui plus d’espèces de fleurs que les contrées les plus favorisées du globe, et que les plantes de ses collections nombreuses surpassent en beauté celles qui font la gloire de la vallée de Cachemire. Une grande partie des arbres qui embellissent le paysage, la plupart des arbustes qui forment nos bosquets, et que nous regardons avec tant de plaisir de la fenêtre de nos maisons de campagne, nous ont été rapportés par le chasseur de plantes. Sans lui nous n’aurions jamais goûté à la plupart des fruits et des légumes dont nos tables sont couvertes et qu’il a rapprochés de nos lèvres; ayons donc pour ses travaux toute la reconnaissance qu’ils méritent.
«Et, maintenant, je vais vous dire ce que j’entends[7q] par un chasseur de plantes: c’est un homme dont la profession consiste à recueillir des fleurs et des plantes rares[8q]; en un mot, un homme qui consacre à cette occupation tout son temps et toute son intelligence. Ce n’est pas ce qu’on appelle un botaniste pur e simple, bien qu’il soit indispensable qu’il connaisse la botanique. Jusqu’à présent, on l’a désigné sous le nom de botaniste collecteur[9q]. Mais, en dépit du rang modeste qu’il occupe aux yeux du monde scientifique, et malgré la supériorité qu’affecte à son égard le savant de cabinet, j’ose affirmer que le plus humble de ces collecteurs de plantes a rendu plus de services au genre humain que le grand Linnée[5] lui-même. Ce sont des botanistes d’une véritable valeur, ceux-là qui non-seulement nous ont fait connaître les richesses du monde végétal, mais encore nous en ont apporté les échantillons les plus rares et nous ont fait respirer des fleurs qui, sans eux, seraient restées inconnues et verseraient inutilement leurs parfums au désert.
«Ne croyez pas, toutefois, que je veuille rabaisser le mérite incontestable des hommes éminents qui s’occupent de théorie botanique; je suis bien loin d’en avoir l’intention; mais je désire mettre en lumière des services que le monde, suivant moi, n’a pas suffisamment appréciés; services que lui a rendus et que lui rend encore chaque jour le collecteur botaniste, que nous appellerons chasseur de plantes.
«Il est possible, même, que vous n’ayez jamais su qu’il existât une pareille profession; et pourtant il s’est trouvé des hommes qui l’ont suivie, dès l’enfance des sociétés humaines. Dans le siècle de Pline[6], il y avait de ces collecteurs qui enrichissaient les jardins d’Herculanum[7] et de Pompéi[8]. Les mandarins chinois, les sybarites de Delhi et de Cachemire avaient à leur service des chasseurs de plantes à une Poque où nos ancêtres, encore à demi barbares, se contentaient des fleurs sauvages de leurs forêts natales. En Angleterre même, la profession de collecteur de plantes est bien loin d’être nouvelle; son origine remonte à la découverte de l’Amérique, et les Tradescant[9], les Bartram[10], les Catesby[11], qui furent de véritables chasseurs de plantes, occupent un rang vénéré dans les annales de la botanique. C’est à eux que nous devons les tulipiers, les magnolias, les érables, les platanes, les acacias, et une foule d’autres arbres que nous admirons dans nos futaies et qui se partagent maintenant, avec nos espèces indigènes, le droit d’occuper notre territoire.
«Mais à aucune époque le nombre des chasseurs de plantes n’a été aussi grand qu’aujourd’hui. Croiriez-vous qu’il y a des centaines d’individus qui, à l’heure où nous sommes, parcourent le monde afin de remplir les devoirs de cette noble et utile carrière? Toutes les nations de l’Europe sont représentées parmi eux: les Allemands s’y trouvent en plus grand nombre; mais on y compte des Suédois aussi bien que des Russes, des Français, des Danois, des Anglais, des Espagnols, des Portugais, des Suisses, des Italiens. On les rencontre s’acquittant de leur mission, dans tous les coins de la terre: au fond des gorges les plus désertes des montagnes Rocheuses, au milieu des prairies sans limites, dans les vallées profondes des Cordillères, au sein des forêts inextricables de l’Amazone et de l’Orénoque, dans les steppes de la Sibérie, les jungles du Bengale, au versant glacé de l’Himalaya[12]; enfin dans tous les lieux sauvages où l’inconnu les attire et où la solitude leur promet de nouvelles richesses végétales. Errant sans cesse, le regard attaché sur chaque feuille, examinant chaque plante, gravissant les montagnes, parcourant les vallées, escaladant les rocs, traversant les maréc[24]ages, passant à gué les torrents, se frayant un chemin au milieu des fourrés épineux, dormant en plein air, souffrant de la faim, de la soif, le chasseur de plantes ne brave pas seulement l’ardeur du soleil ou l’âpreté de la bise, il expose sa vie au milieu des bêtes féroces et des hommes, parfois plus cruels que les bêtes.
«Figurez-vous maintenant les obstacles qu’il surmonte et les épreuves qu’il subit.
«Mais quel motif, me direz-vous, peut déterminer ces hommes à choisir une profession qui offre à la fois tant de misères et de périls?
«Cela dépend; les motifs sont variés: quelques-uns sont entraînés par l’amour de la science, les autres par la passion des voyages; il en est qui sont envoyés au loin par de nobles patrons ou de savants florimanes. Un grand nombre est chargé de faire de nouvelles découvertes pour les jardins publics et royaux; enfin, quelques autres, d’un nom plus obscur ou possédant des ressources plus limitées, sont aux gages de certains pépiniéristes, et n’en ont pas moins de zèle pour leur profession chérie.
«Vous seriez-vous imaginé que cet homme grossièrement vêtu, qui demeure au bout de la ville, dans une maison bien noire et chez qui vous achetez vos oignons de tulipes et de jacinthes, vos griffes de renoncules et vos graines de reines-marguerites, avait à sa solde un état-major de botanistes, occupés sans cesse à fouiller le monde dans tous les sens, afin de découvrir un arbre ou une fleur qui puissent charmer nos yeux ou accroître nos richesses?
«Ai-je besoin de vous répéter que la vie de ces botanistes est remplie d’aventures périlleuses? Vous en jugerez vous-mêmes lorsque vous aurez lu quelques-uns des chapitres suivants, où vous trouverez une partie des dangers qui assaillirent un jeune chasseur de plantes nommé Karl Linden. pendant une expédition qu’il fit dans la chaîne gigantesque des monts Himalaya.»
IIKARL LINDER.
Notre chasseur de plantes était bavarois[10q]. Né sur les confins de la haute Bavière[13] et du Tyrol[14], Karl était loin d’avoir une illustre origine, car son père était simplement jardinier; mais il avait été bien élevé et possédait une instruction profonde, ce qui, à l’époque où nous vivons, a plus de valeur que tous les titres de noblesse. Le fils d’un jardinier, un jardinier lui-même, peut être un gentleman[15][11q], car ce titre, qui est parfois si mal porté, a plusieurs acceptions, et Karl Linden se montrait gentleman dans le véritable sens du mot: il était bon, généreux, plein de délicatesse et d’honneur[12q]; il possédait, malgré son humble naissance, une éducation parfaite, son père, qui ne savait même pas lire, avait l’esprit ambitieux; il connaissait par expérience combien il est fâcheux de ne rien savoir, et il avait résolu d’épargner à son fils le malheur d’être ignorant.
L’instruction est considérée, dans la plus grande Partie de l’Allemagne, comme un bienfait inappréciable: on y recherche avec ardeur tous les moyens d’apprendre qui sont mis généreusement à la portée de tout le monde, et les Allemands sont peut-être les hommes les plus instruits de l’univers. Ils joignent à un savoir étendu l’énergie patiente et laborieuse du travailleur, et c’est à cela qu’ils doivent la place qu’ils ont acquise dans les arts et dans les sciences. Je ne veux pas dire que la nation allemande soit la plus intelligente de toutes les nations de l’Europe, mais seulement l’une des plus instruites.
Arrivé à l’âge de dix-neuf ans, Karl Linden trouva que son pays ne jouissait pas d’une liberté suffisante[13q]. Il se jeta dans une de ces conspirations enthousiastes et mal combinées qu’ourdissent de temps à autre les étudiants allemands.
Bientôt exilé à Londres, ou plutôt réfugié, comme on dit aujourd’hui, Karl Linden se demanda ce qu’il allait devenir; sa famille n’était pas assez riche pour lui envoyer de l’argent; d’ailleurs, son père n’approuvait pas sa conduite et le traitait de rebelle. Karl n’avait donc rien à espérer des siens, du moins jusqu’à l’époque où la mauvaise humeur de son père serait complétement apaisée.
Mais d’ici là comment faire? Notre exilé trouvait l’hospitalité anglaise un peu froide; il était libre, mais cela signifiait qu’il pouvait se promener dans les rues et y mendier son pain.
Heureusement qu’il s’avisa d’une ressource à laquelle tout d’abord il n’avait pas songé. Il lui était arrivé plusieurs fois de travailler au jardin avec son père; il savait bêcher, planter, semer, ratisser; il connaissait la taille des arbres et la manière de propager les fleurs[14q], il était au courant de tous les soins qu’il faut donner à l’orangerie, à la serre chaude, et entendait à merveille la confection des couches; il possédait en outre des connaissances très-étendues sur les plantes, dont il savait le nom, les caractères, les propriétés: il avait eu l’occasion de s’en instruire de très-bonne heure chez un homme fort riche, dont son père cultivait les jardins; et depuis lors, ayant pris goût à cette étude attrayante, il était devenu un savant botaniste.
Il pensa donc qu’il pourrait trouver de l’ouvrage comme garçon jardinier[15q]; cela vaudrait toujours mieux que de vagabonder par les rues et de mourir de faim, au milieu des richesses dont il était environné
Bien résolu de mettre ce projet à exécution, notre jeune réfugié alla frapper à la grille de l’un de ces magnifiques jardins-pépinières qui sont si nombreux à Londres; il raconta son histoire, et fut immédiatement employé.
L’intelligent propriétaire du jardin où travaillait Karl ne fut pas longtemps sans découvrir les connaissances que possédait le jeune Bavarois; il avait besoin d’un botaniste plein de zèle et de savoir, et Karl était précisément l’individu qu’il lui fallait. De nombreux chasseurs de plantes parcouraient pour son compte l’Amérique du Nord et celle du Sud, l’Afrique et l’Australie; mais il désirait se procurer des fleurs de l’Himalaya, dont on se préoccupait beaucoup, en raison des admirables végétaux que venaient de découvrir, dans ces montagnes, les voyageurs Royle[16] et Hooker[17].
Depuis quelque temps on avait décrit les pins magnifiques, les arums, les différentes espèces de bambous, les magnoliers et les rhododendrons qui croissent dans les vallées de l’Himalaya; un certain nombre étaient déjà même parvenus en Europe; ces plantes faisaient fureur, et notre pépiniériste cherchait un jeune homme instruit et courageux qu’il pût envoyer dans les Indes.
Ce qui rendait encore ces arbres splendides plus précieux et plus intéressants pour tout le monde, c’est qu’originaires d’une contrée qui, par l’effet de son élévation, possède une température analogue à celle du nord de l’Angleterre, ils pouvaient supporter facilement les intempéries de notre climat.
Plus d’un chasseur de plantes fut donc, à cette époque, chargé d’explorer la chaîne des Alpes indiennes, qui, par son étendue, offre un champ sans limites aux plus vastes découvertes; et parmi ces chasseurs de plantes se trouvait Karl Linden, le héros de notre histoire.
IIIGASPARD, OSSARO ET FRITZ[20].
Un navire .anglais transporta notre chasseur de plantes à Calcutta, d’où ses bonnes jambes le conduisirent au pied de l’Himalaya. Il aurait pu employer, pour s’y rendre, une foule d’autres moyens; car je ne crois pas qu’il y ait de pays au monde où l’on ait autant de manières différentes de voyager[18] que dans l’Inde; mais les fonds dont Karl Linden pouvait disposer n’étaient pas ceux du trésor public: c’était l’argent d’un particulier, et ses appointements étaient assez minimes. Toutefois ce n’était pas une raison pour que ses découvertes en fussent moins importantes. Plus d’une expédition pompeusement organisée est revenue sans avoir fait autre chose que de gaspiller à tort et à travers les sommes considérables qui lui avaient été allouées, tandis que les voyages les plus remarquables, en fait de découvertes, ceux qui ont le plus contribué aux progrès des sciences et de la géographie, ont été faits avec la plus grande simplicité de moyens; l’exploration des côtes septentrionales de l’Amérique, par exemple, après avoir coûté des sommes énormes et la vie de tant de braves marins, ne s’est exécutée que par la compagnie de la baie d’Hudson, qui, pour obtenir ce résultat, n’a eu besoin que de l’équipage d’une barque, et a dépensé moins d’argent pendant toute la durée du trajet, que nos vaisseaux qui l’avaient précédée dans cette voie n’en absorbaient en huit jours.
Notre chasseur de plantes voyage donc de la façon la plus modeste[16q]; pas d’équipement dispendieux, pas d’escorte inutile, d’animaux ni de valets. Il se dirige à pied vers les monts de l’Himalaya[17q] et compte bien les gravir et traverser leurs vallées rocailleuses, sans avoir recours à d’autres porteurs que ses jambes infatigables.
Cependant il n’est pas seul: Karl est accompagné de son frère Gaspard, l’être qu’il aime le mieux au monde[18q], de Gaspard qui a été le rejoindre en exil, et qui partage maintenant ses travaux et ses dangers.
Il y a peu de différence entre eux sous le rapport de la taille, bien que Gaspard ait deux années de moins que son frère; mais l’étude n’a pas entravé sa croissance; il arrive de ses montagnes, et son corps vigoureux, son teint frais et vermeil, contrastent vivement avec la pâleur et les formes grêles du botaniste.
Le costume des deux frères est en rapport avec leurs habitudes et leur physionomie. Karl est vêt des couleurs sombres et de l’habit du savant, tandis que sa tête est couverte du chapeau des patriotes. La toilette de Gaspard est beaucoup moins sérieuse; il porte un frac vert, une casquette de la même nuance, un pantalon de velours marron se boutonnant sur le côté, et des bottes à la Blücher.
Tous les deux sont armés d’un fusil et pourvus de divers objets qui forment l’équipement du chasseur. Le fusil de Gaspard est une canardière à deux coups; celui du botaniste, une longue carabine qui porte le nom de yager ou chasseur suisse.
Gaspard a passé sa vie à chasser[19q]. A peine sorti de l’enfance, il a fréquemment suivi le chamois sur les cimes vertigineuses des Alpes tyroliennes. Il est peu lettré, car il n’est pas resté longtemps à l’école; mais il serait difficile de rencontrer un tireur plus habile. Joyeux et brave, Gaspard a la vue perçante, l’oreille fine, le coup d’œil juste, le pied ferme, la jambe infatigable, et Karl n’eût pas trouvé, du nord au sud de l’Inde, un meilleur auxiliaire.
Mais ce n’est pas tout, un autre personnage accompagne encore le botaniste. Il faudrait un chapitre pour vous dépeindre Ossaro, que nos deux frères ont engagé comme guide, et Ossaro a bien assez de valeur pour qu’on fasse son portrait d’une façon détaillée; mais nous laisserons à ses actes le soin de le faire connaître. Qu’il me suffise de vous dire qu’Ossaro est un Hindou aux proportions admirables, au teint brun, aux grands yeux noirs, à la chevelure épaisse, qui caractérisent les hommes de sa nation. Il appartient à la classe des Shikarri[19]s, c’est-à-dire à celle des chasseurs, et l’on ne trouverait pas, dans tout le Bengale, un tueur de tigres plus courageux et surtout plus adroit. Sa renommée s’étend au loin, car il possède un courage, une force et une activité bien rares parmi ses indolents compatriotes: aussi est-il vanté, glorifié par tout le monde; c’est un véritable héros, le Nemrod de sa province.
Son costume n’a rien de commun avec celui des deux frères: il se compose d’une tunique de cotonnade blanche; d’un large pantalon serré à la taille par une écharpe écarlate, d’un turban à carreaux et d’une paire de sandales. Quant à son équipement de chasse, il ne diffère pas moins de celui de Gaspard que son turban ne s’éloigne de la casquette du Bavarois. Le Shikarri tient une lance légère à la main, il porte sur le dos un arc de bambou et un carquois rempli de flèches; un long couteau est passé dans sa ceinture; il a au côté un sac de cuir, et différents objets, suspendus à son cou et retombant sur sa poitrine, complètent son attirail.
Ossaro n’a jamais gravi les monts Himalaya; il est né dans la plaine, c’est un chasseur des jungles; s’il a été engagé par notre collecteur de plantes, ce n’est pas en qualité de guide proprement dit, puisqu’il ne connaît pas la région qu’il s’agit d’explorer; c’est comme ingénieux camarade, habitué à coucher en plein air, connaissant mieux qu’un autre les difficultés et les ressources de la vie errante au milieu des solitudes de l’Inde, et pouvant, par cela même, être d’un grand secours à nos deux voyageurs et les assister d’une manière efficace dans leur périlleuse entreprise.
Et puis cette expédition comble les vœux du Shikarri; de la plaine éloignée qu’il parcourait chaque jour, il regardait depuis longtemps cette chaîne de Himalaya qui renferme les montagnes les plus élevées du globe; il contemplait ces dômes couverts de neige, ces pics étincelants qui s’élèvent au-dessus des nuages, et il avait rêvé plus d’une fois au bonheur d’y aller faire une de ces belles parties de chasse qui durent toute une année; mais l’occasion ne s’était jamais présentée pour lui de parcourir ces montagnes imposantes, et ce fut avec une joie bien vive qu’il accepta les offres du jeune botaniste et qu’il se joignit aux deux frères pour les accompagner dans leur expédition.
Enfin, un quatrième individu, également de la race des chasseurs, complète notre petite caravane; il a autant de passion pour la chasse qu’Ossaro ou Gaspard: c’est un beau chien de la taille d’un grand dogue, mais dont les oreilles pendantes et la robe noire marquée de taches fauves annoncent que, loin d’être de la famille des mâtins, il fait partie de celle des limiers; ses mâchoires puissantes ont étranglé plus d’un cerf et ont eu raison de maint sanglier des forêts bavaroises. C’est un chien valeureux que le bel et bon Fritz[20q]; il appartient à Gaspard, qui connaît son mérite, et qui ne le donnerait pas pour le meilleur éléphant des quatre présidences de l’Inde.
IVEST-CE DU SANG?
Karl avait terminé le jour même ses arrangements avec le Shikarri, et c’était la première fois qu’ils voyageaient ensemble. Nos trois compagnons avaient sur le dos leur havre-sac et leur couverture; et comme ils se servaient à eux-mêmes de domestique et de bête de somme, ils n’emportaient, en fait de bagages, que le strict nécessaire. L’Hindou marchait un peu en avant, Karl et Gaspard cheminaient côte à côte, à moins que le sentier ne fût trop étroit pour le permettre; derrière eux trottinait Fritz qui, néanmoins, de temps en temps, passait à l’avant-garde et rejoignait Ossaro, comme si son instinct lui avait dit que c’était un grand chasseur; ils avaient eu, du reste, fait bientôt connaissance, et Fritz était déjà le favori du jeune Hindou.
Tandis qu’ils cheminaient gaiement, l’attention de Gaspard fut attirée par quelques taches qui, à différents intervalles, rougissaient la surface du sentier; ces taches étaient humides, très-apparentes sur l’herbe rase que foulaient nos voyageurs, et il y avait certes peu de temps qu’elles avaient été faites.
«C’est du sang, fit observer Karl, dont ces taches avaient également frappé les yeux.
–Je n’en doute pas, répondit Gaspard; mais je me demande s’il vient d’un homme ou seulement d’un animal.
–Ce doit être celui d’une bête, et d’une bête assez volumineuse, reprit le jeune botaniste, car il y a plus d’un mille que j’ai remarqué la première de ces taches; il faut que ce soit un éléphant qui ait été blessé; il aurait été impossible à un homme de supporter, sans s’évanouir, une pareille hémorrhagie.
–Mais nous verrions la piste de l’éléphant, répliqua Gaspard; je n’en aperçois aucune, ou du moins je n’en vois pas qui soit fraîche, et le sang qui nous occupe est nouvellement répandu.
–Tu as raison, Gaspard; on ne voit aucune empreinte qui annonce le passage d’un éléphant ou d’un chameau; et pourtant d’où viennent ces taches, évidemment sanglantes?»
A cette question, les deux jeunes gens parcoururent du regard le sentier qui se déployait devant eux, dans l’espoir d’y trouver l’explication de l’énigme qu’ils cherchaient à comprendre. Ils ne découvrirent que l’Hindou, qui marchait avec aisance et qui ne paraissait pas avoir la plus légère blessure. Ce n’était point le sang du Shikarri, on ne pouvait en douter.
Cependant, comme les deux frères allaient détourner leurs regards, qui s’étaient fixés sur le guide, ils virent Ossaro pencher la tête et cracher sur l’herbe du sentier; ils remarquèrent la place où avait dû tomber la salive du chasseur, et quel ne fut pas leur étonnement quand, arrivés à cet endroit, ils observèrent une tache rouge exactement pareille à celles dont ils cherchaient l’origine! Cette découverte les fit trembler pour l’existence de leur guide; on ne pouvait pas s’y méprendre, Ossaro crachait le sang.
Voulant s’assurer du fait, Karl et Gaspard attendirent quelques instants; mais à peine avaient-ils fait cent pas, qu’ils virent un nouveau crachat rouge s’élancer des lèvres du malheureux jeune homme.
«Pauvre Ossaro! s’écrièrent-ils; sa mort est prochaine; comment pourrait-il vivre après avoir perdu tant de sang!»
Et les deux frères coururent après leur guide en lui criant de s’arrêter.
L’Hindou pirouetta sur ses talons et regarda les deux Bavarois avec un air de surprise; il détacha son arc et posa une flèche sur la corde, s’imaginant qu’ils étaient poursuivis par un ennemi quelconque. Fritz lui-même avait pris l’alarme en entendant crier son maître, et l’avait rejoint immédiatement.
«Ossaro, mais qu’avez-vous? s’écrièrent à la fois Karl et Gaspard.
–Moi, Sahibs! moi rien avoir, je vous assure.
–Mais qu’est-ce qui vous fait mal, à quel endroit souffrez-vous?
–Moi, pas souffrir; moi, pas malade. Pourquoi, seigneurs, demandez cela?
–Comment se fait-il que vous crachiez du sang?» répondit Karl en désignant les taches rouges que l’on voyait sur l’herbe.
En entendant ces mots, l’Hindou éclata de rire, non pas avec l’intention de manquer de respect aux jeunes Sahibs, mais parce qu’il lui fut impossible de s’en empêcher, lorsqu’il vit la méprise où les deux frères étaient tombés.