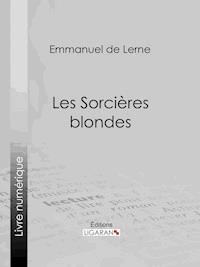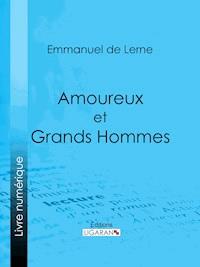
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le lendemain d'un de ses plus grands triomphes, Molière écrivait au savant Jacques Rohault : « Mon cher monsieur, je suis le plus malheureux des hommes : ma femme ne m'aime pas. » La vie de Molière est toute dans ce mot-là. — Eh quoi ! Ce protégé du grand roi, que la foule salue comme le premier acteur de son temps, qui crée à lui seul la comédie et l'élève à des hauteurs qu'elle n'a point atteintes depuis."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le lendemain d’un de ses plus grands triomphes, Molière écrivait au savant Jacques Rohault : « Mon cher monsieur, je suis le plus malheureux des hommes : ma femme ne m’aime pas. »
La vie intime de Molière est toute dans ce mot-là.
Eh quoi ! ce protégé du grand roi, que la foule salue comme le premier acteur de son temps, qui crée à lui seul la comédie et l’élève à des hauteurs qu’elle n’a point atteintes depuis ; ce poète, vivant au milieu de tout un monde d’œuvres immortelles, recherché des plus illustres personnages de ce siècle illustre, dont le nom fait tant de bruit, excite tant de sympathies, soulève tant de haines ; cet homme riche, jeune encore, estimé, aimé, il est malheureux ! Pourtant la cour et la ville admirent et applaudissent ce rieur de génie, qui, sa vie durant, flétrit les vices, critique les petitesses, fustige les ridicules de la société. Quelle gaieté profonde, quel geste moqueur, quelle voix mordante ! Quel joyeux compagnon et quel habile comédien ! Joyeux et habile comédien ? Oui. Mais l’homme ? – Quand les habits d’emprunt sont dépouillés, le fard essuyé de la joue, quand Orgon, Arnolphe, Chrysale, Sganarelle, Mascarille sont descendus du théâtre, que les lumières sont éteintes, que les portes sont fermées, qu’ils s’en vont tous contenant avec peine leurs éclats de rire, lui, Molière, il rentre seul dans sa demeure ; il se retrouve seul, tout seul, à son foyer ! Il cache sa tête dans ses mains ; il pleure en silence de vraies larmes. Qui voudrait le croire parmi ceux qui le voyaient tout à l’heure ? – Et la cause de cette immense tristesse, c’est que sa femme, – une coquette, une ingrate, un mauvais cœur ! – sa femme ne l’aime pas ; c’est que ce grand homme est raillé, insulté, bafoué par l’amour. Que de fois, au théâtre, son geste ou sa voix eussent révélé jusqu’à quel point il se jouait lui-même en paraissant sous le costume de personnages étrangers, s’il eût été possible de pénétrer en même temps au fond de l’âme et du ménage de ce pauvre comédien qui faisait rire ! Ne sait-il pas par lui-même tous les néants, toutes les faiblesses, toutes les contradictions, toutes les rechutes de la nature humaine ? Son amour trahi, il éclate dans ses œuvres ; on le retrouve dans ses épanchements intimes, dans les moindres actes de sa vie. C’est le vautour qui dévore et ne lâche pas sa proie. – Voilà pourquoi Molière souffre ; et ni les triomphes, ni la gloire, ni la fortune, ni les amitiés illustres ne le consoleront, « car il n’est point aimé. » Comme ce cri, jeté à travers les angoisses de son long martyre, comme ce mot, tracé avec le plus pur sang de son cœur, nous le fait aimer ! Et comme nous lui en voulons, à cette femme, de n’avoir rien compris à cette nature sublime et d’avoir rendu un pareil homme si malheureux ! –
Ce n’est pas le poète ou le comédien applaudi et souriant que je veux dire ; c’est cette pâle, mélancolique et grandiose figure qui souffre. Ce n’est point le masque, c’est le cœur ; ce n’est point l’écrivain, c’est le mari trompé qui écrit avec désespoir : « Je suis le plus malheureux des hommes : ma femme ne m’aime pas. »
Dans la rue Saint-Honoré, au coin de la rue des Vieilles-Étuves, s’élevait, vers 1622, une maison d’assez belle apparence. Sa façade était ornée d’anciennes sculptures, et le passant remarquait à l’angle un poteau sur lequel l’artiste avait représenté un pommier et des singes. On lisait sur l’enseigne : Au Pavillon des Singes. C’était la demeure d’un tapissier, valet de chambre du roi. Le magasin semblait vaste et en bon ordre ; de nombreux chalands l’emplissaient à toute heure. Un homme d’un âge mûr, sa femme, bonne et douce figure de mère, attentive, pâle et souffrante, se partageaient la besogne et répondaient aux acheteurs. Après le magasin venaient une cour spacieuse et un long corps d’hôtel.
Si nous pénétrons dans cette cour, nous y trouverons une dizaine de marmots de tout âge, se roulant sur le sable, se querellant, s’embrassant, pleurant, souriant, babillant, tout cela parfois en même temps. Dans un coin, assis dans un large fauteuil, un vieillard contemple complaisamment ces têtes brunes et blondes. De sa voix indulgente, il dirige les jeux et apaise les querelles ; comme un juge sur son tribunal, il reçoit les plaintes et rétablit la concorde ; il sourit au souvenir de ses jeunes années dont il revoit l’image. Souvent, et avec préférence, son regard s’arrête sur l’aîné de ces enfants. Celui-là n’est encore que dans sa dixième année ; son visage est doux, ses cheveux sont bruns et bouclés, ses yeux déjà mélancoliques et pensifs.
Cette famille est celle de Jean Poquelin le tapissier. Cette femme, près de lui, est la sienne. Ce vieillard, Louis Cressé, est son beau-père. L’aîné de ces enfants s’appelle Jean aussi ; plus tard, on le nommera Molière.
Jean Poquelin comptait plusieurs illustrations parmi les siens. Quelques-uns de ses parents étaient juges et consuls de la ville de Paris, fonctions importantes auxquelles étaient souvent attachés des titres de noblesse. Il avait épousé Marie Cressé, fille, comme lui, d’un tapissier. C’était une excellente femme, faite pour être mère ; aussi eut-elle neuf enfants. Du reste, dans cette famille, les enfants ne manquaient pas. Un frère de Molière, marié à Anne de Faverolles, en eut seize, et un de ses cousins, marié à Simone Gaudouin, en eut vingt.
Marie Cressé aimait tous ses enfants, mais c’était à l’aîné qu’elle accordait une légère préférence. Prévoyait-elle que celui-là jetterait sur sa race une gloire immortelle ? Non ; mais sa physionomie était si grave, si triste pour son âge, qu’elle en avait pitié. Et puis elle se sentait atteinte d’un mal dont elle devait bientôt mourir ; son mari prendrait sans doute une autre femme, et Jean, son fils, resterait le protecteur de toute cette petite famille, au milieu de laquelle elle ne serait plus. Et doucement, d’une voix caressante, elle s’efforçait de lui donner le goût du travail. – Poquelin s’y prenait d’une tout autre façon : il gourmandait Jean et le traitait de paresseux. La mère survenait, plaçait l’enfant sur ses genoux ; il pleurait, et Marie Cressé pleurait avec lui, tout en le sermonnant. Jean promettait de prendre goût à la besogne ; mais il avait beau faire, ce travail de marchand le rebutait. Le peu qu’on exigeait de lui, il s’en acquittait assez mal ; les grands registres lui faisaient horreur. Il était incapable même de garder la boutique.
Marie Cressé mourut en serrant la main de son mari, en embrassant ses enfants et les recommandant au bon Dieu. Jean avait alors dix ans, – il était né le 15 janvier 162 – Mieux que ses frères et sœurs, il comprit la perte qu’ils venaient de faire. Il alla se jeter tout en larmes dans les bras de son grand-père, qui pleurait aussi. Un an après, Poquelin se remariait avec Catherine Fleurette, à la paroisse de Saint-Germain-l’Auxerrois.
Depuis lors, les liens qui unissaient le vieillard et l’enfant se resserrèrent encore. Louis Cressé devint le confident, le consolateur, l’ami de Jean. Il l’aidait, en secret, à faire la besogne commandée par Poquelin ; il le conduisait à la promenade ; c’était son petit-fils chéri. Maintes fois il prenait sa défense contre Poquelin, et celui-ci murmurait que le grand-père lui gâtait Jean et que, les choses continuant ainsi, on ne ferait jamais rien de bon de cet enfant.
Louis Cressé avait une passion pour le théâtre. Dans l’espoir de rendre à Jean sa gaieté, il le conduisit, à l’insu de son père, à la comédie. Et, comme Jean parut enchanté de cette distraction et que le bonhomme souriait d’aise aux naïves réflexions, aux reparties et aux demandes de son fils, il ne manqua plus de l’emmener avec lui. Grâce à la discrétion de Jean, à l’habileté du grand-père, aux innocentes supercheries de ces deux enfants, Poquelin ignora quelque temps ces écoles buissonnières.
Le théâtre en vogue était alors celui de l’hôtel de Bourgogne. Les acteurs renommés s’appelaient Bellerose, Gautier-Garguille, Gros-Guillaume et Turlupin, dans la farce. Ce n’étaient pas là des modèles, il s’en fallait ; mais, tant bien que mal, ils jouaient encore la comédie. Bellerose créa les rôles de Cinna et du Menteur de Corneille. Les trois autres acteurs eurent un sort tragique. Gros-Guillaume, ayant osé contrefaire un magistrat sur la scène, fut arrêté. Il en ressentit une telle frayeur qu’il mourut. Et Gautier-Garguille et Turlupin, désolés de cette mort, expirèrent l’un et l’autre dans la même semaine que leur ami. Jean lui-même fut vivement affecté de la perte de ses acteurs favoris, et il en tomba presque malade.
Jean voulait tout savoir ; il interrogeait à tout propos son grand-père. Quel était le nom de celui-ci et le rôle de celui-là ? Il rêvait toute la nuit de comédie. Il se croyait sur les planches ; il jouait en présence de la foule, et la foule l’applaudissait. Durant le jour, au comptoir du magasin, il se montrait plus distrait que de coutume ; il répondait de travers aux demandes des acheteurs. Mais il examinait les gentilshommes et les belles dames que la renommée de Poquelin attirait au Pavillon des Singes ; il observait leurs manières, leur langage, et rien n’échappait à son esprit observateur. Il les examina si bien, que plus tard il s’en souvint et qu’ils se reconnurent eux-mêmes dans les œuvres de Molière.
Un soir, la ruse des deux écoliers fut découverte. À leur retour, ils trouvèrent Poquelin qui les attendait. D’une voix sévère, celui-ci ordonna à Jean d’aller se mettre au lit sur-le-champ, et, s’adressant à Louis Cressé :
– Mon père, je vous le demande, à quoi pensez-vous ? Et que voulez-vous que devienne Jean, si vous-même vous lui enseignez à courir les théâtres et à perdre son temps ? Comment sera-t-il capable de me succéder un jour ? et n’est-ce pas une honte pour nous tous d’avoir dans notre famille un mauvais sujet, paresseux, soucieux, rêveur et incapable de me servir en quoi que ce soit ?
– Mon ami, répondit le grand-père, vous aurez beau faire, Jean ne peut être jamais qu’un fort mauvais tapissier. La nature de cet enfant est rebelle au commerce. Je ne sais point encore quelle sera sa vocation, mais certainement elle n’est pas de rester ici. Son intelligence est grande, son désir d’apprendre le poursuit partout. Croyez-moi, renoncez à votre projet.
– Mais, à vous entendre, ne dirait-on pas que la position de son père n’est pas digne de ce jeune seigneur ? Et n’allez-vous pas me demander de l’envoyer au collège ?
– Précisément, j’allais vous le demander. Il pourra ensuite choisir une carrière en rapport avec ses goûts, et vous verrez que vous n’aurez pas lieu de vous en repentir.
On le pense bien, Poquelin jeta les hauts cris. Il fit un grand sermon sur l’école buissonnière en particulier, et un discours sur les avantages précieux du commerce en général. Il se débattit longtemps, exaspéré de voir prendre au sérieux une proposition qu’il n’avait faite que par ironie ; mais le grand-père tint bon ; et, de guerre lasse, le tapissier consentit à envoyer son fils comme externe au collège de Clermont, dirigé par des jésuites.
– Mon Dieu ! laissez donc faire, dit Louis Cressé vainqueur ; je ne parle point par orgueil, je ne me donne pas comme prophète, mais je vous réponds, moi, qu’il y a quelque chose à faire de cet enfant. Et qui saurait dire ce qu’il deviendra ?
Dès lors une nouvelle existence commença pour le jeune Poquelin. Délivré de tous les ennuis de la boutique, maître de son intelligence et de son temps, ses progrès dans l’étude furent rapides. Durant cinq ans, il alla au collège, revint à la maison, butinant partout, examinant chaque chose, travaillant aussi bien dans les rues que sur son banc, et tournant déjà de préférence son jeune esprit vers l’étude des hommes. Les jésuites louaient son travail, son application soutenue, tout autant que son caractère grave, facile, et son bon cœur toujours prêt à obliger ses amis.
Au collège de Clermont, Jean eut pour camarades plus d’un enfant dont le nom devint célèbre plus tard. Dans son cours se trouvaient Armand de Bourbon, prince de Conti, frère du grand Condé, et protecteur de Molière avant de donner tête baissée dans le jansénisme et de crier anathème contre les spectacles ; Henri Bernier, né à Angers, philosophe et voyageur, mais non parfait courtisan. Louis XIV lui ayant demandé quel était le pays qu’il préférerait habiter : « La Suisse ! » avait trop franchement répondu Bernier. Et puis c’étaient encore Hesnault, poète léger, maître de madame Deshoulières, et généreux défenseur de Fouquet ; et Chapelle, qui resta jusqu’à la fin avec Molière dans les termes de la plus grande intimité. Chapelle était bâtard. Il s’appelait Claude-Emmanuel Luillier, et avait pris son nom du village de la Chapelle, près de Paris, où il était né. Luillier, son père, maître des comptes et conseiller à Metz, était un original et trop adonné aux faciles plaisirs. Quand il partait pour aller se promener, il s’en allait jusqu’à Constantinople et y restait quatre ans. L’éducation qu’il donna à son fils fit de ce dernier, en bien des points, un trop fidèle imitateur de son père. Il nous reste de Chapelle des pièces de poésie fugitive et son Voyage avec Bachaumont. Nous le retrouverons à Auteuil.
Lorsque le cours d’humanité fut achevé, le père de Chapelle détermina Gassendi, l’antagoniste de Descartes, à enseigner la philosophie à son fils. Gassendi voulut bien admettre à ces leçons Bernier, Hesnault, Poquelin et ce fanfaron de Cirano de Bergerac. Chassé du collège de Beauvais, insubordonné avec ses maîtres, querelleur avec ses condisciples, mauvaise tête toute sa vie, Cirano était doué d’une intelligence prompte et d’un esprit étincelant de saillies. Dans la suite, il se fit dans le monde une réputation pour son humeur guerroyante. Il avait le nez mal fait, et ce défaut physique causa, dit-on, la mort de plus de dix personnes, « car il fallait mettre l’épée à la main aussitôt qu’on l’avait regardé. » Il disait de Montfleury père : « À cause que ce coquin-là est si gros qu’on ne peut le bâtonner tout entier en un jour, il fait le fier ! » À la suite d’une querelle avec cet acteur, Cirano lui défendit de monter sur le théâtre : « Je t’interdis pour un mois, » lui dit-il. Le lendemain Montfleury parut sur la scène pour y jouer son rôle accoutumé. Bergerac lui cria, du parterre, de se retirer ; sinon il allait lui couper les oreilles. Montfleury connaissait l’homme ; il fut contraint d’obéir. Le jeune Poquelin ne pouvait éprouver beaucoup de sympathie pour une semblable nature ; il conserva peu de rapports avec Bergerac ; il lui prit seulement deux scènes de son Pédant joué pour les introduire dans les Fourberies de Scapin. Molière disait, à cette occasion, qu’il prenait son bien partout où il le trouvait.
À dix-huit ans, Jean, privé de son grand-père qui était mort, moins que jamais disposé à suivre l’état de tapissier, toujours épris des spectacles, ne savait trop encore de quel côté le poussait sa vocation. En attendant, il s’en alla apprendre le droit à Orléans. Déjà, il paraît, la science du droit était réputée conduire à tout ; ou bien, comme aujourd’hui, quand on ne savait que faire, on se faisait avocat. Jean Poquelin embrassa-t-il avec courage l’étude de la jurisprudence ? devint-il enthousiaste de Cujas et de Justinien ? L’histoire ne le dit pas, et la suite de sa carrière nous autorise à croire qu’il n’était pas né pour être avocat, non plus que Diderot pour faire un jésuite, ou la Fontaine un oratorien.
En 1645, nous le retrouvons à Paris, courant les théâtres, lorsqu’il trouvait au fond de sa bourse un écu pour payer sa place au parterre, flânant un peu, rêvant beaucoup et cherchant sa voie. Et Poquelin le tapissier répétait souvent : « Pauvre grand-père ! je ne lui en veux pas, et Dieu ait son âme ! mais quelle belle éducation il a donné à mon fils ! et les beaux résultats que nous recueillons aujourd’hui ! » Si la bourse de Jean était complètement vide, il fallait bien renoncer à la comédie de l’hôtel de Bourgogne, et se contenter d’assister aux représentations que Bary donnait en plein vent sur le pont Neuf, ou bien encore à celles du célèbre Scaramouche.
Ce Scaramouche n’avait pas des antécédents de la plus haute moralité. Il était d’origine italienne et s’appelait Tiberio Fiurelli. Condamné, dans son pays, pour escroquerie, il prit la fuite, se fit saltimbanque, et, à peine arrivé en France, il trouva moyen de se faire présenter à Louis XIV. Aussitôt en présence du roi, il laissa tomber son manteau, parut en costume de comédie, avec son chien, son perroquet et sa guitare, et chanta des couplets italiens, accompagné de son chien et de son perroquet, habilement dressés à exécuter leur partie. La farce plut au jeune roi, qui garda toujours quelque bienveillance pour ce saltimbanque. Le grand art de Scaramouche consistait à se donner un soufflet avec le pied, talent dans lequel il excella jusque dans un âge très avancé. À la fin, las du métier, riche d’une douzaine de mille francs de rente, qu’il avait envoyés au fur et à mesure en Italie, il obtint la permission de retourner dans son pays. Mais, à son arrivée, le mari trouva sa place prise près de sa femme, et le saltimbanque sa fortune en grande partie dissipée. Force lui fut donc de repartir pour la France et d’avoir de nouveau recours à son industrie. Plus d’une fois, pendant sa carrière, il fut un rival gênant pour Molière, auquel il enlevait ses spectateurs. Mais, pour l’instant, Jean Poquelin, perdu dans la foule, assistait aux farces et aux lazzi des histrions du pont Neuf ; et quelque informes que fussent ces ébauches vulgaires de comédie, elles laissaient bien souvent le petit-fils de Louis Cressé s’en retourner rêveur.
Un jour que la pensée du théâtre le préoccupait davantage, il sortit de la foule en se frappant le front et se demandant pourquoi il ne se ferait pas lui-même comédien. Dominé par cette idée, laissant son esprit, peut-être déjà son génie, errer au milieu des horizons nouveaux, mais lointains et à demi voilés, il s’égara à travers les rues, et, quand il rentra le soir, fort tard, au logis, son parti était pris irrévocablement : Jean-Baptiste Poquelin serait comédien.
Paris renfermait, en ces temps-là, de nombreuses réunions d’acteurs de société. Jean se fit admettre dans une de ces réunions où les représentations étaient gratuites. Mais ce n’était pas là son compte. Il voulait gloire et profit. Il réunit donc ses compagnons, appelle à lui toute son éloquence, se ressouvient qu’il est avocat, fait un beau discours et enthousiasme ceux qui l’écoutent. Séance tenante, la troupe est organisée ; elle est jeune, vaillante, remplie de bon vouloir, d’audace, de persévérance ; elle fera son chemin. Et, pour commencer, elle s’intitule modestement l’Illustre Théâtre. D’abord, et tant bien que mal, plus mal que bien, elle joue aux fossés de la porte de Nesle, et puis au port Saint-Paul, et s’établit enfin dans le jeu de paume de la Croix-Blanche, au faubourg Saint-Germain.
Depuis ce moment, Jean-Baptiste Poquelin disparaît ; Molière commence. En effet, ce fut alors qu’il prit ce nom qu’il a toujours conservé. Il n’y eut dans ce changement ni orgueil blâmable, ni fausse honte de la condition de ses pères. Il n’y eut, de la part de Jean, que délicate affection pour les siens.
À la nouvelle de la détermination du fils aîné du tapissier, la famille entière des Poquelin jeta les hauts cris. Tous, père, frères, beaux-frères, cousins, parents et alliés jusqu’à la dixième génération, réunis en chœur, fulminèrent l’anathème contre l’enfant prodigue. Quelle honte et quelle misère que l’un des leurs déshonorât ainsi un nom jusque-là sans tache ! qu’il traînât ce nom sur les planches ! qu’il s’alliât avec des histrions et des baladins bannis de la société, rejetés du sein de l’Église, relégués parmi les impies ! C’était à en verser des larmes de sang et à se pendre, tous et d’un seul coup, de désespoir et de douleur.
Jean changea son nom et persista dans son dessein. On fit auprès de lui plus d’une tentative pour le ramener à la raison ; on lui envoya même le maître d’école qui l’avait quelque peu, – bien peu, – instruit dans son enfance. L’ambassadeur fit un long sermon en tous points conforme aux instructions qu’il avait reçues et orné des plus belles fleurs de son éloquence. Il parla longtemps, employant tour à tour l’insinuation et la douceur, les menaces et les larmes. Molière l’écouta patiemment jusqu’au bout ; et, quand le maître eut fini, Molière, relevant sa belle tête calme et inspirée, répondit à tous les arguments. Insensiblement, et en abordant l’art auquel il avait résolu de vouer sa vie, il s’anima, ses yeux s’enflammèrent, sa parole s’émut ; il prit la défense du théâtre tel qu’il le concevait, il traça son plan, le développa ; et bientôt le vieux maître, lui aussi ému et troublé, écoutait, applaudissait, et, sans y songer, messager infidèle, disait à Molière qu’il avait bien fait, et que c’était pour lui-même une gloire d’avoir formé un semblable élève. Il s’en retourna donc vaincu, épris davantage de la comédie qu’il aimait déjà, et, plus tard, il vint assister aux représentations de celui qu’il nommait toujours avec orgueil son disciple.
Quant à la famille Poquelin, elle ne pardonna jamais à Jean. Aucun de ses membres ne consentit à venir le voir jouer ses plus beaux chefs-d’œuvre ; ils refusèrent également les entrées libres qu’il leur offrit à diverses reprises. Un cousin fit dresser un arbre généalogique, et Molière n’y fut pas compris. Seuls, un de ses beaux-frères et son père, – un père pardonne toujours ! – consentirent à signer son acte de mariage. Si Marie Cressé eût encore vécu, qui sait ce qu’il fût advenu ? Cette mère qu’il aimait tant, par ses prières et par ses larmes, n’eût-elle pas obtenu ce que les colères et les malédictions ne purent arracher ? Le fils du tapissier Poquelin fût-il monté sur le théâtre ? Jean se nommerait-il aujourd’hui Molière ?
La troupe de l’Illustre-Théâtre ne resta pas longtemps à Paris. Les troubles de la Fronde éclatèrent, et, les plus hauts personnages de France s’étant mis eux-mêmes à jouer, dans la rue une véritable comédie, Molière dut baisser pavillon devant d’aussi célèbres comédiens, qui lui enlevaient tous ses spectateurs. Il partit, avec sa troupe, pour la province.
La voici donc en marche à travers les villes et les campagnes, à la recherche de l’inconnu, de l’art de la vraie comédie, à la découverte d’un monde nouveau, la troupe de l’Illustre-Théâtre, la joyeuse et vagabonde caravane. Ils s’en vont un peu au hasard et à la grâce du bon Dieu, ces insouciants bohémiens. Ils sont jeunes, toujours contents ; ils narguent les misères de la vie et la pauvreté ; ils voyagent à petites journées, à pied, à cheval, par le coche ou en charrette. Les femmes, les premières, ont droit à la voiture. Entassées pêle-mêle avec les bagages, les costumes, les décors, elles sont alertes, bien portantes, non sans un grain de beauté provoquant, et toutes fortes en gueule, comme Toinette et Martine, comme Nicole et Marinette. Elles chantent pour tromper la longueur du chemin ; eux, ils rient en écoutant leurs chansons. Si le gîte et la table sont mauvais, ils se consolent au cabaret. Et puis ce sont à chaque pas les accidents variés du voyage, les rencontres imprévues, les sites des campagnes, les badauds des villages, les haltes sous les grands arbres ou près de l’eau claire des ruisseaux, la pluie, le vent et le soleil.
Ils n’allaient point en berline avec une suite nombreuse et l’aide de camp pour prévenir le maître hôtelier, – comme on fait aujourd’hui. Mais, oh ! les heureuses gens, les honnêtes saltimbanques ! Enfants sans chagrin, sans préoccupation, sans ordre, vrais enfants sans soucis sous la conduite du génie. Et, quand ils arrivent dans la ville, vite, qu’on établisse le théâtre sur les tréteaux, dans les granges, sous le hangar, même en plein vent, comme Scaramouche et Arlequin. Vite, qu’on se dépêche. Et ceux-ci tirent les décors du tombereau, celles-là raccommodent les costumes, remettent à neuf, en deux coups d’aiguille, les jupes, les broderies et les pourpoints. Un autre prépare et mouche les chandelles ; l’orchestre, composé d’une flûte et d’un violon, repasse ses symphonies, et le farceur de la troupe s’en va par les rues, annonçant, au son du tambour, que la représentation va commencer. La foule accourt, la salle est pleine. Que vont-ils jouer ? Les comédiens eux-mêmes ne le savent pas bien. Ils discutent, ils perdent le temps ; le public s’impatiente. De sa voix grave, le maître impose le silence. Chacun jouera un peu à sa guise, le mieux qu’il pourra, et les spectateurs seront indulgents. Ces spectateurs ne portent ni habits noirs, ni cravates blanches, ni gants, ni lorgnons ; ce ne sont point des gourmets, une solide nourriture leur suffit. Alors Mascarille, ce valet fripon qui frise habilement la corde sans jamais être pendu, ce mauvais sujet, ce faiseur de vilains tours, Mascarille entre en scène, et la foule de se pâmer et d’applaudir. Et les autres rôles sont à l’avenant. Comédiens et comédiennes jettent l’esprit en plein air, sans façon, tel qu’il leur vient, à l’improviste ; ils rient d’un bon gros rire, et le public rit avec eux. Les actrices ne se montrent ni mignardes ni coquettes ; les coups de bâton tiennent lieu de coups d’éventail ; Célimène est bien loin encore. Et de toutes parts ce ne sont que franches joies, un peu lourdes, un peu saupoudrées de gros sel et d’épices, de véritables farces italiennes, solides et toutes rondes, et d’épaisses gaillardises.
La recette est-elle abondante, on soupe copieusement et gaiement à l’auberge. Si la recette est mauvaise, on soupe pauvrement et gaiement toujours ; on a médiocre repas et pauvre lit, mais on garde bon espoir.
Ainsi cheminait la troupe de Molière. Et, tandis qu’elle dormait, chantait, buvait et se querellait, lui, le chef, le père de ces enfants, il songeait à eux. Il ne riait pas, il veillait à tout ; car il faut qu’ils vivent, ceux dont il s’est chargé, il faut qu’ils vivent avec lui et par lui ; sa responsabilité est grande ; il doit penser au présent, au soir, au lendemain, à l’avenir. Et ce n’est qu’après avoir pourvu à toutes choses qu’il peut donner quelques instants de liberté à son esprit. Durant la route, au milieu du pêle-mêle et du bruit, la figure grave et reposée, le front méditatif, le sourire triste, les yeux fixés à l’horizon, il cherche comment l’art de la comédie sortira un jour de ces ébauches informes, de ces tentatives grotesques. Il créera un genre ; mais, pour créer en ce monde, il faut souffrir beaucoup, longtemps, de cette souffrance chronique, intérieure, inaperçue du vulgaire, et qui souvent fait mourir. De ces hauteurs, redescendant aux détails de la réalité, il regarde, il examine, il fixe les physionomies et les caractères dans sa mémoire ; il s’empare de l’homme, il étudie son esprit, il sonde son cœur pour le montrer un jour tel qu’il l’a surpris, tel qu’il est. Et, malgré les soucis et les privations qui viennent l’assaillir au début, jamais il ne regrette, au point de vue du bien-être du moins, la vie facile et toute faite du Pavillon des Singes.
Parmi les acteurs de la troupe de l’Illustre-Théâtre, on comptait du Parc dit Gros-René, Béjart aîné, Béjart cadet et Madeleine leur sœur. Ces Béjart étaient fort nombreux, et, leurs parents les ayant laissés pousser au hasard, ils avaient tous embrassé la carrière dramatique. Les frères Béjart gardèrent toujours les plus nobles sentiments d’honneur et de loyauté. Molière les aimait et leur accordait toute sa confiance. À la mort de Béjart aîné, tombé malade au milieu d’une représentation de l’Étourdi, donnée au Louvre en présence du roi, en 1659, le théâtre demeura fermé pendant douze jours. Lors de la retraite de Louis Béjart, la troupe de Molière constitua en sa faveur une pension viagère. Ce fut la première pension établie au profit d’un sociétaire se retirant.
Quant à Madeleine Béjart, c’était une femme vive, spirituelle, entendue dans les soins du ménage et de l’administration théâtrale, mais d’une humeur acariâtre et d’un caractère entier et difficile. Elle portait alors dans ses bras un tout petit enfant, une jeune sœur à laquelle elle tenait lieu de mère. La figure blanche et rose d’Armande, occupant le centre de la voiture au milieu des visages épanouis des comédiens, présentait un gracieux contraste avec son entourage. Molière s’attacha d’une façon toute paternelle à la petite Armande. Il voulait que rien ne lui manquât ; il veillait sur elle comme sur sa propre fille ; il ne pouvait la quitter un seul jour ; il la berçait sur ses genoux pour l’endormir, et demandait qu’on fît silence pour ne pas troubler son sommeil. Près d’elle, il quittait son air mélancolique ; il devenait enfant pour la distraire. Et, en grandissant, Armande lui rendait en caresses naïves toute son affection. Elle tendait vers lui ses bras ; il obtint son premier sourire. Lorsqu’elle commença à parler, elle l’appela d’elle-même et sur-le-champ « son petit mari ; » et Molière fut heureux de ce nom d’amitié trouvé par Armande.
Deux jeunes cœurs vivant sous le même toit se persuadent aisément qu’ils sont faits pour s’entendre et pour marcher de compagnie. Tout en contemplant l’enfant qu’elle tenait dans ses bras, Molière ne put s’empêcher de jeter un regard sur Madeleine. Mademoiselle Béjart se vantait de ne compter parmi ses amants que des gentilshommes. Elle voulut bien déroger en faveur de Molière, et le faire succéder dans son intimité au comte de Modène. Cette liaison fut loin d’apporter le bonheur au chef de l’Illustre-Théâtre, et plus d’une fois il eut à souffrir du caractère de mademoiselle Béjart ; mais il se consolait en se voyant plus rapproché et à toute heure de la petite Armande, qui chaque jour grandissait, plus mutine, plus spirituelle, plus gentille, avec ses yeux vifs et son frais visage, et son sourire doux et provoquant.
Molière séjourna à Bordeaux, où le duc d’Épernon, gouverneur de la Guyenne, lui fit un bienveillant accueil. De là il se rendit à Vienne en Dauphiné et à Nantes ; dans cette ville il eut à subir une terrible concurrence de la part d’un montreur de marionnettes, Vénitien de naissance et nommé Segalla. Après quatre ans de courses à travers le Midi, il revint à Paris en 1650. Le prince de Condé, son ancien condisciple du collège de Clermont, le reçut à merveille et l’invita plusieurs fois à venir jouer la comédie à son hôtel. Molière ne s’établit pas définitivement à Paris, soit qu’il ne fût pas encore suffisamment préparé à paraître devant le roi, soit qu’il eût rencontré plus d’obstacles qu’il ne s’y attendait. Il retourna en province. À Lyon, il lit représenter pour la première fois l’Étourdi. Cette comédie eut un immense succès ; elle valut à l’auteur une telle renommée, que le théâtre rival du sien fut obligé de fermer ses portes, et les acteurs de ce théâtre vinrent se joindre à Molière. De ce nombre étaient mademoiselle du Parc et mademoiselle de Brie.
Mademoiselle du Parc était une véritable beauté, grande, bien faite, mais froide, orgueilleuse et jalouse. Molière en fut épris, et s’efforça longtemps de le lui cacher. Mais, sa passion croissant à mesure qu’il voulait la combattre, il en fit l’aveu à mademoiselle du Parc, qui le repoussa fièrement. Molière se montra profondément affecté, et confia sa douleur à mademoiselle de Brie, avec laquelle il forma dès lors une solide amitié. Sans pouvoir supporter la comparaison avec mademoiselle du Parc, mademoiselle de Brie était cependant jeune, aimable, douce de caractère, douée d’un excellent cœur, et très jolie plutôt que belle. Elle plaignit Molière et le consola. Ce rôle de confidente ne pouvait durer longtemps ; au titre d’ami en succéda bientôt un autre, souvent moins solide, mais plus doux. Quelques mois après, mademoiselle du Parc, témoin des applaudissements accordés à Molière et de sa gloire naissante, se repentit de s’être montrée trop dédaigneuse, et son orgueil souffrit de la préférence accordée par Molière à mademoiselle de Brie. Elle tenta à diverses reprises de reconquérir la place qui lui semblait due. Molière ne voulut être ni infidèle ni ingrat envers celle dont il était tendrement aimé et justement apprécié, et refusa l’amour que mademoiselle du Parc lui offrait. Néanmoins, comme elle s’acquittait parfaitement de ses rôles, il continua à lui confier les plus importants de ses comédies.
Désormais la troupe de Molière n’est plus cette troupe bohémienne du premier voyage. Partout on l’appelle, on l’applaudit, on met à sa disposition des chariots pour transporter ses bagages. Molière passe à Avignon, à Gignac, où sa valise lui est volée ; à Narbonne, à Montpellier, et le prince de Conti veut se l’attacher comme secrétaire.
– Non, monseigneur, répond-il, je n’accepte point l’honneur que vous voulez me faire ; chacun doit rester à sa place et à son rang. Je suis, dit-on, un passable comédien ; je pourrais être un fort mauvais secrétaire. D’ailleurs, puis-je quitter ceux qui m’environnent, puis-je les abandonner ? Monseigneur, ce sont mes enfants, je suis leur père, leur guide, je dois vivre avec eux et comme eux. Je ne les quitterai qu’à ma mort. Ils m’ont suivi partout, ces pauvres gens. Qui me remplacerait auprès d’eux ? Il ne faut pas être ingrat. Ne m’en veuillez pas, monseigneur, et permettez-moi de continuer de mon mieux mon métier.
À Pézenas, on montre encore un grand fauteuil de bois appelé le fauteuil de Molière. Chaque samedi, jour du marché de cette ville, on prétend qu’il se rendait chez un barbier du coin nommé Gily, où il passait l’après-midi. Là, les habitants et les étrangers venaient livrer leurs visages au rasoir habile du barbier ; on y racontait, on y recueillait les nouvelles. Assis à l’écart, dans le célèbre fauteuil, Molière écoutait et regardait, observant chaque chose, dont il faisait ensuite son profit.
À Gignac, M. de Laurès, consul de la ville, avait fait établir sur la place une fontaine avec une inscription latine. Les oisifs et les curieux, qui ne la comprenaient guère, se livraient, en face de cette inscription et avec la vivacité méridionale, à mille critiques et quelquefois à des injures contre le consul qui venait de rendre un service réel à la cité. Molière, passant par là, fut mis au courant de la discussion, et proposa de graver les deux vers suivants, qui ne pouvaient manquer d’être compris de tous :
On ajoute que M. de Laurès, mécontent de la conduite de ses compatriotes, fit graver sur la fontaine les vers de Molière.
Enfin, après de nombreuses excursions dans toute la France, à Grenoble, à Rouen, etc., Molière obtint l’autorisation de s’établir à Paris. Paris, alors comme aujourd’hui, était le but de quiconque sentait germer en soi une idée, une ambition ou du génie. Ces pérégrinations de douze années n’avaient été, dans la pensée de Molière, qu’une étude, qu’un essai, que le prélude de sa vie d’artiste. Il appelait de tous ses vœux les plus ardents l’instant où il se trouverait digne de paraître devant la cour et la ville, en face du grand roi. Maintenant sa troupe est formée ; il compte lui-même trente-six ans : l’heure est venue d’essuyer la lie de vin qui barbouille le visage de l’histrion, de dépouiller sa livrée, de revêtir l’habit brodé d’Alceste, de donner à ses vaillants camarades le vaste théâtre qu’il leur a promis. Le temps de vagabondage sur les grandes routes est terminé ; Molière ne veut plus dire à sa troupe : « Je ne comprends pas comment des personnes d’esprit prennent du plaisir à ce que je leur donne ; mais je sais bien qu’à leur place je n’y trouverais aucun goût. » Assez comme cela de farces et de vieil esprit français jeté en plein vent et en gros sous à la foule des bourgeois. Il faut être de son siècle, qui est le grand siècle. Si le saltimbanque a du génie, qu’il le prouve. Que chacun salue chapeau bas le profond écrivain et l’habile comédien. Allons, Gros-René, Mascarille, place à don Juan, à Harpagon, à Tartufe, au Misanthrope ! place à Molière !
Grâce à la protection de Mazarin et du prince de Conti, Molière s’installe à la salle du Petit-Bourbon, située vis-à-vis du cloître Saint-Germain-l’Auxerrois. Ce théâtre n’occupait alors, à Paris, que le troisième rang après ceux de l’hôtel de Bourgogne et du Marais. Louis XIV lui permit de prendre, pour lui et les siens, le titre de troupe de Monsieur. Secondé par ses anciens acteurs, et en outre par Jodelet l’Épy, du Croisy, qui créa avec talent le rôle de Tartufe, Lagrange, cœur parfait, ami fidèle, il commença à doter la France de cette suite de chefs-d’œuvre, la plus solide gloire de notre théâtre. Il se montre tout à coup poète, dramaturge, moraliste, satirique. Aucun ridicule ne lui échappe, ni dans la société, ni dans le cœur de l’homme. Il les fouette tous jusqu’au sang. Ce sont d’abord les Précieuses ridicules, critique mordante de l’hôtel de Rambouillet, ce cénacle de beaux esprits livrés aux dissertations frivoles, métaphysiques, puérilement raffinées, et qui abandonnaient au vulgaire l’art de parler d’une façon intelligible, dit la Bruyère. L’extravagance du faux goût, l’absence du naturel, étaient portées alors, par des femmes belles, distinguées et spirituelles, aux limites les plus extrêmes. La comédie de Molière eut un immense succès ; la foule accourait de vingt lieues à la ronde, et un vieillard s’écriait du parterre : « Courage, Molière, voilà la bonne comédie ! »
Loret, un brave homme qui ne comprenait pas toute la portée de l’œuvre de Molière, et qui pourtant ne manquait pas d’esprit, parle ainsi de la représentation des Précieuses ridicules, à laquelle il assista :
(Lettre du 6 décembre 1659)
L’année suivante, la salle du Petit-Bourbon fut démolie pour les constructions de la colonnade du Louvre. Le roi autorisa Molière à s’établir au Palais-Royal ; et, en attendant que tous les apprêts de la nouvelle salle fussent terminés, la troupe de Monsieur donna plusieurs représentations chez différents seigneurs de la cour. Elle joua, entre autres, chez Mazarin, le 26 octobre 1660, l’Étourdi et les Précieuses. Le ministre, malade, allait bientôt mourir. Un théâtre fut improvisé dans sa chambre à coucher, au Louvre. Il était étendu sur sa chaise, et le roi se tenait debout derrière lui. Mazarin fit remettre aux acteurs mille écus.
Successivement Molière écrit l’École des Maris, qui fait oublier l’insuccès de Don Garcie de Navarre ; les Fâcheux, représentés à Vaux, au milieu de la fête sans pareille que Fouquet, la veille de sa ruine, offrait à Louis XIV, et l’École des Femmes, la Princesse d’Élide, le Misanthrope, Tartufe, l’Avare, le Mariage forcé, etc. On rapporte que, dans cette dernière pièce, il eut en vue une assez bizarre aventure arrivée au chevalier de Grammont. Contraint de s’éloigner de France, le brillant chevalier s’en était allé distraire ses ennuis sur les bords de la Tamise, et mademoiselle Hamilton, touchée de ses bonnes grâces et le prenant en pitié, lui avait accordé ses faveurs, non pas sans que Grammont ne lui eût de son côté promis de l’épouser. Mais, sitôt qu’il eût obtenu l’autorisation de rentrer en France, le chevalier s’enfuit sans mot dire et gagna en poste la ville de Douvres. Il songeait à s’embarquer, lorsqu’il vit accourir les deux frères de miss Hamilton qui lui criaient : « Chevalier de Grammont, n’avez-vous rien oublié à Londres ? – Pardonnez-moi, messieurs, répondit le chevalier, surpris désagréablement de cette rencontre ; j’ai oublié d’épouser votre sœur, et j’y retourne avec vous pour terminer cette affaire. »
Obligé de diriger sa troupe, de faire tour à tour l’éducation dramatique de chacun de ses acteurs, d’apprendre ses rôles, de passer ses soirées au théâtre, de remplir son service de tapissier valet de chambre du roi, de haranguer le parterre – ce qu’il faisait bien et volontiers, – de composer sans relâche, Molière, doué, il est vrai, d’une facilité de travail surprenante, trouve encore le temps de soigner sa rime toujours riche et heureuse, et de mériter les justes louanges de Boileau.
À cette époque, nul homme ne semble plus digne d’envie. Son existence est glorieuse. Entouré d’amitiés puissantes, il frappe à son gré marquis, barons, chevaliers, médecins ignorants, mauvais poètes, faux dévots. Comme auteur, il est sans égal ; comme acteur, les bravos l’accueillent chaque soir. Il est maître, il règne comme le roi et à côté du roi ; et pourtant il se dit le plus malheureux des hommes. Encore une fois, – sa femme ne l’aime pas.
Armande avait grandi sous les yeux de Molière, dans sa maison, où les femmes n’étaient déjà que trop nombreuses. On y voyait Madeleine Béjart, conservant des droits que son ancienne intimité avec le directeur de l’Illustre-Théâtre lui avait donnés, et dont elle usait et abusait avec hauteur. Molière s’était promptement aperçu qu’il ne trouverait pas dans Madeleine les qualités de cœur qu’il rêvait et cette affection dévouée près de laquelle il souhaitait si fort de pouvoir abriter son existence agitée. Il s’était réfugié vers mademoiselle de Brie, toujours calme, bonne, indulgente, mais dont la présence irritait l’humeur querelleuse de sa rivale. Molière n’avait pas le courage de se séparer de l’une ou l’autre de ces deux femmes ; et souvent sa demeure devenait le théâtre de scènes violentes qui lui enlevaient toute sérénité d’âme. Habile à découvrir les passions et les travers d’autrui, censeur redoutable, il se laissait dominer lui-même par les faiblesses du cœur, et, si c’était encore de la comédie, c’était une comédie triste, navrante et désolée.
Il se consolait de toutes ces misères par les soins qu’il donnait à l’éducation d’Armande. Armande était devenue une jeune fille de seize ans. Elle avait une belle voix, elle chantait avec goût l’italien et le français, et savait admirablement, à l’aide de sa coiffure et de sa toilette, faire ressortir tous les avantages que la nature lui avait accordés. Au dire de Molière lui-même, elle avait les yeux petits, mais pleins de feu, brillants, perçants, et les plus touchants du monde ; sa bouche était grande, mais pleine de grâce et amoureuse ; sa taille n’était pas élevée, mais aisée et bien prise ; nonchalante dans son parler et sa démarche, elle savait s’insinuer dans les cœurs par la grâce souple de ses manières. Rien de fin, de délicat, de capricieux, comme sa conversation et son esprit ; d’original et de distingué comme sa toilette ; enfin, toutes choses lui allaient à merveille, « car tout sied bien aux belles ; on souffre tout des belles. »
Avec les conseils d’un pareil maître, Armande fit de rapides progrès dans l’art auquel elle était destinée et qu’elle avait aimé de bonne heure. Molière, la trouvant suffisamment préparée pour ses débuts, écrivit à son intention le petit rôle de Léonore de l’École des Maris. Il était impatient et fier de montrer son élève à ce public, confident, sans s’en douter, de tous les drames de la vie intime du grand comédien, et auquel il racontait, le soir, sous des noms supposés et au milieu d’intrigues et de récits imaginaires, ses douleurs, ses joies, jusqu’à ses propres faiblesses, qu’il ne méconnaissait pas.
Le public fut de l’avis du maître. En apercevant Armande, il la trouva charmante, avec la fraîcheur et la naïve coquetterie de ses seize ans. Elle fut applaudie, encouragée, et plus d’un des seigneurs de la cour jeta sur elle un regard où la bienveillance se mêlait déjà à un tout autre sentiment. À la fête de Vaux, elle représenta, dans le prologue, la nymphe chargée de commander aux autres divinités, celle qui les évoque de leurs marbres et les invite à divertir Sa Majesté. Dans la pièce, elle remplit le rôle d’Orphise, et Molière celui d’Éraste, amoureux d’Orphise.
Tout en applaudissant à ces heureux débuts dont il était fier, Molière remarqua pourtant l’aisance précoce, la coquetterie, les tendres œillades, les allures dégagées de son élève. Il sentit comme un pressentiment de l’avenir pénétrer dans son âme ; il songea que ce précieux trésor pouvait devenir la proie des gentilshommes à la mode ; qu’un autre allait peut-être lui voler un bien si longuement, si tendrement protégé. Il eut peur ; il devint jaloux.
Car l’affection de Molière s’était modifiée à mesure qu’Armande avait grandi. À l’enfant il avait donné protection et amitié ; à la jeune fille il donnait son cœur. Contre Madeleine il avait bien souvent pris en père sa défense ; maintenant il voulait la défendre en amant. Il l’aimait avec toute la puissance de sa nature ardente et dévouée. Jamais, quoi qu’on lui pût dire, quoi qu’elle lui fit souffrir, il ne parvint à ne plus l’aimer.
Depuis longtemps il caressait en secret une douce pensée : Armande serait sa femme. Il s’était chargé lui-même de l’élever comme il comprenait que devait l’être une jeune fille. Il ne l’avait pas quittée ; il savait ses qualités et ses défauts. Quel rêve réalisé : trouver enfin un cœur qui répondit au sien ! Quelle calme vie de travail, sans préoccupations et sans soucis, il allait mener ! Quel repos dans le bonheur !
On lui disait bien, et il se disait lui-même, lorsque son projet de mariage fut définitivement arrêté, qu’Armande avait dix-sept ans et qu’il en avait quarante ; qu’elle semblait coquette et recherchait le plaisir. Était-il prudent d’épouser cette jeune fille ? saurait-il exclusivement occuper le cœur d’Armande, distraire son esprit, lui, ce grand rêveur, qui ne rit qu’au théâtre, et reste sombre tout le jour ? Il comprend mieux que personne les infortunes conjugales des mariages mal assortis, il s’en est moqué vingt fois dans ses comédies. Qu’il se tienne donc sur ses gardes, qu’il examine et y réfléchisse mûrement. Mais, à tant de bonnes raisons Molière répondait : « Je connais Armande, je l’ai trouvée enfant parmi les bagages des saltimbanques ; je l’ai élevée comme Ariste de l’École des Maris élève Léonore, sans soucis, sans contrainte. Aujourd’hui encore son choix est libre, et si elle consent à devenir ma femme, les quelques imperfections de la jeune fille auront bientôt disparu en face d’une vie sérieusement rangée, des devoirs quotidiens, de la raison, de l’affection et de la reconnaissance. »
Ainsi répondait-il, en se berçant d’illusions, ce cœur trop confiant. Et, tout à l’heure, quand il faudra la flétrir, cette femme, car elle aura manqué à tous les devoirs, à tous les sentiments d’une âme honnête, vous n’oublierez pas, vous plus calmes et qui ne tiendrez pas la plume, que Molière eut sa part de torts, qu’il tenta presque l’impossible et fut imprudent.
Il l’épousa donc le 20 février 1662, à Saint-Germain-l’Auxerrois, en présence de Poquelin son père, de son beau-frère André Boudet et de Madeleine Béjart. C’était le jour du Lundi-Gras, jour des gaietés et des folies, et qui semblait déjà de mauvais augure pour ce pauvre mari, dont la femme devait tant aimer à se divertir.
Molière était alors dans toute la vigueur de l’âge et du talent. Son œil était noir, sa moustache brune, fine et retroussée, son visage inspiré. Mademoiselle Poisson, femme du comédien de ce nom, trace ainsi le portrait du mari d’Armande : « Il n’était ni trop gras, ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite ; le port noble, la jambe belle ; il marchait gravement, avait l’air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts, et les divers mouvements qu’il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l’égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux ; il aimait fort à haranguer, et, quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu’ils y amenassent leurs enfants, pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. » Quant à l’acteur, mademoiselle Poisson dit encore : « La nature lui avait refusé ces dons extérieurs si nécessaires au théâtre, surtout pour les rôles tragiques. Une voix sourde, des inflexions dures, une volubilité de langue qui précipitait trop sa déclamation, le rendaient, de ce côté, fort inférieur aux acteurs de l’hôtel de Bourgogne. Il se rendit justice, et se renferma dans un genre où ses défauts étaient plus supportables. Il eut même bien des difficultés pour y réussir et ne se corrigea de cette volubilité, si contraire à la belle articulation, que par des efforts continuels qui lui causèrent un hoquet qu’il a conservé jusqu’à la mort et dont il savait tirer parti en certaines occasions. Pour varier ses inflexions, il mit le premier en usage certains tons inusités qui le firent d’abord accuser d’un peu d’affectation, mais auxquels on s’accoutuma. Non seulement il plaisait dans les rôles de Mascarille, de Sganarelle, d’Hali, etc. ; il excellait encore dans les rôles de haut comique, tels que ceux d’Arnolphe, d’Orgon, d’Harpagon. C’est alors que, par la vérité des sentiments, par l’intelligence des expressions et par toutes les finesses de l’art, il séduisait les spectateurs au point qu’ils ne distinguaient plus le personnage représenté d’avec le comédien qui le représentait. Aussi se chargeait-il toujours des rôles les plus longs et les plus difficiles. » Enfin, dit un journal du temps, « il était tout comédien, depuis les pieds jusqu’à la tête. Il semblait qu’il eût plusieurs voix ; tout parlait en lui ; et, d’un pas, d’un sourire, d’un clin d’œil et d’un remuement de tête, il faisait plus concevoir de choses que le plus grand parleur n’aurait pu en dire en une heure. »
Quant à son existence, elle était grande et somptueuse. Riche, il dépensait largement sa fortune en réceptions et en bienfaits. Son domestique était nombreux, sa table ouverte à tout venant, et sa vie ne respirait en rien cette odeur nauséabonde du bourgeois sordide et mesquin, ou du parvenu sottement vaniteux.
Tel était l’homme auquel venait de s’unir Armande Béjart. Après son mariage, il suivit le roi à Saint-Germain avec sa femme, et les premières semaines furent heureuses. Molière ne demandait plus rien. Quant à Armande, à ce moment du moins, aima-t-elle Molière ? N’approfondissons pas trop cette question. Ne sondons pas trop avant son cœur. Puisque aucune preuve négative ne nous est connue, croyons qu’elle l’aima, ne fût-ce que par reconnaissance, par orgueil de porter un nom justement honoré et dont elle partageait la gloire.
Ces jours de bonheur ne furent pas de longue durée. À cette époque, les comédiennes étaient recherchées, courtisées par les plus grands seigneurs de la cour. C’était un insigne honneur d’être admis à leur petit lever, comme à celui du roi ; on les accablait de flatteries et de présents ; à tout instant on venait leur offrir son cœur. Armande eut bientôt de nombreux courtisans, et « dès lors, dit un contemporain, elle se crut duchesse. » Molière avait l’œil au guet ; et, un jour qu’Armande lui avait semblé plus coquette et plus étourdie que d’habitude, bien doucement, et la main dans la sienne :
– Mon Armande, lui dit-il, je t’ai connue petite enfant, je t’ai aimée dans ton berceau, j’ai reçu ton premier sourire et ton premier baiser. Plus tard, je n’ai jamais consenti à me séparer de toi ; je t’ai défendu contre tous, je t’ai instruite, et de mon mieux, dans mon art, dans ce bel art de la comédie. Et tu as répondu à toutes mes espérances. J’avais besoin d’une affection, moi triste par nature et songeur par métier. Je t’ai demandé d’unir ton sort au mien, et tu l’as bien voulu. Et maintenant, vois-tu, sans toi, la vie n’aurait plus pour moi aucun charme. C’est ton amour dont j’ai besoin. Tous les autres triomphes me sont indifférents. Pour toi, s’il le faut, je deviendrai moins rêveur, je serai plus joyeux. Je suis prêt à obéir à tous tes désirs. Parle ; mais laisse-moi ton affection, donne-moi ton cœur. Je ne pourrais vivre sans toi.
Il lui parlait ainsi, avec le langage du cœur, qui ne change pas comme le style ; et ses conseils étaient sages, indulgents, paternels. Elle aimait trop la toilette, la vie décousue et dépensière, les conversations futiles, le luxe, les flatteries et les propos galants ; elle devait prendre soin de la dignité de celui dont elle portait le nom, de sa dignité à elle-même. Elle était belle et adulée ; mais ils abandonnent bien vite, ces gens de cour désœuvrés, l’idole qu’ils adoraient la veille. Armande l’écoutait en silence. Elle devait se dire qu’il était bon comme un enfant, cet homme de génie ; elle se promettait peut-être de suivre ses conseils, et, le jour suivant, elle reprenait sa vie légère de coquetteries et de caprices.
Bientôt elle fut coupable. En 1664, la Princesse d’Élide fut représentée. Jusqu’ici, Armande n’avait paru que dans des rôles secondaires ; elle remplit cette fois le rôle de la princesse, et se montra depuis ce jour une comédienne de talent. « Elle n’était jamais inutile sur le théâtre, et jouait aussi bien lorsqu’elle se taisait que lorsqu’elle parlait, dit un comédien du temps. En scène, si elle retouchait ses cheveux, si elle raccommodait ses nœuds ou ses pierreries, ses petites façons cachaient une satire judicieuse et spirituelle ; elle entrait même par là dans le ridicule des femmes qu’elle voulait jouer. » Le succès qu’elle obtint acheva de lui tourner la tête ; elle fut enivrée, éblouie par les hommages que les plus grands seigneurs de la cour vinrent déposer à ses pieds. Parmi tous ces gentilshommes, ce fut le comte de Guiche vers lequel se tournèrent ses regards et son cœur, mais le comte de Guiche n’y prit pas garde. Le comte de Guiche était le fils du duc de Grammont, cet homme aimable par excellence et le plus agréable de la cour. Guiche, selon les uns, passait pour une nature assez indifférente à l’amour ; selon les autres, il gardait toute son affection pour madame Henriette d’Angleterre, femme de Monsieur. De dépit, Armande prêta l’oreille aux doux propos de M. de Lauzun – et de bien d’autres. L’abbé de Richelieu, neveu du cardinal, premier amant de mademoiselle Molière, dit-on, ou l’un des premiers, surprit une lettre d’Armande adressée au comte de Guiche et l’envoya à Molière. On a discuté sur les noms de ces amants. Qu’importent ici les noms ? mademoiselle Molère, – on ne donnait alors le titre de madame qu’aux personnes de qualité, – fut infidèle. Elle refusa désormais d’écouter aucun conseil ; elle passa ses journées au milieu des plaisirs et des fêtes. Souvent elle ne rentrait que fort tard dans la nuit.
La conduite d’Armande n’avait pu échapper à l’œil clairvoyant et jaloux de Molière. Pourtant il voulait douter encore de tant d’ingratitude, lorsque la lettre au comte de Guiche lui apporta la certitude de la trahison. Ce soir-là, il avait été plus applaudi que jamais. L’enthousiasme du parterre avait été à son comble ; les gentilshommes étaient venus en grand nombre le complimenter. La représentation terminée, il rentre dans sa demeure de la rue Saint-Honoré, seul, comme de coutume, et trouve la lettre d’Armande. Il la relit vingt fois ; son cœur est prêt à faillir. Mille pensées confuses se croisent dans son esprit. Il veut la chasser, ne plus la voir ; elle est indigne de tant d’affection. Et il écoute avec anxiété les bruits de la rue. – Armande ne revient pas. Pourtant, si elle revenait, maintenant, à l’instant même, faudrait-il perdre tout espoir, renoncer au rêve de toute sa vie, à une affection de vingt années, briser sans retour tout son bonheur ? Est-elle aussi coupable qu’elle le semble ? – Qu’elle revienne, qu’elle parle elle-même. S’il le faut, qu’elle se repente ; il est tout prêt à pardonner.
Mais les heures s’écoulent ; la nuit est noire, la pluie tombe par torrents, les bruits de la rue ont cessé. Ils ont tous regagné leur demeure, ces admirateurs assidus du grand comédien ; ils s’en sont allés en riant aux éclats, et ils se sont endormis en riant encore et en disant : « Quel habile homme que ce Molière ! » Et lui, il veille dans l’anxiété ; il ne rit pas, il pleure ; sa tête est en feu, ses jambes fléchissent, sa raison l’abandonne ; il tombe anéanti dans un fauteuil. Tout à coup des voix le réveillent en sursaut. Il écoute : un carrosse roule dans la rue ; il approche, il s’arrête. On se dit adieu et au revoir. Au revoir ! Ils se reverront ! Armande monte sans bruit ; elle veut encore épargner au moins au mari les apparences du déshonneur. Mais, sur la porte, Molière est devant elle. Il a essuyé les larmes de ses yeux, il a commandé à son cœur d’être calme ; on n’eût pu deviner tout ce qu’il venait de souffrir.
Alors, – que vous dirai-je que vous n’ayez prévu d’avance ? – Armande daigna, pour cette fois, chercher à se justifier. Elle avoua qu’elle éprouvait au fond du cœur, pour le comte de Guiche, une affection dont elle avait en vain tenté de se défendre ; qu’elle avait éconduit avec raillerie le chevalier de Lauzun ; qu’elle était restée honnête. Elle fut habile, pleine d’art et de mensonges. Elle fit des serments, elle versa des larmes.
Et lui, le profond connaisseur de la nature humaine, vous l’avez dit, il se laissa persuader comme un naïf enfant ; il pardonna. Il avait tant besoin et tant de désir de pardonner ! Il alla presque jusqu’à s’accuser de tous les torts ; il résolut de modifier sa vie, s’il le fallait, pour complaire à sa femme chérie, d’étudier plus attentivement les moindres désirs d’Armande pour les satisfaire tous, de chasser les soupçons, la jalousie, d’être indulgent à ces plaisirs si naturels à vingt ans et qu’on blâme injustement à quarante. Ainsi fit-il, et il crut avoir reconquis le bonheur !
Vain espoir ! Au bout de quelques semaines, Armande avait repris sa vie accoutumée ; elle courait à de nouvelles fêtes et à de nouvelles amours. Et, une fois sur la pente des plaisirs coupables, elle laissa de côté toute convenance et toute pudeur ; elle ne se donna plus la peine de dissimuler ; elle ne prit nul souci de sa propre dignité et de l’honneur de celui dont elle portait le grand nom ; elle resta étrangère à ses luttes, à ses soucis, à ses douleurs. Elle devint mère pour la seconde fois, et Molière se demanda, avec une poignante incertitude et la rougeur au front, si cet enfant était le sien. Les jours d’Armande s’écoulaient au milieu des applaudissements accordés à sa vanité, des paroles doucereuses, de la toilette, des galanteries. Elle menait grand train, jetait l’or à pleines mains. Le scandale de sa conduite était public ; Molière était la fable de la ville.