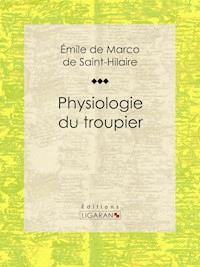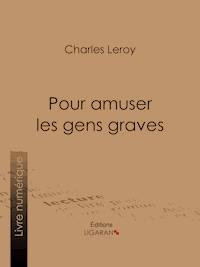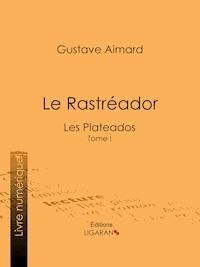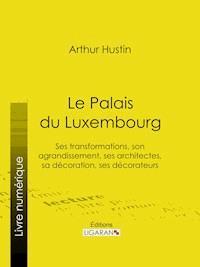Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "La détonation aiguë d'un revolver éclate soudain sous un bouquet d'arbres isolé au milieu de la plaine. Un Indien tombe, le crâne fracassé. – A cheval !.... gentleman, à cheval !... s'écrie d'une voix retentissante l'homme qui vient de faire feu. Ses deux compagnons accroupis sur le sol, au moment de cette agression inattendue, se sont levés précipitamment."
À PROPOS DES ÉDITIONS Ligaran :
Les éditions Ligaran proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Conséquences probables du meurtre d’un Peau-Rouge. – Chasseurs de bisons devenus gibier. – Le « colonel » Bill. – Au galop ! – Colonel et vacher tout à la fois. – Ce que c’est qu’un cow-boy. – La vie des pionniers d’avant-garde. – Chevaux sans cavaliers. – Friquet ouvre l’œil et passe capitaine. – Le Gamin de Paris refuse les honneurs et veut rester Monsieur Friquet. – Mais André ne peut s’empêcher de devenir major. – Le nouvel armement des Indiens de l’Ouest Américain. – Horrible spectacle.
La détonation aiguë d’un revolver éclate soudain sous un bouquet d’arbres isolé au milieu de la plaine. Un Indien tombe, le crâne fracassé.
– À cheval !… gentlemen, à cheval !… s’écrie d’une voix retentissante l’homme qui vient de faire feu.
Ses deux compagnons accroupis sur le sol, au moment de cette agression inattendue, se sont levés précipitamment.
Ils s’élancent d’un bond vers leurs chevaux, attachés tous trois au tronc grêle d’un mimosa, et se mettent en devoir d’enlever, le plus vite possible, les longes de cuir qui les retiennent.
– En selle ! et laissez-moi faire, reprend l’homme.
À peine ont-ils le temps d’enjamber chacun leur monture et de chausser les étriers, qu’il tranche en trois coups rapides de son bowie-knife les trois courroies, saisit sa bête aux crins, pousse un cri strident et se trouve en selle par une voltige exécutée en écuyer consommé.
Les chevaux, excités par ce cri bien connu, partent à fond de train à travers les herbes, pendant que les Indiens laissent échapper un long hurlement de désappointement et de fureur.
En même temps quelques coups de carabine retentissent, mais les balles, heureusement mal dirigées, passent en sifflant au-dessus de la tête des cavaliers.
Ceux-ci, par un geste machinal, mettent la main au Winchester à répétition qu’ils portent accroché à l’arçon.
– En avant !… continue de sa voix de clairon leur conducteur qui a pris la tête.
Laissez vos armes en repos.
Batailler serait folie !…
Ne perdons pas une seconde, et en avant !… si vous tenez à vos chevelures.
– Il est bon, celui-là, interrompt un des fugitifs auquel ce silence paraît peser, j’t’écoute que nous y tenons, à nos perruques.
Avec ça que les fabricants de postiches sont loin d’ici et que ça nuirait à nos avantages personnels, de nous en aller le crâne tout nu.
– Ces Français rient de tout, grommelle d’un air de mauvaise humeur le premier personnage, que son affreux accent nasal fait aussitôt reconnaître pour un Américain pur sang.
– Vous croyez que je ris…
… Pas plus envie que de m’en aller à pied jusqu’au Groenland.
D’autant plus que l’aventure n’est pas drôle, pour nos débuts sur le libre territoire de l’Union américaine !
Halte-là !… Cocote, dit-il à son cheval qui vient de faire un écart, pas d’embardées…
Nous arrivons ici en bons chasseurs pas trop naïfs, mais un peu gobeurs pour chasser le bison, et crac !… voilà un homme mort et les chasseurs devenus gibier.
Voyons, m’sieu André, n’est-ce pas un vrai guignon ?
– Tu as parfaitement raison, mon pauvre Friquet, et je trouve en outre que l’honorable master Bill a eu la main un peu leste.
– Le colonel Bill… rectifia le Yankee.
– Le colonel, soit !
Peste ! l’existence d’un homme est peu de chose pour vous, paraît-il.
– D’abord, ce n’est qu’une vermine de Peau-Rouge, dit-il avec cette expression de mépris écrasant que manifeste pour l’Indien l’Américain du Nord.
– C’est peut-être une raison essentielle pour un ancien chef de la milice américaine, mais elle est absolument insuffisante pour des voyageurs français qui n’ont même pas été caporaux dans la garde nationale.
– Il était en outre, de son vivant, le plus enragé voleur de chevaux de tout le territoire, et vous savez, ou vous ne savez pas qu’un, Peau-Rouge voleur de chevaux est capable de tous les crimes.
De plus, lui seul peut avoir scalpé, il n’y a pas encore deux mois, une famille entière d’émigrants irlandais, composée du père, de la mère et de huit enfants !…
– Vous m’en direz tant !
– Enfin, si vous aviez vu comme moi les regards de convoitise qu’il lançait sur nos montures et sur nos armes, si vous aviez entendu les ordres donnés à voix basse à ses compagnons, vous trouveriez mon acte tout naturel.
Nous étions bel et bien tombés dans un traquenard dont le hasard seul m’a fait deviner la présence.
– Quoi qu’il en soit, nous voici avec une meute de Peaux-Rouges collés à notre piste…
– Ni plus ni moins que les héros des livres de Cooper, du capitaine Mayne-Reid et de notre compatriote Gustave Aimard…
– Avec la poésie et la couleur en moins.
Je ne trouve rien de banal comme ces Indiens fagotés de haillons civilisés, affublés de chapeaux défoncés et de pantalons sans fond.
– Et cette lande sablonneuse sur laquelle nous galopons à perdre, haleine, au point que nous sommes forcés de crier comme des aveugles pour nous communiquer nos pensées, est-elle assez terne dans sa stérile monotonie…
– Les coquins sont en loques, mais ils ont comme nous des Winchester, reprit le colonel en homme pratique.
Heureusement qu’ils tirent mal.
Quant à cette plaine, je voudrais bien qu’elle s’étendît encore à vingt milles devant nous.
Nous allons arriver bientôt à la « Prairie ». Il y a là des herbes et des fleurs éblouissantes…
C’est très joli comme coup d’œil, mais on peut y être rôtis comme des poulets.
– Vous parlez d’or, colonel.
Mais, contre toute présomption, il me semble que nous ne sommes pas poursuivis.
Si nous faisions souffler un peu nos chevaux pour les reposer de cette course enragée ?
Le Yankee se retourna, se haussa sur ses étriers, inventoria minutieusement la plaine, et ajouta :
– J’aimerais mieux voir ces vermines galoper à nos trousses comme des furieux.
Je soupçonne là-dessous quelque diablerie.
Ralentissons notre allure et gagnons les hautes herbes.
Le colonel, à ces mots, tire de sa poche un volumineux cylindre de tabac « en carotte », en déroule un morceau long de dix centimètres, le sectionne d’un coup de dents, l’insinue sous sa joue et se met à le mastiquer avec une sensualité que rien ne semble justifier, mais qui, paraît-il, constitue pour les Américains en général une véritable grâce d’état.
C’est un homme de haute taille, maigre et pourtant vigoureusement charpenté. Sa figure aux traits énergiques, mais froids et durs, ses yeux clairs, mobiles, aux gros sourcils charbonnés, sa bouche aux coins tombants, sa longue barbe tannée, roussie par les alternatives de soleil et de pluie, lui donnent un aspect fort peu sympathique à première vue.
Quant à son équipement, un homme à idées préconçues, ou simplement imbu des préjugés de l’ancien monde, le regarderait comme étant susceptible de couvrir le plus éhonté gentilhomme de grands chemins, plutôt qu’un honnête citoyen de l’Union américaine.
En effet, le colonel, avec son large feutre gris bossué, ravagé, que sa ganse d’or effiloquée rend plus minable encore, sa chemise de laine rouge, son pantalon indien en cuir fauve orné de franges sur toutes les coutures, ses bottes monumentales chaussées d’éperons mexicains larges comme des soucoupes, sa ceinture garnie de deux revolvers Colt, son grand couteau, sa carabine Winchester à répétition, a véritablement l’aspect d’un bandit accompli.
Nonobstant son titre de colonel, auquel il parait tenir autant qu’à sa propre existence, Mr. Bill est un simple cow-boy (vacher).
Mais, hâtons-nous de dire que cette appellation ne doit impliquer en aucune façon, dans l’esprit du lecteur, l’idée d’une fonction pastorale, telle que l’ont remplie avec leur incomparable majesté les patriarches de la Bible, et telle que la remplissent encore, avec leur terre-à-terre d’hommes salariés, les pacifiques auxiliaires de nos exploitations agricoles.
Les vachers américains sont de terribles hommes, et l’on serait souvent fort embarrassé de dire où finit en eux l’honnête travailleur et où commence le sacripant.
Un de nos compatriotes, qui a raconté avec infiniment d’esprit un récent voyage aux Montagnes Rocheuses, M. le baron de Grancey, né nous laisse guère d’illusion sur le compte de ces redoutables pasteurs auxquels sont confiés les immenses troupeaux de l’Ouest Américain.
Ils sont une véritable plaie pour ces régions de l’Ouest encore à peine peuplées, où s’avancent peu à peu le colon et l’émigrant et où s’improvisent des stations et des bourgades qui deviendront des villes. Toujours sur cette zone indéfinie qui n’est plus tout à fait sauvage, mais qui n’est pas encore civilisée, ils mènent l’existence enragée de l’aventurier n’ayant plus rien à perdre, dont la vie se partage entre un travail excessif et des plaisirs désordonnés.
Recrutés parmi tous les désœuvrés, ou plutôt parmi tous les déclassés qui fourmillent dans les énormes cités du Nouveau-Monde, ayant pour la plupart un compte à régler avec la justice américaine, pourtant peu susceptible d’un excès de pruderie, incapables en outre de s’astreindre au travail des mines ou des fermes, ils sont venus offrir leurs services aux ranchmen (éleveurs).
On ne leur demande ni ce qu’ils sont, ni d’où ils viennent, pourvu qu’ils puissent rester à cheval dix heures par jour et se contenter de l’ordinaire déplorable dont le lard salé et la farine trop souvent gâtée forment le fond invariable.
On leur fournit à chacun six chevaux, douze cents têtes de bétail à garder entre cinq, des armes pour se défendre, un chariot pour transporter leurs vivres, et puis : go ahead !…
Toujours à cheval du matin au soir, circulant au petit galop sur les flancs du troupeau pour empêcher les bêtes de s’attarder, de s’égarer ou de se mêler aux troupeaux étrangers, ne s’arrêtant que pour changer de monture quand la leur est trop fatiguée, forcés de veiller deux nuits sur cinq, couchant à la belle étoile, vivant à la diable, et touchant au bout du mois, pour ce travail surhumain, la modique somme de quarante dollars – deux cents francs – il n’est pas étonnant qu’ils célèbrent par de monumentales orgies le jour de l’émargement.
Alors seulement ils se rapprochent des bourgades ou des villes en voie de formation, y apportent leur brutalité de sauvages blancs toujours en guerre avec les Indiens, et deviennent la terreur des habitants qui, d’ailleurs, les pillent et les rançonnent à merci, après les avoir intoxiqués de leurs drogues malsaines.
Les journaux sont pleins de leurs prouesses, et il n’est pour ainsi dire pas de semaine où ils ne réalisent quelqu’une de ces monstrueuses fantaisies de buveurs affolés, qui font penser aux exploits de l’équipage de la Salamandre.
De temps en temps, on apprend que des cow-boys mis en belle humeur par de formidables lampées de whisky, se sont emparés d’une petite ville de la frontière et l’ont simplement pillée de fond en comble, ou que pris d’un subit accès de gaîté, ils ont réuni les habitants sur la place et les ont forcés à danser devant eux des heures entières, en envoyant des balles de revolver dans les mollets de ceux qui manquaient d’entrain ou d’agilité.
Telle est la monnaie courante de leurs facéties, jusqu’à ce que, un beau jour, les citadins fatigués de ces plaisanteries un peu hasardées, se forment en comité de vigilance. Ils prennent au hasard une demi-douzaine de cow-boys et les accrochent au premier arbre susceptible de former une potence. L’exemple n’est perdu pour personne, et les autres s’en vont à la recherche d’endroits où il est possible de s’amuser sans courir de pareils risques.
Tel est le vacher américain, représenté, dans le cas présent, par ce personnage qui se fait appeler le colonel Bill.
Quant à ses deux compagnons, leur personnalité est suffisamment connue de ceux qui ont lu les Aventures d’un Gamin de Paris au pays des Lions, pour qu’il soit besoin de la définir à nouveau.
Arrivés à la limite des hautes herbes, les trois hommes s’arrêtent complètement et inspectent attentivement l’espace qu’ils viennent de parcourir.
Ils sont déjà loin du lieu où l’Indien a succombé, et leurs yeux ne découvrent aucun indice alarmant. Ils aperçoivent seulement une vingtaine de chevaux paissant en liberté, en avant du bouquet feuillu formant une tache sombre sur les herbes courtes servant, en quelque sorte, de transition entre la plaine de sable qui s’étale au loin, comme une mer aux flots jaunes, et la prairie constellée de fleurs éblouissantes.
Le colonel rumine son tabac, envoie de longs jets de salive et demeure rigide comme une statue équestre, mais visiblement intrigué.
Friquet, de son côté, darde son regard aigu sur les chevaux et trouve au moins singulières leurs allures, qui sembleraient parfaitement naturelles à un observateur superficiel.
– Voyez donc, m’sieu André, dit-il à son ami, comme ces animaux semblent obéir intelligemment à un mot d’ordre.
Au lieu de batifoler comme ils en ont l’habitude, de caracoler sans pour cela s’écarter beaucoup du campement, ne dirait-on pas qu’ils s’alignent à droite et à gauche, de façon à former un vaste croissant.
– Tu as, pardieu ! bien raison.
– Ah ! j’y suis, cette fois, et j’évente le truc.
Ces chevaux ont chacun leur cavalier.
Tenez, je viens d’apercevoir la jambe fauve d’un pantalon de cuir former un instant comme une tache, sur la robe de ce cheval blanc qui trottine à un demi-kilomètre.
J’ai vu les Peaux-Rouges de la Pampa Argentine se livrer à ces petites acrobaties.
– Vous avez de bons yeux, capitaine, s’écrie en même temps l’Américain.
– Hein !… capitaine ?… moi ?…
Capitaine de quoi donc ? s’il vous plaît…
Puis, il ajoute en français, après s’être tourné vers André :
– Ce militaire de haute fantaisie est tout simplement épique.
Nous l’avons comme guide, comme homme à gages, je dirai presque comme domestique, et il daigne m’élever au grade de simple capitaine, tandis qu’il se goberge avec son titre de colonel…
De façon que non seulement je ne suis pas l’égal de notre employé, mais encore je serais virtuellement son inférieur.
Elle est jolie, la démocratie américaine !…
– Mais, capitaine… reprend le Yankee.
– Master Friquet tout court… sans grade, ni titre, ni particule, interrompt le jeune homme.
– Mr. Friquet… je le veux bien, continue le cow-boy sans comprendre comment on dédaigne ce grade qui peut conduire son titulaire à obtenir au choix, et par le même procédé, celui de major ou de colonel.
Vous connaissez les ruses de ces vermines, et je suis de votre avis.
– M’sieu André, vous n’avez pas votre pareil pour envoyer un coup de carabine.
Sans vous commander, si vous essayiez de « dégoter » ce cheval blanc…
Ceux du centre ne sont guère qu’à six cents mètres.
– Pour te faire plaisir et pour l’honneur du pavillon, je vais essayer, répond le jeune homme en épaulant son Winchester sans quitter sa selle.
L’arme resta deux secondes immobile, le canon s’empanacha d’un flocon de fumée et la détonation retentit.
Puis, l’animal qu’avait signalé Friquet fit, après un temps fort appréciable nécessité par le trajet de la balle, une pointe terrible, se dressa sur les pieds de derrière, battit l’air de ceux de devant, et s’abattit lourdement de côté.
Son cavalier, qui se dissimulait derrière son flanc gauche, en se tenant accroché aux crins et à l’étrier, avait déjà mis pied à terre et s’était prudemment aplati derrière le cadavre palpitant.
– Pétard !… comme c’est envoyé ! fit le Parisien enthousiasmé.
– Bravo ! major, s’écria le cow-boy en applaudissant chaleureusement à la rectitude merveilleuse de ce beau coup.
– Bon ! reprit Friquet, il y tient.
Vous voilà major !
Voyons, puisque ça vous coûte si peu, pourquoi ne nommez-vous pas d’emblée général monsieur André, en sa qualité de chef de l’expédition ?
Car enfin, tout colonel que vous êtes, je ne réponds pas que vous en feriez autant.
Un incident qui n’avait rien d’imprévu, dispensa le colonel d’une réponse probablement embarrassante.
Les Indiens, se voyant découverts, ont accueilli par une clameur furibonde la chute du cheval.
Dédaignant alors tout subterfuge, ils reprennent, avec leur agilité de clowns, la position normale du cavalier et se précipitent en avant, en agitant leurs armes et en poussant leur farouche cri de guerre.
Les trois compagnons ne les ont pas attendus. Sans essayer d’engager une lutte disproportionnée contre des adversaires six fois plus nombreux et possédant un armement semblable au leur, ils se sont enfoncés dans la prairie.
La particularité au moins singulière de cet armement n’a pas échappé à Friquet. Aussi, le Parisien, stupéfait de voir des carabines Winchester aux mains de Peaux-Rouges, n’a pu s’empêcher de faire cette réflexion fort judicieuse :
– Mâtin ! Il paraît que le bon temps de l’arc et du fusil à pierre est passé, et je ne m’étonne plus si les Indiens donnent tant de fil à retordre aux Américains.
Mais, aussi, quelle drôle d’idée de leur fournir des armes à répétition avec les munitions !
Grâce à la vigueur de leurs chevaux, les trois blancs savent bien qu’ils maintiendront à peu près leurs distances pendant au moins quatre heures.
Aussi, ne sont-ils pas trop inquiets, car c’est plus de temps qu’il ne leur en faut pour atteindre le camp où ils ont laissé la veille un pesant chariot portant leurs provisions, leurs effets de campement et d’équipement, leurs chevaux de rechange et les sept hommes engagés en même temps que le colonel, pour les besoins d’une longue croisière cynégétique à travers la Prairie.
En forçant leur allure, ils auront rejoint leurs compagnons en moins de temps encore, et alors, n’étant plus qu’un contre deux, ils pourront résister à l’attaque des Peaux-Rouges avec de grandes chances de succès.
Le colonel, qui suit une direction évidemment familière, a pris la tête et les guide imperturbablement à travers cet océan de verdure et de fleurs.
Les Indiens redoublent de vitesse et finissent, en rouant de coups leurs chevaux avec cette brutalité qui leur est familière, par se rapprocher sensiblement.
Mais, qu’importe au cow-boy et aux deux Français !
Est-ce que bientôt les coups de feu et les hourras de leurs compagnons ne vont pas dominer les clameurs des sauvages habitants de la prairie.
Ils arrivent enfin au camp et annoncent leur retour par un vivat retentissant.
Mais quoi !… Personne ne leur répond. La solitude est complète. On ne voit ni hommes ni chevaux, et les Indiens, se rapprochent.
Seul, le chariot dresse sa lourde masse au milieu de tisons éteints…
Les fugitifs, en proie à de lugubres pressentiments, examinent plus attentivement les hautes herbes foulées, et ne peuvent retenir un cri d’horreur, à la vue de l’affreux spectacle qui s’offre à leurs regards.
Massacre. – Oraison funèbre. – Antagonisme des rouges et des blancs. – Anéantissement ou absorption des Indiens. – Après le pillage. – La « Réserve » des Cœurs d’Alène. – L’herbe aux buffalos. – Incendie dans la Prairie. – Entre le danger d’être brûlés vifs, ou attachés au poteau de tortures. – Palouse-River. – Cernés à droite. – Escarmouche et chute d’un cheval blanc. – Cernés à gauche. – Cernés derrière. – André reprend le commandement. – Friquet arrose trois couvertures et les coupe en deux. – André passe général au choix. – À travers les flammes.
Une douzaine de loups, le mufle sanglant, à peine effrayés par la subite arrivée des cavaliers, s’arrachent comme à regret à un horrible festin, pendant que des vautours zopilotes tournoient sans interruption au-dessus d’un véritable charnier, sur lequel leur couardise, plus forte que leur rapacité, les empêche de s’abattre.
À quelques pas du chariot, et près des tisons éteints, six hommes, affreusement mutilés, sont étendus sur les herbes plaquées de taches brunes.
Il est facile de reconnaître à leur attitude qu’ils ont été surpris sans avoir eu le temps de se mettre en défense.
Tous ont été frappés par derrière, au moment où, assis à la turque, ils allaient prendre leur repas.
Tous les six ont été scalpés, et leurs crânes dépouillés n’offrent plus qu’une surface rouge pâle du plus hideux aspect. Détail horrible, les loups se sont de préférence attaqués à leurs visages, qui sont devenus absolument méconnaissables.
Le colonel fit passer de la joue droite à la joue gauche son paquet de tabac, toussa légèrement, envoya à quatre pas un long jet de salive et grommela d’une voix sourde :
– By God ! Les vermines ont joliment arrangé les pauvres camarades !…
Mais, aussi, comprend-on des westerners (habitants de l’Ouest) se laisser ainsi surprendre et massacrer comme des veaux !
Où donc est le septième ?
Ah ! très bien ! Il était en sentinelle… continua-t-il en trouvant un dernier cadavre allongé sur le dos, à quinze pas de là.
À ce bouquet de poils roux que les loups ont laissé au menton, je reconnais le colonel Jim, mon compère.
Le digne garçon aimait bien le whisky.
Je ne serais pas étonné que, en notre absence, il n’ait découvert votre provision particulière et oublié qu’il peut être imprudent de se griser, quand on est en sentinelle non loin des « Réserves ».
Eh bien ! gentlemen, avais-je raison de casser tout à l’heure la figure à ce damné hypocrite qui tâchait de nous entortiller, de façon à nous faire subir sans danger le sort de nos compagnons ?
– Croyez-vous donc à leur complicité ? demanda André d’une voix à laquelle le Yankee, surpris, ne put trouver la moindre altération.
– Eh ! pardieu ! ces gredins s’entendent comme larrons en foire.
– Mais, je croyais que jadis les tribus en paix ne déterraient la hache de guerre qu’après provocation et n’attaquaient qu’après déclaration préalable.
– Sans doute, autrefois… mais les Peaux-Rouges ont vu qu’ils faisaient là un métier de dupe et ils nous tombent dessus où et quand ils le peuvent.
Nous le leur rendons bien, d’ailleurs.
– De façon que certaines parties du Grand-Ouest sont continuellement en guerre.
– Continuellement, vous l’avez dit, gentleman, et cela, jusqu’à ce que la race rouge ait été anéantie par la blanche, ou se soit fondue dans elle.
– Quant à ceux qui ont ainsi lâchement massacré nos camarades ?…
– Ce sont, à mon avis, les maraudeurs que nous avons rencontrés avant d’arriver à Waitsburg, et qui, bien que prétendant appartenir aux Nez-Percés, ne font partie d’aucune tribu, vivent sur les frontières des réserves, et non loin des établissements fondés par les pionniers d’avant-garde.
– De sorte qu’il nous sera impossible d’obtenir justice devant les sachems.
L’Américain eut un rire brutal que la présence des cadavres rendit effrayant de cynisme.
– On voit bien que vous êtes Français, dit-il avec une pointe d’ironie.
La justice, la voici, quand on est le plus fort ! dit-il en frappant sur la crosse de son Winchester.
Et quand on n’est pas le plus fort, il faut jouer des jambes, sous peine d’être scalpé.
– Mais, interrompit à son tour Friquet, il est bien désagréable de battre ainsi en retraite sans seulement brûler une cartouche.
Ne pourrions-nous pas nous défendre ici ?
Voyez donc, le chariot est intact.
– Voilà qui est, en effet, assez singulier.
– Pas du tout, reprit l’Américain.
Ils ont enlevé les chevaux, les harnais, les couvertures, les armes et les munitions renfermées dans les cartouchières.
Comment voulez-vous qu’ils aient essayé d’emporter les lourdes caisses contenant les provisions ou les armes de réserve.
Ainsi ferrées et clouées, leurs planches de chêne défient la hache elle-même.
– Il me semble pourtant, reprit Friquet, que le chariot deviendrait pour nous une véritable forteresse…
– Dans laquelle nous serions enfumés comme de simples jambons de Chicago.
By God !… capitaine… je veux dire Mr. Friquet, vous ne connaissez pas la guerre de la Prairie !…
Notre unique ressource est dans les jambes de nos chevaux.
Car, ou je me trompe fort, ou avant peu ces vermines à peau de brique vont faire flamber les herbes qui nous entourent, et c’est dommage, car c’est du buffalo-grass (herbe aux buffalos) de première qualité.
Il y a là une fortune pour dix ranchmen.
J’y penserai plus tard.
Pour le moment, voici nos chevaux reposés ; si vous m’en croyez, nous allons, sans plus tarder, essayer de gagner la réserve des Indiens Cœurs-d’Alène.
Là seulement nous serons en sûreté.
– Soit, répondit André sans paraître étonné de ce nom singulier qui est celui d’une tribu peu connue, appartenant à la grande famille des Serpents ou Têtes-Plates.
– Cette réserve est-elle éloignée ?
– De trente-cinq milles environ.
– À peu près seize lieues de France.
– Exactement soixante-quatre mille huit cent vingt mètres.
– Diable ! Nos chevaux arriveront-ils ?
– Je vous dirai cela demain… si je ne suis pas scalpé.
Et maintenant, si vous m’en croyez, en avant !…
À ces mots, le colonel, sans même jeter un regard sur ses compagnons massacrés, pique lestement des deux et s’enfonce, suivi des deux Français, dans la Prairie qui s’étend à perte de vue.
– Voyons, colonel, ne put s’empêcher de demander Friquet après une heure de galop silencieux dans les hautes herbes, êtes-vous bien certain que nous sommes poursuivis ?
– Comme de mon existence, capitaine… je veux dire Mr. Friquet.
Je suis même sûr que le nombre de nos ennemis a pour le moins doublé.
– Pas possible !
– Je leur ai joué tant de bons tours, qu’ils feront tout au monde pour m’enlever ma chevelure.
Mais, les vermines ne me tiennent pas encore.
Tiens !… fit-il tout à coup, non sans une nuance d’inquiétude et en arrêtant brusquement son cheval.
– Qu’y a-t-il ?
– Ne sentez-vous pas, comme moi, une légère odeur de brûlé ?
– Nous ne sentons absolument rien, répondirent en même temps les deux Français, après avoir humé l’air à plusieurs reprises.
– Cela tient à ce que vous n’avez pas, comme moi, vécu dix ans au grand air.
Il n’est rien de tel pour aiguiser nos sens et faire de nous de vrais sauvages blancs, que de galoper nuit et jour dans la plaine, sans savoir si demain notre crâne aura encore sa peau.
– Et pourrait-on savoir ce que vous révèle cet odorat si subtil ? demanda Friquet d’un ton légèrement railleur.
– Volontiers, Mr. Friquet.
Je n’affirme pas encore, mais il se pourrait que le buffalo-grass, cette belle herbe qui sèche sur pied et donne une espèce de foin dont nos bœufs sont si friands, il se pourrait, dis-je, que le buffalo-grass brûle non loin d’ici…
– Et alors ?…
– Et alors nous courrions grand risque d’être asphyxiés tout d’abord, puis rôtis…
– À moins que…
– À moins que nous ne tombions entre les mains des rôdeurs à peau rouge.
Ce qui serait bien pis.
– Ah ! oui, le nommé poteau de tortures.
J’ai vu ça dans les livres…
Il paraît que ce n’est pas tout ce qu’il y a de plus drôle.
– Ne riez pas, jeune homme, interrompit gravement le cow-boy.
J’ai vu de mes compagnons attachés au-dessus d’un brasier, de façon qu’ils pussent se sentir cuire à petit feu…
Les squaws leur enlevaient une à une les phalanges des doigts… leur découpaient sur la peau de minces lanières…
Pendant ce temps, les guerriers hurlaient leur chant de guerre.
– Ce qui devait être une rude aggravation de peine s’ils chantaient faux !
Pour le coup, le colonel regarda le Parisien de travers.
– Dame ! reprit imperturbablement Friquet, vous vous appesantissez sur le talent de ces braves gens avec une complaisance qui n’enlève rien à mon admiration pour leurs procédés opératoires, mais me donne une déplorable opinion de la façon dont ils entendent les rapports sociaux.
En voilà qui auraient rudement besoin des bienfaits de l’instruction gratuite et, surtout, obligatoire.
– Bien !… bien !… Nous verrons, si les affaires tournent mal, ce que deviendra cette gaîté.
– Tiens !… on dirait que ça vous déplaît, de me voir blaguer, quand vous nous racontez vos histoires de l’autre monde.
Nous avons la bravoure joyeuse, nous autres, et nous ne pensons pas à trouver singulier que vous ayez le courage grognon.
Chacun sa manière, pas vrai, m’sieu André.
André sourit, se leva sur ses étriers, mouilla son doigt en le passant sur ses lèvres et tendit le bras verticalement, comme les marins qui s’assurent de la direction du vent.
– Je dis, fit-il en manière de réponse, que le colonel a raison.
Le buffalo-grass flambe à n’en pas douter, bien que nous n’apercevions pas la fumée, et nous avons vent arrière.
Je crois que le foyer de l’incendie est en avant.
Qu’en pensez-vous, colonel ?
– Que vous avez raison, major.
En avant le feu de la prairie, en arrière, les Peaux-Rouges.
Nous voilà dans une jolie situation.
– Que faire ?
– Atteindre à tout prix cette zone bleuâtre qui coupe l’horizon là-bas, devant nous, à environ quatre milles.
Cette ligne doit être produite, si je ne me trompe, par les bois qui bordent Palouse-River.
Nous avons à traverser, pour cela, cette plaine qui est Kamas-Prairie…
À ce moment, un bruit singulier, comparable au grondement que produit la marée montante, ou mieux encore un fleuve enflé par une crue subite, se fait entendre.
Puis, de minces colonnes de fumée blanchâtre s’élèvent au milieu de la plaine, juste entre les fugitifs et la ligne d’horizon formée par les arbres bordant le fleuve.
En moins de dix minutes, trente foyers d’incendie se montrent dans la même direction, et, chose étrange non moins qu’alarmante, ils sont placés sur une même ligne, assez régulièrement espacés, de façon qu’avant peu ils seront réunis et intercepteront complètement toute communication avec le Nord, où coule Palouse-River, perpendiculairement à la direction suivie par les trois voyageurs.
– Eh bien, Mr. Friquet, que dites-vous de cela ?
– Je dis que les Peaux-Rouges ont mis le feu devant nous de façon à nous empêcher de gagner la rivière, et qu’ensuite ils sont revenus, à travers les herbes, former derrière nous un demi-cercle destiné à nous acculer à une ligne de feu, et qu’il faut absolument traverser les flammes qui ronflent en avant, ou passer sur le ventre des coquins qui galopent derrière.
C’est à peu près cela, n’est-ce pas ?
– Absolument.
Avec cette différence, toutefois, que nous n’avons plus affaire seulement à une vingtaine de Peaux-Rouges.
Les vauriens avaient des complices dans les environs, et je ne serais pas étonné que leurs mesures n’aient été prises déjà depuis deux jours.
Ou je me trompe fort, ou ils se sont réunis au premier signal, et ils doivent être environ deux cents rôdeurs divisés en trois troupes.
Nous allons d’ailleurs savoir avant peu à quoi nous en tenir.
Essayons d’abord de nous échapper sur la droite.
Car il nous devient à peu près impossible de franchir la prairie pour gagner Palouse-River.
Les trois cavaliers piquent des deux, enlèvent leurs chevaux après avoir décroché la courroie qui attache leur Winchester, de façon à pouvoir faire feu si les Peaux-Rouges se montrent.
À peine galopent-ils depuis dix minutes qu’ils aperçoivent, sur la crête d’un mamelon, une cinquantaine d’Indiens à cheval et qui, à leur aspect, poussent des cris furieux, en se formant en ligne à droite et à gauche avec une merveilleuse précision.
– Ah ! je m’en doutais, grogne de sa voix nasillarde l’Américain.
De ce côté, la retraite est coupée.
Arrêtant alors brusquement son cheval comme ont coutume de le faire les cavaliers mexicains, il saisit sa carabine, épaule vivement et fait feu à quatre cents mètres.
Un superbe cheval blanc se dresse aussitôt sur ses pieds de derrière et s’abat, frappé à mort, sur son cavalier.
– Maladroit ! s’écrie le cow-boy.
– Comment, répond Friquet, vous n’êtes pas content ?
Peste ! le coup est pourtant assez joli et n’est pas à la portée de tout le monde.
– Eh ! que m’importe un cheval par terre, reprend le Yankee avec un accent de haine implacable, j’en donnerais dix pour crever la peau à un de ces putois rouges !
Ah bravo ! major…
– Eh ! voyez-vous ça… c’est très bien, capitaine.
Friquet et André voyant l’escadron continuer sa course au petit galop, ont à leur tour fait feu sur la ligne.
L’homme visé par André est tombé comme une masse, et celui qui servait de but à Friquet a lâché les rênes et oscillé sur la croupe de son cheval.
Rendus plus circonspects par ces arguments sans réplique, du moins à pareille distance, car les Indiens, quoi qu’on en ait dit, sont de piètres tireurs, ils se dissimulent comme précédemment derrière leurs chevaux et se contentent de ralentir leur allure, mais sans quitter leurs places respectives.
– Il est bien entendu que nous ne passerons pas là sans essuyer un feu de peloton, dit André en remplaçant par une cartouche pleine sa cartouche vide, afin de conserver au complet le réservoir de sa carabine.
– Essayons sur la gauche, interrompt le cow-boy en faisant volte-face.
Ils n’ont même pas le temps de parcourir trois cents mètres, qu’un nouveau groupe émerge des hautes herbes et s’éparpille comme le précédent en ordre dispersé.
Les Indiens semblent certains du succès. Ils ne se donnent même pas la peine de se cacher et s’avancent lentement, de façon à enserrer les blancs, qui bientôt n’auront plus qu’une alternative : s’élancer dans les flammes ou tenter de rompre leur ligne.
La situation devient de plus en plus critique.
L’Américain, toujours impassible, mâchonne son tabac et jette sur les deux Français un regard étonné, presque admiratif, à l’aspect de leur contenance intrépide.
Friquet sifflote son air favori : « Bon voyage, monsieur Dumollet » et André inspecte avec sa lorgnette la zone de feu d’où s’échappent des pétillements sinistres qui deviennent plus forts et plus distincts.
Les trois lignes formées par les Indiens se resserrent lentement, mais avec une précision mathématique.
– Eh bien, colonel ? demanda le jeune homme.
– Hum !…
– Votre avis ?
– Je crois que nous sommes bien malades, et je ne donnerais pas un dollar de nos trois chevelures.
– Il faut pourtant sortir d’ici.
– C’est mon opinion.
Nous ruer sur les Indiens et en tuer le plus possible est un moyen scabreux.
Ils massacreront nos chevaux, nous empoigneront, quoique nous fassions, et nous attacheront au poteau.
– Et si nous traversions le feu ?
– Essayons.
– Colonel, je reprends pour l’instant le commandement de l’expédition.
– Alors, chacun peut se débrouiller à sa fantaisie ?
– Parfaitement.
Mais, croyez-moi, suivez mon plan, c’est le moins impraticable de tous.
Toi, Friquet, descends de cheval et décroche lestement nos trois couvertures.
Vous, colonel, ouvrez l’œil sur un côté de l’horizon, pendant que j’inspecte l’autre.
L’outre que tu portes en portemanteau est pleine, n’est-ce pas ?