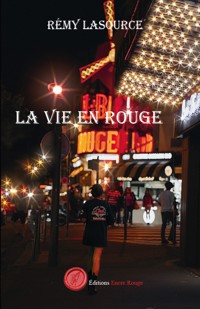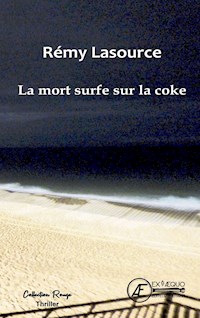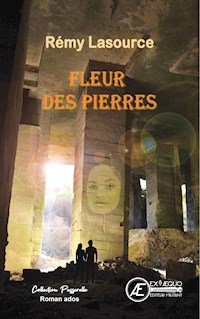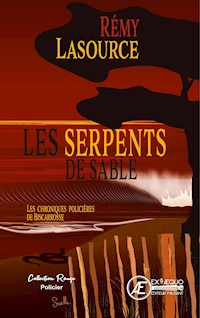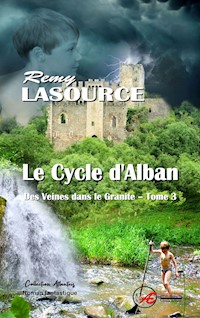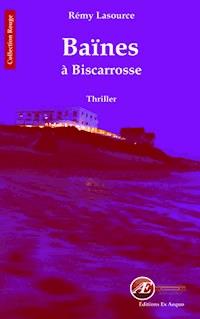Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes de Barbicaut
- Sprache: Französisch
De retour en banlieue avec le lieutenant Barbicaut, qu'une nouvelle enquête entraine plus loin dans l'insoutenable.
Choqué par la mort suspecte d’un enfant, Barbicaut commet une bavure à l’encontre d’un dealer. Quand il apprend que ce dernier est un adorateur de Satan, il cherche à le retrouver en suivant une piste que jalonnent des cadavres. Aux prises avec une communauté qui pratique le vaudou, le policier passera des épreuves où seule la valeur humaine compte. Barbicaut qui sera bientôt père, ne vivra que pour traquer le meurtrier d’un enfant. Quitte à jouer sa vie aux dés pour affronter un ennemi aussi insaisissable que cruel.
Ce polar de banlieue est le 3è tome des enquêtes de Barbicaut.
« Alors je serre les mâchoires parce qu’elles se mettent à trembler malgré moi. Je sais que je suis trop sensible, trop humain pour ce boulot. J’ai trop envie d’aider les gens, c’est mon talon d’Achille mais c’est aussi et surtout mon moteur, et probablement la source de ma vocation. »
Barbicaut doit rester debout et éviter de défaillir face à la mort, la mort violente, la mort sanglante.
EXTRAIT
On se regarde avec Gaétan, aujourd’hui on a bien failli mourir comme des pleupleu, comme des écervelés la fleur au fusil. Et on rit comme des idiots. Si ce type avait cru que c’était le défenestré qui revenait, il nous aurait troué la peau sans qu’on ne comprenne rien. On se regarde et on comprend qu’on pourrait être mort là, tout de suite, tué par un mourant qui serait mort juste après nous, qui nous aurait assassinés par erreur. On pense à cela, j’ai les boyaux ensanglantés du type qui tachent mes genoux et je sens son sang maintenant froid qui colle sur ma peau, j’ai les odeurs de sa mort dans les poumons, j’ai les yeux bleus de mon ami qui me regardent et que je regarde et on pense aux mêmes choses en même temps. On s’assoit sur le cul à côté du mort. Puis on ne parle plus
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après avoir fait des études de droit Rémy Lasource est devenu fonctionnaire. Il a travaillé quelques années en banlieue nord de Paris au contact des policiers et magistrats, et vit aujourd’hui en limousin. Edité chez Ex Aequo pour ce 9è ouvrage, l’auteur fait partie du jury Zadig de la nouvelle policière. Avec ce roman débute la série des Barbicaut, des polars ayant pour théâtre la banlieue.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbicaut joue son âme
Une enquête de Barbicaut
Polar
ISBN : 978-2-37873-838-9
Collection Rouge
ISSN : 2108-6273
Dépôt légal : Janvier 2020
© couverture Ex Aequo
© 2019 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
Éditions Ex Aequo
6 rue des Sybilles
88370 Plombières les bains
www.editions-exaequo.fr
Je suis toujours allongé et cherche mon revolver à ma ceinture, mais elle me fait non de la tête. Alors elle sort mon arme qu’elle tenait dans sa main derrière son dos et me la montre doucement. J’ai dû la perdre durant la bagarre.
Je sécrète inconsciemment de l’adrénaline, je sais que les premières balles vont me couper les jambes, qu’il faudra ruer avec désespoir pour ma survie. Je pense à Camille et à mon fils à naître, comment en suis-je arrivé là ?
Le bruit s’accompagne d’un éclair de flamme et la chair explose comme une citrouille en formant un bouquet de sang, de gélatine et de débris d’os. Il y a toujours cette présence floue comme un rayon de lune autour de moi et je vois distinctement des organes traverser ce voile lumineux pour s’éparpiller dans l’air et s’épanouir dans leur mort, comme sur un tableau sanglant avec des coquilles d’os. L’instantané d’une vie qui s’échappe. Mon cœur bat toujours, je le sens frapper furieusement au tambour de mes tempes, même si je comprends qu’il s’affole pour de bon.
Je suis le lieutenant de police Hugues Barbicaut, et adolescent, comme beaucoup de jeunes bourrés d’hormones en quête d’absolu, ma crise identitaire s’est cristallisée autour de Nietzsche. En plus de la grande séduction qu’exerçait sa poésie sur moi, il y avait toujours ce discours qui revenait, le surhomme est le grand danseur au bord des abîmes.
L’égoïsme et l’esthétique de soi portés comme une valeur narcissique au service de la grande santé me plaisait. Il fallait faire de sa vie une œuvre d’art. L’art était l’exercice vers l’exigence, et un homme fort riait de sa force en tapant sur la table du destin ; l’insouciance et l’innocence du devenir poussaient Zarathoustra à jouer sa vie aux dés sur la table du jeu et de la fatalité. La force étant une vertu et la miséricorde une faiblesse, la cruauté une surabondance d’énergie et la compassion une dégénérescence de la vie, je m’étais naturellement imaginé que le policier serait ce qu’il y avait de mieux pour moi, pour sonder les égouts de l’humanité et faire du danger un exercice de style pour la grande santé.
Être un guerrier poète, tout un programme. Le policier, homme débarrassé du commandement militaire, s’annonçait comme un individualiste, un libre penseur et un homme d’action. Fouiller l’âme humaine et danser au bord des abîmes.
Le problème, c’est que confronté à la violence je me suis découvert plus que de l’empathie, de la compassion, surtout pour les enfants violés, voire pour des adultes victimes de trucs sordides. Ensuite, je ne voyais vraiment pas comment justifier des actes violents comme une revendication identitaire et puis je me suis rendu compte que jouer avec le danger cela ne valait pas toujours le coup, les rares fois où j’avais trouvé cela justifié c’était pour une cause supérieure, donc par chevalerie et pas par grandeur égoïste nietzschéenne. J’étais donc un dégénéré, selon la lecture de mes valeurs adolescentes.
Quand je lisais des articles ou des essais sur Nietzsche je me demandais lequel de ces grands commentateurs avait connu le vrai visage de la violence, lequel avait été un assassin ou en avait affronté un, lequel pouvait voir la violence d’autrui sans souffrir, et puis je me demandais lequel avait fait face au danger de mort, lequel comme moi avait bêtement joué sa vie aux dés sur la table du destin. Et ça, c’était un jeu auquel je n’aimais pas me prêter. Et pourtant je rentrais dans un cycle où j’allais lancer mon existence dans le vide et m’en remettre à la grande loterie.
Je me lève la tête encore embrumée dans les rêves. Je prends un expresso serré ; ma machine, une Krups 15 Bars ne me verse que du café Illy, c’est mon caprice, mon plaisir et ma douceur matinale. Je n’ouvre les yeux que pour effectuer des tâches matérielles, j’ai la conscience rentrée à l’intérieur, le regard tourné vers le monde des songes, les yeux émerveillés des lueurs dansantes dans la caverne de l’âme. Je suis bien comme ça, semi-conscient, rêveur gagnant à pas feutrés le monde réel.
J’enfile mon cuir et prends ma vieille voiture que j’ai achetée avec un prêt étudiant. Je pénètre dans la forêt domaniale d’Halatte qui sépare la province de l’île de France. Les arbres dorment dans des lambeaux de brume ; je mets les veilleuses. On est à une époque de l’année où quand je pars au boulot le soleil me fait le plaisir d’apparaître sur le monde dans des aubes lisses et lumineuses. C’est un moment privilégié que je partage avec l’univers et ça me met plutôt de bonne humeur. Je suis heureux de vivre. Une épaisse mer nuageuse écume l’est, et je me demande quelles grâces va m’offrir cette aurore. Je ne suis qu’un gros ours mal léché dans le froid de ma voiture. Les arbres semblent en pleine méditation dans leur aura de brume, j’observe leurs branches sortir flottantes dans le halo du brouillard, ainsi que de longs bras tendus dans l’inconnu matinal. Le soleil lance un dôme rougeoyant pour m’avertir de regarder de son côté de bord du monde. Je suis de permanence avec le gros Gaétan en ce moment. Il a laissé tomber la course à pied après une blessure et s’est mis à fond à la muscu, dans l’excès, comme tout ce qu’il entreprend, il travaille ses gros pectoraux, du coup avec gros Béber on l’appelle cap’taine pec’.
Le soleil sort — englué dans la dentelle sanguinolente des nuages —, et ça ressemble à un accouchement sale ou plutôt à un linge souillé par une blessure douloureuse, et le dieu solaire apparaît au monde dans un suaire ensanglanté.
C’est la première aube que je vois ce mois-ci qui n’est pas harmonieuse. Mince. Je passe le long des hangars vides de l’aéroport dans le matin glacé, ouverts comme des bouches béantes et muettes. Des casses de voitures où s’empilent des véhicules en mauvais état et qui rouillent sur place. Puis j’arrive dans ma circonscription.
Une fois au commissariat je vois le commandant, le « Comanche », enveloppé dans son nuage de fumée à pipe avec des yeux qui pétillent. Il a l’air d’un mandarin malicieux, tout sourire dans son aura de volute blanche qui s’accorde avec la blancheur de ses cheveux.
— Barbicaut, y a un cadeau pour vous ce matin.
Il sourit et ses yeux en amande plissent leur bleu délavé, couleur mer d’Iroise sur les grèves bretonnes.
— Barbicaut, vous avez un macchabée au frigo ce matin, il vous attend à 9H00 pour examen de corps avec le Docteur, allez-y une fois que vous aurez pris votre café. Vous allez pouvoir draguer la légiste, hein, Barbicaut ?
— C’est quoi comme affaire ?
— Un défenestré de la nuit. Faut s’assurer qu’il n’avait pas de couteau dans le dos, hein, Barbicaut, qu’on ne passe pas à côté d’un homicide, hein et aux petits oignons l’enquête !
— L’officier de nuit a fait les constats, non ?
— Ouais, mais il vous baise, il vous a laissé le cadeau au funé dans un joli paquet en plastique.
Gaétan arrive en retard comme tous les jours et quand il apprend la nouvelle il commence à sourire avec des « Ah bon ? » comme un parfait abruti à grosses joues qu’il adore jouer, surtout dans les circonstances sérieuses. Avec le Comanche ils n’arrêtent pas leur petit jeu comme de grands enfants ayant raté leur vocation d’amuseurs publics.
— Gaétan au frigo avec Barbicaut ! crie le Comanche.
— Ah bon ?
— Gaétan et Hugues ont un défenestré de la nuit, euh !
— Ah bon ?
— Ah ! Ah ! L’officier de nuit, il vous baise ! Il a shooté les constatations sur le corps avec le médecin de nuit pour tout filer aux flics de jour et au légiste, c’est la baise ! Hugues et Gaétan c’est la baise !
— Ah bon ? Mais comment que ça se fait, ça ? On nous aurait baisés ?
Voilà et ils n’arrêtent pas dès le matin.
Funé, tiroir glacé, macchabée. Après l’examen du corps, nous partons au domicile du défunt avec les clefs que nous avons prises dans ses affaires. Tout roule, le type n’a pas de couteau dans le dos pour reprendre l’humour du Comanche, aucune trace de violence pouvant faire suite à une bagarre, on part sur un bon vieux suicide basique. Le malheureux habite une tour grise dans un quartier gris. Mais je sais que la vue sera belle ; par temps dégagé, on voit se dérouler une mer de béton au-delà de Garges-lès-Gonesse, Stains et même jusqu’à Paris, avec sortie d’une plaine comme une allumette de fer, la tour Eiffel.
Gaétan ouvre la porte et on se marre comme des andouilles quand nos bras tombent paralysés de surprise devant ce type debout dans le couloir, gémissant et pointant sur nous sa main au bout de laquelle tremble un revolver. Il se tient le ventre et marmonne un soupir guttural, et déjà nous sortons nos calibres pour le désigner, mais le type aurait déjà pu nous tuer s’il avait voulu, et puis sa main tient ce revolver pour un autre que nous, c’est évident, il avait l’avantage de la surprise et a décidé de ne pas nous tirer dessus, il tient son flingue pour le défenestré, c’est évident. Il nous regarde avec des yeux gonflés de désespoir, et presque sans vie. Il est moribond. Nous approchons de lui et il lâche son arme en murmurant :
— Aide.
Quand il s’effondre de côté il lâche la main qui tenait son ventre et nous voyons ses boyaux sortir d’une éventration dans une mare gluante. Son fauteuil posé dans le couloir pour faire face à la porte est noir de sang poisseux, et le sol en est souillé. On se porte à son secours, son sang colle à nos semelles, son pouls est faible. On appelle le SAMU, « — Oui c’est le Capitaine Gaétan. On a un blessé grave par couteau, a perdu beaucoup de sang », les boyaux sortis, putain, putain, je lui donne quelques claques, mais je ne me sens pas de lui rentrer les tuyaux dans la chaudière, putain, putain, comment remettre tout l’attirail sans l’infecter, que faire ? Putain et puis rien. Il meurt sans parler. C’est quoi ce bordel ? Il a attendu dans l’appartement du défenestré toute la nuit et tout le matin. Éventré. Assis dans son fauteuil, baignant dans son sang. Le couloir est écœurant de cette odeur de sang tiède, amère et cuivrée. Je regarde la peinture beige qui me renvoie une lumière huileuse.
On se regarde avec Gaétan, aujourd’hui on a bien failli mourir comme des pleupleu, comme des écervelés la fleur au fusil. Et on rit comme des idiots. Si ce type avait cru que c’était le défenestré qui revenait, il nous aurait troué la peau sans qu’on ne comprenne rien. On se regarde et on comprend qu’on pourrait être mort là, tout de suite, tué par un mourant qui serait mort juste après nous, qui nous aurait assassinés par erreur. On pense à cela, j’ai les boyaux ensanglantés du type qui tachent mes genoux et je sens son sang maintenant froid qui colle sur ma peau, j’ai les odeurs de sa mort dans les poumons, j’ai les yeux bleus de mon ami qui me regardent et que je regarde et on pense aux mêmes choses en même temps. On s’assoit sur le cul à côté du mort. Puis on ne parle plus.
Comment savoir qu’il y avait un type qui attendait à l’intérieur ? Les flics de nuit ont ramassé un corps défenestré avec l’appellation suicide, on pensait qu’ils avaient fait leur boulot, merde. Putain ils ne sont même pas montés faire les constatations de base au domicile, ils n’ont pas ouvert, ils n’ont pas vu qu’un type éventré leur aurait réclamé du secours. Je m’écoute respirer, tout congestionné pour être sûr que je suis vivant. Oui je suis vivant, c’est ça, t’es vivant mon gros. T’es vivant, mais bien remué avec un dos qui serre la vis de ses nerfs et l’estomac noué. Me lever me fait l’effet d’un déchirement de terminaisons nerveuses, comme si des toiles d’araignées invisibles avaient emprisonné ma colonne vertébrale et les briser m’est désagréable. Bon, on est en vie, je m’adresse à mon pote abasourdi :
— Gaétan, tu vas bien, gros ?
Puis on se laisse aller à un peu de colère pour remettre de l’ordre dans l’imprévu, des types comme nous on en trouve plus, jamais on ne fait face à une porte derrière laquelle nous attendent des bâtards qui pourraient nous dégommer, les mesures de sécurité on sait ce que c’est, oui on joue avec le feu, mais on prend des risques calculés et on évite le pire dans les interventions grâce à notre présence, grâce à ce foutu charisme dont on irradie et qui pourrait bousculer les étoiles, à ça oui on a un sacré charisme, une putain de flamboyance je te dis, de vrais acteurs d’improvisation passant de la dérision à la parfaite violence, des comme nous ça ne se fait pas surprendre hein gros, parce qu’on est des bons, hein gros ? C’est pas vrai ? Et nous rions nerveusement. On s’est fait prendre comme des bleus.
Commençons l’enquête. Bon l’affaire, rien que l’affaire. Le défenestré a fermé la grande fenêtre qui a une glissière à fermeture automatique, donc il a pu refermer celle-ci une fois sur le bord. Ce n’est probablement pas l’éventré qui l’a poussé dans le vide. Sur le rebord de la fenêtre il n’y a aucune trace de griffures, donc pas lieu de croire que le défenestré s’est accroché au rebord tandis qu’un autre aurait cherché à le précipiter dans le vide, pas de trace de lutte dans la chambre d’où a sauté le malheureux, donc on ne l’a pas poussé. Un témoin, ouf ! a vu le type sauter, et il a sauté tout seul, sans que personne ne l’y ait poussé. L’enquête de voisinage nous apprend que l’éventré était un ami du défenestré et qu’ils avaient eu de violentes disputes récemment à propos de sujets intimes. Sans qu’il ne soit permis de dire qu’ils avaient une relation passionnelle ces deux anciens hétérosexuels passaient leur temps ensemble et il semble qu’ils soient devenus un couple, oui, mais un couple avec des engueulades. L’éventré vivait plus ou moins dans l’appartement et les voisins entendaient crier régulièrement.
L’idée qui nous vient est que le défenestré a éventré son compagnon, puis dans un remords amoureux s’est jeté dans le vide. On a donc un homicide suivi du suicide de l’assassin. Ça semble être cela. Mais on est nauséeux. Dans un cas comme celui-là on aurait pu crever, en plus on n’a même pas mis notre pare-balles, depuis quand les morts gardent-ils chez eux des moribonds pour vous tuer ?
C’est quelque chose comme la fin de l’hiver et le début du printemps. La banlieue a des matinées humides et des après-midi où la chaleur monte déraisonnablement. Je suis dans la voiture pour rentrer, le Procureur semble séduit par nos déductions, mais je ne me sens pas mieux. Flic c’est être un homme ordinaire qui doit tirer au puits de son courage pour des combats qui n’en valent pas ou peu la peine, et ceux qui meurent en service chez nous, c’est toujours sur des trucs cons, pour des cas sociaux ou à cause d’un type bourré qui conduisait vite et qui vous fauchait alors que vous étiez en signalisation au bord de la route. Si je voulais un peu d’aventure en rentrant dans la police je ne connais en commissariat de banlieue que la détresse des gens, la violence de personnes au bout du rouleau, le racket de petites frappes qui aiment humilier et je ne suis finalement qu’un acteur dans des vies qui basculent. Un type qui doit prendre sur lui pendant qu’en face des paumés lui hurlent à la figure. Pas un aventurier comme j’avais souhaité. Si je dois risquer de crever, ça sera pour une intervention sordide chez des gens glauques.
Ma mauvaise humeur ne passe pas, comme celle de Gaétan d’ailleurs. On rentre pour finir de longs procès-verbaux relatant notre intervention. On a le corps plein dans le jus comme on dit, j’ai l’habitude de ça, je suis vraiment flic et pas grand-chose aujourd’hui ne m’étonnera ni ne m’écœurera à traiter. J’accepterai de travailler sur n’importe quelle affaire sordide sans rechigner ni soupirer, parce que je suis « dedans ». L’affaire m’a complètement dépucelé pour la journée, et je ne suis bien que dans la poisse de mon travail et bien dans ma peau de flic. Ce type qui n’aurait jamais dû être là aurait pu me tuer et est mort à mes pieds, j’ai son sang sur mon pantalon, et je n’ai pas envie de me changer. Je suis dans leur vie à tous les deux, et j’ai un peu de sa vie à lui sur moi, maintenant on est presque intimes, faut faire parler les cadavres voilà tout, je suis complètement immergé dans leur jus et dans ses boyaux, maintenant j’ai oublié nos risques parce que je suis happé par l’enquête. Et j’aime ça parce que je suis un flic. Cela sera une fois que je me retrouverai seul que je devrai faire face à ma conscience.
Je rentre chez moi un peu rêveur et j’égare mon regard dans les méandres des nuages, nous abordons le printemps et les grandes forêts encerclant la ville de Senlis s’étoilent de jonquilles. Je sens que dans ce boulot rien n’est certain, que contrairement aux autres professions on vit trop dans le présent, on a parfois l’impression qu’on peut rester marqué, blessé ou même y passer. La violence réveille les instincts de survie, c’est-à-dire votre vigilance, votre agressivité, votre peur et votre excitation. Le tout mélangé avec un des quatre qui domine les autres, pour sceller votre attention dans le présent. Je pense à Camille, je ne sais pas trop si je dois lui parler de cette affaire. Il y a quelques mois elle m’a annoncé qu’elle était enceinte. Elle s’était levée avant moi et était sortie de la salle de bains, son petit test rose dans la main avec deux barres de couleur au milieu. Je l’avais prise dans mes bras puis j’avais pris son visage dans mes mains pour lui dire que j’étais heureux, que je l’aimais et depuis nous vivons un nouveau bonheur parce qu’il est inédit. Nous découvrons ensemble sa grossesse, et nous sommes déjà habités par cette présence qui grandit dans son ventre.
Je rentre chez nous et tais ma journée à Camille. La soirée se passe sans rien de précis. Je ne veux pas regarder la télévision, je privilégie une écoute musicale avec des lectures de poésie. Cette nuit-là je rêve d’une journée graisseuse de pollution où les objets suintent de saleté poussiéreuse. Avec Gaétan nous montons à l’appartement comme de parfaits idiots qui à chaque étage se rendent compte de leurs oublis de sécurité et qui en rient alors que moi, observateur qui vis le rêve, je sens le danger, pas comme cet idiot de Barbicaut qui me fait l’effet d’un parfait abruti. Avant de frapper à la porte, celle-ci s’ouvre et une grande maigre habillée d’une aube à capuche noire nous fait signe d’entrer, le temps de voir dans sa capuche qu’il s’agit d’un squelette je vois au fond du couloir le type avec les boyaux au sol qui vide son barillet sur Gaétan et moi. Je le vois tirer distinctement et sens chacun des pruneaux me rentrer dans la viande, avec un sentiment d’impuissance qui fleurit à ma bouche un « merde ». Nous sommes perforés au niveau du ventre et on se vide de sang chaud ; au sol on glisse dans notre vie gluante et rouge et on se regarde avec Gaétan sans pouvoir parler, sans pouvoir se dire un mot, comme des poissons qui ouvrent la bouche, mais sont muets et je me réveille.
Je me lève et vais chercher entre les persiennes des volets le sillage de la lune. Je regarde notre bibliothèque et fouille quelques poèmes à lire pour rentrer dans le silence apaisé de la nuit comme un noyé s’enfonce et finit par se dissoudre dans l’eau claire. Le problème dans ce boulot c’est qu’on ramène un corps au système nerveux prêt à affronter n’importe quoi, mais qu’il est rarement au repos, je n’arrive pas toujours à éteindre l’énergie qui court sans cesse le long de mes nerfs. Il est 3H40. Je reste assis et nu afin que le froid m’engourdisse, et que mon corps avec une température plus basse glisse vers le sommeil. Je me rappelle qu’avant le dîner j’ai appelé Gaétan qui vit à Montmorency pendant que son ex-femme et potentiellement future se trouve à Bordeaux. Il a été désagréablement surpris comme moi, et même si une fois racontée cette affaire semble anodine, il faut l’avoir vécue et avoir vu les yeux de ce moribond se planter dans les vôtres avec le pouvoir qu’il avait sur vous de vous tuer, il fallait vivre cette surprise et voir qu’il bénéficiait de l’avantage de nous tuer en premier. Si nous sommes vivants, nous ne le devons qu’à lui. Gaétan me disait au téléphone qu’il avait des aigreurs d’estomac, probablement à cause des deux/trois bières qui avaient fait office de repas. Alors je lui avais demandé de quel type de bière il s’agissait, de pintes (50 cl) ? Ou de demis (25 cl) ?
— Plutôt le dosage anglo-saxon, avait-il dit en riant nerveusement. Évidemment que je bois des pintes, le demi est non-sens, m’avait-il répondu.
Je pense à cette conversation en lorgnant sur ma bouteille de cognac, mais je n’en ai pas envie. Je vois le halo de la lune surgir au-dessus des toits et des rares étoiles, le monde est silencieux et calme, pas comme celui des hommes. J’aimerais bien dormir, comme quand j’étais enfant. À quatre heures dix, je sens une vague engloutir mon corps et brûler mes yeux. Je vais me coucher mal dans ma peau.
***
Le lendemain en arrivant à l’étage des enquêteurs je croise la toute nouvelle commissaire toujours très pressée qui vient de donner ses consignes à mon commandant. Elle me salue d’un énergique :
— Bonjour, Monsieur Barbicaut.
Et j’entends ses talons résonner dans le couloir. Elle a mon âge, un cerveau qui carbure plus vite que la moyenne, mais elle a l’air humaine, enfin je veux dire pour un haut fonctionnaire. Disons que pour l’instant nous sommes tous en période d’observation mutuelle, mais la jeune commissaire n’affiche pas le complexe de supériorité propre à ceux qui se sentent appartenir à une élite. Je vois le Comanche qui me fait un clin d’œil.
— Les chiffres Barbicaut, c’est le nerf de la guerre pour les tauliers, elle est sympa la nouvelle taulière, mais bientôt elle va nous imposer ses exigences.
Je hausse les épaules à l’attention de mon chef d’unité ; faire le tampon entre les stats voulues par un commissaire et l’enquêteur comme moi c’est son job, et je lui laisse bien volontiers sa position hiérarchique. J’ai juste le temps d’avaler mon café pour ma première convoquée.
C’est une femme d’une cinquantaine d’années aux yeux très bleus et aux seins énormes qui éclatent son décolleté. Elle a fait exprès ? Je l’entends pour une affaire de chèques frauduleux qu’elle a faussement déclarés volés pour se sortir de ses fins de mois difficiles.
Le Comanche apparaît enveloppé dans son nuage de fumée et il tire sur sa pipe bruyamment. Avec ses yeux en amande, il attire l’œil de la femme. Alors, tout en malice, comme un acteur de théâtre se met en scène, il commence à louer ma jeunesse et mon sérieux, et pourquoi est-elle là, est-elle bien traitée à mes côtés ? remarque-t-elle quel officier exemplaire je suis ? Apprécie-t-elle mon charme d’homme jeune, mais déjà mûr ? Etc., etc., pour moi l’audition part à la rigolade, une fois qu’il comprend que cette affaire est mineure le Comanche nous fait son jeu. Je me retrouve malgré moi dans le rôle du jeune bellâtre plein de talents et elle roucoule devant les yeux bleus du Comanche qui s’éclairent d’une lumière amusée.
Il faut voir comme cette femme remue son postérieur sur sa petite chaise et comment ses hanches épaisses font onduler son opulente poitrine. Il faut dire qu’avec ses yeux bleus qui fixent ceux du Comanche il doit avoir les bourses à petit feu. Une vraie ode à l’amour, une vraie parade nuptiale que le Comanche aime orchestrer. Il me demande d’aller le trouver à l’issue de l’audition afin qu’il rende compte lui-même au magistrat. Puis il demande à la femme qu’elle vienne le trouver afin que lui soit notifiée la décision judiciaire.
Quand je rentre du sport un peu avant quatorze heures, je vois sortir discrètement du bureau de Comanche, anormalement fermé, ma mise en cause décoiffée, qui s’enfuit avec des pas d’oiseaux dans le silence du couloir des enquêteurs. Alors je vais trouver mon chef, que je trouve rayonnant de bien-être encore enveloppé dans sa fumée avec un air qu’il veut méditatif. Je lui lance :
— Alors ? Vous venez d’approfondir ses aveux ?
Il éclate d’un rire contenu pour rester discret, mais qui secoue sa poitrine et ses yeux regorgent de larmes. Il aime l’autodérision et le comique de la situation.
— J’ai été sérieux, je l’ai bécotée et je lui ai tripoté les nichons, répond-il en remuant des mains ouvertes qui caressent une forme invisible. Elle a les tétines énormes, j’avais l’impression d’être un nouveau-né à la tétée.
Il me dit ça en ouvrant ses yeux puis tire sur sa pipe pour sourire silencieusement. Fin de l’entrevue.
Y a un truc qui est vraiment important dans la vie et que trop peu de philosophes ont su mettre en lumière. On trouve cette recette de bonheur commentée dans un bouquin de Kenneth White, un poète que je découvre avec un plaisir glouton dans son livre « la maison des marées ». Cet auteur a très justement loué le western, en ce qu’il montrait le cow-boy disparaissant dans les grands espaces au soleil couchant. Le poète qui vante les vertus de la rencontre entre l’homme et la vie sauvage me fait du bien alors que les intellectuels français anémiés tournent en dérision cette fresque en cliché. Je ne suis pas étonné de savoir que Kenneth White est écossais et dépourvu des préjugés dégénérés français.
Moi j’ai une façon toute personnelle de vivre cette grande rencontre. Les soirs ensoleillés et sans nuages j’embarque Camille dans la voiture, et j’emprunte souplement des routes bordant les forêts ou débouchant sur les plateaux d’où nous pouvons voir les villes et les collines, mais, et c’est ma touche personnelle, en sirotant une ou deux bières (moi je tourne au demi et pas à la pinte). Rouler et boire une bière est une expérience de premier ordre je veux dire, sortir le bras dans la douceur de l’air et tenir une bière fraîche pendant que la voiture vous promène à 50 km/h est un exercice de contemplation. Ensuite, s’emporter un truc à frites et attendre que le soleil se couche vous remet les idées à l’endroit. Les étés souvent je nous conduis au bord des champs de maïs et nous attendons que les canons à eau arrosent la voiture dont on laisse les vitres ouvertes. Comme ça on rit comme des gosses, et la terre remonte par la fenêtre avec ses odeurs d’argiles poussiéreuses et mouillées ; ça, c’est une communion. Et c’est ce genre de recette qui me remet d’aplomb.
J’en suis là à rassembler ces pensées décousues, assis à mon bureau, un recueil de poésies de Kenneth White entre les mains et les pieds posés sur ma fenêtre, face au crépuscule qui recouvre la ville d’un dôme de pourpre tendre quand mon téléphone sonne. Je remarque juste que l’auréole orange des lampadaires caresse le ciel violet du soir.
— Oui ?
— Lieutenant, c’est vous de perm ?
— Oui, ça vient de changer, c’est encore moi.
— Bien, y a une demande bizarre, on a eu un appel 17 pour un truc tombé en bas d’une tour. Le témoin est confus et parle d’un chien ou d’un chat, et là j’ai plus de patrouille police secours disponible, la dernière est partie au tribunal.
— C’est une blague ?
— Il commence à y avoir un attroupement et des cris au square du nord de la cité. C’est là que s’affrontent tous les Congolais et les Maliens. Ils ne vont pas tarder à s’entre-tuer pour une bête tuée ou sacrifiée. Vous vous sentez d’y aller, ou je laisse faire ?
— Bon, je prends un collègue et on va y jeter un œil, y aura du renfort s’ils décident de me sacrifier ?
— J’ai la Brigade Anti-Criminalité qui prend son service dans trente minutes, dès qu’ils sont dans les locaux je vous les envoie comme une balle de fusil. À mon avis ils seront assez forts pour vous extraire de la foule.
— Ça marche.
Je pose mon livre de poèmes près du crâne de chien qui orne mon armoire de vestiaire, il a un pétard bourré de cannabis entre les canines et des médailles de course dont les rubans sont accrochés à la mâchoire. Une mousse décore son globe oculaire et j’ai remarqué que ce crâne a toujours l’air de se marrer, comme s’il me surveillait depuis l’au-delà d’une bienveillance pleine de recul avec une dose d’humour noir, oui c’est ça ; comme s’il savait ce qui m’attendait dehors, mais qu’il serait là à mon retour, fraternel, mais ironique, parce qu’à la fin on finit tous les os blanchis. Je me retiens de répondre à ses muettes provocations sarcastiques parce que je tomberais dans son piège. Je prends mon calibre, un vieux revolver 38 spécial dans un étui en cordura que je fixe à ma ceinture. Qui reste-t-il chez les enquêteurs à cette heure du soir ? Lolo, mon pote juif qui a grandi dans les cités de Sarcelles, un type débrouillard et filou qui a trop de personnalité pour être le fonctionnaire robot pensé par les énarques, et c’est justement sa débrouillardise systématiquement en infraction au code de déontologie qui fait de lui un des meilleurs, ou plutôt un flic un vrai, et pas un fonctionnaire.
Après lui avoir expliqué, il me sourit :
— Tu sais que j’ai une hôtesse de l’air à voir avant vingt et une heures ce soir ?
— Promis, on ramasse le chat crevé et on calme la foule.
— Ah bon ? T’as vu l’heure qu’il est ? Tu sais ce qu’ils ont pris tout l’après-midi dans ce quartier-là ? Depuis quand t’arrives à calmer une foule de types bourrés et shootés en colère ?
— Eh bien, j’ai mon charisme, dis-je en haussant les épaules.
Lolo me sourit.
— Attends. Je nous prends une assurance.
Il sort de son armoire un fusil à pompe, une vieille prise de guerre qu’il alimente avec des cartouches gomme-cogne, des balles en caoutchouc, et la présence de Lolo dans un quartier avec son fusil cracheur de feu suffit à disperser n’importe quelle foule enragée.
En arrivant sur place, je comprends juste qu’on va avoir besoin de la Brigade Anti-Criminalité dès qu’elle prendra son service, la fameuse « BAC ». Il y a beaucoup trop de monde dehors qui se bouscule. Ce n’est plus un groupe, mais une foule qui ne cesse de grossir. Je mets mon brassard Police sur mon cuir marin en endossant ma gueule des mauvais jours. C’est quand j’avance vite vers le centre de l’attroupement, Lolo sur mes talons, que soudain les gens se taisent en me voyant, ce qui crée une étrange atmosphère insurrectionnelle tant l’air électrique est anormalement silencieux. Alors je comprends. La lune se penche entre deux lampadaires pour me désigner ce qui gît sur l’asphalte entre des papiers gras et des ordures, et c’est à partir de là que mon esprit m’échappe. Ce que je vois génère en moi quelque chose d’impérieux où je ne comprends plus tellement ce que je fais, car ce sont mes réflexes qui prennent le relais. Je dis juste à Lolo, « tiens-les tous en respect et tire dans le tas au premier qui s’approche ». Mais aucun ne bouge. J’ai dit ça d’une voix glaciale pour alerter mon ami qui brandit aussitôt le fusil vers la foule. Pourtant, personne ne réagit à ma provocation tant ils sont implicitement d’accord. Tant ils partagent mon émotion. J’entends Lolo dans mon dos qui regarde enfin au-dessus de mon épaule et qui comprend. Mes yeux brûlants m’empêchent de bien voir, c’est juste le temps nécessaire à mon corps pour s’habituer à la violence et au stress. À une situation de colère et de tristesse. Alors je serre les mâchoires parce qu’elles se mettent à trembler malgré moi. Je sais que je suis trop sensible, trop humain pour ce boulot. J’ai trop envie d’aider les gens, c’est mon talon d’Achille, mais c’est aussi et surtout mon moteur, et probablement la source de ma vocation.
Un homme me désigne simplement le haut de la tour de son doigt en marmonnant « c’est tombé sans bruit ». Accroupi, je regarde le corps sans vie. Il devait avoir quoi ? Trois ans peut-être. Un petit enfant noir intact, son visage tourné vers moi les yeux ouverts, la bouche entrouverte et ensanglantée ; les organes ont explosé à l’intérieur sous le choc. On dirait un ange endormi sous un rayon de lune. Je m’accroupis au plus près. Les gens sont autour de moi et retiennent leur souffle, la foule semble être devenue un animal composé de tous ces passants que la colère a aggloméré en monstre vengeur. Alors je prends délicatement l’enfant dans mes bras sans réussir à contenir une larme, bien que je me force à rester silencieux. Les membres sont désarticulés, comme ceux d’un pantin. Ça fait trop de choses comme ça que je vis au quotidien. Lolo prend le relais et interroge les témoins, relève les identités. Je pleure intérieurement la mort de ce gosse parce que c’était de notre devoir à tous d’en prendre soin, et peut-être aussi parce que je suis trop émotif en cette période où j’attends la venue de mon premier bébé. Je fends la foule silencieuse avec l’enfant mort dans mes bras entre des regards qui m’observent, c’est comme si chacun était devenu muet, que la colère avait fait place à une forme de sidération, et je me dirige vers l’immeuble. Je regarde le visage tendre du mort ; il devrait être au chaud chez lui et grandir dans une bulle d’innocence, et je le tiens aussi précautionneusement que possible ainsi que je le ferais s’il avait été endormi et que je le conduisais dans sa chambre.
Lolo me suit ainsi qu’une délégation de témoins qui se tient derrière moi comme des gens prêts à exploser. Je ne gère plus rien, je le sais. Je porte simplement le garçon mort pour retrouver le foyer duquel il est tombé. Je sonne à chaque appartement pour demander si l’enfant habitait dans ces lieux. Ainsi je renouvelle ma demande à chaque porte, à chaque étage. L’opération s’avère assez longue, pourtant on est tous silencieux, même Lolo a l’air marqué, et tout ce temps l’enfant reste dans mes bras, comme s’il dormait. J’ai sa bouche posée contre mon cuir de marin où elle pose des gouttes de sang, des larmes d’ange. Les gens qui ont vu la chute restent derrière moi, ils veulent connaître les raisons du drame. Heureusement que Lolo reste dans mon dos et les tient implicitement en respect avec son fusil. Il a fait un premier compte rendu radio à la salle de commandement qui m’envoie du monde dès que possible. Il a appelé le médecin et les pompes funèbres.
Pendant ce temps-là, silencieusement et invariablement, je me rends à chaque porte pour sonner, et je présente le corps dans mes bras pour m’entendre dire « non, l’enfant n’habite pas ici monsieur, c’est grave ? ». J’ai chaud, la tristesse est une force invisible qui m’écrase. Enfin, à l’avant-dernier étage je frappe et quand la porte s’ouvre je comprends que je suis au bon endroit. Un nuage épais de fumée sort sur le palier. Des silhouettes dansent dans l’appartement plongé dans une semi-obscurité, on dirait des corps qui ondulent lentement et langoureusement. La personne qui m’a ouvert n’a pas toutes ses facultés, je le vois à son œil engourdi et à sa paupière lourde. C’est une femme fatiguée d’une quarantaine d’années qui reconnaît l’enfant, mais qui ne comprend pas ce qu’il fait là, ni ce que je lui veux. Alors je rentre.
Il y a des bouteilles partout par terre. Des bougies qui dégueulent de cire sur toutes les tables. Des femmes et des hommes torse nu qui dansent, des foulards colorés déposés sur les tables. Alors je crie :
— Est-ce que cet enfant vivait ici ?
Dans mon dos Lolo s’est mis en travers de la porte et empêche la délégation de témoins de rentrer de peur d’un lynchage. À l’intérieur les murs sont sales et une odeur nauséabonde se mêle aux parfums des corps en sueur. Il y a des plats posés sur des tables basses et de la nourriture par terre, et à côté des gens qui dansent pieds nus.
J’ai un athlète visiblement défoncé par autre chose qu’un marathon qui s’approche. Il a des dorures sur les dents, des bagues décoratives pour faire peur aux gens, j’imagine, et séduire les dégénérés dans son genre. Il regarde de haut mon brassard police et me lance un œil rempli de dégoût. Je lui ordonne d’arrêter la musique. Il me toise comme s’il allait exploser de méchanceté et s’éloigne en m’ignorant, le regard méprisant. J’ai cette boule de tristesse qui grossit et qui embue mes yeux, des larmes doivent s’en échapper certainement, tout le monde ici est très occupé à s’enivrer jusqu’à laisser mourir un enfant. Je dépose alors son cadavre sur un canapé où est avachie une femme en soutien-gorge et j’arrache les prises électriques de la chaîne hi-fi pour avoir toute l’attention des occupants. Puis j’allume le plafonnier. Un étonnement ouaté se lit sur des visages déçus. Une noire me fait un doigt d’honneur en tirant la langue, puis part lentement avec une mine boudeuse.
Je me dirige d’un pas pressé vers le connard qui me tourne le dos, il est torse nu avec des muscles aussi développés que les miens, mais bien plus secs, et quand il se retourne vers moi je ne contrôle pas mon poing lancé avec toute la vélocité de mon épaule dans un mouvement de hanche, comme m’avait appris un prof de boxe française, à la façon d’un fouet, et sous la violence de l’impact je m’écorche les jointures contre la ferraille de ses dents. Je ne maîtrise pas non plus la menotte que j’ai prise autour de mes doigts pour en faire un poing américain avec mon autre main, et tandis que je m’approche du type encore sonné, qui me sourit la bouche pleine de sang je le frappe à nouveau sur la pommette d’un direct ; mais Lolo crie soudain dans mon dos :
— Allez, ça suffit, les mains en l’air et face au mur.
Le grand balaise pisse le sang, et il a vraiment l’air heureux qu’on en vienne à cette sauvagerie. Il se met en position de garde. J’ignore pourquoi j’ai envie de me battre contre lui, sinon pour le punir de son mode de vie ayant conduit à la mort de l’enfant que je tenais dans mes bras il y a deux minutes encore. « La banlieue fait de moi un type comme lui », c’est que je me dis quand j’évite son premier coup de poing, mais pas le coup de genou de ce type qui remonte vers mon ventre. Voilà, on a mal tous les deux, et on est vraiment en train de devenir des bêtes. Finalement, j’explose, je serre son cou sous mon bras en guillotine pour garder son torse à hauteur de mes genoux et l’en matraquer, au bout du troisième coup, je renverse mon adversaire sur le dos. Je sais que je cherche à le punir d’un acte qu’il n’a pas peut-être pas commis. Est-ce que c’est ça une folie aveugle ? Meurtrière ? Je m’assois sur lui, mais Lolo me gueule dessus :
— Hugues, qu’est-ce que tu fais ? Merde !
C’est là que j’entends la sirène deux tons de la BAC en bas de l’immeuble.
Je me relève étourdi, je tends ma main vers le black qui l’accepte, et je l’aide à se relever en le hissant près de moi. On dirait qu’on est devenus amis, que nos présentations viennent d’être faites. Il me sourit avec du sang plein ses bagues dorées. Et si je fais partie de son monde à présent, je réalise soudain que je quitte le mien à la dérive.
Le lendemain matin, je regarde mon poing aux jointures écorchées assis dans le bureau de la commissaire, que tous les flics appellent « la taulière ». Évidemment je ne l’écoute pas ou alors distraitement, tandis qu’elle me remonte les bretelles. Je me rappelle de Trop Chaud de la BAC qui est venu poser sa main sur mon épaule quand il est rentré dans l’appartement, il avait l’œil enflammé avec cette lueur verte qu’il a quand il goûte à la violence. Avec lui Damou avait sa matraque tonfa et son grand calme pour sécuriser les lieux, tandis que Lolo relevait les identités sur place.
J’entends la logorrhée de ma commissaire sur la déontologie et la maîtrise de soi sans l’écouter. Je suis abasourdi par ce drame. Lors de leur orgie, les adultes ont oublié le gosse, ou alors ils n’étaient pas en état de surveiller un enfant qui est tombé du 7e étage. « Il n’est pas monté au 7e ciel », m’a dit une des femmes présentes dans l’appartement quand je prenais ses déclarations.
— Vous m’écoutez, Barbicaut ?
Ma commissaire s’agace.
— Oui, Madame.
— Je sais que l’intervention a été difficile, mais là vous avez perdu votre sang-froid.
— Oui, ça ne se reproduira plus.
Hier soir, après ma douche et avoir pris soin de taire mon intervention à Camille, elle m’a montré son ventre énorme qui ondulait sous les coups de pied du bébé. Et elle a souri. J’ai pu toucher son ventre et sentir les mouvements de notre fils contre ma paume. Et j’en ai eu les yeux brillants de joie.
— Allez-y, racontez-moi votre version, je vous écoute, Monsieur Barbicaut.
— J’avais cet enfant mort dans les bras, et il y avait ce grand type qui avait un look de dealer.
— Qu’est-ce qui vous permet de dire qu’il avait un look de dealer ? Soyez objectif, je vous prie.
— Musclé, torse nu, des bagues dentaires sur les dents, l’air agressif et méprisant. Un type qui impose sa loi aux autres à cause de son physique et de son agressivité, ça vous va ?
— Ça me va, oui, mais est-ce que ça irait au Procureur s’il saisissait l’Inspection Générale de la Police Nationale ? Mais ce dealer, puisque nous savons que c’en est un au regard de ses antécédents judiciaires, ne dépose pas plainte contre vous, alors vous passez entre les gouttes. Vous comprenez ? Je vous dis ça parce que vous mettez votre carrière en danger. Contrôlez-vous ou vous ne vaudrez pas mieux qu’un voyou de banlieue.