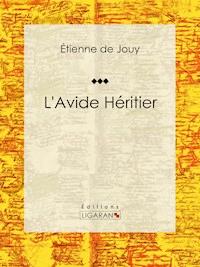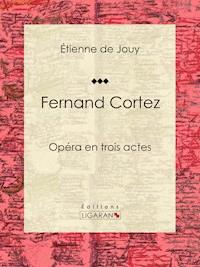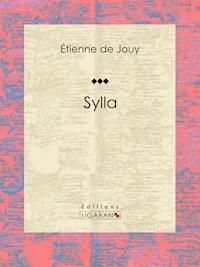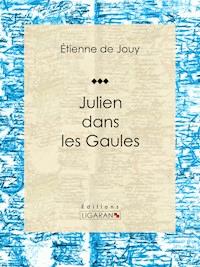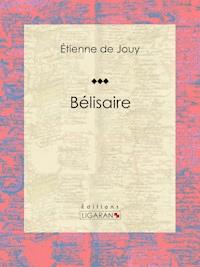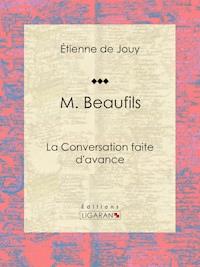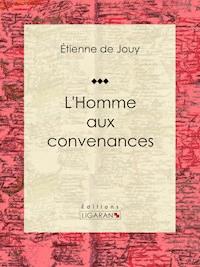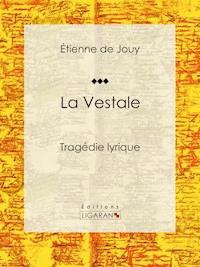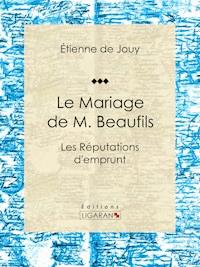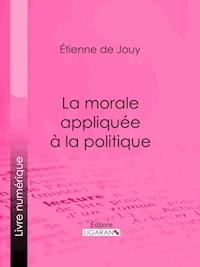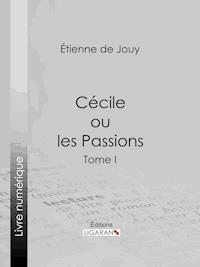
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Tu crains, dis-tu, de me fâcher, ma bonne petite Pauline, en continuant à te moquer de ce comte de Montford, que tu t'imagines devoir être un jour mon époux. Tes craintes sont mal fondées; tu peux te livrer tout entière à tes pensées malignes ; poursuis, ma bonne amie, et souviens-toi qu'il y a deux choses décidément impossibles : la première, que Cécile cesse d'aimer Pauline ; la seconde, qu'elle s'appelle jamais comtesse de Montford."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Jacques publia la Nouvelle Héloïse, parce qu’il connaissait son siècle, et que les mœurs de son temps l’engageaient à faire paraître un roman d’amour, sous les auspices d’une cour galante et d’un public frivole. Si je livre à l’impression les Lettres suivantes, c’est au contraire malgré les mœurs qui m’environnent ; c’est, j’ose le dire, contre le mouvement même du siècle et la tendance des esprits.
Une marche rapide, violente, a entraîné, depuis trente années, la société entière à travers tous les écueils. Deux passions dont le prix est de valeur inégale, mais également séduisantes pour les âmes élevées, la liberté et la gloire, ont enivré tour-à-tour le peuple le plus mobile et le plus passionné de l’Europe. Les évènements se sont pressés ; les chutes, les triomphes, les revers des partis, les défaites inattendues, les espérances trompées, les regrets amers, les dévouements héroïques, les défections, les bassesses surprenantes ; tout ce que madame de Sévigné nommait ces grands étonnements des peuples, se sont multipliés sous nos yeux. Cette éducation politique donnera ses fruits plus tard ; et tout porte à croire que ses leçons ne seront point perdues. Mais dans le moment où j’écris, un sol si longtemps agité n’a pu se rasseoir encore ; les esprits ébranlés violemment ont conservé quelques traces de l’impulsion fébrile que la révolution leur avait communiquée. On peut le dire sans exagération, la négligence de l’avenir, la précipitation des jugements, la légèreté des actions, le besoin de jouir vite, l’impatience enfin, sont les principaux caractères de cette époque, qui succède immédiatement à la plus grande secousse que le monde moral et politique ait éprouvée. Il semble que l’on redoute un nouveau caprice de la fortune, et que l’on se hâte de vivre. Les entreprises qui demandent de la patience et de longs travaux ne trouvent plus d’hommes assez courageux pour s’arracher aux délices du présent, et préparer les succès futurs. On ne gagne plus l’opulence ou la renommée, on veut les conquérir. Cette précipitation inquiète envahit tout le corps social et domine toutes les intelligences. Les jouissances de l’esprit elles-mêmes se sont empreintes de ce caractère de l’époque.
Si madame de Sévigné faisait ses délices de la lecture aride du métaphysicien Descartes ; si les têtes les plus frivoles de son temps connaissaient la philosophie de Gassendi, dont Ninon de l’Enclos était la première prosélyte ; c’est qu’une certaine stabilité dans l’état social, achetée il est vrai par une humiliante compensation, la servitude, engageait les esprits à se nourrir d’aliments solides, et favorisait le besoin d’étudier et de connaître. Les loisirs des grandes dames acceptaient pour amusement les détails fastidieux dont La Calprenède remplissait ses romans in-quarto ; la patience des lecteurs du dix-septième siècle ne peut se comparer qu’à l’avide impatience des lecteurs du dix-neuvième. Aujourd’hui tout développement fatigue ; les incidents doivent se succéder comme les vagues de la mer, pour que le livre ne soit point rejeté à la dixième page ; à peine permet-on à un caractère de se dessiner, à une passion de se montrer, que l’on veut de nouvelles passions et de nouveaux caractères. L’analyse des sentiments paraîtrait insupportable ; l’éloquence du cœur n’arriverait elle-même à l’esprit que si, à force d’art ou d’audace, on la jetait pour ainsi dire à l’improviste, au milieu du fracas des évènements. Le public ne demande aux écrivains que de tromper son ennui par cette variété de tableaux qui frappent l’imagination, comme les décorations de l’Opéra frappent les sens. Étrange situation de la littérature, dont une sévère misanthropie accuserait la vieillesse d’un siècle blasé, mais que je me contente d’observer comme le résultat nécessaire des longues inquiétudes, du déplacement de tous les intérêts, de l’incertitude de toutes les existences.
Le roman par lettres était précisément le genre d’ouvrages dont la vogue devait s’affaiblir davantage, au milieu d’un public ainsi disposé. Ces détails de mœurs, ces peintures de sentiments, ces analyses de passions qui constituent la perfection du genre où Richardson et madame Cottin ont excellé, échappent au coup d’œil rapide qu’une attention fugitive accorde maintenant à ce genre d’ouvrages. C’est cependant, je l’avoue, une série de lettres que je publie : s’il y a quelque témérité dans cette tentative, ce n’est pas sans avoir réfléchi à cette espèce d’imprudence, et au goût particulier de mon temps, que j’ai osé la commettre.
Après avoir examiné comment l’état moral de l’Europe avait influé sur les plaisirs de l’esprit, cherchons, dans la nature même du roman, si l’antipathie que j’ai signalée contre le roman épistolaire est fondée sur la raison ou née d’un caprice du public. Je ne me permettrai pas de remonter, comme l’évêque d’Avranches, jusqu’à Mathusalem pour trouver l’origine des romans ; mais il ne sera pas inutile à la question que je traite de chercher comment s’est établi, chez les nations modernes, le succès de ces fictions que le génie inventa, et que l’ancienne civilisation ne connaissait pas.
La vie des nations fut d’abord héroïque et mythologique. Quand la société grossière se formait, les dieux étaient sans cesse présents à ces imaginations ardentes et crédules, et l’intervention des êtres surnaturels dut se mêler à la narration des faits sublimes, au récit des exploits accomplis par les hommes. L’épopée d’Homère est le roman de ces vieux âges. L’homme, aidé par une industrie naissante et luttant avec la nature, n’avait pas encore assez de confiance en ses forces pour être le héros de ses propres récits. Minerve, Apollon, Vénus, protégeaient sa faiblesse et planaient sur le champ de bataille, sur le palais des rois, sur l’autel des sacrifices. Les mœurs, les passions, les vices des hommes, dépendaient de la volonté toute-puissante des divinités. Si la vertu ou le courage élevaient un mortel au-dessus de ses semblables, aussitôt il cessait d’être homme, il était dieu.
La société politique naquit ; et le roman ne put éclore, ni chez les Hellènes, ni chez les Romains. La vie civile absorba tout. On ne fut spécialement ni orateur, ni poète, ni jurisconsulte, ni sophiste, ni général ; on fut citoyen. La maison devint l’asile des plus vulgaires nécessités de la vie ; le Forum ou l’Agora étaient la véritable demeure de tout citoyen de Rome ou d’Athènes. L’existence des femmes, sans éclat et sans intérêt, se bornait aux soins du ménage et à l’éducation des enfants. Plus il y avait de simplicité, peut-être de grandeur dans cette manière d’envisager la civilisation, plus elle s’éloignait de celle qui devait donner naissance au roman. La peinture des mœurs privées aurait paru puérile, dans un temps où Ion ne connaissait que les mœurs publiques. L’imagination des poètes enfanta des fictions épiques, dont les dieux et les demi-dieux étaient les acteurs ; ils ne pensèrent jamais à choisir pour texte exclusif et particulier les peines et les plaisirs de l’homme, ses joies domestiques, encore moins l’observation délicate de ces nuances de passion, qui s’effaçaient dans le grand mouvement des esprits et des affaires. Cependant le luxe, en s’étendant, éteignit peu à peu cette flamme patriotique qui animait la société. C’est quand la vie civile des sociétés antiques commence à disparaître, que le roman commence à se montrer. Les Asiatiques, dans leurs fables milésiennes, racontent les aventures d’amants malheureux, que le sort sépare et réunit tour à tour. Pétrone, qui semble avoir écrit son ouvrage sous les Antonins, et non pas sous Néron, s’amuse à retracer, avec la naïveté du vice et l’élégance d’un homme de cour, les scènes d’une vie dissolue. Le platonicien Apulée, dans une allégorie à laquelle il mêle des récits de mœurs populaires, et dont le fond est emprunté aux Grecs, se moque des sorciers et des prêtres. Au temps où florissait Lycurgue, où tonnait Démosthène, où Rome écoutait Cicéron, qui aurait prêté l’oreille à ces narrations ingénieuses ? On n’a pu trouver quelque plaisir dans ces premiers essais de l’art du romancier, qu’au moment où les peuples, voyant leur existence sociale détruite, perdirent de vue les intérêts de la liberté et de la patrie, et se réfugièrent au sein de la famille.
Le roman fut, pour ainsi dire, le dernier produit, le résultat définitif de la civilisation. Le christianisme changea le sort des femmes, et rétablit l’égalité entre elles et le sexe plus fort qui n’avait cessé de les tenir dans une servitude domestique. La passion de l’amour se développa sous toutes ses formes. Les mœurs antiques, si simples et si grandes, furent remplacées par une Complication d’intérêts que la féodalité vint encore embrouiller. C’était un mélange de liberté tyrannique, de servitude oppressive, de platonisme et dépassions brutales, de dévotion et de crimes, un chaos qui n’était pas sans quelque grandeur, et dont la nuit profonde fut sillonnée par des vertus éclatantes. L’étude des hommes devint plus difficile et plus intéressante, comme une matière plus complexe et plus hétérogène offre plus d’attrait aux expériences du chimiste. Quand tous ces éléments disparates se confondirent, quand la société reprit une situation fixe, sous la monarchie absolue de Louis XIV, les souvenirs et leur influence modifièrent la littérature. Il n’y avait plus pour les sujets, ni patrie, ni esprit national, ni intérêt public : le roman véritable, celui qui retrace les faiblesses et les passions de l’humanité, s’éleva naturellement du sein de la société même.
Je ne m’arrêterai point sur les essais des écrivains diffus, qui commentèrent, en style de plaidoirie, les chroniques anciennes des exploits de Roland et d’Amadis. La chevalerie était éteinte ; son souvenir avait du prestige ; les romanciers essayèrent de s’en emparer. Ce genre devait avoir quelque succès sous le règne d’un monarque dont le despotisme s’environnait encore d’une sorte de majesté chevaleresque. L’empire des femmes n’avait cessé de s’agrandir ; elles furent les créatrices du roman de passions. On n’avait pas tenté d’analyser le cœur humain, dans ses émotions les plus tendres, de donner pour seuls mobiles à une fiction les développements et les combats de l’amour, avant madame de La Fayette. D’Urfé, peintre fade d’une passion monotone et fausse, n’avait donné au public qu’un tableau sans vie, et pour ainsi dire monochrone, d’une seule teinte langoureuse et fatigante : le besoin de ce genre d’ouvrages se faisait dès lors si vivement sentir, que tout cet ennui, distribué en douze volumes, avait joui d’une grande réputation, et trouvait partout des lecteurs, avant que la femme spirituelle que je cite n’eût publié sa Zayde.
Telle est, je crois, la naissance du roman. C’est de la vie privée qu’il s’occupe, c’est dans les secrets replis du cœur qu’il descend. Madame de Tencin et plusieurs autres écrivains de la même époque montrèrent un rare talent d’observation, une extrême finesse de vues, dans le genre que madame de La Fayette avait créé. Cependant il était réservé à un homme de reproduire toute la société moderne dans un roman : cet homme est Le Sage. Aucune émotion du cœur, aucune des variétés de la passion de l’amour, n’avaient échappé aux femmes dont je parle : aucun des vices de nos mœurs, aucun des ridicules de nos sociétés modernes, ne restèrent cachés à l’auteur de Gil-Blas. Il créa le roman des mœurs. Ce La Fontaine des romanciers, naïf par la force même et la franchise de son génie, varié comme la vie humaine, instructif comme l’expérience, est à la fois triste et plaisant comme elle.
Les Anglais, qui avaient combiné par un singulier bonheur l’esprit national et le patriotisme antique, avec l’aristocratie née de la féodalité, eurent à la fois des mœurs publiques et des mœurs privées, mélange inconnu aux anciens. Un climat sombre les forçait de se réunir plus souvent sous le toit de la famille, et leur inquiète indépendance se serait révoltée contre l’inquisition hardie qui eût osé violer le secret de ce sanctuaire. Ils créèrent un mot pour exprimer tous les plaisirs du coin du feu, tout le bonheur de la propriété, toute la liberté d’action qu’ils voulaient conserver dans leur vie privée ; c’est le home, le chez soi, terme ignoré du reste de l’Europe, et qui ne pouvait être que l’idiotisme spécial de ces insulaires. Le roman consacré à retracer les mœurs intimes se développa rapidement chez ce peuple ; et il faut avouer qu’il excella dans un genre qu’il aurait créé, quand même les nations étrangères n’en eussent pas conçu la moindre idée, et ne lui en eussent pas fourni le premier exemple.
Aussi vit-on paraître en Angleterre des peintures sans nombre de ces coutumes privées, de cette intimité domestique à laquelle on attache tant de prix ; et tandis que Le Sage renfermait en trois volumes les leçons les plus plaisantes et les plus profondes de l’expérience sociale, les portraits les plus frappants de tous les travers de nos mœurs, Richardson, certain de plaire à ses concitoyens, écrivait l’histoire d’une famille comme on écrivait l’histoire universelle : n’oubliant aucun détail, ne faisant grâce au lecteur d’aucune particularité ; vrai et minutieux comme la nature, bavard et incorrect comme la passion ; ne vivant pour ainsi dire que de la prolixité même de ses détails, et trouvant le secret d’attacher ceux qui le lisent en délayant en huit volumes le simple récit d’une séduction.
Diderot, dont le génie brûlant s’enflammait comme la lave et roulait comme elle des torrents de feu, mêlés de scories, a consacré à Richardson un dithyrambe en prose dont l’exagération a rendu moins plausibles les justes éloges qu’il renferme. Si l’on veut entrer pour ainsi dire dans le génie des mœurs anglaises, et considérer la famille comme le théâtre le plus intéressant pour l’homme, comme un drame dont la plus petite scène a du prix, on admirera chez Richardson la sagacité de l’observation, le coup d’œil vaste et varié du peintre, l’imitation exacte des tons les plus divers, la fidélité parfaite des détails, l’admirable unité des caractères, la vérité de tous, la profondeur de quelques-uns. C’est Richardson qui a donné au roman de mœurs, non la perfection la plus haute sous le rapport du goût, mais le plus de portée et d’étendue : c’est chez lui que se sont reproduits avec le plus d’exactitude et de variété ces détails de mœurs intimes, qui constituent le roman moderne.
Ses admirateurs l’ont comparé à Homère ; sans discuter la justesse d’un parallèle aussi ambitieux, avouons qu’il a porté dans ce poème épique des mœurs privées les longueurs, la force de tête et l’éloquence naturelle qui distinguent le chantre des temps mythologiques de la Grèce ; il est assez bizarre que l’on puisse établir une sorte de comparaison entre le génie poétique du barde ancien, et le génie observateur et éminemment prosaïque de fauteur de Clarisse Harlowe.
Richardson comprit la nécessité de ne point donner à ses romans la forme d’une narration racontée par l’écrivain. Le romancier ne devait jamais paraître dans ses ouvrages ; c’était la nature même, les caractères des hommes, leurs passions réelles, les secrets ressorts de leurs pensées qu’il voulait reproduire. Il laissa parler ses personnages. Chacun rapporta sa propre histoire, fit la confidence de ses sensations, déposa pour ou contre lui-même. C’était entrer profondément dans le génie du roman moderne. C’était faire pour ainsi dire un nouvel emploi de l’art dramatique. Chaque lettre du roman, contenant une espèce de monologue, initiait le lecteur aux secrets les plus intimes de chacun des acteurs du drame. Lovelace révélait sa propre perversité ; l’amour caché de Clarisse pour le séducteur se trahissait malgré les efforts de sa vertu ; et la correspondance triviale des personnages subalternes assignait aux personnages principaux le degré d’estime, de considération où Richardson avait jugé convenable de les placer : vaste machine, dont la conception atteste le génie de celui qui l’a créée, et dont l’exécution offrait des difficultés presque insurmontables.
À peine les maîtres de la scène sont-ils parvenus, dans quelques-uns de leurs chefs-d’œuvre, à s’identifier complètement avec l’esprit et le caractère du petit nombre de personnages qu’ils plaçaient dans leur drame. Plus de soixante individualités différentes, toutes empreintes de caractères opposés, se présentaient au romancier anglais. Il s’agissait de leur faire parler leur propre langue, sans confondre jamais leurs mœurs, leurs habitudes, leur idiome. On ne peut refuser à celui qui a réussi dans une telle entreprise un rang parmi les hommes de génie.
J’ai cherché à prouver que la forme épistolaire était essentiellement convenable au genre du roman. Né de la complication des intérêts sociaux, et du besoin de voir retracés à la fois la diversité des caractères humains, et les mouvements secrets du cœur dans la vie privée, il s’approche davantage de la perfection, à mesure qu’il est plus naïf. Quand l’auteur se montre, quand un récit, même vraisemblable, laisse soupçonner une fiction, ce caractère de vérité entière s’affaiblit. Le roman est l’étude de l’homme social ; c’est en l’écoutant parler, en le voyant agir, que cette étude peut devenir réelle et profonde.
Fielding, au lieu de suivre la route tracée par Richardson, imita les formes adoptées par Le Sage. Il peignit les masses de la société, esquissa des caractères généraux, et raconta les évènements de la vie de ses personnages avec une énergie et une vérité qui le placent immédiatement après le peintre de Gil-Blas.
Plus la civilisation faisait de progrès, plus le roman acquérait d’influence. Il devint la lecture favorite de toutes les classes de la société, et marcha de pair avec le drame. On le vit emprunter toutes les formes : Sterne y esquissa, sous des traits fantasques, les bizarreries du cœur humain ; Voltaire en fit la satire et le châtiment de tous les vices qu’entraînent la superstition et l’immoralité politique ; Rousseau, doué d’un génie plus austère, osa l’élever à la dignité d’une œuvre philosophique.
On reconnaît aisément, dans la Nouvelle Héloïse, le mélange et la fusion de plusieurs conceptions diverses. Jean-Jacques, séduit par la prodigieuse variété des personnages mis en scène par Richardson, voulut aussi que ses acteurs rendissent compte eux-mêmes de leurs émotions et de leurs sentiments. Il plaça la scène de l’Héloïse dans une solitude complète, pour que ses héros, éloignés des préjugés et des habitudes dont on ne peut s’affranchir dans les grandes villes, développassent sans réserve et sans crainte les dogmes hardis d’une philosophie nouvelle, et les paradoxes qu’une vie retirée rend moins étranges aux yeux de ceux qui les soutiennent. Madame de La Fayette avait peint les délicatesses de l’amour chez les personnes d’un rang élevé ; Rousseau, l’ennemi des distinctions sociales, voulut retracer toutes les fureurs, les voluptés, les peines, le dévouement de l’amour chez des jeunes gens d’une naissance ordinaire, et séparés du grand monde. Enfin, comme Richardson avait offert un tableau exact, ou plutôt un miroir d’une vérité parfaite, où se répétaient les plus légers mouvements des mœurs de famille, l’auteur d’Héloïse, toujours entraîné par son imagination vers des régions idéales, essaya de créer une famille entièrement heureuse, et de réaliser, par la magie de son talent, une sorte de paradis terrestre animé par des mœurs privées, dont la simplicité, la pureté, l’ordre, devaient faire tout le charme. Si un immense talent n’a pu accomplir dans son ensemble une si noble création, et lui donner toute la perfection à laquelle les vœux de l’auteur aspiraient, on doit croire que l’entreprise dépassait les forces humaines, et que l’audace du philosophe s’était proposé un but placé au-delà du terme que le génie peut atteindre.
Les ressources de l’éloquence, la beauté de la diction, l’éclat du paradoxe, le talent de décrire, l’ardeur de la passion, la force du raisonnement, furent réunis, pour ainsi dire, par Jean-Jacques, et combinés avec une incroyable énergie de pensée, pour déguiser et embellir les vices réels d’un plan vers lequel il avait essayé de faire aboutir tous les résultats de ses méditations, tous les objets de son enthousiasme, de ses souvenirs, de ses rêveries, de ses doutes, de ses craintes, et de ses regrets. Trop passionné pour être observateur impartial, il ne donna pas à ses héros la vie réelle et le langage spécial que Richardson avait prêté aux siens. Julie et Saint-Preux, Claire et lord Édouard parlèrent la langue de Jean-Jacques : langage audacieux, brillant, plein de véhémence et de grandeur, modèle presque inimitable, mais dont la beauté oratoire était à elle seule un contresens, et s’accordait mal avec la forme épistolaire qu’il avait voulu choisir.
En adoptant cette forme, Jean-Jacques paraît s’être réservé surtout le droit de discuter dans des lettres de controverse philosophique, plusieurs points de morale, de religion, de politique. Madame de Staël l’a imité : Delphine, le premier ouvrage que cette femme célèbre ait publié sous le titre de roman, est le développement d’une maxime qui nous semble fausse : « Que les femmes doivent se soumettre à l’opinion, et les hommes la braver. » On trouve dans ce roman plus de connaissance du grand monde, que dans la Nouvelle Héloïse ; mais les caractères en sont plus factices, l’enthousiasme y est moins vrai, le style moins parfait, la moralité plus équivoque. Il y règne une croyance à l’empire illimité des passions, une sorte de foi à leur noblesse et à leur puissance, dont les résultats sont dangereux. Le culte que Delphine et Léonce professent pour leur propre enthousiasme, leur amour, leur dignité, leur véhémence, est une espèce d’égoïsme de sensibilité qui se couvre d’un masque de philosophie : il semble qu’ils s’agenouillent eux-mêmes devant leurs passions.
La femme spirituelle et supérieure dont je parle a exagéré dans ce roman tous les défauts que l’auteur de l’Héloïse avait palliés à force d’art. Comme lui, elle a répudié les avantages qu’offre à l’auteur du roman par lettres la variété des caractères : la même monotonie de dialectique passionnée règne dans toute la correspondance de ses héros. Malgré la force et l’éclat du génie de Jean-Jacques, malgré la mobile énergie de pensée qui caractérisait madame de Staël, ces deux écrivains ont concouru, selon nous, à décréditer le roman épistolaire. En l’engageant dans cette fausse route, ils l’ont privé de ce mérite dramatique qui naît de la vérité parfaite du langage prêté aux personnages différents. D’autres romanciers ont marché sur les traces de Jean-Jacques, et encouru le même reproche dans des ouvrages où le plus remarquable talent s’est déployé quelquefois, mais sans s’astreindre aux règles naturelles que Richardson s’était imposées, et qui nous semblent essentielles au genre de roman dont il est question.
Tel est Werther, ouvrage célèbre, que la vieillesse de Goëthe a désavoué comme un fruit trop précoce d’une jeunesse ardente. Ce n’est à proprement, parler qu’un monologue distribué par lettres. Il y a aussi dans cet ouvrage une sorte de but philosophique ; c’est une peinture cruelle du néant des choses humaines, de la vanité de nos passions, de nos ambitions, de nos désirs ; c’est une excuse du suicidé, fondée sur le dégoût que peuvent inspirer à une âme exaltée les peines de la vie vulgaire, et les exigences d’une société faite pour le commun des hommes. En reconnaissant la supériorité de l’auteur et la force de cette éloquence métaphysique qu’il a déployée, avouons qu’un tel ouvrage n’est point sans danger, et que la sagesse des dernières années de Goëthe peut voir avec quelque regret cet emploi de son jeune talent. Il est trop facile de se dégager des liens sociaux, sous prétexte que l’on est au-dessus du vulgaire, pour qu’il n’y ait pas quelque péril à soutenir qu’un homme supérieur peut s’affranchir de toutes les entraves, et rejeter plutôt le fardeau de la vie que de partager les ennuis de l’existence sociale avec une foule puérile ou corrompue.
Madame Krudner, dans son roman de Valérie, imita les passions du jeune Werther ; madame Cottin et quelques femmes anglaises suivirent les pas de Richardson ; il était réservé à l’auteur des Liaisons dangereuses, de lutter avec lui corps à corps : quelque talent que je reconnaisse au peintre de madame de Merteuil, je ne lui ferai cependant pas l’honneur de le comparer à l’auteur de Lovelace : même à génie égal, il n’y a point de parallèle possible entre deux écrivains dont l’un emploie son talent à faire triompher le vice, et l’autre à faire aimer la vertu.
Le règne du roman par lettres trouva son terme ; et, changeant de nature, il contracta une espèce d’alliance avec le mélodrame, dont il s’appropria les incidents multipliés, les scènes incohérentes, les transitions brusques, et quelquefois le style extravagant. C’est aujourd’hui, que le genre du roman mélodramatique jouit de toute sa puissance, qu’il est curieux d’examiner comment, après avoir parcouru tant de phases diverses, on en est revenu, en dernière analyse, aux grands coups d’épée de mademoiselle de Scudéry, aux personnages historiques de la Clélie, et à la complication d’incidents que la jeunesse de nos bisaïeules admirait dans l’Astrée.
Le roman historique, puisqu’il faut l’appeler par son nom, n’a pas le mérite de la nouveauté. Le mélange de fictions avec les évènements réels est une des plus vieilles inventions de la littérature en enfance. Les chroniqueurs, dont le style emphatique raconte les prouesses d’Amadis de Gaule et des pairs de Charlemagne, ne sont en effet que des historiens romanesques. Tous les romans de chevalerie reposent sur un fonds de vérité : Scudéry, La Calprenède, et leur école, ne sont que les imitateurs de l’archevêque Turpin. Mademoiselle de Lussan s’est encore amusée, pendant le dix-septième siècle, à revêtir d’un costume romanesque la cour de Philippe-Auguste. Enfin, si je voulais poursuivre dans toutes ses branches, et analyser avec exactitude le genre semi-historique et semi-imaginaire dont il est question ici, je prouverais que l’abbé de Vertot, l’abbé de Saint-Réal, et Sarrazin, auteurs académiques, inventeurs de détails fictifs destinés à embellir des incidents réels, ont infiniment plus de droits aux titres de créateurs du roman historique, que madame de Genlis et Walter Scott.
Mais sans chercher au loin le berceau du roman historique, sans retrouver ses langes primitifs dans les narrations mensongères de Darès-le-Phrygien et du faux archevêque Turpin, voyons un peu quelles sont ses prétentions, quel but il se propose, et quelles ressources il emploie.
Le passé n’est point sans séduction pour l’imagination humaine ; une espèce d’auréole vague l’environne. Les récits d’autrefois ont de la majesté dans leur mouvement, du charme dans leur naïveté. Les noms historiques frappent vivement la pensée. L’histoire s’empare à la fois des grandes masses et des détails curieux que les souvenirs du passé lui fournissent. Les mémoires et les biographies complètent ce que l’histoire des peuples considérés dans leurs masses est obligée de laisser de côté : c’est une lecture pleine d’instruction et de charme ; les rois s’y instruisent ; les philosophes y trouvent la plus intéressante de leurs études. Elle est, comme dit Montaigne, « profitable et plaisante ».
Le romancier historique, abandonnant à l’historien tout ce qu’il y a d’utile dans ses travaux, prétend s’emparer de tout ce qui plaît dans les souvenirs de l’histoire : il ne s’embarrasse point des leçons du passé, il se contente de s’envelopper du prestige qu’il lui emprunte. Peindre les costumes, décrire les armures, tracer des physionomies imaginaires, prêter à des héros réels des mouvements, des paroles, des actes dont rien ne peut prouver la réalité, tel est son ouvrage. Au lieu d’élever l’histoire jusqu’à lui, il rabaisse l’histoire jusqu’à la fiction ; il force cette muse véridique à devenir un témoin de mensonge : son talent ne peut jamais parvenir qu’à s’approcher d’une manière incertaine et à peine probable de la réalité telle qu’on peut soupçonner qu’elle a dû être. Genre mauvais en lui-même, genre éminemment faux, que toute la souplesse du talent le plus varié ne pare que d’un attrait frivole, dont la mode se lassera bientôt après l’avoir adopté.
Comme le roman s’occupe de peindre dans leurs détails les mœurs privées des hommes, quelques écrivains érudits ont créé une sorte de roman étayé de leur science et où ils ont essayé de reproduire les mœurs privées du temps passé. C’est dans ce sens qu’Anacharsis, de l’abbé Barthélémy, et le Palais de Scaurus, de M. Mazois, sont des romans pleins d’érudition. Mais ces hommes distingués n’ont employé que des matériaux reconnus vrais, et leurs autorités sont les témoignages irrécusables des anciens dont ils retracent les mœurs. Quand madame de Genlis, au contraire, lasse d’avoir appris aux enfants la chimie et la physique, au moyen de petits contes, voulut enseigner aux hommes d’un âge mûr l’histoire des rois, au moyen de romans historiques, la critique littéraire et le simple bon sens durent se révolter contre les suppositions que la romancière prétendait introduire dans le domaine de l’histoire. On voulait avoir de meilleures preuves que celles apportées par elle, de la délicatesse galante qu’elle prêtait à l’inconstant amant de mademoiselle de La Vallière, et de la ferveur romanesque dont elle avait fait don au plus froid des monarques, au faible Louis XIII. Tous les gens raisonnables protestèrent contre un système qui changeait les figures historiques en figures de fantaisie et une certaine faiblesse de pinceau et de coloris, nuisant encore aux succès de ces romans, le genre dont je parle ne s’accrédita point encore.
Un écrivain se présenta, plus distingué par l’érudition que par la force de la pensée ; profondément versé dans les antiquités de l’Écosse sa patrie ; prosateur correct et poète élégant ; doué d’une mémoire prodigieuse et du talent de faire revivre, pour ainsi dire, les souvenirs du passé ; dépourvu d’ailleurs de philosophie, et ne s’embarrassant jamais de soumettre à un jugement la moralité des actions, ni celle des hommes. Après avoir publié des poésies brillantes, mais où rien ne révélait la profondeur ou la vigueur du génie poétique, il s’avisa de réduire, sous la forme d’un récit, la plupart des souvenirs d’antiquité dont il avait fait son étude. Il retraça les vieilles mœurs d’une contrée encore sauvage aujourd’hui ; les coutumes, le dialecte, le paysage, les superstitions de ces descendants des anciens Celtes, qui ont conservé jusqu’à leur costume primitif, étonnèrent par leur singularité. On était fatigué des romans sentimentaux ou licencieux ; on crut respirer l’air des montagnes et voir s’élever, du sein des vapeurs qui couvrent les vallées, les pics aigus du Ben-Lomond. La langueur de la civilisation moderne trouva, dans ces tableaux naïfs et sauvages, un contraste piquant avec sa propre faiblesse. Plus l’auteur de ces narrations avait accumulé les descriptions d’objets inconnus, dont la réalité est attestée par les voyageurs, ou dont la crédulité conserve la tradition, plus les esprits, charmés par tant de nouveautés, s’attachèrent à ces ouvrages dont le nombre ne le rebuta pas. Les sites choisis par Walter Scott s’accordaient avec ses personnages : on eût vainement cherché à rendre vraisemblable, dans tout autre pays que l’Écosse, la présence de ces Bohémiennes logées sous des abris basaltiques, la rusticité chevaleresque des paysans, et leur langage toujours poétique dans sa simplicité. En adoptant avec une sorte de fureur les ouvrages du baronnet écossais, il sembla que les mœurs modernes, avec leur luxe, leur frivolité, leur petitesse ambitieuse, rendaient un hommage involontaire à la majesté naïve des mœurs des peuples sauvages.
La faculté d’inventer des figures idéales, de les revêtir d’une beauté céleste, de leur communiquer une vie surhumaine, cette faculté de création que les grands poètes ont possédée était étrangère à Walter Scott. Il écrivit sous la dictée de ses souvenirs ; et après avoir feuilleté de vieilles chroniques, il se contenta de copier ce quelles offraient de curieux et d’étonnant. Pour donner quelque consistance à ces récits, il inventa des dates, s’appuya légèrement sur l’histoire, et publia volumes sur volumes. Comme son talent consistait à faire renaître sous nos yeux les détails du passé, il ne voulut point prendre la peine de tracer un plan, ni de donner un héros à ses ouvrages ; presque tous se composent de détails heureusement rendus, mais on n’aperçoit sur le premier plan que des figures sans intérêt : c’est sur le second que se trouvent celles qu’il a dessinées avec le plus d’attention, et pour ainsi dire caressées. Le goût et l’exactitude des peintres hollandais se retrouvent dans ses tableaux, qui n’ont que deux défauts marquants, celui de se nommer historiques, et celui de manquer d’ordre, de régularité, de philosophie, et de présenter moins une composition parfaite, qu’une confusion d’objets jetés au hasard, quoique copiés avec une fidélité piquante.
C’était un roman d’espèce nouvelle ; on crut l’avoir suffisamment défini en le nommant historique : définition fausse comme la plupart des termes nouveaux que l’on emploie pour suppléer à l’indigence des langues. Le roman est une fiction, et toute fiction est mensonge. Appellerons-nous mensonges historiques les volumes du baronnet anglais ? Ce serait une injure peu méritée. Ces narrations originales sont dignes d’éloges à plus d’un titre ; mais ce n’est point dans les rangs des Tacite, des Machiavel, des Voltaire, et des Hume, que leur auteur doit se placer : le moindre compilateur d’anecdotes est plus historien que lui. Peu d’écrivains ont employé avec autant d’habileté et de succès les trésors d’une science communément aride, les extraits des vieux manuscrits, et les découvertes de l’antiquaire.
Le mouvement, la grâce, la vie, que Walter Scott prête aux scènes du passé ; la rudesse et souvent l’inélégance d’un récit qui paraît en harmonie complète avec l’époque à laquelle il se rapporte ; la variété de ces portraits singuliers, dont le caractère bizarre respire un air d’antiquité sauvage ; l’étrangeté de l’ensemble, et la minutieuse exactitude des accessoires, rendirent populaires les romans que l’Europe attribue à Walter Scott, et que lui seul désavoue. Les émotions qu’on leur devait étaient universelles, et l’on s’aveugla sur leurs défauts. En transportant l’imagination loin de la société civilisée, telle que nous la connaissons, ces ouvrages portèrent les derniers coups à l’ancien roman, tel que Richardson l’avait conçu. Les tableaux des mœurs civilisées semblèrent pâles à côté des mœurs de ces montagnards et de ces sibylles, que le raconteur écossais faisait agir et parler. Les peintures de la passion, dans ses égarements, ses caprices, ses scrupules, ses retours, cessèrent d’exciter l’intérêt. C’est ainsi qu’un homme, dont les sens ont émoussé leur énergie par l’abus des liqueurs fortes, se dégoûte de ce qu’il aimait autrefois, et repousse avec dédain la liqueur plus salubre qui suffisait pour étancher sa soif.
Le roman par lettres ne jouit plus dès lors que d’une estime de souvenir ; c’est un ami qui nous a plu, et que nous voulons bien tolérer encore, sans désirer sa présence, sans lui demander des consolations ou des plaisirs. J’ai montré comment, après une si grande vogue, ce genre de roman avait vu son éclat pâlir et s’éteindre par degrés ; mais son mérite, fondé sur la nature même du roman, survivra au goût capricieux de la génération qui l’a vu naître ; et dès que la foule des imitateurs aura fatigué la patience des lecteurs de fictions prétendues historiques, je ne doute pas que le public ne revienne aux objets de sa prédilection première. Le roman par lettres, dont la forme permet aux caractères de se développer, aux personnages d’envisager les évènements récents sous le point de vue qui trahit leurs passions secrètes ; le roman par lettres, qui comporte tous les genres de talent, et admet toutes les variétés de discussion, de raisonnement, de description, d’éloquence, survivra à l’espèce d’anathème que la frivolité impatiente des contemporains semble avoir lancée contre lui.
Éditeur des lettres que l’on va lire, j’ai cru devoir justifier la forme sous laquelle je les fais paraître ; il m’eût été facile de changer en une narration rapide la correspondance qu’une suite d’évènements extraordinaires ont placée entre mes mains. J’ai pensé que je lui ôterais par là ce cachet de vérité si précieuse pour les observateurs de l’homme. J’ai laissé les jeunes héros de ce drame exprimer eux-mêmes les passions qui les agitaient ; et si je me suis épargné le travail qu’aurait pu me donner la rédaction d’une anecdote d’ailleurs intéressante en elle-même, cela n’a point été pour soulager ma paresse, mais par la conviction intime que les longueurs mêmes des lettres qui composent ce recueil offrent plus de mouvement, de naïveté, et de vie, que ne pourrait en avoir le récit le plus exact et le plus éloquent des faits qui s’y trouvent consignés.
C’est donc malgré mon siècle que je publie ce recueil de lettres. Non seulement la forme en est passée de mode, mais la majorité des lecteurs préfèrent le mouvement de ces scènes mal amenées, ces coups de théâtre que les romans ont empruntés aux tréteaux du boulevard, à la fidèle peinture des mouvements du cœur humain. Je ne puis croire que ce caprice, d’un goût dépravé, doive durer longtemps, et je ne voudrais point déférer, par flatterie pour le public, aux nouveaux arrêts d’une critique de circonstance, à laquelle la mode du lendemain peut dicter un arrêt contraire aux sentences de la veille.
Je puis attester que les personnages et les faits dont ces lettres font mention ne sont point imaginaires ; le véritable nom des uns, l’époque et le lieu réels où se sont passés les autres, sont inutiles aux lecteurs, et je ne pourrais satisfaire une curiosité stérile sans trahir un secret dont l’amitié m’a fait dépositaire. J’ai cherché un titre convenable au récit qui s’y trouve. Deux passions véhémentes animent toutes ces lettres : l’amour porté jusqu’à la frénésie ; l’amitié elle-même devenue une passion ardente, et dans son dévouement sans bornes, s’abandonnant à tous les excès qu’elle condamne et qu’elle a cherché vainement à réprimer.
Il y a peu d’histoires plus véritables que ce roman ; non seulement le fond, les caractères, les épisodes, et les principaux détails en sont rigoureusement vrais, mais une partie des lettres dont il se compose, celles-là même dont on pourra suspecter avec plus de raison l’authenticité, ne sont que des copies, ou des extraits fidèles des lettres originales qui m’ont été confiées. J’ai intitulé ce livre les Passions ; j’ose espérer qu’on ne se méprendra pas sur le but moral que je m’y suis proposé.
CÉCILE DE CLÉNORD À PAULINE D’AMERCOUR.
Beauvoir, février 1786