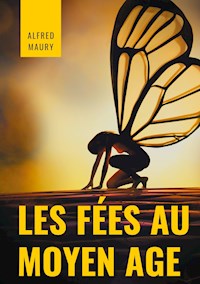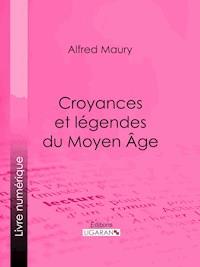
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le sentiment religieux s'éveille, chez tous les hommes, en présence du spectacle imposant de la nature ; mais suivant la physionomie de celle-ci, il prend un caractère différent et s'attache à des objets divers. Sous le ciel brumeux et triste de la Celtique ou de la Germanie, l'esprit n'est point affecté des mêmes impressions que sous le soleil brûlant de l'Afrique, ou sous l'atmosphère molle et vaporeuse de la Toscane."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Depuis longtemps les deux premiers ouvrages d’Alfred Maury, les Fées du Moyen Âge et l’Essai sur les Légendes pieuses du Moyen Âge, publiés tous les deux en 1843, sont devenus introuvables. Les amateurs de livres rares les recherchent avidement. Tous ceux qui s’intéressent aux études d’histoire se plaignent de ne pouvoir les posséder. L’idée d’en donner une nouvelle édition a trouvé, aussitôt émise, un accueil empressé. Avec une libéralité digne d’éloge, le libraire M. H. Champion s’est offert à la publier. Ainsi se trouvent rendus au public des travaux qui doivent occuper leur place dans l’histoire du développement de l’esprit critique vers le milieu de ce siècle.
Tel est, en effet, le caractère dominant de ces deux essais. Par la liberté du coup d’œil, par l’étendue de l’érudition, par l’absence de toute idée de polémique actuelle, ils se distinguent des livres du même temps. C’est le pur esprit de recherche scientifique qui les a inspirés. L’auteur, qui n’avait que vingt-six ans, apportait dès son premier livre ses qualités personnelles. Il était déjà tel que l’Alfred Maury que nous avons connu.
Voici comment, dans ses Mémoires encore inédits, il parle des Légendes pieuses :
« Depuis ma rentrée à la Bibliothèque royale, j’avais redoublé d’assiduité au travail, et mon besoin d’activité intellectuelle ne trouvait jamais assez à se satisfaire. J’avais d’abord songé à écrire une histoire de l’art ancien… Je me plongeai dans la lecture de la Rome souterraine de Bottari, dans celle des mémoires de Raoul Rochette sur les antiquités des Catacombes de Rome… Je traduisais de l’allemand les livres du savant danois Münter sur les symboles des premiers chrétiens. Ces études me conduisirent à chercher dans les monuments l’explication de diverses légendes chrétiennes. Je fus amené de la sorte à examiner, au point de vue critique, les Vies des Saints, j’abordai la lecture du vaste recueil des Bollandistes, des Actes des martyrs de Dom Ruinart. Je compulsai les Pères de l’Église et une foule de livres de théologie… »
Le seul énoncé de ces lectures montre dans quel esprit le jeune savant se mettait à l’ouvrage. Si l’on se rappelle qu’à cette époque personne en France ne songeait à des études de ce genre, on sera encore plus frappé de ce besoin d’information, de cette ardeur de recherche. La mode était de se ranger parmi les défenseurs ou parmi les adversaires de l’Église ; mais on négligeait des deux parts le seul moyen de donner une base à la discussion : l’examen des textes. D’un côté, c’étaient les affirmations de l’orthodoxie ; de l’autre, les moqueries d’un scepticisme frivole. Alfred Maury s’afflige d’une ignorance qui laisse passer en Allemagne des études autrefois cultivées chez nous. « Ces études, dit-il dans une note des Légendes pieuses, sont chez nous englobées dans l’antipathie que professent tant d’esprits, éclairés pourtant, pour les questions théologiques. Le clergé lui-même a laissé s’éteindre dans ses mains l’héritage des Huet, des D. Calmet, des R. Simon et des Arnauld ; à peine sait-il ce qui se passe au-delà du Rhin, et sur quel terrain nouveau la critique transporte aujourd’hui l’Ancien Testament. »
À la différence des écrits du même temps, la critique d’Alfred Maury est toujours respectueuse. Il est difficile de s’exprimer avec plus de sérieux qu’il ne le fait dans le chapitre final où il expose les principes qui l’ont dirigé. Quand on s’occupe des hagiographes, on n’a pas besoin, dit-il, de supposer toujours la mauvaise foi. C’étaient des disciples enthousiastes, des historiens crédules et ignorants… La légende, d’ailleurs, ne se formait que peu à peu, se grossissant de faits nouveaux à mesure qu’elle vieillissait. Des hommes en proie à l’enthousiasme ne voulaient, ne pouvaient voir autour d’eux que prodiges, naissant sous la main de Dieu. En outre, dans les premiers siècles de la foi, rien de plus fréquent que les interpolations et les suppositions… Sans doute il existait déjà un certain genre de critique qui s’appliquait à écarter les documents suspects. Mais cette critique s’attachait moins à constater l’authenticité de la tradition que la conformité aux dogmes. L’exégèse sacrée n’existait pas. Les évangiles sont des recueils de légendes, de traditions sur le Sauveur ramassées, coordonnées par des collecteurs, qui les plaçaient sous le nom imposant d’un apôtre ou d’un des premiers disciples du Christ.
Une étude plus complète de l’intelligence, de ses troubles et de ses faiblesses, avait appris à Maury de combien de gradations la bonne foi est susceptible. « On ignorait l’origine de la fiole qui servait à l’onction de nos rois. Un clerc rêva, se persuada, puis affirma que Clovis l’avait reçue en présent du Saint-Esprit… Que pouvait faire un moine composant sans matériaux et sans guide la vie d’un saint ? Plein d’admiration pour ce saint, il se le représentait comme une copie de son divin maître, copie d’autant plus fidèle que son culte était plus vif ou son ignorance plus grande. Les témoignages ne pouvaient manquer de lui venir en aide de toutes parts : ne sait-on pas comment l’enthousiasme d’un seul se communique à la foule ? »
Voilà ce qu’écrivait en 1843 un jeune homme qui n’avait reçu les enseignements d’aucune école, d’aucun maître. On est surpris autant de la gravité de l’exposition, que de la portée des aperçus. Tout ce qui, vingt-deux ans plus tard, en un livre célèbre, parut d’une hardiesse extrême, existe en germe dans les Légendes pieuses. « Je trouvai dans cette publication, disent modestement les Mémoires, la satisfaction de produire mes idées en matière religieuse. » Heureusement pour son repos, ces idées étaient trop en avance sur l’esprit général. Elles passèrent sans provoquer ni contradictions, ni anathèmes.
Pendant une série d’années, Alfred Maury paraît avoir préparé les matériaux d’une seconde édition élargie et développée : un exemplaire tout couvert de notes s’est retrouvé parmi ses livres.
Mais à un certain moment, il a dû renoncer à cette idée. Les éditeurs ont eu soin, dans la présente publication, de faire entrer toutes ces notes, qu’on trouvera les unes au bas des pages, les autres, celles qui étaient trop étendues, à la fin du volume.
L’autre essai, sur les Fées du Moyen Âge, qui a précédé le volume des Légendes pieuses de quelques mois, est un travail de mythologie comparée. L’ampleur du savoir, sur ce domaine si différent, n’est pas moins étonnante. Non seulement il voit dans les fées un reste de l’ancienne mythologie gauloise, mais sur un grand nombre d’autres points il remonte plus haut et devance la science de son temps. Sur d’autres points, la philologie a fait quelques pas en avant. On rapprocherait encore aujourd’hui les trois Nornes germaniques des trois Parques grecques, mais ce ne serait plus pour y voir la preuve d’une primitive parenté. Nous avons appris depuis que la mythologie germanique et Scandinave cache plus d’une infiltration gréco-latine, et même plus d’un emprunt chrétien.
Les conclusions du livre sur les Fées sont remarquables et peignent bien la philosophie de l’auteur. « Ces divinités cachées, dont la mère redoutait jadis la colère pour son fils au berceau, leur histoire est devenue un moyen d’égayer nos enfants. La réflexion de l’homme se fortifiant sans cesse, les croyances d’hier sont devenues des hochets. L’homme ne cherche plus en dehors des lois de l’univers la cause des phénomènes, ni en dehors de lui-même la règle de la morale. Le moi pensant est devenu la raison dernière des choses… Déjà l’on entrevoit une société où le sentiment du devoir envers Dieu et notre semblable sera notre seul guide. »
Voltaire, Locke ou Lessing n’auraient pas dit mieux.
Même après un demi-siècle écoulé, ces deux livres paraîtront encore riches en enseignements de toute sorte. Ce que l’auteur disait de l’état d’abandon où le public laisse un si important ordre de recherches, n’a malheureusement pas perdu de son actualité.
À part quelques intrépides travailleurs, nullement aidés, nullement encouragés, qui, chez nous, s’occupe d’exégèse hagiographique ? Si le folk-lore a ses enthousiastes et ses adeptes, la voie plus ardue qu’Alfred Maury avait ouverte en abordant la critique des Acta sanctorum et en scrutant les sources de l’iconographie religieuse, reste à peu près délaissée. Espérons que la lecture de ces pages suscitera de nouveaux disciples à une branche d’étude sans laquelle la théologie manque de fondement et l’histoire reste incomplète.
Il faut remercier M. Auguste Longnon, l’élève préféré d’Alfred Maury, et M. Bonet-Maury, si dévoué à sa mémoire, pour avoir entrepris, sur l’invitation de sa veuve, cette nouvelle édition. Leur principale récompense sera de rappeler aux jeunes générations une mémoire qui, à plus d’un titre, mérite de rester toujours honorée. On sait qu’Alfred Maury a été initiateur dans plus d’une direction. Sans parler de ses grands ouvrages historiques, son livre sur le Sommeil et les rêves a commencé d’ébranler bien des théories convenues et d’introduire des vues nouvelles en psychologie ; ce n’est pas un médiocre honneur pour un homme d’avoir préparé à la fois et plus qu’à moitié annoncé Ernest Renan et Hippolyte Taine. Quant à ceux qui ont eu le bonheur de connaître ce noble et vaste esprit, ils reliront avec émotion les deux essais où il se fit d’abord connaître et sur lesquels il a déjà mis l’empreinte de ses qualités distinctives : l’amour du vrai, la sincérité.
Michel BRÉAL.
Depuis que l’on a porté dans les études relatives au Moyen Âge un esprit d’analyse et de critique qui leur avait d’abord manqué, les superstitions de cet âge crédule et naïf ont dû être examinées comme un des traits qui le caractérisent. Les fées occupent incontestablement l’un des premiers rangs dans les traditions populaires de notre contrée. Le tableau complet de leur mythologie, présenté dans un ordre systématique, pourrait donc jeter quelque jour sur la question des origines celtiques. Le sentiment religieux si profondément gravé dans le cœur, que l’homme ne quitte guère plus sa foi que sa langue, est un des attributs distinctifs de celui-ci ; ainsi, l’on peut appeler l’étude des religions, aussi bien que celle de la linguistique et de l’anthropologie, à l’œuvre commune du débrouillement des origines d’une nation. Bien des auteurs avaient avant moi parlé des fées, exprimé sur leur nature leur opinion personnelle. Tantôt on les faisait descendre des nymphes et des parques, tantôt des druidesses. Depuis Gabriel Naudé, Sainte-Foy et Dom Martin, M. Th. de la Ville-marqué, dans deux publications pleines du plus vif intérêt sur les chants et les contes populaires de la Bretagne, a jeté une lumière inattendue sur ce problème historique. J’avais déjà entrepris mes recherches, lorsque j’ai connu ces deux ouvrages ; ils sont venus donner plus de force aux idées que je m’efforçais de faire prévaloir, et mon travail leur doit sans contredit une bonne partie du faible mérite qu’il peut présenter.
J’ai tâché, ainsi qu’on le verra, de montrer comment dans des investigations de ce genre, il ne faut négliger aucun élément de la question et combien il serait dangereux de se ranger tout d’abord pour une opinion exclusive. En matière de légendes et de superstitions populaires, rien n’est arrêté, limité ; tout se confond et se mêle ; le cercle dont on cherche à s’entourer, pour les examiner, doit donc se déplacer et s’étendre, suivant les époques et les lieux. J’ai rassemblé tous les rapprochements, toutes les analogies qui pouvaient amener à la découverte du véritable berceau des fées, et, ces matériaux une fois réunis, j’ai essayé de les rétablir dans l’ordre que leur assigne l’histoire. C’est cette reconstruction que je revendique comme mon œuvre plus particulière ; les faits sur lesquels je me suis appuyé, avaient déjà en grand nombre été rassemblés avant moi.
Ce petit ouvrage n’a pas la prétention de former un traité complet sur une matière presque entièrement neuve. C’est un essai, et le plus modeste de tous les essais, sur une partie intéressante de la critique sacrée, critique malheureusement fort négligée en deçà du Rhin, bien qu’elle mérite pourtant à tant d’égards d’être cultivée pour l’avancement des connaissances historiques. M’occupant depuis longtemps de rassembler les matériaux d’un grand travail sur la symbolique chrétienne, j’ai eu fréquemment occasion de consulter les martyrologes et les légendes des saints. En les compulsant, j’ai été frappé à la fois de l’importance des renseignements de tout genre qui s’y trouvent consignés et du déplorable mélange qui y est opéré entre le vrai et le faux, entre des récits offrant tous les caractères désirables d’authenticité et de certitude, et des fables absurdes, des contes incroyables dont la moralité blesse souvent les sentiments les plus simples de justice et d’humanité. J’ai vivement regretté alors qu’il n’existât pas d’ouvrage où fussent posés les principes d’un système de critique applicable à la majeure partie de ces légendes, et qui permit de discerner la vérité du mensonge, en éclairant ce chaos obscur où j’apercevais la possibilité de l’ordre et de la régularité. C’est ce qui me fit concevoir l’idée de tenter moi-même ce qui n’avait point encore reçu d’exécution, et de chercher, par une comparaison longue et attentive d’une foule de vies de saints, à découvrir les bases de la critique à établir. Tel est le résultat du travail que je publie aujourd’hui. Voici maintenant la méthode que j’ai suivie : J’ai pensé que, dans la tâche que j’avais entreprise, je devais chercher à démêler, dans tous les faits qui se présentaient à mon examen, l’idée qui paraissait avoir présidé à leur rédaction. Ces différentes idées ainsi obtenues, je les ai classées entre elles de manière à les rapporter au moins grand nombre de chefs possible, et ces divisions générales une fois formulées m’ont fourni des principes élémentaires que j’ai pris pour hase de ma critique. Ce sont donc ces principes élémentaires que cet essai est destiné à exposer. Ils se réduisent au fond à trois, lesquels ont encore entre eux une fort grande parenté et se confondent même en certains points. On pourrait les énoncer ainsi :
1° Assimilation de la vie du saint à celle de J.-C.
2° Confusion du sens littéral et figuré, entente à la lettre des figures de langage.
3° Oubli de la signification des symboles figurés et explication de ces représentations par des récits forgés à plaisir ou des faits altérés.
Chacun de ces principes, appuyé par des exemples de son application à l’interprétation des légendes, est développé séparément dans cet essai.
Les auteurs modernes qui ont écrit sur la vie des saints avaient senti depuis longtemps la nécessité d’en faire disparaître une foule de faits impossibles à croire, ridicules à raconter. Mais, comment ont-ils procédé dans une semblable épuration, quelles règles de critique ont-ils suivies, quel critérium les a conduits dans ces suppressions, ces modifications de la substance des vieux textes ? Aucun ou presque aucun ; pas la moindre unité dans leur marche. La vraisemblance a été leur unique guide. Mais il ne suffit pas de rejeter ; les faits repoussés sont trop nombreux pour qu’on ne justifie pas son rejet. Ils sont erronés, mensongers, mais encore, qui a donné naissance à tant d’erreurs et de mensonges ? C’étaient ces causes qu’il fallait rechercher ; on ne l’a point fait, on s’est peut-être même gardé de le faire ; mais en se privant d’un pareil moyen d’exégèse, on s’est privé de toute certitude, et, il faut le dire, il n’y a souvent aucune raison de croire plus à tel fait conservé par Butler qu’à tel autre qu’il a omis à dessein. En l’absence de toute méthode herméneutique, mieux eût valu faire comme le récent auteur de la Vie de sainte Élisabeth de Hongrie, reproduire naïvement le récit original dans sa candeur et sa simplicité. On y trouverait au moins une poésie qui a disparu de la composition moderne, sans que pour cela la vérité y ait beaucoup gagné.
À Dieu ne plaise que j’aie l’impertinence de donner mon système comme infaillible, comme remédiant à tous ces embarras ; j’ai déjà dit que ce n’était qu’un simple essai ; mais il me semble, si je ne m’abuse pas étrangement, que l’on pourra marcher avec plus de certitude dans la voie des suppressions à opérer dans les légendes, une fois qu’on connaîtra les sources d’erreurs. On pourra du moins se défier de l’authenticité du fait, là où apparaîtra clairement l’action d’une des influences que je vais examiner.
En voilà assez pour faire connaître au public la pensée de ce mince in-8°. J’ajouterai seulement que dans tout le cours de sa composition, je n’ai cessé de conserver une grande indépendance d’opinion. J’ai dit partout, et sans restriction, ma manière de voir. Le premier qui parcourt cette carrière, je n’ai trouvé aucun modèle à suivre, par conséquent aucune doctrine déjà assise à respecter ; car j’ai toujours cru qu’il ne pouvait y avoir de large et saine critique, tant que l’esprit ne se dépouillerait pas préalablement de toutes ses idées antérieures, et ne chercherait pas la vérité pour elle-même et par elle-même.
Ce 20 décembre 1842.
Le sentiment religieux s’éveille, chez tous les hommes, en présence du spectacle imposant de la nature ; mais suivant la physionomie de celle-ci, il prend un caractère différent et s’attache à des objets divers. Sous le ciel brumeux et triste de la Celtique ou de la Germanie, l’esprit n’est point affecté des mêmes impressions que sous le soleil brillant de l’Afrique, ou sous l’atmosphère molle et vaporeuse de la Toscane. Devant les granits sévères de l’Armorique que la mer vient souvent ronger de ses Ilots écumeux, à l’entrée de ces forêts ténébreuses et profondes, telles que l’Erzgebirge ou les Ardennes, le long de ces fleuves majestueux aux bords romantiques et solitaires, comme le Rhin ou la Loire, au milieu de ces landes stériles, de ces immenses bruyères, de ces dunes mobiles de l’Aquitaine ou de la Domnonée, l’imagination est saisie d’une pensée grave et rêveuse ; elle ne s’allume pas d’un enthousiasme soudain ; elle ne se berce pas d’idées voluptueuses et riantes, comme elle le fait en face des scènes grandioses de l’Inde ou de l’Égypte, des vallées fraîches et fleuries de la Thessalie, des jardins magnifiques de la Perse. La pensée religieuse semble grandir avec la végétation, avec la force vitale d’expansion qui nous entoure. On pourrait la comparer à cette herbe modeste et humble de taille qui parcourt en un an le cercle de ses destinées, mais qui, transportée sous un climat plus actif, sous l’influence d’agents atmosphériques plus énergiques, s’élance fièrement en arbuste ligneux et se transforme même en un arbre d’une majestueuse procérité !
L’étude des religions met tous les jours en lumière ces oppositions dans le caractère des croyances de chaque peuple, nées de la dissemblance des contrées qu’ils habitent. Qu’il y a loin de ce Dieu si vaste et si incompréhensible des Hindous, de ce Brahma, qui se cache dans des profondeurs insondables pour l’intelligence humaine, à ce Dieu informe du Kamtschadal, dont la figure est un pieu grossièrement taillé, planté près du foyer d’une yourte misérable ! On comprend donc que dans la Germanie, la Gaule et l’Helvétie, la religion ne se manifestât pas avec le gracieux cortège dont elle s’entourait dans la Grèce. Un site monotone et austère n’évoquait, dans l’âme des Celtes hardis et farouches, que des croyances terribles, que des conceptions religieuses simples et sévères comme la nature qui les environnait. Des divinités impitoyables régissaient à leurs yeux l’univers et faisaient pleuvoir sur les mortels les désastres et les maladies. Pour les nations septentrionales, aux regards desquelles s’offraient sans cesse des scènes de mort et de destruction, le spectacle effrayant de longues nuits, la pensée du néant venait se mêler à toutes les croyances et les dominait tout entières. Le trépas, la terreur, la souffrance semblaient des caractères plus particuliers aux Dieux que l’amour, la justice et la bonté ; ces fléaux étaient les attributs divins par excellence, et tant paraissait fatale et nécessaire aux Scandinaves cette loi de la destruction et de la mort, qu’ils y soumettaient leurs divinités elles-mêmes, lors de ce grand crépuscule qui devait éclairer les derniers instants de la nature.
Les météores étonnaient surtout l’esprit de ces anciens peuples, et c’était dans ceux dont ils redoutaient davantage les effets qu’ils reconnaissaient plus particulièrement l’intervention divine. Taranis frappait souvent de la foudre la cime orgueilleuse de leurs montagnes, et Circius faisait souffler un vent desséchant et impétueux. Au sein de cette Gaule que le soc de la charrue n’avait pas encore transformée en un des pays les plus riches de l’Europe, l’eau, la terre, la pierre et le bois, éléments premiers de l’industrie, étaient presque les seuls dons que le créateur eût départis aux habitants, dons précieux qui leur apparaissaient comme autant de divinités bienfaisantes révélant leur présence par ces objets grossiers en apparence, et dont la puissance mystérieuse devait être invoquée et bénie.
Antérieurement au druidisme, né des croyances orientales, l’adoration des fleuves, des forêts, des pierres, des lacs, des monts et des fontaines constituait tout le culte de nos ancêtres. Le druidisme ne le détruisit pas, il se combina seulement avec lui. L’épigraphie latine ne laisse aucun doute à cet égard. Les Vosges étaient pour les Celtes le dieu Vosegus, les Alpes, le dieu Pœninus ; la forêt des Ardennes, la déesse Arduinna ; le Rhin, le Danube, étaient honorés comme des divinités ; les sources thermales étaient invoquées sous le nom du dieu Borvo, du dieu Grannus, sous ceux des déesses Damona ou Sirona etc.
Rome, qui plaçait dans son Panthéon les dieux de tous les peuples qu’elle soumettait à son empire, confondit dans son vaste polythéisme les divinités de la Gaule et de la Germanie, et lorsque les inscriptions nous révèlent l’existence de divinités topiques, de croyances locales, elles nous les montrent déjà transformées par l’influence latine. Le nom du dieu romain est joint à celui du dieu gaulois avec lequel il offrait quelque analogie. C’est ainsi qu’Ogmius devint Hercule Ogmius ; Grannus, Apollon Grannus ; Camulus, Mars Camulus ; Abnoba et Arduinna, Diane Abnoba et Diane Arduinna ; Visucius, Mercure Visucius. La racine de ces vocables divins, étrangère au latin, dénonce la confusion que le peuple-roi s’efforçait d’opérer entre toutes les religions, pour les ramener à la sienne et étreindre par un même lien sacerdotal ceux qu’il étreignait déjà par un même lien politique. Quelquefois le nom primitif du dieu a tout à fait disparu ; le nom latin est resté seul. Mais malgré cette substitution d’un nom nouveau, il est presque toujours aisé de reconnaître la divinité nationale originaire. Que de fois on a retrouvé dans la France et l’Allemagne des inscriptions qui sont relatives aux Nymphes, aux Suleviæ, aux Sylvains, aux Junones, et qui font voir combien le culte de ces divinités secondaires était répandu dans les contrées gauloises et germaniques ! Tantôt c’est un Præfectus aquæ qui, sur les bords du Rhin, dresse un autel aux nymphes qui président aux ondes sacrées du fleuve ; tantôt c’est une druidesse, Arété, qui, sur l’ordre d’un songe, consacre un ex-voto aux sylvains et aux nymphes du lieu ; une autre fois ce sont des charpentiers (tignarii) de Feurs qui réparent un temple de Sylvain. Ne sont-ce pas là des monuments qui attestent que le culte des bois, des eaux et des fontaines s’était encore conservé dans la Gaule pendant la domination romaine ? Dans ce lac dédié à Apollon et situé près de Toulouse, lac qui recevait les offrandes d’or et d’argent qu’y venaient jeter les Tectosages, ne retrouve-t-on pas également l’antique adoration des eaux ?
Non seulement les peuples de la Gaule et de la Germanie adressaient leurs vœux aux agents physiques de la nature qui étaient pour eux les manifestations de puissances divines cachées, mais chaque ville plaçait encore son territoire sous la garde d’une divinité particulière avec laquelle cette ville, ce territoire étaient pour ainsi dire identifiés. Cette croyance à des divinités autochtones et topiques, vestige épuré du fétichisme plus grossier dans lequel la terre elle-même recevait un culte, exerçait une heureuse influence sur le patriotisme des Gaulois ; elle attachait, par le lien le plus sacré, l’homme au sol qui l’avait vu naître en transformant ce sol même en une divinité qui vivait en lui et en protégeait les habitants. Les dieux ne faisaient qu’un avec la patrie : abandonner son toit, sa cité, c’était quitter sa religion. Cette idée empêcha plus d’une fois le Gaulois, prêt à émigrer, de délaisser un sol ingrat pour une terre plus féconde ; elle contribuait aussi à réveiller, dans l’âme de celui qui avait quitté sa demeure, la pensée du retour. Il n’y avait pas, sans doute, que les Gaulois et les Germains qui eussent ainsi divinisé leurs villes, afin d’y attacher davantage les citoyens ; dans toute l’antiquité, chaque peuple eut ses dieux, comme ses lois, distincts de ceux des autres peuples ; dieux qui prenaient fréquemment leur nom de celui de la nation ou de la cité qui les invoquait. Athènes et Rome, personnifications des deux plus célèbres villes de la Grèce et de l’Italie, étaient regardées comme des déesses. Mais chez les Gaulois, cette localisation religieuse était le fondement même de leur mythologie. Chaque divinité était affectée à une ville, à laquelle elle empruntait son nom : Nemausus veillait sur Nîmes, Vesontio sur Besançon, Luxovius sur Luxcuil, Bibracta sur Beuvray. Plus souvent, c’étaient plusieurs divinités réunies qui étendaient à la fois leur protection sur une peuplade, sur un territoire. On ne les désignait pas par un autre nom que celui de cette même peuplade, de ce même territoire. À Rumenheim, elles s’appelaient Rumanehæ ; à Hamm, Hamavehæ ; à Trêves, Treveræ ; Vacalinehæ à Wachlendorf ; chez les Gallaici ou Callaici, Gallaicæ ; et lors même qu’on ne reconnaît pas quel était le peuple qui les honorait d’une manière spéciale, la terminaison seule de leur nom indique qu’il est dérivé d’un nom de peuple ou de ville.
Ces divinités étaient ordinairement représentées par trois femmes portant dans leurs mains des fleurs, des fruits ou des pommes de pin ; les inscriptions de la période romaine leur donnent le nom générique de mairie, emprunté sans doute à la langue gantoise, ou ceux de maires et matronæ. Ces deux derniers vocables, empruntés à la langue latine, font voir que le polythéisme romain s’était associé ces divinités locales.
Déesses-Mères
(Sculptures du Musée lapidaire de Lyon).
De même qu’il substituait les nymphes, les sylvains et les campestres de l’Italie aux esprits des rivières, des bois et des fontaines, adorés dans la Celtique, il remplaçait les divinités topiques dont nous venons de parler, par les Fata ou Parcæ. Celles-ci rappelaient en effet par leurs attributs les deæ patriæ et indigetes de la Gaule et de la Germanie. Dans l’antiquité, les Parques veillaient à la prospérité des hommes, présidaient à leurs destinées comme les matræ ou matrones gauloises ; comme elles, elles protégeaient les villes et les nations.
Les Parques, Mορɩɑτ, avaient été d’abord chez les Grecs en nombre indéterminé, ou, pour mieux dire, la Parque fut à l’origine la déesse des destinées de chaque mortel. Plus tard on fixa les nombres des Parques à trois ; d’après la donnée d’Hésiode, on les nomma Lachésis, Clotho et Atropos ; on les appelait tantôt filles de Jupiter et de Thémis, tantôt de l’Erèbe et de la Nuit, tantôt du Temps et de la Nuit ou de la Terre et de la Mer. On leur attribua également pour mère, la Nécessité. On les représentait dans des monuments votifs presque semblables à ceux que nous avons trouvés existants pour les déesses-mères. On figurait les Parques couronnées de fleurs, avec un sceptre ou bâton à la main ; on leur dressait des temples et des autels.
On possède un certain nombre d’inscriptions latines consacrées aux Fata ou Parcæ. On en reconnaît généralement trois, qui répondaient au passé, au présent et à l’avenir. On les représentait par trois femmes qui filaient les destinées humaines : Tria autem Fata fingunt, dit Isidore de Séville, in colo et fuso, digitisque fila ex lana torquentibus propter tria tempora. L’une, le Passé, formait le fil ; la seconde, le Présent, le tissait ; la troisième, le Futur, le rompait. Unde etiam tres Parcas voluerunt, dit Lactance, unam quæ vitam hominibus ordiatur, alteram quæ contexat, tertiam quæ rampat ac finiat. Les trois Parques portaient le nom de Nona, Decima et Parca. Voici ce que nous dit à ce sujet Varron, dans un passage que nous a conservé Aulu-Gelle : Antiquos autem Romanos Varro dicit nomina Parcis tribus fecisse, a pariendo, et a nono atque decimo mense. Nam Parca, in quit, immutata littera una, a partu nominata ; item Nona et Decima a partus tempestivi tempore.
Les Fata se rattachaient en outre aux Junones, aux Campestres, aux Nymphæ, à toutes les divinités champêtres. Le nom de Fatuæ, souvent donné aux nymphes, était emprunté à la même racine que le nom de fatum. Ce radical fat renfermait l’idée d’avenir et de destin. Les Parques tenaient ainsi à la fois des divinités champêtres et des divinités généthliaques ; et si, d’une part, elles partageaient avec Lucine et les Junones les fonctions d’obstetrices, de l’autre, elles étaient redoutées des habitants des campagnes, et c’était dans les vallées de la Phocide qu’on plaçait leur séjour.
Les Fatuoe ou plus anciennement Fentha, étaient les épouses des Futui, appelés aussi Fauni, divinités champêtres habitant les bois, les lieux sauvages et qui tantôt protégeaient les hommes, les troupeaux, tantôt les tourmentaient et persécutaient. Leur nom était dérivé de celui d’un dieu auquel on avait originairement prêté les caractères que les poésies saturniennes attribuèrent ensuite à plusieurs. Faunus et Fauna étaient des divinités fatidiques : Quidam deus Fatuus, dit un mythographe latin ; hujus uxor Fatua, idem Faunas et eadem Fauna. Dicti sunt autem Faunus et Fauna a vaticinando ; unde et fatuos dicimus, inconsidere loquentes. Ces dieux étaient représentés sous la figure d’êtres velus ; on les supposait identiques aux incubes qui produisent les cauchemars. Faunus infernus dicitur deus et congrue, dit un autre mythographe ; nam nihil est terra inferius, in qua habitat et responsa dat. Ipse est et Fatuus ; hujus uxor est Fatua ; idem Faunus et eadem Fauna a vaticinando, id est fando. Fauni autem saut qui vulgo incubæ vel pilosi appellati sunt, et a quibus, dum a paganis consulerentur, responsa vocibus dabantur.
Faunus s’appelait encore Fontus, et sous ce nom présidait aux fontaines. Les Faunes, les Fortes ou Fontes, les Fatuæ, les Satyres, les Sylvains, étaient, comme l’an et les nymphes des Grecs, les divinités des forêts, des bocages, des rivières et des sources ; comme nous l’apprend Martianus Capella. Ipsam quoque terram, quæ hominibus invia est, referciunt longævorum chori, qui habitant silvas, nemora, lacus, fontes ac fluvios ; appellanturque Fanes, Fauni, Fones, Satyri, Nymphæ, Fatuæque vel Fantuoe vel etiam Fanoe, a quibus fana dicta, quod soleant divinare.
Ces analogies conduisirent à confondre les attributs des Fata ou Parques, prédisant la destinée, avec ceux des Fatuæ ou nymphes latines, protectrices des champs. Les Nymphes, à l’instar des Fata, furent regardées comme des fileuses. Fauna ou Fatua, comme la Bonne Déesse, était la gardienne de la chasteté, de la virginité ; nul homme ne devait prononcer son nom. Les Parques étaient également regardées comme vierges.
La troisième Parque, celle qui présidait à l’avenir, à la mort, s’appelait aussi Morta, d’un nom apparente au mot latin mors, mort.
Les Parques ou Fata latines n’étaient qu’une copie des Mοϊρατ grecques : Tria Fata etiam Plutoni destinant, écrit un mythographe ; quoque Parcæ dictæ per antiphrasim, quod nulli parcant. Clotho colum bajulat. Lachesis trahit, Atropos occat. Clotho græce, latine dicitur evocatio, Lachesis sors, Atropos sine ordine.
Le culte des Parques, dominoe fati, comme les appelle Ovide, fut donc associé, confondu même avec celui des divinités topiques dont il a été parlé plus haut. Le fait est attesté par des inscriptions de la Gaule cisalpine. Sur l’une d’elles, on lit la dédicace fatis Dervonibus, sur une autre matronis Dervonnis. Une inscription de l’île de Bretagne porte matribus Parcis. L’association s’étendit même jusqu’aux Junones, aux Nymphes, aux Sylvains, et, en général à toutes les divinités champêtres des Romains, dont plusieurs recevaient, nous l’avons déjà remarqué, les titres de matres et matronoe.
La déesse Nehalennia, dont le culte, répandu chez les habitants de la Zélande, se rattachait à celui de ces divinités-mères, présidait, suivant les conjectures de M. Marchal, à la culture des plaines et rappelait par ses attributs la Pomone italique. Toutes ces immortelles habitantes des forêts de la Germanie et de la Gaule, des bords du Rhin et de la Loire, ces vierges divines, invoquées comme les protectrices des champs et du sol, ne formaient donc qu’une immense famille à laquelle on adressait les mêmes vœux et dressait les mêmes autels.
À l’avènement du christianisme, que devint le culte des déesses-mères, celui des Nymphes, des Sulèves, des Sylvains, des Junons, qui lui était associé ? Disparut-il sans laisser aucune trace, aucun souvenir dans l’esprit du peuple ? Fut-il anéanti tout à coup, avec ces temples de Jupiter et de Mercure que les premiers apôtres de la Gaule renversèrent dans leur impétueuse indignation contre le paganisme ? On répondrait non, à ne juger que d’après l’ordre des révolutions religieuses, et d’après ce que l’on sait de la persistance et de la ténacité des croyances, surtout chez un peuple ignorant et tenace, tels qu’étaient les Celtes, et comme sont encore les paysans bas-bretons ; on répondra doublement non, lorsqu’on aura étudié les témoignages que nous a conservés l’histoire. Ceux-ci, en effet, ne nous permettent pas de douter que le culte des objets physiques ne se soit conservé longtemps chez nos ancêtres. Les Capitulaires condamnent comme sacrilèges ceux qui continuaient à allumer des feux et des lumières près des arbres, des pierres et des fontaines, et qui adressaient leurs vœux à ces êtres inanimés. Les lois de Luitprand font la même défense. Dans son allocution pastorale aux Belges qu’il venait de convertir, saint Eloi avait déjà défendu de placer semblablement des luminaires et des offrandes auprès des rochers, des sources, des arbres, des cavernes et des carrefours, et il engage ce peuple à détruire tout ce qui servait à entretenir cet usage superstitieux.
Les conciles joignaient leurs anathèmes aux efforts isolés des princes chrétiens et des premiers missionnaires de la foi. Le 23e canon du concile d’Arles, tenu en 442, proscrit formellement le culte des arbres, des pierres et des fontaines. Ces dispositions prohibitives furent renouvelées en 567, par le concile de Tours, et par d’autres conciles encore.
En 743, le concile tenu à Leptines, près de Binche, dont les canons célèbres sont communément désignés sous le nom d’Indiculus superstitionum et paganiarum énumère une foule de superstitions qui remontaient chez les Belges au temps du paganisme. Parmi les prohibitions qu’il prononce, on remarque celles de sacris sylvarum quæ Nimidas vocant ; de his quæ faciunt super petras ; de fontibus sacrificiorum . Au XIIe siècle, le culte des arbres et des fontaines subsistait encore chez les Saxons qui habitaient au-delà de l’Elbe.
Mais ces défenses, prononcées par les princes temporels et par l’Église, restaient impuissantes devant les vieilles croyances des Gaulois et des Germains. Un respect pieux continuait à entourer les objets si longtemps vénérés ; et ce n’était qu’en les consacrant au nouveau culte, qu’en sanctifiant pour ainsi dire ces vestiges païens, que les apôtres de l’Évangile, fidèles en cela au conseil que le pape Grégoire le Grand donnait à l’abbé Mellitus allant travailler à la conversion des Anglo-Saxons, parvenaient à extirper les souches de la superstition qui avaient projeté dans le sol de si profondes racines. Ces forêts sacrées que les Celtes avaient si longtemps honorées comme la demeure des divinités, dans lesquelles ils n’entraient que comme dans un sanctuaire, l’âme saisie d’une crainte religieuse, ces forêts, dis-je, continuèrent à inspirer le même respect, la même vénération. Des images pieuses furent placées sur les arbres jusqu’alors adorés, sur le chêne, le hêtre, le tilleul et l’aubépine ; et le peuple, en venant, selon son antique coutume, se prosterner sous leur ombre, honora presque à son insu un nouveau dieu.
Ces idées nouvelles, ces pensées chrétiennes qui allaient désormais s’attacher à ces simulacres naturels, n’effaçaient pas, dans l’imagination populaire, la croyance à l’essence mystérieuse de ces forêts. Rappelons-nous la célèbre forêt de Bréchéliant, devenue la demeure des enchanteurs et des magiciens, après avoir été sans doute le théâtre des cérémonies druidiques ; rappelons-nous ces forêts qu’ont décrites les romanciers et les poètes du Moyen Âge, depuis celle où demeurait Auberon « le petit roi faé, » et que traversa Huon de Bordeaux pour arriver à Babylone, jusqu’à celle d’Armide que décrivit le pinceau du Tasse, inspiré par Lucain et les souvenirs d’Arthur et de Merlin. Les fontaines sacrées furent consacrées à la Vierge et aux saints ; on crut encore à leurs vertus tout en cessant de croire aux divinités qui y demeuraient : des croix surmontèrent les monuments mégalithiques, et les dolmens ou les menhirs furent transformés en calvaires. Ce ne fut plus à l’intervention des déesses-mères, à l’effet des incantations magiques de quelques druidesses, qu’on attribua la vertu mystérieuse de certaines plantes, de certaines herbes, mais aux saints sous le patronage desquels elles furent placées. Le clergé, en un mot, couvrit tous les vestiges de la religion, qu’il avait abattue, du manteau de son orthodoxie.
Ainsi, jusqu’à l’époque des Carolingiens, le vieux culte gaulois résista encore çà et là aux victoires de la foi chrétienne : les bois, les pierres, les fontaines ne s’étaient point complètement dépouillés, aux yeux des paysans, de leur caractère auguste et sacré. Nul doute que le culte des nymphes, des campestres, des déesses-mères, qui s’était, comme nous l’avons vu, identifié à ce fétichisme plus ancien, pour l’ennoblir et l’épurer, ne continuât à se mêler à ces souvenirs vivants du druidisme ; nul doute que les croyances, dont ces divinités formaient l’élément premier, ne laissassent encore dans les esprits des racines innombrables.
Des différents vocables sous lesquels les Gallo-Romains avaient désigné les divinités dont on vient de parler, un seul s’était conservé dans la mémoire du peuple, celui de Juta, jadis employé comme synonyme de « parques », de matræ ou de matrones ; et les fata antiques devinrent les fées des pays de langue d’oïl, les fadas des pays de langue d’oc, les hadas de Gascogne. Mais il faut soigneusement distinguer le substantif fée d’un adjectif presque identique : du latin fatum, en effet, on tira un adjectif bas-latin falatus, envieux français faé, plus tard fé, signifiant « destiné » et, par extension « enchanté ». C’est ainsi que Perrault a pu dire que la clef de Barbe-Bleue était « fée ». On peut citer de nombreux exemples de l’emploi du vieil adjectif français faé :
dit le roman de Troie. On lit dans celui de Brun de la Montagne :
et dans celui de Partonopeus de Blois, au sujet de la forêt des Ardennes :
C’est donc à la fois dans le culte des Parques et des deæ matræ, aussi bien que dans celui des bois et des fontaines, qu’il faut aller chercher l’explication des attributs qui furent donnés aux fées et la preuve que celles-ci sont réellement nées d’un mélange de croyances et de traditions primitivement distinctes. Les moyens de démonstration ne manquent pas, et leur abondance seule annonce assez sur quelle base solide on peut asseoir le rapprochement que nous avons entrepris.
C’est, avons-nous dit, aux fontaines et aux forêts que présidaient les divinités de la Gaule ; c’était au fond de ces forêts, sur les bords des eaux, des sources qui jaillissaient parfois à l’ombre de quelques-uns de leurs arbres, que se célébraient les cérémonies en leur honneur. Ces lieux devaient donc être, dans l’imagination populaire, le séjour des fées, et c’est précisément ce qui a eu lieu. Les fées se rendaient visibles près de l’ancienne fontaine druidique de Baranton, dans la forêt de Bréchéliant :
écrivait, au XIIe siècle, le poète normand Wace. Ce fut également dans une forêt, celle de Colombiers en Poitou, près d’une fontaine, que Mélusine apparut à Raimondin. C’est aussi près d’une fontaine que Graelent vit la fée dont il tomba amoureux et avec laquelle il disparut pour ne jamais reparaître. C’est près d’une rivière que Lanval rencontra les deux fées, dont l’une, celle qui devint sa maîtresse, l’emmena dans l’Île d’Avalon, après l’avoir soustrait au danger que lui faisait courir l’odieux ressentiment de Genièvre. La fée Viviane, transformation d’une nymphe des bois au nom gallois de Vivian, célèbre dans les traditions de la Bretagne insulaire, habitait au fond de la forêt de Bréchéliant, sous un buisson d’aubépine, où elle tint Merlin ensorcelé.
Plusieurs fontaines portaient, en France, le nom de Fontaine des Fées. Ce fut près de l’une d’elles, au pied d’un arbre, que Jeanne d’Arc eut sa première vision. C’est sous le patronage de ces êtres mystérieux que les montagnards de l’Auvergne placent les eaux minérales de Murat-le-Quaire. Dans le Béarn, une fontaine porte encore le nom de Houn de las Hadas, c’est-à-dire « fontaine des Fées »; et Dumège en mentionne une autre, près de Saint-Bertrand de Comminges.
Sur la Dive, en Normandie, et sur toutes les rivières du Maine, de l’Anjou, de la Saintonge, de l’Orléanais et du Berry, les Milloraines, les Blanches mains, les Fadettes ou Demoiselles, gardent les ponts ou les moindres passages. Enfin, en Angleterre, les habitants de Gloucester prétendent que neuf fées, neuf magiciennes, veillent à la garde des eaux thermales de cette ville ; et ils ajoutent qu’il faut les vaincre, si l’on veut faire usage des eaux.
Les Irlandais attribuent aux fées une très petite stature, ils les supposent habillées de vert, avec de larges bonnets écarlates. De là vient que la digitalis purpurea s’appelle en anglais « fairy cap. »
Un des traits les plus caractéristiques des fées, c’était le soin qu’elles prenaient d’assister à la naissance des enfants auxquels elles dispensaient à leur gré les défauts et les qualités, le bonheur et la mauvaise fortune. Nous reconnaissons, dans cette présence près du berceau des nouveau-nés, un des attributs des Parques, dont une des fonctions était d’assister Ilithye et de se trouver à la naissance des enfants pour prononcer sur leur avenir. Les Parques présidèrent à la naissance d’Achille. Pindare nous montre Apollon ordonnant à ces déesses d’être présentes aux couches d’Evadné ; Ovide les fait pénétrer dans la chambre d’Althée, pour allumer le tison fatal auquel est attaché le sort de Méléagre. À la naissance d’Hercule, ministres de la jalousie de Junon, elles prolongèrent les douleurs d’enfantement d’Alcmène. Une patère du musée Borgia les fait assister de même à la naissance de Bacchus ; et, à titre de divinités Génétyllides, elles sont associées aux Heures et aux Grâces, qui, comme elles, recevaient les nouveaux-nés et les ornaient de mille dons brillants.
Dans la Grèce moderne, on invoque les Mires, c’est-à-dire les Parques des anciens (Mοϊρατ se prononce Mirai dans la langue moderne, à la naissance des enfants ou pour obtenir un époux. Le cinquième jour de l’accouchement, l’amphidromie des anciens, porte le nom de « visite des Mires ». La plus pauvre cabane prend ce jour-là un air de fête, pour recevoir les bonnes demoiselles qu’on ne voit jamais, quoiqu’elles emportent la fièvre de lait de l’accouchée (έλτϰτονα). Malgré cette attente, il faut se garder de laisser celle-ci seule, de peur qu’elles ne lui tordent le cou. On reconnaît dans cette croyance la trace du double caractère génétyllique et léthique de ces divinités.
La jeune Grecque, qui éprouve une émotion inconnue, fait exposer par une bonne ( Bατα) une offrande de gâteaux et de miel dans une grotte, afin de supplier les Mires de lui envoyer un époux, qu’elle a soin de désigner par quelque emblème, propre à faire connaître son âge et ses qualités. Les nouvelles mariées invoquent aussi les Mires pour obtenir la grâce de la fécondité.
Les romanciers du Moyen Âge nous montrent également les fées se présentant la nuit que naquit Ogier le Danois, pour lui faire chacune un don différent. Brun de la Montagne fut, peu de temps après sa naissance, porté dans la forêt de Bréchéliant, où les fées vinrent, comme les Parques, au nombre de trois, le doter de grandes vertus. Trois fées firent aussi présent de trois beaux souhaits au fils de Maillefer. Les fées assistèrent de même à la venue au monde d’Isaïe le Triste. Aux environs de la Roche-aux-Fées, dans le canton de Rhétiers, les paysans croient encore aux fées qui prennent, disent-ils, soin des petits enfants, dont elles pronostiquent le sort futur ; elles descendent dans les maisons par les cheminées et ressortent de même pour s’en aller. Suivant une tradition pyrénéenne, les fées (hadas) viennent dans les habitations de ceux qui les vénèrent ; elles portent le bonheur dans leur main droite, le malheur dans la gauche. On a soin de leur préparer, dans une chambre propre et reculée, le repas qu’on doit leur offrir. On ouvre les portes et les fenêtres ; un linge blanc est placé sur la table, ainsi qu’un pain, un couteau, un vase plein d’eau et de vin et une coupe. Une chandelle ou une bougie occupe le milieu de la table. On croit en général que ceux qui leur présentent les meilleurs mets peuvent espérer que leurs troupeaux se multiplieront, que leurs moissons seront abondantes et que l’hymen comblera leurs vœux les plus chers ; tandis que ceux qui ne s’acquittent qu’à regret de leurs devoirs envers les fées, et qui négligent de faire des préparatifs dignes d’elles, doivent s’attendre aux plus grands malheurs. Le 1er janvier, au point du jour, le père, l’ancien, le maître de chaque maison, prend le pain qui a été présenté aux fées, le remet et après l’avoir trempé dans l’eau et le vin, il le distribue à tous ceux de sa famille, et même à ses serviteurs. On se souhaite donc la bonne année et l’on déjeune avec ce pain. Les colas Scandinaves allaient de même prédire la destinée des enfants qui naissaient dans les grandes familles ; elles assistaient aux accouchements laborieux et aidaient par leurs incantations (galdrar) les femmes en travail. Souvent même, les fées prétendaient être invitées. Longtemps, à l’époque des couches de leurs femmes, les Bretons servirent un repas dans une chambre contiguë à celle de l’accouchée, repas qui était destiné aux fées dont ils redoutaient le ressentiment. Trois fées furent invitées à la naissance d’Auberon, elles le dotèrent à l’envi des dons les plus rares ; mais l’une d’elles, mécontente, condamna Auberon à ne jamais dépasser la taille d’un nain.
Il serait bien long de rapporter ici toutes les traditions qui rappellent encore cette parenté entre Lucine et les fées, ce rôle d’obstetrices, de « ventrières » comme disaient nos pères, qu’elles tenaient des Parques antiques. Nous ne citerons plus qu’un fait : dans la légende de saint Armentaire, composée vers l’an 1300 par un gentilhomme de Provence nommé Raymond, on parle des sacrifices qu’on faisait à la fée Esterelle qui rendait les femmes fécondes. Ces sacrifices étaient offerts sur une pierre nommée la Lauza de la Fada.