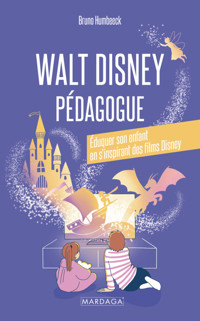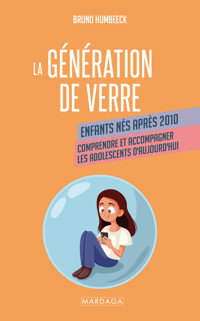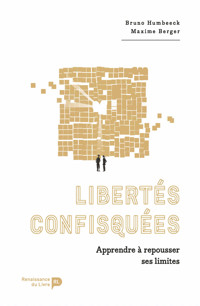Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mols
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les contes de fées au service de la (re)construction de soi
Ce livre, on pourrait – ou plutôt, on devrait – le mettre entre toutes les mains. À travers l’analyse des contes de fées, sous la forme de dialogues vrais avec de jeunes ados de 13 ans, il nous fait entrer, par une porte dérobée, dans le monde des vies cassées et reconstruites. Le recours à des acteurs imaginaires donne naissance à une œuvre à la fois légère et profonde, simple et complexe, humoristique et sérieuse.
Il se révèle à ce titre un facilitateur de conscientisation, démarche essentielle pour susciter le changement en comprenant ce qui se passe chez l’enfant et l’adolescent quand il est confronté à des difficultés pour grandir et qu’il faut l’aider à rebondir. Puisse chacun être imprégné des idées fécondes qu’il contient. En alliant idéalisme et réalisme, ce voyage en résilience proposé par Bruno Humbeeck nous emmène sur un chemin plein d’espoir. En ces temps d’incertitude et de désarroi, c’est sans doute le plus beau des cadeaux à offrir aux autres et à soi-même.
Un ouvrage indispensable pour comprendre la résilience et qui sera utile tant aux adolescents qu'aux parents et aux professionnels de l’éducation !
EXTRAIT
Tout un programme… et comment se préparer à faire face à toutes ces charmantes catastrophes que tu nous annonces ?
On s’y prépare tous les jours. Qu’est-ce que tu crois qu’il apprend le petit enfant qui regarde Bambi ?
Je ne sais pas moi, l’histoire d’une petite biche, d’un faon…
Oui, mais il apprend surtout le sens tragique de l’écoulement de la vie quand elle s’emmêle trop brutalement à la mort. En une image, il est confronté brutalement aux trois sources fondamentales de l’angoisse humaine : l’incertitude, la finitude et la solitude. Nous mourrons tous, on ne sait pas quand et comment cela se produira et les gens que nous aimons mourront eux aussi… Voilà pourquoi cette scène fait autant froid dans le dos. « La mort est un définitif non-retour »…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bruno Humbeeck est docteur en psychopédagogie de l’Université de Rouen. Psychopédagogue, responsable de recherche au sein du service des sciences de la famille (Dir. W. Lahaye) et chargé de cours à l’UMons, il est actif à la fois sur le terrain et dans le domaine de la recherche. Cette double approche des questions de société contribue à rendre sa vision particulièrement convaincante. Spécialiste de la résilience, il travaille à ce titre avec
Boris Cyrulnik, auteur de la préface.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRÉFACE
Boris Cyrulnik
Les mots sont des organismes vivants. Ils apparaissent un jour, se développent, prennent un peu trop de poids, s’usent et disparaissent.
C’est Karl Marx qui a donné naissance au mot « ouvrier ». Au milieu du XIXe siècle, dans un contexte où l’industrie se développait à un prix humain terrifiant. Émile Zola a décrit une condition sociale qui n’a plus grand-chose à voir avec ce que désigne aujourd’hui le mot « ouvrier ». Au siècle dernier, ces hommes n’étaient que des annexes de machine, allant à pieds au travail et rentrant dans un tout petit logement près de l’usine. Aujourd’hui, un ouvrier quand il n’est pas chômeur est un technicien qui possède voiture et maison. Balzac, à la fin du XIXe siècle inventait le mot « touriste » qui désignait un groupe d’oisifs se promenant lentement alors qu’aujourd’hui ce mot évoque des groupes de voyageurs pressés, se distrayant entre deux journées de travail.
Alors que signifie l’apparition récente du mot « résilience » ? Cette naissance verbale témoigne-t-elle d’un changement culturel ?
C’est intéressant les métaphores, parce que ça aide à penser en mettant une image, facile à voir, à la place d’une définition, difficile à comprendre. C’est dangereux une métaphore, quand notre tendance à la pensée facile nous mène à croire que l’image est la chose. Ce mot qui vient du latin « resalire » a donné « ressault », « résilier » un contrat avec un malheur passé. Les marins avec qui je travaille l’emploient couramment quand ils veulent désigner l’aptitude à reprendre sa forme après un grand coup. Et pourtant, déjà, ils disent que, lorsqu’un résilient a reçu trop de coups, il en garde la trace, et ils disent même que la résilience d’une barre de fer n’est pas la même dans l’air et dans l’eau. Alors, vous pensez bien que cette métaphore en psychologie garde la trace du passé et dépend du contexte encore plus.
La psychologie est remplie de métaphores avec lesquelles elle fonctionne : l’étayage est une métaphore de maçon, la sublimation une métaphore de chimiste, et l’idée noire une métaphore de marchand de couleur. Personne ne s’y trompe sauf ceux qui ont de graves troubles de la symbolisation.
Après ce petit préambule linguistique, on peut tout de même se demander pourquoi ce mot, à peine âgé de vingt ans, se développe de manière parfois hypertrophique ? La réponse qui me vient, c’est que jusqu’aux années 1980 toute la psychologie a été pensée dans la perspective du pire.
Relisez La première année de la vie de l’enfant1 vous verrez, clairement décrits, les stades que nous avons tous constatés sur les troubles de la carence affective : protestation, désespoir, indifférence. Par quel mystère, personne ne s’est-il intéressé au quatrième stade pourtant abondamment commenté dans la guérison (page 120-125) ? René Spitz et Anna Freud écrivent clairement que, dans certaines institutions, 37 % des enfants traumatisés par les bombardements de Londres sont morts de « marasme » alors que, dans une autre institution, de type maternelle… pas un ne mourut.
Le problème était déjà magistralement posé : pour un trauma identique, le devenir des enfants, leur évolution est totalement différente selon le « type » des institutions qui prennent en charge l’enfant blessé.
Mais pour s’intéresser à cette question, il fallait avoir un regard moins misérabiliste sur le traumatisme et il fallait aussi une méthode d’observation. Dans la synchronie, dans le moment immédiat, il fallait apprendre à observer comment l’enfant s’y prend pour gagner sa place parmi les autres. Et, dans la diachronie, il fallait faire des études qui suivent l’enfant longtemps. Alors, on peut observer des changements, des métamorphoses et parfois même des résurrections. Les échecs existent bien sûr, mais cette méthode qui permet de comparer des groupes d’enfants, pris en charge différemment et suivis pendant longtemps peut nous aider à mieux comprendre, soigner et éduquer.
Parce que, si l’on fait une observation instantanée, on extorque hors du réel un morceau de vérité qui est vrai comme sont vrais les flashs : l’enfant abandonné ou maltraité augmente les comportements autocentrés (se balancer, sucer son pouce, éviter le regard et la parole). Il souffre de troubles sphinctériens, de retard de développement physique et mental, son quotient intellectuel est très bas et même son scanner peut révéler une atrophie des circuits limbiques de son cerveau, ceux de la mémoire et de l’émotion.
Mais quand cette observation clinique vraie entraîne une généralisation excessive, on arrive à une conclusion fausse. Un enfant mal parti dans la vie est altéré, ce qui est vrai, donc il le sera toute sa vie, ce qui est faux. Sauf dans une culture qui pense qu’un enfant abîmé le sera toujours et qui dans ce cas organise autour de l’enfant des comportements, des gestes, des mimiques, des mots, des circuits sociaux qui tutorisent l’enfant mal parti vers une histoire difficile, réalisant ainsi une prophétie négative : celle qui, prévoyant le mal, organise le mal.
Or, il se trouve que les récits qui répondent à cette représentation collective structurent le bain sensoriel dans lequel se développe l’enfant. Dire à un enfant « Mon pauvre petit, puisque tu n’as pas de famille, tu ne peux pas faire d’études. Dans notre grande bonté, nous allons faire de toi un garçon de ferme », c’est amputer son devenir et gouverner son destin.
On crée ce qu’on craint quand on prononce des prophéties telles que : « Tu finiras en prison comme ton père »… « On ne sait même pas d’où tu viens »… « Puisque tu as été maltraité, tu répéteras la maltraitance ». En revanche, quand on change un discours collectif, l’enfant blessé éprouve de lui un sentiment différent. On change l’enveloppe affective qui tutorise son développement. « Regarde Oliver Twist, il a perdu sa famille, il a été très malheureux et pourtant un jour, il a retrouvé une famille et a appris un métier. C’est possible. Mets-toi au travail. On va t’aider. »
Ces attitudes face à l’enfant blessé sont totalement différentes et tutorisent des développements adaptés à ces représentations. Le regard des adultes possède un étonnant pouvoir façonnant, mais les enfants ne sont pas des récipients passifs, des cires vierges sur lesquelles on pourrait écrire n’importe quelle histoire. Nous sommes donc co-auteurs, adultes et enfants, de tout récit que l’enfant se fait de lui-même.
Ces récits sont fondamentaux et même fondateurs de l’identité du petit qui souvent joue à se rappeler les événements, les manques, les souffrances, les victoires, les bonheurs de sa jeune histoire. Ce travail de récit constitue la représentation qu’il se fait de lui-même, donc le sentiment de désespoir différent de : « J’étais petit et tout seul quand j’ai rencontré un adulte merveilleux : qu’est-ce que j’ai comme chance ! »
Cette liberté intérieure permet d’accepter l’idée qu’il est possible de modifier l’idée que l’on se fait de ce qui nous est arrivé. Le problème n’est pas de dire : « Vous êtes blessé, vous êtes foutu. » Il s’agit plutôt de faire passer le message : « Vous êtes blessé, nous allons vous soigner, mais ensuite, qu’allez-vous faire de cette blessure ? »
Faire vivre le concept de résilience, c’est probablement changer de regard sur les blessures d’enfance. Et quand on regarde différemment, on change de mimiques, de gestes, de comportements, de mots adressés aux enfants. Donc, la bulle affective qui les entoure change de forme et les tutorise différemment.
La pensée évolutionniste de la résilience ne les fixe pas dans une blessure incurable, un destin inexorable. L’optique développementale mènera probablement à repenser le traumatisme. Il faut agir sur la personne blessée bien sûr, pour réparer le trauma, mais il faut agir aussi sur le contexte familial et culturel pour changer la représentation qu’on se fait de ce trauma et ne pas en souffrir une deuxième fois.
Toutes les étoiles qui participent à la constellation qui entoure l’enfant peuvent participer à sa résilience. Quand la mère souffre, une étoile majeure s’éteint, mais il reste un père, des tantes, des voisins, un quartier, des institutions, une école, une fratrie, des copains et surtout une société structurée par des stéréotypes culturels. Il faut agir sur chaque étoile pour que le contexte permette la reprise d’un type de développement après qu’une étoile se soit éteinte.
Quand un enfant perd sa mère, il tombe dans un vide, une lacune affective qui l’entoure désormais. C’est le corps-à-corps sensoriel qui permettra de réparer ce manque. Mais quand plus tard, il cherchera à se représenter ce qui lui est arrivé, par une série d’images et de souvenirs, c’est le récit de sa tragédie qui constituera son identité narrative. Ça, on peut le travailler. On peut chercher les images, les préciser et les raconter. Les réactions émotionnelles de l’auditeur participent au sentiment que le parleur éprouve. Si l’autre manifeste une mimique de dégoût, ne vous étonnez pas que le blessé ait honte de ce qui lui est arrivé. Si l’auditeur accepte de partager l’aventure, de poser des questions, d’inviter à préciser l’image ou le mot, s’intéresse ou s’indigne, cherche à comprendre ou à sourire, ne vous étonnez pas que le blessé soit entraîné à remanier les émotions provoquées par la représentation de son passé, à éprouver différemment sa blessure.
Le conte, le récit, le partage verbal, le travail de l’image et de la parole possèdent ainsi un pouvoir de remaniement sentimental. Quand on travaille la représentation, l’émotion n’est plus la même. On éprouve différemment sa blessure passée.
L’élaboration du récit nous permettrait-elle d’acquérir l’attachement serein que le traumatisme a déchiré ?
Bruno Humbeeck nous invite à cette réflexion comme sait le faire un homme de terrain capable d’emmêler les témoignages d’une pratique et les réflexions d’une modélisation théorique dans le souci permanent d’une représentation poétique.
1. Spitz R.A. (1962), La première année de la vie de l’enfant, P.U.F.
AVANT-PROPOS
Des vilains petits canards, j’en ai croisé tous les jours dans les centres d’accueil que j’ai eu l’immense bonheur d’animer pendant plus de quinze années. J’ai passé un temps fou à écouter leurs histoires. Je les ai vus grandir, se développer et pour la plupart d’entre eux, souvent contre toute attente, s’épanouir… Bien sûr, tous ne sont pas devenus des cygnes… Mais était-ce réellement l’objectif ? La dignité ne pourrait-elle donc pas se passer de majesté ? La résilience ne parviendrait-elle donc à se manifester qu’en arborant les signes distinctifs de quelques cygnes distingués ? Je ne le pense pas. Je suis, au contraire, convaincu qu’on peut mener une superbe existence quand on doit continuer à vivre en canard parmi les canards. Sortir du lot n’est pas indispensable quand on doit s’extirper du malheur, s’échapper du drame. J’en ai accompagné tant dans les centres d’accueil des exemples d’hommes qui parvenaient à se construire une vie solide sur la conscience lucide d’une histoire désastreuse que j’en ai pris la leçon. Les voies de la résilience, ce sont les arpenteurs de ces vies ordinaires qui me les ont indiquées en tissant sur leurs drames des existences pleines de sens.
Andersen prétend qu’il n’y a pas de honte à être né dans une basse-cour quand on sort d’un œuf de cygne. J’affirme moi que, de nos jours, certaines existences de canards sauvages valent bien celle d’un cygne d’étang. Je suis même convaincu que Donald Duck n’aurait jamais connu une si brillante carrière s’il avait dû se transformer en palmipède majestueux. Et s’il a plu à Monsieur Andersen de célébrer la petite bourgeoisie pour dissimuler son enfance passée dans les marécages d’une misère ordinaire, ce combat-là n’est pas le mien. Pour ma part, je pense qu’il est plus urgent d’apprendre à aimer les vilains petits canards pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils souhaitent eux-mêmes devenir… des oiseaux gracieux, cocasses, sauvages ou domestiques. Tout est bon pour autant qu’ils renoncent à s’empêtrer dans une vie de canard boiteux et qu’ils évitent de finir en pâté par un foie de canard.
« Les vilains petits canards » dont je parle à demi-mot dans ce livre se reconnaîtront. Lucien, Romu, Manu, Ingrid, Naïma, et tous les autres qui m’ont donné cette leçon de réussir leur vie malgré tout pour me prouver que nous avions les bonnes raisons d’y croire. Si je les ai camouflés derrière des personnages de Walt Disney ou de Rowling, c’est par pudeur. Pour parler de résilience à des personnes qui n’en ont jamais entendu parler, je ne pouvais tout de même pas mettre ces vies en pâture. Certaines étaient pourtant sans doute plus parlantes que ces contes de fées.
Mais il convient de rendre ici aux vilains petits canards la paternité qu’ils méritent. Boris Cyrulnik a mis si joliment mes espoirs en mots en donnant à la résilience ses lettres de noblesse que je pourrais le citer à chaque page. Je préfère donc, pour ne pas alourdir le texte, dire une fois pour toutes ce que je dois à la lecture de son « merveilleux malheur » et de ses « vilains petits canards ». Sans ces travaux, beaucoup d’idées se seraient sans doute coupé les ailes…
Ce que j’ai écrit puise tout autant au travail que Jean-Pierre Pourtois a accompli pendant des années dans le domaine de l’éducation familiale. Pendant plus de quinze ans tout ce que j’ai réalisé a bénéficié de son éclairage. Si Boris Cyrulnik a mis la résilience en mot, Jean-Pierre Pourtois, lui, a fait subir le même sort à l’épanouissement… Et voilà donc comment deux Professeurs s’y sont pris pour mettre l’humanisme en théorie et rendre les voies de l’espoir tellement mieux praticables… Je me suis donc retrouvé à la croisée de chemins, enrichi de l’expérience de tant de vies. Toutes ces théories étaient bien pratiques pour mettre de l’ordre dans le chaos d’existences compliquées par le malheur et pour m’aider à les accompagner. La résilience indiquait des pistes, l’épanouissement montrait des voies. Du pain bénit sans doute pour un psychopédagogue de terrain perdu en recherche ou pour un chercheur égaré dans l’action.
C’est cette leçon d’espoir que j’ai prise au jour le jour que je souhaitais transmettre. Mais comment expliquer la résilience à des personnes a priori épargnées par les drames sans sombrer dans le misérabilisme ? Comment montrer notamment à des adolescents, à cheval entre enfance et âge adulte, balançant le plus souvent leurs certitudes entre espoir et désespoir, des voies d’épanouissement susceptibles de guider en permanence leur vie entre le futile et l’essentiel ? Comment transmettre à tous ceux qui en ont besoin ce « kit de survie psychologique » qui, je l’avais observé, avait redressé tant d’existences saccagées ? Pour tenter une telle expérience, il fallait bien que de fameux personnages imaginaires me viennent en aide…
Les personnages de Walt Disney étaient d’ailleurs déjà venus plus d’une fois à mon secours lorsque j’abordais avec les enfants, les adolescents et même les adultes des maisons accueil les questions essentielles qu’ils étaient amenés à se poser. Beaucoup d’entre eux servaient de supports à nos entretiens lorsqu’ils éprouvaient des difficultés à parler d’eux-mêmes. Et, s’ils parvenaient à m’aider dans des circonstances aussi difficiles, je pouvais sans doute compter sur eux pour quelques discussions passionnées avec ma fille et quelques-unes de ses copines de la classe 3R2… Ces élèves de l’école Saint Pierre à Leuze (Belgique) que Madame Lebreton a bien voulu me confier lors de quelques rencontres sur la résilience m’ont aidé à tracer le chemin. Du haut de leurs quinze ans et de leurs permanentes remises en question, Nadège, Maud, Delphine, Melissa, Charline, Adeline et ma fille, Marie-Lise, ont balisé avec moi ces itinéraires de résilience pour les mettre à la portée de tous.
LA RÉSILIENCE EN QUESTIONS
Gare de Varsovie, 1945… À la voie 4, on annonce un train en provenance de Dachau. À l’intérieur des centaines d’enfants juifs qui ont vécu l’enfer des camps de concentration. Essayez d’imaginer la scène. Vous êtes là et dans une poignée de minutes, sur le quai, des cohortes d’enfants encombrés de leur malheur vont se répandre. Essayez maintenant de vous figurer un avenir pour eux, orphelins pour la plupart, en l’échafaudant sur les lambeaux d’une enfance volée, dilapidée dans la haine et l’humiliation. Sont-ils donc condamnés pour avoir vécu de telles horreurs ? Sont-ils perdus pour s’être confrontés à une douleur aussi inconcevable ? Est-il encore possible pour eux de se développer normalement après cela ? Qui peut raisonnablement faire preuve d’optimisme en songeant à l’avenir de ceux qui ont vécu un tel enfer ?
C’est terrible ce que tu demandes là… Rien qu’à y penser, ça me fiche une angoisse pas possible. J’ai vu des images du même genre dans « holocauste »… Des petits bouts avec des casquettes, en culotte courte, tout décharnés… Non, je ne peux pas, même en le voulant très fort, être optimiste pour eux ; on ne se relève pas après ça. Sans parents, en plus… C’est clair, ces enfants vont êtregravement perturbés. Ils vont se développer très difficilement. Il va toujours y avoir comme une peur de grandir. Moi, je ne me fais pas trop d’illusions. Je crois qu’à leur place… Je n’arrive même pas à m’imaginer à leur place… Je ne sais même pas si cela valait la peine de survivre. Si c’est pour être tout bousillé à l’intérieur…
Cela vaut toujours la peine de survivre mais c’est vrai que ce n’est pas si simple. Comme l’a dit l’un d’entre eux, « la sortie des camps n’est pas la liberté ». Après, il faut seulement reconstruire une vie qui ait un sens ou, pire, former un adulte à partir d’une enfance en friche… Bref, construire sur un désastre.
Et c’est possible ?
Sans doute. En tout cas les recherches menées dans le domaine montrent que si certains enfants du train de Dachau ont effectivement eu du mal à construire leur vie d’adulte, d’autres se sont parfaitement tirés d’affaire. Un petit nombre d’entre eux est même apparemment parvenu à dénicher dans l’intensité du désastre vécu les germes d’une vie d’exception.
Et comment ont-ils fait ces rescapés du malheur ? Qu’est-ce qu’ils avaient de plus que les autres ? Moi je te le dis. Je ne suis même pas certaine que j’aurais accepté de continuer à vivre une vie de merde si on avait tué mes parents sous mes yeux. Alors il ne faut surtout pas venir me bassiner avec une vie d’exception. Je n’y pense même pas.
C’est justement cela qui est intéressant : comprendre pourquoi certains s’en sortent là où tant d’autres ont tendance à s’effondrer. C’est intéressant précisément parce que ceux qui parviennent à s’extraire du malheur sont des hommes, qu’ils ne sont ni des surhommes ni une forme plus ou moins évoluée de superhéros. L’analyse du fonctionnement psychologique de Superman, ce n’est pas franchement passionnant. Pas plus que ne le serait probablement l’étude de la psyché sans doute un peu rudimentaire des Avengers ou une aventureuse plongée psychanalytique dans les profondeurs inexplorées de l’inconscient un peu sommaire de Thor, de Wolverine ou même de Hulk… Par contre, comprendre pourquoi, en dépit de toutes les probabilités qui en faisaient de futurs losers, ces enfants saccagés par l’existence ont fini par gagner leur vie d’adulte, savoir qui ils sont et surtout comment ils s’y sont pris, c’est important. Pas pour les mettre en valeur ou les glorifier – la plupart d’entre eux n’en éprouvent par ailleurs pas le besoin – mais parce que cela permet de mieux aider ceux qui ont du mal à rebondir, à sortir du trou pour dépasser leur traumatisme. C’est cela que l’on appelle l’étude de la résilience.
L’étude de… quoi ? Hé là, on était bien d’accord, pas de mots compliqués… Surtout pas pour expliquer des trucs pas simples ! Alors, carton jaune pour la résilience. Ou alors, débrouille-toi pour l’expliquer avec des mots qu’on comprend.
La résilience, le dictionnaire la définit comme la résistance au choc d’un matériau.
Ça y est, il nous fait de la physique maintenant… Méfie-toi, cette fois tu risques la carte rouge.
En réalité, il s’agit de désigner par ce même terme emprunté à la physique, la résistance manifestée par une personne et sa capacité à se construire une vie pleine malgré les circonstances difficiles, un environnement défavorable, voire hostile. Plus simplement, la résilience définit la solidité d’un être humain exposé à des conditions de vie difficiles ou à des traumatismes importants. Ce que les psychologues appellent, quand ils versent dans la métaphore, la faculté de rebondir ou, quand ils veulent davantage être pris au sérieux, l’aptitude à produire un néo-développement. On l’étudie chez l’adulte mais aussi chez l’enfant exposé à des conditions éducatives difficiles.
Si je comprends bien, les questions que tu te poses en étudiant la résilience, c’est du genre : Alors, c’est solide un bébé ? Existe-t-il des exemplaires incassables, des quasi invulnérables ? Et un être humain, ça tient bien le choc ? Est-ce que ça rebondit bien ?
Si tu veux. Mais c’est aussi la question de savoir comment intégrer le malheur dans le déroulement d’une vie et continuer quoiqu’il arrive à se développer. Nous sommes tous susceptibles d’être exposés à un manque cruel, à d’énormes difficultés familiales, à des situations dramatiques qui, sur le moment, sembleront nous anéantir. Et il faudra pourtant bien que ces malheurs participent à notre construction. Il faudra se relever et continuer.
I - LA LEÇON DE BAMBI :REBONDIR APRÈS LE DEUIL
Tout un programme… et comment se préparer à faire face à toutes ces charmantes catastrophes que tu nous annonces ?
On s’y prépare tous les jours. Qu’est-ce que tu crois qu’il apprend le petit enfant qui regarde Bambi ?
Je ne sais pas moi, l’histoire d’une petite biche, d’un faon…
Oui, mais il apprend surtout le sens tragique de l’écoulement de la vie quand elle s’emmêle trop brutalement à la mort. En une image, il est confronté brutalement aux trois sources fondamentales de l’angoisse humaine : l’incertitude, la finitude et la solitude. Nous mourrons tous, on ne sait pas quand et comment cela se produira et les gens que nous aimons mourront eux aussi… Voilà pourquoi cette scène fait autant froid dans le dos. « La mort est un définitif non-retour »… C’est exactement cela qu’il apprend, Bambi, quand il se rend compte que sa mère ne reviendra pas et il comprend en sus que « l’amour ne protège pas de la mort » quand il prend conscience que l’on peut aimer sa maman tant que l’on veut, cela ne l’empêche pas de mourir. Voilà, convenons-en, deux fameuses leçons pour un enfant. Et là, avec Bambi, il l’apprend sans ménagement. Pan ! Un coup de fusil et puis plus rien. Un cerf glacial, son père, lui annonce avec détachement qu’il ne verra plus sa mère et qu’il devra se débrouiller seul. Après un coup pareil, mon cher Bambi, tâche de faire preuve de résilience et bon vent !
Et Bambi, il est résilient, puisqu’il s’en sort ?
Effectivement, il réussit en tout cas pleinement son affiliation, puisqu’il fonde une famille à son tour. Cette quête affective d’un enfant déprivé dans sa famille d’origine, mais qui trouve la force de rebondir pour créer sa propre famille de procréation, c’est sans doute le thème le plus important de l’œuvre de Disney.
Mais dans le cas de Bambi, on ne sait pas grand-chose de ce qui l’aide à s’en sortir. On sait qu’il parvient à faire le deuil de sa mère, mais on ne sait trop comment. Son père lui dit bien quelques mots du genre : « Bambi, sois courageux. Jamais plus tu ne reverras ta maman. Va donc voir Tantine. » Et le brave faon obéit. Il est courageux, il ne revoit plus sa maman, et il grandit à l’ombre de sa tante…
Pas contrariant le petit… Moi, Bambi, il n’y a rien à faire, ça me fait chialer : perdre sa mère, à son âge, c’est terrible. En plein hiver en plus, brrr…
Mais apprendre aux petits enfants à résister à cela, c’est une façon de leur suggérer la résilience avec comme seuls conseils : « Accepte la mort et laisse faire le temps. »
En même temps, c’est aussi peut-être mieux d’être encore petit quand ça arrive. Ça permet de savoir sans se rendre compte vraiment. Un enfant, il commence sa vie. Alors, s’il arrive à accepter ce qui s’est passé, il pourra peut-être mieux s’en sortir… Il lui reste de l’avenir, mais il n’y a rien à faire, pour moi, il vaut mieux savoir que sa mère est morte, qu’on doit se débrouiller seul… Le pire serait de se dire : « Elle va revenir ; elle va revenir… »
Le deuil s’accommode mal de l’illusion, c’est vrai. Son cheminement suppose qu’une phase de révolte et un moment de dépression laissent place, progressivement, à une forme de résignation. L’illusion ou toutes les autres formes de déni de la réalité, en masquant l’épreuve, empêche en fait le deuil de se réaliser pleinement. Ces mécanismes de défense ne sont souvent efficaces qu’à court terme. Ils font payer l’addition plus tard. C’est un peu comme si le fait de ne pas reconnaître la réalité endormait la souffrance pour la laisser ensuite agir plus sournoisement. Tapie dans l’ombre de nos souvenirs, elle peut alors ankyloser toute notre envie d’être humain. C’est sans doute pour cela qu’on parle du réalisme des enfants résilients…
Alors, le cerf glacial n’a pas eu tout à fait tort ?
Sur ce plan-là, sans doute pas… Cependant, il n’aurait rien gâché en se montrant plus humain. Sa manière de dire la réalité n’est pas en cause – les mots ne changent pas grand choses à la dureté des faits – mais il aurait pu laisser une place à la parole de l’enfant. Se confronter à la mort, c’est en même temps affronter la fin absolue et définitive, assumer le désespoir du non-retour. Il est important d’aider le petit enfant à mettre ses propres mots sur cette dure réalité. Mais c’est peut-être beaucoup demander à un cerf… Et puis, ça rappelle peut-être des souvenirs à Walt Disney…
Pourquoi ? Son père était un cerf ?
Non mais, d’après ses biographes, c’était un type instable et violent. Et comme sa mère, une dame effacée, manifestait peu de compassion pour le petit Walt et son frère Roy, il est probable que la froideur affective dont il est si souvent question dans leurs dessins animés, les deux frangins savaient ce que c’était pour l’avoir eux-mêmes éprouvée.
Au moins Bambi lui, il a eu une mère plutôt sympa… Tendre, attentionnée, protectrice, mais pas trop…
Sans doute une maman idéale pour un petit en faon. Et c’est certainement une des sources de sa résilience. Le fait d’avoir éprouvé un sentiment d’attachement sécurisant – ce que les psychologues appellent un attachement sécure – permet effectivement de mieux affronter les difficultés, de mieux préserver ses chances de développement malgré les épreuves. La confiance dans un lien d’attachement lorsqu’elle est éprouvée par le tout petit enfant, c’est comme si elle se stockait dans sa mémoire. Elle lui sert ensuite de modèle pour ses relations ultérieures et l’aide notamment à s’armer d’une confiance en lui-même suffisante pour acquérir un comportement de charme, et s’attirer des amis.
Donc, si ta mère ne t’aime pas, tu n’as aucune chance d’être résilient…
Non, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. Je n’ai pas dit qu’il était indispensable d’avoir vécu un tel lien pour faire preuve de résilience, ni qu’il était impensable de devenir résilient sans l’avoir vécu. J’ai uniquement dit que cela facilitait les choses, que cela rendait la résilience plus probable. C’est la différence entre une corrélation et une causalité. Quand on dit qu’une relation est causale, on suppose un lien automatique entre les éléments qui sont reliés entre eux, et on affirme aussi que l’un est la cause de l’autre. C’est souvent imprudent de parler comme ça et on évite généralement de le faire en sciences humaines.
Dire qu’il y a une corrélation entre deux phénomènes, c’est uniquement constater qu’ils ont tendance à se présenter ensemble. On ne prétend pas que l’un est inconcevable sans l’autre et, surtout, on n’affirme rien sur la nature du lien qui unit les deux phénomènes. On dit juste que les deux caractéristiques ont tendance à se présenter plus souvent ensemble, mais on laisse entendre que, si cela se trouve, c’est peut-être dû au hasard, qu’il est possible aussi qu’on ne les observe pas ensemble, et surtout que l’un n’explique pas nécessairement l’autre.
Pour revenir à notre Bambi, il est probable que la relation chaleureuse qu’il a eue avec sa mère a facilité sa résilience, mais personne ne peut affirmer qu’il ne s’en serait pas sorti s’il ne l’avait pas vécue de cette manière. En tout cas, elle lui a permis d’apprendre ce qu’est une relation d’attachement.
Encore heureux qu’il ait eu le temps d’apprendre à aimer. Ça l’a peut-être aidé à se faire des tas de copains… Panpan, Fleur, Maître Hibou.
C’est vrai, c’est ce qu’on appelle se trouver des tuteurs de résilience.
C’est le nom savant du lapin, de la mouflette, et du hibou ?
Non, mais c’est comme cela qu’on appelle des amis sur lesquels on peut compter quand on est en grosse difficulté dans sa famille. Des amis qui nous acceptent de façon inconditionnelle. Les recherches montrent d’ailleurs qu’un environnement constitué de plusieurs attachements favorise la probabilité de résilience du petit quand la mère défaille ou disparaît. Ici aussi, les chercheurs n’ont fait que confirmer ce qui se trouvait déjà dans ce dessin animé… Enfin, dans le cas de Bambi, le rôle de ces tuteurs est surtout évident pendant la toute petite enfance du jeune Prince, lorsqu’il s’agit de l’aider à maîtriser son environnement. Après la mort de sa mère, c’est surtout sa famille élargie, Faline et sa tante, qui l’aideront à grandir, qui lui serviront de tuteurs. Et les saisons feront le reste…
La leçon de Bambi, c’est qu’on est assez solide pour se remettre d’un drame si l’on parvient à l’accepter et si on a la patience de laisser le temps faire son travail.
Oui, et c’est un peu moins difficile à surmonter si l’on bénéficie d’un contexte familial chaleureux et sécurisant, et de supports disponibles en dehors de la famille. Mais Bambi nous parle peu des caractéristiques psychologiques qu’il faut avoir pour rebondir après un drame. Tout se passe en dehors de lui. L’environnement, le temps, tout cela est important dans l’étude de la résilience, mais il y a aussi le caractère personnel, la consistance psychologique. Et là, le faon en manque un peu, il faut bien le reconnaître… Pour cela, je préfère Blanche-Neige.
II - LA LEÇON DE BLANCHE-NEIGE :TRACES DE RÉSILIENCE EN MALTRAITANCE
Décidément, tu es branché Disney Channel aujourd’hui. N’oublie quand même pas qu’on en était à parler de traumatisme et de résilience…
C’est vrai. Mais parler de résilience et de maltraitance, cela peut se faire à partir de Walt Disney. Cendrillon et Blanche-Neige sont à la fois de fameux enfants maltraités, et de belles images de résilience. En analysant Blanche-Neige, on comprend la signification du concept de maltraitance psychologique et on intègre la notion de résilience dans presque toutes ses dimensions.