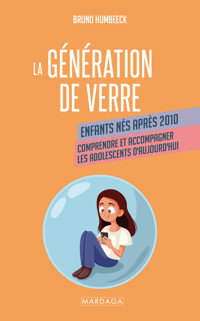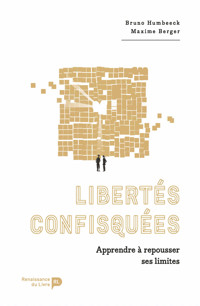Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mols
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Être et Conscience
- Sprache: Französisch
« Ma vie aurait sans doute changé du tout au tout si un jour, ou plutôt une nuit, presque un matin, j’avais osé parler... Raconter... Mais je me suis tu. Je n’ai rien dit.
J’ai laissé le silence s’interpréter... Et elle est partie... Sans comprendre... Ma vie s’en est trouvée désertée.Bien entendu, je l’ai remplie comme je l’ai pu... Plutôt bien somme toute puisqu’il m’en est resté trois merveilleux enfants et que j’y ai été parfaitement heureux... Il n’empêche...
Et puis, trente années plus tard, un autre jour ou plutôt une autre nuit, presque un autre matin, j’ai osé parler... Je ne me suis plus tu... J’ai mis des mots sur le silence... Et elle est restée... Pour ensoleiller tout ce qui reste de ma vie...
Voilà pourquoi, en définitive, ce livre pour aider à se raconter, c’est à elle que je veux le dédier... Parce que je me suis tu il y trente ans... Et que cela, jamais, jamais, je ne me le suis pardonné. »
EXTRAIT
En descendant très loin, bien en dessous de la ligne de flottaison que constitue le quotidien quand il se raconte au jour le jour, on atteint un socle bas sous les souvenirs, émotions ou sentiments où on ressent, directement et sans langage, une chaleur vitale. On pourrait s’évanouir de froid si elle s’absentait. La glace tue. Et certains meurent de grelotter. Ils vivent au jour le jour une quotidienneté désenchantée qui ne se raconte plus, ou à peine, quand elle s’évoque à coups de commentaires désabusés sur le temps, pas le temps passé bien sûr, pas le temps intériorisé bien entendu, le temps qu’il fait, actuel, extérieur à soi. Beau, mauvais, ensoleillé, pluvieux, trop chaud, trop froid… Paroles de coiffeur, juste bonnes à couper les cheveux, en quatre ou à moitié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Raconte-moi… Que s’est-il passé ce matin-là? »
C. Pihart
À toi qui m’aides à me transformer en moi-même.
PRÉFACE
Boris Cyrulnik
Je me suis longtemps demandé pourquoi, après avoir subi une épreuve de l’existence, nous éprouvions toujours une contrainte intérieure à nous raconter ce que nous savions mieux que personne.
Raconter à une personne de confiance, à quelqu’un qui nous sécurise, c’est ne plus être seul au monde avec le malheur qui vient de nous arriver, mais pourquoi se raconter à soi-même, quel étrange besoin! Il m’a fallu plusieurs années de pratique et de nombreuses rencontres, pour comprendre que lorsqu’on a été bousculé par l’existence nous sommes devenus un jouet du destin, un objet emporté par le malheur. Se raconter ce qui vient de nous arriver, c’est reprendre possession de son monde intime et identifier ce qui nous a agressé. Comprendre comment nous y avons réagi, c’est reprendre en main son destin, redevenir capable de se gouverner soi-même au lieu d’être fracassé par un impact extérieur.
Raconter son malheur à quelqu’un d’autre constitue un processus différent. Il ne s’agit plus d’identifier l’agresseur, il faut maintenant trouver les mots et enchaîner les représentations de façon à agir sur le monde mental de l’autre. On ne cherche plus à s’identifier, on veut simplement ne plus être seul au monde, monstre, chassé de la condition humaine par un malheur impensable. Il faut désormais penser, élaborer afin de partager nos mondes mentaux.
Bruno Humbeeck, possède ce talent qui permet de comprendre et de faire comprendre. Il explique comment ce processus d’aptitude à la narration se met en place au cours de notre développement. Ce facteur de résilience ne tombe pas du ciel, il s’installe pré-verbalement dans l’affectivité quand un bébé est sécurisé dans son entourage. Confiant, amusé, intéressé par la présence d’un autre, il tente l’aventure de la parole, bien avant de la maîtriser. Il chante la musique des phrases bien avant de connaître les mots. Il acquiert la prosodie, l’accent qui s’inscrit dans la mémoire et qu’il gardera toute sa vie. Plus tard, il parlera, et plus tard encore, il ne pourra faire un récit de soi que lorsque son développement lui permettra de se faire une représentation du temps. Alors seulement, il pourra éprouver le plaisir des contes et conter l’histoire de sa vie.
La narration a pour fonction de nous identifier alors que nous ne cessons de changer. C’est la narration qui nous permet de rester nous-mêmes dans un monde où rien n’est pareil. Sans cette aptitude à la narrativité nous ne pourrions pas gouverner notre existence, nous serions soumis aux événements, comme les traumatisés.
N’allez pas croire que le développement de notre cerveau et celui de notre affectivité suffisent pour acquérir ce facteur de résilience. Le contexte joue un rôle majeur: la famille est imprégnée dans notre mémoire et la culture nous donne la parole, ou l’interdit selon ses propres récits. Quand Rimbaud dit « Je est un autre », Bruno précise « Je est tout ce que les autres sont en moi ». Les cultures démocratiques valorisent l’expression de la personne et apprécient les autobiographies. Les cultures dictatoriales ne supportent pas l’existence de mondes intimes, tout le monde doit être pareil, répéter la voix du chef et dire ce qu’il dit. Dans un tel contexte culturel, tout secret est un blasphème qui mérite punition.
Proust et Baudelaire, en accord avec Bruno Humbeeck, confirment que la plongée poétique intérieure échappe aux conventions : une odeur, nous dit Proust, en stimulant les circuits limbiques de la mémoire évoque un souvenir de tendresse. (Il nous le dit presque comme ça). Et Baudelaire ajoute qu’avec l’âge la mémoire implicite s’efface, libérant ainsi les empreintes précoces que nos compagnons ont tracées dans notre mémoire.
Bruno est en bonne compagnie quand il précise qu’il n’est pas de ceux qui pensent que tout est possible, ce qui mène à la mégalomanie, ni que rien n’est possible, ce qui mène à la démission.
Bruno Humbeeck pense que nous pouvons devenir les metteurs en scène de notre existence, et il le démontre dans ce livre scientifiquement clair et littérairement très agréable à lire.
INTRODUCTION
« Rassembler les morceaux, les fragments de souvenir, les traces d’avant la cassure, et puis, quand il manque un morceau, l’inventer pour que tous les souvenirs reliés entre eux fassent une histoire. Les histoires, c’est la colle qui fait tenir les morceaux… »
A. Glykos
Parler de soi ce n’est pas se constituer comme le centre du monde. Parler de soi c’est se faire exister au sein de ce monde. Personne ne peut exister indépendamment de l’histoire qu’il se raconte à propos de lui-même. L’homme est un être dont la substance est fondamentalement narratrice, une espèce nécessairement fabulatrice. Sans histoire à propos de soi il éteindrait la conscience qu’il a de lui-même et délaisserait jusqu’à l’idée même de se constituer un soi. Sans la capacité de se raconter, l’homme perdrait aussi toute possibilité de donner du sens à ce qu’il vit puisqu’il deviendrait incapable d’éclairer toute expérience présente à la lueur de ce qu’il en aurait déjà vécu. Sans l’aptitude à la narration de soi tout apprentissage s’écraserait aussi vite dans un présent aussi nu que désolé, dans une expérience essentiellement actuelle qui serait rendue insignifiante parce qu’elle aurait été désertée par tout ce qui fait le passé.
L’oubli immédiat n’est jamais profitable à l’humanité. Il permet à certains animaux de vivre sans anxiété au-delà d’une agression. Le buffle, incapable de conserver la plus élémentaire trace mnésique des attaques répétées qu’il subit dans sa vie de buffle, y survit sans le moindre signe de stress. C’est sans doute profitable à court terme. Mais, au-delà, c’est un frein absolu à tout apprentissage et une limite infranchissable qui se dresse entre le destin d’un homme et celui d’un animal. Que le premier grand singe capable de raconter une histoire à propos de lui-même ou de ses semblables me soit immédiatement amené ! Il cache sans doute le premier homme. L’hominisation s’est sans doute constituée de cette façon. Homo erectus, vraisemblablement. Homo faber, sans doute. Homo sapiens, peut-être. Homo fabula, immanquablement… L’homme n’a pu émerger qu’en racontant des histoires, l’homme n’a pu advenir qu’en se racontant son histoire.
Comment ce récit prend-il naissance en chacun de nous ? À quel âge commençons-nous à nous raconter ? Jusqu’à quand ? Et qu’advient-il du sujet quand ce récit devient impossible parce que la mémoire flanche, parce qu’elle perd le fil de l’histoire et n’inscrit plus le moindre souvenir ? Que devient celui qui survit à sa propre histoire quand, frappé d’Alzheimer, il n’est plus qu’un chapitre ajouté au roman d’une vie qui se déroule désormais sans lui ? Cette déroute signifie-t-elle la fin de l’histoire ou, au contraire, le début d’une autre, inhumaine parce qu’elle ne se raconte pas, et pourtant si humaine par la souffrance qu’elle déploie ?
Et l’identité dans tout cela, comment s’y prend-elle pour se déjouer des pièges multiples que lui tend la mémoire défaillante. Comment fait-elle pour se constituer sur les lambeaux épars d’un passé mal reconstitué? Comment parvient-elle à s’élaborer sur les fragments de souvenir que le temps laisse çà-et-là à ceux qu’il dépasse ? Comment en définitive peut-elle en métaboliser le tout en un ensemble cohérent qui se constituerait dans une histoire unifiée ?
Notre identité n’est en définitive rien d’autre que ce récit. Cette identité est collective quand elle se fonde sur un mythe, un grand récit fondateur. Identité collective quand elle résulte de nos appartenances multiples, sociales, culturelles, idéologiques… Certaines sociétés, privilégiant l’histoire collective, ont ainsi aidé les sujets qui la constituaient à exister au sein de grands mythes collectifs, de grands récits qui organisaient les vies, en expliquaient le sens et en justifiaient le développement.
De nos jours, dans nos sociétés postmodernes avancées, les grandes idéologies ont, de toute évidence, eu tendance à voir faiblir leur influence. La fonction unificatrice qu’elles jouaient apparaît moins évidente. On ne se rassemble plus si facilement autour d’un grand et unique récit. Certains (Fukuyama) en ont même déduit que l’on était arrivé à la fin de l’histoire. Ils l’ont alors annoncé à grand bruit et leur récit, apocalyptique, en a séduit plus d’un.
Ce n’est sans doute pas vrai. On ne termine pas si vite une histoire surtout quand elle concerne tant de monde. Mais ce qui est par contre une incontestable réalité c’est que les histoires individuelles ont, dans nos sociétés, eu tendance à se démultiplier et que, dans ce domaine comme ailleurs, la narration de soi a de plus en plus tendance à privilégier le chacun pour soi.
C’est l’identité individuelle qui, de nos jours, sert de socle au développement identitaire. C’est pour cela que l’histoire de soi – et la narration qui la rend possible – y prend une importance sans cesse croissante. On ne compte plus désormais les autobiographies, les écrits intimes devenus extimes à force d’être donnés à lire, les confessions publiques, les mémoires publiées, les aveux privés et les formes multiples que le récit de soi peut prendre de nos jours.
Cette prolifération de formes est encore renforcée par la multiplication des médias qui leur servent de caisse de résonance. L’espace cybernumérique et tout ce qui sert de toile de fond à une communication à propos de soi qui peut maintenant s’établir partout et, instantanément, s’étendre à une foule de gens. Aucun débat sur la narration de soi ne peut évidemment faire l’économie de l’analyse d’un tel phénomène.
Les enjeux de la narration de soi sont évidemment devenus, dans un tel contexte, particulièrement complexes. Ils se manifestent tant sur le plan de la construction identitaire que sur celui, plus large, de l’inscription sociale du sujet. Plus personne ne peut survivre en perdant le fil de son histoire. Plus personne ne peut non plus apparemment subsister socialement sans un récit communicable par lequel il s’identifie aux yeux de ses semblables. La question « qui suis-je ? » ne reçoit de définition que dans le récit que je me fais de ce que je produis sur les différentes scènes qui constituent le théâtre de ma vie.
Nous proposons dans cet ouvrage de tenter de répondre à un ensemble de questions qui nous permettront d’approcher au mieux la réalité que sous-tend l’idée de narration de soi lorsqu’elle se constitue en argument de résistance identitaire, voire, nous le verrons, comme un vecteur de résilience :
– C’est quoi la narration ? Comment advient-elle ?
– C’est quoi le soi ? Comment se constitue-t-il ?
– C’est quoi la narration de soi ? À quoi sert-elle ?
– Comment la stimuler chez l’enfant, chez l’adolescent ?
– Comment en faire un argument de résistance identitaire, la constituer en vecteur de résilience ?
Le récit accompagne l’angoisse, l’atténue souvent et l’efface parfois. Dans tous les cas, il réorganise l’expérience, lui donne, temporairement ou plus durablement, une structure. Toute narration est une construction. Tout récit est une reconstruction. C’est pour cela qu’évoquer le passé n’est pas toujours sans danger et que ce n’est en tout cas jamais un exercice anodin.
Partie 1 C’est quoi la narration de soi ?
Se raconter…
POURQUOI SE RACONTER?
En descendant très loin, bien en dessous de la ligne de flottaison que constitue le quotidien quand il se raconte au jour le jour, on atteint un socle bas sous les souvenirs, émotions ou sentiments où on ressent, directement et sans langage, une chaleur vitale. On pourrait s’évanouir de froid si elle s’absentait. La glace tue. Et certains meurent de grelotter. Ils vivent au jour le jour une quotidienneté désenchantée qui ne se raconte plus, ou à peine, quand elle s’évoque à coups de commentaires désabusés sur le temps, pas le temps passé bien sûr, pas le temps intériorisé bien entendu, le temps qu’il fait, actuel, extérieur à soi. Beau, mauvais, ensoleillé, pluvieux, trop chaud, trop froid… Paroles de coiffeur, juste bonnes à couper les cheveux, en quatre ou à moitié.
D’autres parlent, parlent et parlent encore cherchant désespérément les mots pour évoquer ce qui se passe en deçà de ce socle bas. Pour eux, tout est bon à raconter. Ils trempent leurs mots dans cette chaleur vitale et entrent en poésie. Ils puisent dans ce même vivier des arguments à la construction de ce qu’ils sont et empruntent les voies de l’autobiographie. Ils y ajoutent de quoi nourrir leur rêverie identitaire et se font romanciers de leur propre existence ou de celle de leurs semblables, peu importe. Pour chacun d’eux, il s’agit en définitive de se raconter des histoires à propos d’eux-mêmes, des autres et de tout ce qui constitue une vie quand elle est véritablement habitée.
C’est pour cela que, chaque fois que nous fouillons derrière nos souvenirs, nous retrouvons cette chaleur envoûtante qui parfois ne se fait plus que faiblement ressentir dans notre quotidien trop embarrassé de conversations de coiffeurs. Évidemment, alors la tentation est grande de se retourner et, tel Orphée, de descendre définitivement vers les fondements de ces premiers récits, de délaisser l’histoire en cours, trop lente à raconter, trop empêtrée dans la quotidienneté pour s’engager dans ces voies royales de reconnaissance de soi qu’offre à chacun le récit de son passé. Évidemment, dans ce monde sans âge, tout est modifiable à souhait, chaque être humain, dans l’ombrage de ce qu’il a vécu, se revisite comme il se plaît et métamorphose ce qui lui déplaît. Les petites musiques du passé qui couvrent les bruits dépassés deviennent alors souvent ensorcelantes. Tout semblait tellement plus beau quand tout paraissait possible. C’est pour cela que l’on ne revient jamais indemne d’un tour complet sur soi-même dans le passé. Et c’est ainsi qu’Orphée, entraînant, au son de la Lyre, Eurydice hors de l’ombre, comme il se retournait pour la voir, la fit disparaître.
La narration de soi n’est pas toujours sans danger et il faut, pour s’y engager, éviter de penser qu’il suffit de se raconter ce qui fut pour aussitôt pouvoir revivre ce qui a été. Seuls quelques esprits forts y sont parvenus et, s’ils y sont arrivés, c’est uniquement parce qu’ils ont pris le parti de se raconter en nimbant leur récit de rêverie, de rêve éveillé et d’une forme d’irréalité pour que ce passé ne menace pas le présent qu’ils s’étaient constitué. Et ce n’est que de cette façon-là qu’Eurydice, maintenue ombrée, a enfin pu rejoindre Orphée dans un même rêve partagé.
Dans le passé, seul le rêve permet véritablement d’avancer… à pas de géants, en reculant vers l’avant parce que le rêve permet de conjurer tous les paradoxes et d’intégrer dans une réalité enfin assumée ce qui fut, ce qui est et ce qui sera sans que la tyrannie de l’un menace jamais l’existence de l’autre. Dans un rêve, le passé ne sert jamais à congédier le présent. Il s’y agglutine, s’y condense et, quelquefois, s’y superpose, mais, jamais, au grand jamais il ne cherche à le remplacer.
Voilà pourquoi on se raconte… Pour rattacher le présent vécu à un passé qui lui donne sa signification, qui en structure le sens mais ne le remplace pas. Voilà pourquoi on se raconte, pour construire, pour rendre à ce présent devenu sensé la part d’avenir qu’il contient nécessairement et que les philosophes désignent à travers le concept de protension.
Sans histoire de soi, il n’y aurait que le nu présent et l’avenir insensé se consumerait aussi vite en son sein. C’est pour cela qu’il est impératif de se constituer une histoire, vraie ou inventée, ça nous le verrons, mais une histoire… constituée en mots, mise en discours au moyen d’une langue naturelle, d’une organisation de pensée censée refléter une réalité ou un imaginaire dans le temps.
C’est à cela que servent les mots, c’est pour cela qu’ils deviennent signes et se mettent en phrases pour transmettre un contenu narratif sans lequel, à partir d’un moi balbutiant, le soi n’adviendrait même pas.
COMMENT SE RACONTER? DES MOTS, DES PHRASES, UN RÉCIT
Parler de soi ne va pas de soi
Pour parler de soi, d’abord, il faut parler. Mais que signifie parler ? En d’autres termes, qu’est-ce que parler veut dire ? Parler c’est s’exprimer, certes, mais c’est surtout s’exprimer en utilisant les sons articulés d’une langue naturelle. On peut parler pour ne rien dire mais on le fait toujours avec les arguments d’une langue : des mots, des phrases, des morphèmes.
Bien entendu, on peut aussi laisser parler les silences. Mais alors il faudra bien que celui qui les reçoit puisse les traduire en mots pour qu’ils se mettent à signifier. On peut également laisser parler son cœur. « En lui tout parlait d’amour excepté ses paroles », dira par exemple Stendhal… Mais là aussi il s’agira sans doute d’une langue qui à un moment ou l’autre ne pourra se passer d’une conversion en mots.
Parler suppose dès lors la maîtrise d’une langue. Or, entre le babil du nourrisson et les premiers textes argumentés de l’adolescent (vers 17 ans), il y aura la place pour toute une histoire, celle de l’acquisition de la parole – sous sa forme orale ou écrite – comme modalité privilégiée d’expression de la pensée. C’est cette histoire que nous souhaitons retracer brièvement dans les pages qui suivent.
Parler…
Pourquoi les bébés chantent-ils avant de parler ?
Si nous avions eu des mots dès notre arrivée sur terre, nous n’aurions sans doute jamais eu l’idée d’un jour chanter. Effectivement, Monsieur Bébé vient au monde sans le moindre vocabulaire pour raconter ce qui lui arrive. Mais il ne vient pas pour autant en silence dans un monde sans bruit. Il chante. Et il entend autour de lui un univers qui s’enchante par la voix chantonnante de ceux qui s’occupent de lui.
Les bébés sont par ailleurs, comme le montrent de récentes études, davantage attirés par la voix de leur maman lorsqu’elle chante que lorsqu’elle se contente de parler. Les bébés aiment leur maman en chanteuse, leur papa en chanteur parce que c’est dans ces voix-là, d’emblée, qu’ils vont apprendre la musique de la langue et le sens du langage.
Cette musique d’une langue, c’est ce qu’on appelle la prosodie. C’est elle que le parent transmet au bébé quand il utilise cette langue que parlent spontanément les mamans quand elles s’adressent à leur nourrisson. Cette langue qu’on appelle le « mamanais ».
Parlez-vous couramment le « mamanais » (ou le « papanais » si vous êtes un papa)? Pour le savoir, placezvous devant un bébé de moins de six mois. Regardez-le fixement dans les yeux et laissez-vous aller à lui parler.
Si vous parler d’une façon monotone, dans un registre monocorde, vous ne maîtrisez pas le « mamanais » et vous êtes, aux yeux de Monsieur Bébé, à ses oreilles plus exactement, un personnage un peu ennuyeux, comme une mer sans vague, comme une maman sans musique. Si, par contre, vous constatez que spontanément votre voix se module, que les accents toniques se font entendre plus fort, que vous ponctuez vos phrases de points d’exclamation sonores, que vous découpez naturellement les mots en petits morceaux (que les linguistes appellent des phonèmes) et bien ça y est : vous parlez le mamanais.
C’est une manière d’interagir avec l’enfant qui vient généralement assez naturellement aux mamans. Pour les papas, c’est un peu plus compliqué. Souvent, quand on les invite à parler à des bébés, ils sont un peu gênés et freinent, allez savoir pourquoi, leur tendance naturelle à adapter leur manière de parler à ce que souhaitent entendre les bébés. Le papanais semble dès lors s’installer plus timidement que dans la version réservée aux mamans. C’est dommage. C’est joli comme tout un papa qui se laisse aller à deviser avec un bébé en papanais.
C’est joli et c’est surtout très utile. Le mamanais, comme le papanais, exerce en effet une fonction adaptative essentielle. C’est en effet par le biais de la courbe intonative de l’énoncé que le tout petit enfant va pénétrer la signification du langage et apprendre à tenir son rôle dans une conversation.
Ce processus adaptatif se met en place dès la naissance. Dès le premier jour, en effet, les tout petits enfants sont effectivement capables de distinguer des langues ayant un rythme différent. Dès le deuxième jour, le lendemain, il est déjà sensible à la musique des mots et, cinq mois plus tard, il a acquis l’ensemble de l’unité rythmique de sa langue maternelle.
En modulant davantage la courbe intonatoire de l’énoncé et en segmentant avec insistance le flux de parole, le parent transmet en effet à son enfant deux principes essentiels de la conversation : la succession et la réciprocité. À travers ces deux modalités discursives, la conversation devient réellement un dialogue d’action dans lequel une action communicative est entreprise conjointement par l’adulte et l’enfant. C’est pour cela que les mamans et les papas, quand ils osent le papanais, même s’ils savent pertinemment que leur tout petit enfant ne comprend pas les mots eux-mêmes, se comportent comme si leurs bébés les comprenaient et, dès lors, les impliquent dans des échanges dialogiques.
C’est pour cela que le mamanais comme le papanais se caractérisent par deux traits essentiels :
– la mélodie de la phrase est accentuée surtout dans sa phase terminale ;
– les gestes, les variations de la hauteur tonale et d’intensité dans le discours apparaissent davantage contrastés.
C’est le cas, par exemple, de la voix qui s’élève ou qui s’abaisse en fin d’énoncé signalant à l’interlocuteur que le moment est venu pour lui de répondre ou d’intervenir.
Évidemment, sachant tout cela, on mesure à quel point on ne perd jamais son temps en parlant, en communiquant activement avec bébé dès le premier jour… Il ne s’agit pas seulement de lui apprendre à parler, il s’agit de le faire rentrer, par le corps, par la musique et par les mots dans l’histoire à propos de lui-même qu’il aura tôt ou tard à se raconter. C’est de cette manière, et seulement de celle-là, qu’il parviendra à se découvrir comme être pensant en se faisant progressivement sujet de son propre récit. C’est sa seule chance d’accéder un jour à ce que sera son identité.
Hegel dit qu’il n’y a pas de pensée sans langage. L’univers des bébés n’a pourtant pas de langue. Il babille,