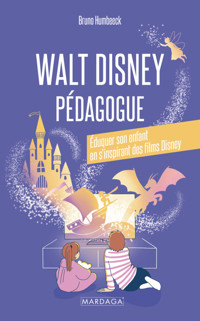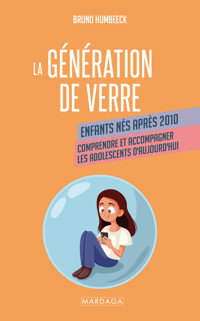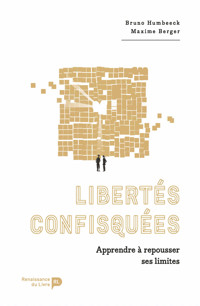Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Tous les parents "" suffisamment bons "" le savent, l'éducation n'est pas un long fleuve tranquille et les enfants peuvent parfois mettre beaucoup d'énergie pour ne pas avancer dans la direction qu'on leur indique. Il est alors tout à fait salutaire de se réserver le droit d'être tenté de les "" envoyer promener ""... Mais c'est là aller à l'encontre de la psychologie positive et de ses préceptes (ne pas frustrer, ne pas punir, "" accueillir "" la colère de l'enfant...), ce qui a pour conséquence d'épuiser le parent.
Ces "" théories du bonheur sans tache "" s'appliquent en outre aussi à la pédagogie, prétendant fournir à l'enseignant les clés d'une méthode d'apprentissage sans faille. Dans La Dictature de la "" babycratie "", Bruno Humbeeck accompagne les parents dans cette épreuve quotidienne qu'est l'acte d'éduquer un enfant et leur fournit une véritable bouffée d'oxygène en leur rappelant que l'éducation bienveillante ne doit pas être confondue avec la manifestation d'un bonheur de surface.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Docteur en Sciences de l'éducation de l'université de Rouen,
Bruno Humbeeck est psychopédagogue et directeur de recherche au sein du service des Sciences de la famille de l'université de Mons (Belgique). Il est aussi l'auteur de nombreux livres, dont, aux éditions Renaissance du livre, "Et si nous laissions nos enfants respirer ?" et "Dis, c'est quoi le harcèlement scolaire ?" Diplômé des Beaux-Arts de Tournai (Belgique), Maxime Berger est, entre autres, l'illustrateur des collections " Les outils de la résilience " et " Polo le lapin " parues chez Mols.
Maxime est également auteur-compositeur de chansons françaises.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Introduction
S’autoriser à ne plus supporter des enfants que l’on aime par-dessus tout quand ils se montrent exaspérants, se permettre de les envoyer promener quand ils accaparent excessivement notre attention, prendre la liberté de ne pas les écouter quand ils se révèlent résolument inintéressants, ne pas se mettre à leur service quand leurs exigences nous paraissent absurdes ou disproportionnées, leur faire savoir sans retenue à quel point ils peuvent se montrer contrariants quand leurs façons d’agir chamboulent systématiquement tous nos projets, demeurer sourd à leurs émotions quand celles-ci se manifestent à tout bout de champ de manière spectaculaire et impérieuse…
Voilà un panel de tentations auxquelles chacun doit régulièrement se soumettre une fois que, « devenu parent », il s’est donné pour mission essentielle de transformer cette petite boule de cris, de pensées incontrôlées, d’émotions mal calibrées et de mouvements désordonnés que l’on appelle un enfant en un adulte suffisamment épanoui pour trouver, dans le monde complexe qui est le nôtre, une place qui correspond partiellement à ses attentes puériles tout en ne s’éloignant pas trop de celle qui définit globalement nos aspirations d’adulte responsable.
Les parents « suffisamment bons », comme le dirait Winnicott, éprouvent nécessairement tous, de temps en temps, l’envie de jeter leurs enfants par la fenêtre. Rien de plus normal à cela. L’éducation n’est pas un long fleuve tranquille et les enfants peuvent mettre beaucoup d’énergie pour ne pas avancer dans la direction qu’on leur indique, au rythme que l’on souhaite leur voir adopter et par la voie que l’on juge la plus recommandable.
Il est alors tout à fait salutaire de se réserver le droit d’être tenté, juste dans sa tête évidemment et généralement furtivement, de les « envoyer promener » quand on ne parvient pas à les faire obéir, alors que l’on sait à quel point c’est « pour leur bien » ou, à tout le moins, nécessaire dans la perspective de leur bonheur futur. Il est également très sain d’éprouver de manière transitoire l’envie de « s’en délester » quand ils ne parviennent pas à exprimer d’une façon socialement acceptable des émotions que l’on était sans doute prêt à « accueillir », mais pas sous cette forme.
Dans le même ordre d’idées, un parent n’a aucune raison de se culpabiliser quand il rêve de disposer du pouvoir magique de faire disparaître temporairement ce petit bout d’homme arrogant qui, par ses conduites, nous fait connaître continuellement sa ferme résolution de ne s’en référer à personne d’autre qu’à lui-même pour juger ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. Aucune raison non plus de battre sa coulpe s’il se surprend à imaginer mille et une façons de confier à un autre que lui ce petit être envahissant qui décide tellement souvent de prendre toute la place et semble prendre un malin plaisir à le faire au moment précis où l’adulte désirait par-dessus tout avoir la paix.
Il n’est pas davantage question pour un parent de plaider systématiquement coupable chaque fois qu’il se met à regretter confusément de ne pas avoir fait naître un enfant muet, soit parce que celui-ci, refusant de dormir, a pris l’option, à quatre heures du matin de préférer le cri à la parole, soit même parce que, devenu parlant, le minilocuteur miniature paraît avoir décidé que tout ce qu’il pouvait dire devait nécessairement prendre le pas sur le silence ou faire systématiquement passer au second plan tout ce qui évoque de près ou de loin une conversation adulte.
Et la pédagogie positive ne fait alors sans doute sur ce plan qu’enfoncer le clou. Ne pas frustrer, laisser s’exprimer sans frein et sans fin, « accueillir » la colère de l’enfant, au même titre que chacune de ses émotions, comme un don du ciel, ne punir aucun de ses comportements quitte à ce qu’il ne sache plus identifier ce qui est attendu de lui, préserver l’estime qu’il a de lui-même au risque de cultiver son arrogance ou d’enterrer définitivement tout espoir qu’il identifie et corrige ses défauts… Tout cela épuise le parent et contribue à fabriquer des petits êtres parfois infâmes, généralement sans repère et souvent tyranniques qui, chaque fois qu’ils se frottent à une réalité qui les cogne, n’ont souvent comme seule stratégie que de chercher à la plier pour conformer le monde à leurs attentes.
C’est encore pire quand ces théories « du bonheur sans tache » que propose la psychologie positive prennent les habits de la pédagogie pour mieux dire aux parents ou aux enseignants ce qu’ils doivent faire pour ne plus mettre au monde que des enfants continuellement heureux et destinés à le demeurer sans faille jusqu’à la fin de leur vie. Pris au piège de cette course effrénée, les parents et les enseignants, à bout de souffle, finissent par ne plus pouvoir eux-mêmes respirer pour avoir voulu mettre des enfants ou des élèves en situation de bonheur perpétuel, de contentement constant, de satisfaction éternelle ou de joie continue.
C’est pour rompre avec ce salmigondis d’happy pédagogies qu’il apparaît de nos jours salutaire, dès ses premiers pas de parents, non seulement de se donner le droit, juste par la force de l’imaginaire, d’envoyer symboliquement son enfant « par la fenêtre », mais aussi, tout au long du parcours, de se reconnaître le droit de « respirer » tout autant que son enfant. Ce n’est aucunement la marque d’une faille parentale, ni l’indice d’une faiblesse éducative, ni le symptôme d’une maladie pédagogique. C’est même plutôt un signe de bonne santé. Seuls les parents mal assurés dans leur rôle et dans leur fonction refusent d’éprouver ce double sentiment. Faisant raisonner dans leur tête une petite voix qui leur répète sans cesse « Sois parfait(e), soit fort(e), fais un effort… », ils prennent alors l’habit inconfortable de ces hyper-parents qui, à force de se montrer trop exigeants vis-à-vis d’eux-mêmes, finissent par le devenir également par rapport à leurs enfants, et mettent sous tension un acte éducatif qui gagne pourtant tellement à être réalisé dans le calme et la sérénité.
J’ai récemment publié un ouvrage qui invitait les parents à « laisser leurs enfants respirer1 », celui-ci en constitue en quelque sorte le prolongement. Dans un contexte d’hyper-parentalité, c’est en effet toute la famille qui risque de manquer d’air chaque fois que l’on y soumet l’éducation à des contraintes excessives, déraisonnables ou disproportionnées. Même chose quand l’école prend la tangente et que, sous la double pression d’enfants qu’ils perçoivent comme des tyrans et de parents qui leur donnent l’impression d’avoir couvé cette tyrannie, les enseignants craquent en se consumant lentement ou en s’enflamment brutalement parce qu’ils ne parviennent plus à identifier les moments où, pour enseigner, il leur paraît nécessaire de se montrer exigeants. Les parents et les enseignants, en laissant leurs enfants ou leurs élèves respirer, doivent y trouver l’opportunité de retrouver leur souffle. Faute de cela, ils risquent de se transformer en simples bonbonnes d’oxygène et de ne pas songer, eux-mêmes, à se donner de l’air.
C’est en écoutant tous ces récits de parents épuisés par leur souci de perfection, déboussolés par l’injonction qu’ils se donnent à eux-mêmes de ne jamais punir, laminés par leur souci d’être toujours à l’écoute, usés par leur volonté de délivrer une éducation optimale, éreintés à force de se courber devant les exigences de leurs enfants que l’idée d’écrire ce livre consacré à la « babycratie » m’est venue. C’est aussi en prêtant une oreille attentive à un grand nombre d’enseignants qui avaient de plus en plus l’impression d’assimiler les vacances scolaires à de trop courtes périodes de convalescence que j’ai compris l’urgence d’écrire un ouvrage qui casse un peu les codes de la pédagogie positive en mettant notamment un bémol sur une partie de ses revendications principalement quand, portées par Montessori, remises au goût du jour, et Céline Alvarez, habile à refaire du neuf avec du vieux, elles se font, de manière souvent simpliste et réductrice, agressivement exclusives, épouvantablement prescriptives et résolument excessives.
En proposant d’accompagner le parent et l’enseignant dans cette épreuve quotidienne à laquelle ressemble parfois, et même parfois souvent ou souvent parfois, l’acte d’éduquer un enfant ou de tenter de lui transmettre des connaissances, cet ouvrage vise essentiellement à leur permettre de prendre un peu de hauteur pour observer ce qui est véritablement en jeu dans l’acte éducatif quand celui-ci est soumis au diktat du bonheur absolu, de la satisfaction instantanée et du contentement permanent de l’enfant.
Ainsi envisagé, ce livre permet de cheminer pas à pas avec le parent et de l’accompagner, sans brutalité, en mettant de la légèreté là où la lourdeur empêcherait d’avancer. Vous ne trouverez pas ici de « petits trucs », pas d’« astuces », pas de « procédures » qui, dans la lignée de la pédagogie positive, sont si souvent livrés comme des manières de faire « clé sur porte » et qui, quand ils ne marchent pas – ce qui est si souvent le cas – laissent le parent désemparé, coupable de ne pas être ce papa positif ou cette maman positive, ce parent toujours zen, qui, à force d’écouter les émotions de son enfant, en a fini par oublier complètement les siennes et qui, à force de s’incliner face aux exigences de son enfant, finit, en avançant courbé, par ne plus voir le mur contre lequel il finira bien, s’il ne relève pas la tête, par s’écraser.
Il ne sera pas davantage question ici de « trouvailles pédagogiques » ou de procédés miracles à travers lesquels le plaisir d’apprendre s’imposerait magiquement. De telles suggestions pédagogiques trop simplistes, en niant la difficulté du rôle et en minimisant l’ampleur de la tâche, laissent trop souvent l’impression que tout est simple, qu’« il n’y a qu’à » pour que l’enfant – et plus tard, l’adolescent –, se mette en marche. Une pincée de Montessori, un zeste de Céline Alvarez, un soupçon de Steiner et tout se fera tout seul… L’enfant avancera et l’adolescent arrêtera illico de faire du sur-place et, si cela ne fonctionne pas, il n’y aura évidemment qu’un coupable : l’enseignant inadapté, incapable d’adopter ces méthodes pseudo-nouvelles qui ont certes eu tout leur sens dans l’histoire de la pédagogie et une signification essentielle dans son évolution, mais ne gagnent certainement rien à être présentées comme des méthodes exclusives sous les formes radicales que tend à leur donner la pédagogie positive. Ici aussi, dès lors qu’elles sont présentées comme infaillibles ou réduites à des formules simplistes, les techniques pédagogiques menacent d’écraser l’enseignant coincé entre les exigences parentales, quand ceux-ci, mal renseignés par des livres réducteurs, ne mesurent plus la difficulté de la tâche de l’enseignant, et les résistances de l’enfant – ou de l’adolescent –, quand, comme c’est souvent le cas, il peine à apprendre ou refuse d’être enseigné…
Dans le monde scolaire, cet écrasement constitue le vecteur principal de ce qui constitue la pénibilité de la fonction enseignante. C’est là qu’il faut, dans de nombreux cas, chercher l’origine de l’essoufflement professionnel qui menace tant d’enseignants ou de directeurs d’école. Les plus exposés sont par ailleurs sans doute, à cet endroit, ceux qui montraient à l’origine les signes les plus tangibles de motivation. Pour eux, confrontés chaque jour à une cohorte d’enfants ou d’adolescents rétifs à apprendre, le risque de se sentir déconsidérés, parce qu’ils ne se sentent pas reconnus dans l’ampleur de leur rôle et la difficulté de leur fonction, apparaît d’autant plus important chaque fois qu’ils se sentent pris au dépourvu par des résistances ou des critiques qu’ils n’avaient pas anticipées.
Combien d’entre eux ne rêvent-ils pas de confier leur classe pour une matinée seulement à un de ces parents donneurs de leçons armés de leur Montessori illustré et de leur Freinet en dix formules ou brandissant leur version opportunément parue aux Éditions LectureFacile des Lois naturelles de l’enfant, juste pour leur montrer à quel point l’acte d’enseigner ne s’improvise pas mais s’apprend lentement et de manière suffisamment rigoureuse pour se donner les moyens de comprendre, de connaître et d’analyser la façon la plus opportune d’enseigner un savoir qui s’organise en connaissance dans un cerveau prêt à la concevoir ?
Évidemment, quand le coup de pression se fait sentir de l’intérieur de l’école en colonisant la pédagogie scolaire à travers le retour en force de Montessori et la tentative de coup d’État de Céline Alvarez, la pilule est encore plus difficile à avaler. Prise d’assaut de l’extérieur, contaminée de l’intérieur, l’école, sommée de se mettre au pas de la babycratie, fait alors craquer de nombreux enseignants épuisés d’avoir l’impression d’être devenus à la fois l’esclave de leurs élèves et le bouc-émissaire de leurs parents.
Dans l’univers familial également, la pédagogie positive peut s’avérer terriblement écrasante. Cet écrasement y prendra alors le nom de « burn-out parental », de « ras-le-bol éducatif » ou d’« exaspération pédagogique », selon le terme que l’on voudra bien lui associer. Il se révélera de façon sourde ou brutale par une déprime longue durée ou par une succession de phases sporadiques de mauvaise humeur, selon la manière dont le parent s’autorisera à vivre son coup de mou. Le couple conjugal mis KO par le couple parental, lui, généralement ne s’en relèvera pas, parce qu’il ne songe même plus à le faire et que, les enfants canalisant l’essentiel de l’énergie, il n’en reste plus assez, ni pour nourrir la vie affective des conjoints, ni pour alimenter le souci de bienveillance réciproque, ni, bien entendu, pour stimuler une vie sexuelle suffisamment consistante pour souder le couple derrière un objectif qui ne concerne en rien les enfants.
Usé, anéanti ou carbonisé, le parent en viendra alors éventuellement à consulter un spécialiste en coaching parental « positif » qui s’attachera sans doute à suggérer de nouvelles pistes pour être de meilleurs parents et continuera ainsi à creuser le trou dans lequel le papa ou la maman (parfois les deux) ivre de perfection est occupé à s’enterrer.
Dans ce livre, il sera davantage question d’« autoriser » les parents à se permettre un zeste de « pédagogie négative », à se donner du lest en mettant leur préoccupation éducative en sourdine, à laisser faire de temps en temps les écrans, à s’accorder le droit au relâchement et à s’interdire de vouloir être un parent parfait à plein temps au service exclusif d’une graine de tyran. C’est par ailleurs ce que j’ai tendance à faire chaque fois qu’un parent consulte pour un « désordre éducatif majeur » et qu’à bout de souffle, il vient consulter parce l’éducation de ses enfants, terriblement décevante, lui donne l’impression de n’être plus qu’un immense fiasco. Pour ce parent-là, l’urgence, c’est de lui livrer une bonbonne d’oxygène et de l’autoriser à respirer.
Pour cela, il faut évidemment illico presto renoncer à l’abreuver de conseils issus de cette pédagogie positive qui, dans le terreau asséché de son négativisme, ne trouveraient qu’une terre bien peu fertile. C’est pour cela d’ailleurs qu’en pédagogie familiale, d’une manière générale, les conseils ne servent à rien. Ceux qui sont prêts à les entendre n’en ont généralement pas besoin et ceux qui en ont besoin ne sont pas prêts à les entendre.
Le premier bénéficiaire de cette manière de procéder qui remet en selle le souci d’épanouissement de l’adulte, c’est l’enfant qui, lors de la consultation, voit quelqu’un lui venir concrètement en aide en suggérant à ses parents de lui lâcher un peu les baskets, de cesser de temps en temps de mettre ses jeux sous surveillance et de renoncer à être ces « parents parfaits » dont il ne sait que faire, ces parents encombrants dont il rêve de se défaire sans oser imaginer s’en débarrasser. La pédagogie positive ne l’est généralement qu’envisagée du point de vue des parents. Vue à hauteur d’enfants, elle n’a souvent de positif que le nom et se révèle souvent, à travers l’importance excessive qui est donnée à tout, comme une source de tension dont il préférerait se passer. Aussi, lorsqu’un enfant perçoit que le thérapeute s’occupe surtout de ses parents, en les invitant à souffler, à ne plus se préoccuper exclusivement de son éducation et à se donner à eux-mêmes les moyens de s’épanouir individuellement ou en couple, l’enfant, percevant qu’il n’est plus l’unique centre des difficultés, le point focal des problèmes, se met à respirer mieux en rêvant librement à des jeux qui ne seraient pas qu’éducatifs, à un usage détendu des écrans, à une nourriture variée qui ne serait pas choisie exclusivement en fonction d’une norme d’hygiène alimentaire rigoureuse et de résultats scolaires qui ne seraient plus envisagés avec anxiété, au moindre fléchissement, comme une brusque poussée de fièvre.
Pas de trucs donc dans ce livre mais, je l’espère, des façons d’agir, de penser, de réagir qui permettent d’éclairer le parent-éducateur ou l’enseignant pour qu’il ne soit plus condamné à avancer dans l’obscurité parce qu’il se serait par exemple laissé aveugler par la lumière trop forte que portait sur l’acte éducatif une version outrageusement positive de tout ce qui favorise le développement affectif et cognitif de son enfant.
Armé d’une positivité à tout crin, le parent, ignorant non seulement où ses pas le mènent mais aussi où ils mènent ceux de son enfant, risque en effet de s’égarer avec lui chaque fois qu’il sera amené à confondre l’idée d’une éducation bienveillante soucieuse d’épanouissement avec celle d’une forme résolument positive de pédagogie qui ne se préoccupe souvent que de manifester ce bonheur de surface qui, par nature, en réclame toujours un autre, plus grand, plus sûr ou plus clinquant. La première accepte l’idée du trouble sans en faire une maladie, de l’insatisfaction transitoire qui aide à s’orienter, du doute qui permet d’avancer et du questionnement intelligent sur soi qui permet de progresser, à l’estime, en sachant mieux qui l’on est. La seconde se met à l’affût d’une douance qui fait toute une maladie de chaque trouble d’apprentissage, s’oppose à toute frustration affective en réduisant l’intelligence émotionnelle à la seule émotivité, remplit l’enfant de tellement de certitudes à propos de lui-même et du monde qu’il n’a plus à questionner ni l’un ni l’autre et, au nom de l’idée qu’il faut préserver une estime de soi tellement mal définie, encourage, pour le meilleur, à ne pas connaître ses défauts, pour le pire, à s’en contenter.
Ce livre consacré à la « babycratie » veut apparaître comme une véritable bouffée d’oxygène qui aide les parents et les enseignants à respirer chaque fois qu’ils se sentent étouffer à force d’éduquer… « J’ai tout fait pour toi… » « J’étouffais pour toi… » Si ces deux phrases s’emmêlent un peu trop souvent dans votre tête quand vous vous adressez à votre enfant, ce livre est sans doute fait pour vous. Plongez donc dedans sans modération et vous vous surprendrez, je l’espère, après chaque chapitre… à mieux respirer…
1 Bruno Humbeeck, Et si nous laissions nos enfants respirer ? Comprendre l’hyper-parentalité pour mieux l’apprivoiser, Renaissance du Livre, 2017.
La babycratie : de quoi parle-t-on ?
Un néologisme né d’un autre
Quand une notion nouvelle apparaît, ce n’est généralement qu’en jouant avec les mots, éventuellement dans toutes les langues, que l’on parvient le mieux à en cerner les contours. C’est comme cela, en faisant naître les néologismes, que l’on définit les tendances émergentes dont on perçoit clairement le mouvement naissant sans pouvoir toutefois en déterminer suffisamment le sens pour en faire un mot amené à se répandre dans le langage courant.
Le néologisme apparaît alors comme un terme en mutation, suffisamment présent pour être nommé, mais insuffisamment installé pour être désigné par un mot. C’est pour cela sans doute que les sciences humaines en consomment en quantité.
Le terme « happycratie » est ainsi apparu récemment pour rendre compte d’une forme contemporaine d’injonction à l’euphorie perpétuelle qui tend à imposer à chacun une course effrénée vers un bonheur continu et, si possible, intense. Dans une happycratie, il est non seulement question d’être heureux mais aussi de se donner l’obligation de l’être.
Dans un tel contexte de quête permanente du bonheur, les pairs, transformés en juges, ne font pas de quartier. L’happycratie apparaît souvent comme un univers impitoyable. Sur le plan de l’image sociale, malheur au vaincu considéré comme responsable de ne pas s’être donné les moyens de découvrir ses propres voies d’épanouissement individuel, haro sur le jouisseur poussif déclaré coupable de sous-développement personnel et pas de pitié pour les infirmes du bonheur incapables, dans un monde de surconsommation, de profiter de tout ce qui semble leur être offert sur un plateau.
Se déclarer « mal heureux » dans une société d’abondance, c’est comme exposer une infirmité dans un univers d’athlètes, manifester un stigmate dans un monde sans aspérité ou montrer une fêlure là où tout est parfait. Cet aveu d’incomplétude démontre tout à la fois l’inaptitude à se servir de ce qui nous est donné, l’incapacité à se saisir de ce qui est mis à notre portée et l’incompétence de celui qui ne parvient pas à utiliser ce qui est mis à sa disposition. Une telle démission face au confort qui nous est promis, à la satisfaction qui nous est due et au contentement qui nous est offert apparaît à la fois totalement incongrue et fondamentalement inacceptable.
« Ne pas pouvoir se payer une Rolex à trente ans, c’est avoir raté sa vie », « Être incapable d’exploiter tout le potentiel d’un outil numérique, c’est se gâcher l’existence », « Ne pas être en mesure de s’offrir de la démesure en devenant “scandaleusement” riche »… Voilà le genre de formules que l’on ne peut entendre que dans une happycratie qui s’assume pleinement. L’affirmation d’un bonheur décomplexé y renvoie alors en miroir l’image en creux de celui qui n’a pas réussi à se parer des signaux ostensibles de l’opulence qui l’entoure, de celui qui doit se frustrer d’une part du confort qui semble lui être dû ou de celui qui doit se contenter d’une vie terne et sans éclat alors que tant d’expériences extrêmes sont mises à sa portée…
Évidemment, ce bonheur « clé sur porte » a un coût. Et le prix peut être très lourd. Naviguant de séances de coaching en cures de bien-être, en passant par les stages de remise en forme, les sessions de méditation et les thérapies de développement personnel, l’individu, sommé d’être heureux, participe pleinement à cette économie nouvelle, celle de l’épanouissement autocentré de soi comme centre de son monde.
Dans un tel contexte, les traversées du désert sont fréquentes. Au figuré, quand l’individu au bonheur chancelant est invité à se reconnecter à son Soi authentique. Au propre, quand pour se retrouver, il est convié à payer le prix fort pour une balade collective à travers laquelle il lui sera proposé de se recentrer sur lui-même en jouant une semaine par an au Bédouin dans une méharée de citadins en profond questionnement identitaire. Cela évidemment lui aura coûté un pont mais, c’est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Et quand l’objet de cet amour est essentiellement son Soi intérieur authentique, il n’est évidemment pas question de regarder à la dépense.
Voilà donc pour ce qui relève de l’happycratie, de son retentissement psychologique et de ses implications économiques… Or, comme j’ai eu l’occasion de le décrire longuement dans un précédent ouvrage, notre modèle social est également marqué par la pression éducative intense que les parents se mettent à eux-mêmes. Ce que nous désignons par le terme d’« hyper-parentalité » définit précisément cette tendance à focaliser l’attention sur la sécurité absolue, le développement optimal et l’épanouissement idéal de l’enfant.
Au contact de cette inflexion éducative, l’happycratie va inévitablement prendre une forme particulière. Avec l’hypertrophie de la fonction parentale et l’excès de pression que le parent fait peser sur le rôle qu’il se donne et la fonction qu’il s’assigne, la voie semble en effet toute tracée pour faire naître une société entièrement vouée au bonheur de l’enfant et essentiellement composée de parents totalement dévoués à sa réalisation.
Les parents « hélicoptères » n’y cherchent pas seulement à contrôler les mouvements de leurs enfants pour assurer leur sécurisation absolue, ils se mettent à tourner dans tous les sens pour s’assurer de sa parfaite stabilité psychique. Au moindre signe d’insécurité, ils consultent à tout va et cherchent à remettre leur enfant sous contrôle.
J’ai eu l’occasion de constater ce mouvement un jour ou, alors que j’avais sommairement décrit au cours d’une conférence les caractéristiques de l’attachement insécure, certains parents avaient cru y voir le portrait de leur enfant. La séance de questions postconférence s’est transformée illico en thérapie de groupe pour parents inquiets. « Ne risque-t-il pas de devenir un infirme affectif ? Comment le soigner ? Quel est le traitement ? Peut-on guérir ces handicapés de l’amour serein ? Est-ce ma faute, celle de son père, celle de sa mère ou alors celle de ce dessin animé que je lui laisse imprudemment regarder ? Je lui ai un jour raconté l’histoire du Vilain petit canard, est-ce à cause de cela ? Suis-je coupable ? Est-ce réversible ? Doit-on dès aujourd’hui le mettre sous perfusion affective et commencer le traitement ? » Face au flot de questions des parents hélicoptères tournoyant dans tous les sens, tout ce que j’ai trouvé à répondre pour calmer leur angoisse, c’est que leur enfant, même s’il devait avoir développé superficiellement des styles affectifs alternatifs, ne risquait en définitive pas grand-chose d’autre que de se montrer temporairement ou transitoirement un peu attachiants1 et que ce trouble, passager, ne serait somme toute que légèrement incommodant pour eux-mêmes amenés pour un oui ou pour un non à refaire tourner leurs hélicos.
Dans le même ordre d’idées, les parents « drones », au sein d’une happycratie, ne cherchent plus uniquement à offrir à leur enfant ce qu’il y a de meilleur. Ils le font en s’assurant que ce « meilleur » soit avant tout un gage de bonheur. Ainsi, il ne s’agit plus seulement de lui trouver ce « stage qui tue » qui peut prendre des formes aussi diverses que « la méditation pleine conscience dès le plus jeune âge », « apprendre à parler avec les arbres dès six ans », « s’initier au yoga dès dix-huit mois » ou « apprendre tout petit à observer son nombril pour favoriser la quête de soi ».
Non, pour un parent drone immergé en babycratie, cela ne suffit pas. Il faut encore que ce stage apporte à l’enfant satisfaction immédiate, contentement sans faille et joie sans retenue… Bien entendu, cela relève souvent de la gageure tant il paraît souvent difficile de joindre ce qui est perçu comme utile par le parent à ce qui est vécu comme agréable par l’enfant… Et quand, comme nous le verrons, cette double exigence se met à contaminer l’école, le poids qui pèse sur une institution scolaire qui, au lieu d’être envisagée comme un lieu d’apprentissage collectif, n’est plus perçue que comme un espace de développement personnel au sein duquel il ne doit plus être question que de bonheur, la pression que le parent met sur l’établissement peut rapidement devenir la source de véritables tensions.
C’est encore plus vrai pour les parents « curling » qui, soucieux de tout faire pour garantir l’avenir de leur enfant, se mettent à balayer avec frénésie tout ce qui pourrait encombrer son chemin ou ralentir son cheminement sur ce qu’il voudrait transformer en voie royale vers un épanouissement complet. Porteuse de cet avenir, l’école doit, pour eux, remplir ses promesses sans faillir, tout en renonçant pourtant à se montrer contraignante. Il faut que l’enfant n’y apprenne qu’en s’amusant et, bien plus, qu’il le fasse spontanément en emmagasinant des savoirs utiles et exclusivement envisagés en termes de rentabilité cognitive et de retour sur investissement intellectuel.
Pas question d’y voir l’ombre d’un Bob l’éponge ou un petit bout de Peppa Pig, il faut, et ce n’est pas gagné, qu’il s’amuse en regardant Kirikou, Les Ritournelles de la Chouette ou la version dessin animé des poésies de Paul Éluard, parce que les « contenus éducatifs » y sont clairement déclarés et explicitement affirmés… Pour l’enfant, il faudra alors mettre beaucoup d’énergie pour satisfaire ses parents, en disqualifiant Bob l’éponge qui le faisait bien rire au bénéfice de dessins animés moralisateurs beaucoup moins drôles qui, nous le verrons, découragent l’esprit critique et stimulent le moutonnage au nom de « grands principes » adultes par rapport auxquels le petit enfant ne manifeste que très peu d’intérêt.
C’est donc pour définir cet environnement éducatif nouveau que le terme de « babycratie » a vu le jour… Là où l’happycratie désignait cette dictature latente du bonheur, générant chez chacun et chacune cette forme d’exigence personnelle à être heureux à tout moment et en toutes circonstances, la babycratie s’est imposée pour signifier cette tendance appliquée à l’éducation familiale et scolaire et la propension qui en découle à vouloir mettre au monde des enfants impeccablement heureux et surtout destinés à le rester, sans la moindre faille, jusqu’au bout de leur vie…
À l’happycratie, nous prenons donc le parti d’en accoler un autre, celui de babycratie pour signer l’émergence du règne de l’enfant et de son prolongement dans l’adolescence… et même, dès lors qu’il est question d’ériger le culte de l’épanouissement éducatif en mettant l’enfant au centre de tout, d’hybrider le premier avec le second, en proposant le néologisme de babe-happycratie ou d’happy-babycratie pour signifier ce culte de l’enfant heureux qui se propage à la même vitesse que se répandent ces pédagogies et ces psychologies dites « positives » à travers lesquelles chaque éducateur est invité à n’observer le développement de l’enfant et de l’adolescent qu’en se servant de lunettes roses…
Une telle injonction latente à l’euphorie perpétuelle n’est, comme nous le verrons plus tard, pas sans risque. Elle peut même se transformer en véritable tyrannie si l’on perd de vue le sens des limites en délaissant à ce petit morceau d’homme trop de pouvoir, en l’investissant d’une autorité excessive ou en lui donnant l’illusion d’une puissance infinie. Ce faisant, on n’aura en définitive pas fait grand-chose d’autre que de pousser un peu loin les différentes composantes qui expliquent comment, dans nos modèles sociaux, cette tendance pédagogique lourde s’est progressivement mise en place.
1 Le risque de devenir « attachiant » se manifeste notamment chez quelqu’un quand il se met toujours à la recherche de relations fusionnelles par peur d’être quitté. L’attachement insécure crée des formes d’hypervigilance qui sont assez difficiles à vivre parfois pour le partenaire.
D’où vient la babycratie ?
Premier ingrédient : un pouvoir flottant
—Les pérégrinations de Kratos
Dans la mythologie grecque, Kratos est une divinité personnifiant la puissance et le pouvoir. Rejeton du Titan Pallas et de l’Océanide Styx, il est aussi le frangin de Niké (Victoire), Bia (Force) et Zélos (Ardeur). Pouvoir, victoire, force et ardeur, c’est en rassemblant l’ensemble de ces forces que l’on formait, au temps où la mythologie grecque dictait le tempo, un panthéon parfait susceptible de gouverner le monde et de le soumettre à la volonté impérieuse des dieux.
L’autorité que procurent une filiation divine et une fratrie solide permettait à Kratos de se poser comme un principe de commandement à la fois dominant et ferme. On ne conteste pas un dieu et d’autant moins s’il démontre une vitalité qui lui permet de s’affirmer victorieux, fort et ardent. Kratos, en colonisant le vocabulaire, a traversé les âges. Il s’est glissé partout pour désigner les endroits où le commandement visait à se concentrer, à s’installer ou à se mettre en place.
C’est pour cela que lorsque l’on cherche où se niche le pouvoir, on doit toujours se montrer particulièrement attentif à la manière dont le suffixe qui évoque le divin kratos trouve à se combiner dans un mot ou à se glisser dans un néologisme pour comprendre la manière dont le pouvoir et la puissance qui lui est associée circulent et concevoir ce qu’ils prennent prioritairement pour objets d’élection. Les dieux grecs ne sont pas morts. Ils se sont juste installés dans notre vocabulaire pour survivre et permettre à la mythologie de continuer à produire en sourdine ses effets sur l’être humain.
Ainsi, quand il est associé au démos, comme dans une démocratie, le kratos était censé adouber un nouveau mythe, celui qui suppose une véritable prise de pouvoir par le peuple. Or, on sait ce que l’on peut faire d’un mot quand on étend de manière exagérée sa signification en lui fixant des limites sémantiques floues et incertaines. C’est ce qui explique pourquoi la notion de démocratie fait autant débat à l’heure actuelle et c’est ce qui montre comment, en ce compris au sein des familles et à l’école, chacun éprouve le sentiment que l’idéal démocratique doit être retravaillé sans fin.
La démocratie n’est pas une évidence. Elle ne s’impose pas de manière naturelle, mais relève d’une construction sociale. Aucune société animale n’est instinctivement démocratique. C’est pour cela que lorsque les lieux de pouvoir vacillent, c’est l’idée même de démocratie qui, parfois, se met à chanceler.
La contestation de ce lieu théorique de centralisation du commandement se manifeste par ailleurs également par la prolifération de mots amenés à rendre compte des glissements d’un pouvoir qui, perdant sa souveraineté, se met à chercher des objets sur lesquels il peut se poser. L’apparition de néologismes constitue à cet endroit un indice particulièrement édifiant de ces formes de remodelage.
Acratie (absence d’autorité), adhocratie (management souple), aristocratie, autocratie, axiocratie (pouvoir à l’élite du peuple), biocratie (eugénisme), bobocratie, bureaucratie, calotinocratie (pouvoir des bigots), canaillocratie, cancrocratie, christocratie, cleptocratie, clérocratie, clitocratie (pouvoir des femmes), commissariocratie, cosmocratie, davocratie (pouvoir de la finance), démoncratie, démocratie, doxocratie (pouvoir de l’opinion), éditocratie, égocratie, émocratie, épistocratie, ergocratie, ethnocratie, eurocratie, expertocratie, fricocratie, gérontocratie, gynécocratie, hétérocratie, hiérocratie, holocratie, hystérocratie, idiocratie, imbécilocratie, inaptocratie, ineptocratie, isocratie, kakistocratie, médiacratie, médiocratie, mercatocratie, méritocratie, mollahcratie, moncratie, nomocratie, noocratie, nucléocratie, ochlocratie, opiniocratie, particratie, pédantocratie, phallocratie, philocratie, physicratie, ploutocratie, pornocratie, robinocratie, robocratie, sacerdocratie, sondageocratie, sondocratie, stochocratie, stratocratie, technocratie, tellurocratie, testocratie, thalassocratie, théocratie, timocratie, voyoucratie, vaginocratie, vulvocratie, logoscratie, vincratie…
Voilà 78 façons de décliner le pouvoir en l’associant au vide, à la bigoterie, à la finance ou à l’opinion publique, en le teintant d’eugénisme ou de conflits genrés ou en sous-entendant qu’il a été confié aux plus mauvais, aux bandits, aux voleurs ou aux canailles… Cette floraison des « craties », cette démultiplication de « kratos », cette prolifération du suffixe utilisé pour évoquer la source du commandement constituent sans doute à la fois l’indice d’une crise de légitimité du pouvoir et le signe d’un glissement permanent de l’autorité dans une société flottante qui se construit au sein d’un monde liquide (Zygmunt Bauman, 2004). Pour le dire autrement, quand le pouvoir se met à ondoyer, l’autorité ne sait plus très bien où se poser et les structures sociales, comme l’école où la famille, voient leur armature perdre de leur solidité.
Ainsi, aux formules surannées du style « Tu feras comme je le dis parce que je suis ton père » et autre « Sois sage et écoute bien Monsieur ou Madame » s’offrent en écho des phrases plus contemporaines du genre « D’abord t’es même pas mon père, t’es mon beau-père et puis je fais ce que je veux… » et autre « Pas question que je reste assis sans bouger plus de cinq minutes, c’est au-dessus de mes forces, et, de toute façon, je ne l’écouterai que s’il dit des choses qui m’intéressent » davantage en phase avec l’ère du temps.
L’objet n’est pas ici de réaliser l’examen sociopolitique de ce phénomène en essayant d’identifier d’où vient le glissement et de comprendre vers où il peut nous conduire. Non, notre propos centré sur l’évolution de l’éducation familiale et scolaire visera davantage à examiner la manière dont la circulation du pouvoir affecte un contexte éducatif fondé sur l’« hyper-parentalité » et consacrant le culte de l’« épanouissement performant ». Ce double pilier des conduites parentales face auquel doit si souvent céder l’offre enseignante.
—L’injonction à l’optimisme perpétuel
Pour évoquer ce changement de paradigme éducatif, les 78 déclinaisons reprises ci-dessus n’étaient apparemment pas suffisantes. Eva Illouz et Edgar Cabanas, en pointant du doigt la dictature du bonheur, en ont déjà, pour leur part, rajoutée une en parlant d’happycratie… Ce concept sous-tend l’idée que, dans nos sociétés occidentales contemporaines, c’est le bonheur qui a pris la main et que c’est désormais en son nom que l’on acceptera de se laisser gouverner. Le diktat du bonheur à tout prix, l’injonction à l’euphorie perpétuelle et la tyrannie du contentement constant se font sentir autant chez les individus que dans les groupes.
Une société de ce type tend à se mettre sous le joug d’une économie paradoxale qui, promettant le bien-être satisfait, attise en réalité les désirs, surfe sur les envies et crée des besoins pour maintenir chacun dans un état d’insatisfaction continue qui pousse à consommer toujours davantage dans l’espoir, systématiquement déçu, d’être enfin rassasié.
Le bonheur érigé en valeur morale, en norme économique, en socle pédagogique et en clé du développement psychique, induit une forme de tyrannie de l’optimisme de surface, une sorte de religion de l’individualisme altruiste à la sauce bouddhique et une forme de consommation hédoniste saturée de bonne conscience. L’optimisme superficiel comme exercice imposé s’affiche alors à coups de citations réductrices. Il voue alors à la géhenne les philosophes de la désespérance ou de l’absurde.
Haro sur Cioran, Schopenhauer, Camus, Onfray et Kierkegaard, ces empêcheurs de penser le bonheur de manière simplifiée parce que, exigeants avec l’esprit, ils expliquent à longueur de livres comment la réflexion, qu’elle prenne soi ou les autres comme objet, est toujours une construction complexe qui impose de prendre le temps de comprendre, de connaître et d’analyser le phénomène qu’ils étudient avant d’en envisager la synthèse et bien avant de prétendre produire, sous la forme d’un concept novateur ou d’une argumentation différente, une quelconque innovation. Vivent Salomé, Gounelle, Kotsou et autre Giordano, ces producteurs en chaîne de sentences positives qui légitiment des manières de ne cogiter qu’à coups de citations et privilégient à l’idée de faire penser leurs lecteurs celle de les pousser à dépenser leur argent pour acquérir des ouvrages vides, creux et simplistes dans lesquels leurs idées éculées croient pouvoir se répandre en faisant l’économie de la réflexion…
Il ne suffit plus d’imaginer Sisyphe heureux pour paraphraser Albert Camus, il faut maintenant le voir éternellement content, affichant un sourire béat qui manifeste son état de bonheur constant, distribuant les émojis satisfaits qui le revendiquent et multipliant les selfies qui l’attestent. Un Camus contemporain aurait certainement beaucoup de choses à nous dire à propos de cette joie mise en spectacle et de la façon dont elle prétend camoufler l’absurdité de l’existence en la faisant passer derrière la course effrénée à la consommation et la quête éternellement inaboutie d’une satisfaction constamment prise en défaut.
L’absurdité d’un contentement à la fois impossible et continuellement recherché comme artefact de l’absurdité existentielle, c’est un peu comme de l’absurdité mise au carré et cela constituerait sans doute une matière à penser infinie pour un esprit camusien soucieux de repérer l’absurde sous les décombres de la liberté mise à mal par les multiples aliénations que l’homme se donne à lui-même et de toute justice prise au piège de l’inégalité face à une hyperconsommation qui n’a de cesse de creuser de la distance sociale…
Il faut donc imaginer Sisyphe heureux et tout le temps content mais aussi, dans le même temps, concevoir Narcisse insatisfait et continuellement mécontent. L’individualisme forcené pousse ainsi chacun à se transformer en mécontemporain viscéral revendiquant essentiellement en faveur de sa personne des droits universels dont celui, bien dans l’esprit du temps, de droit au bonheur sans ombre et à la réalisation optimale de soi.
—Le bonheur du Soi : l’individualisme triomphant
Le bonheur terrestre doit bien évidemment, dans un tel contexte, être mis à portée de l’enfant. L’enfant n’est plus seulement une personne – cela on le sait depuis Dolto –, il se constitue d’emblée en individu et cela signifie notamment que le monde et les adultes qui le peuplent doivent s’adapter à son rythme, se conformer à sa vitesse d’apprentissage et, surtout, lui éviter toute secousse émotionnelle qui le laisserait penser que la réalité pourrait être source de tristesse, de peur, de dégoût ou de colère.
Fondamentalement ancrée dans l’idée de la finitude de chaque existence individuelle, l’éducation est envisagée comme une manière de réaliser la sculpture d’un Soi qui serait à la fois conscient de sa valeur, assuré de son unicité et rassuré quant à ses capacités de développement. Voilà ce que l’on attend d’une éducation positive conçue comme une véritable autoroute vers la réussite d’une existence dont le sens n’implique pas la recherche d’une signification, mais suppose l’idée d’une réalisation.
Se réaliser, mener une vie pleine, accomplie, intense à travers laquelle il devient possible de s’épanouir tout en manifestant l’étendue de son potentiel, voilà l’enjeu de l’éducation, qu’elle soit familiale ou scolaire. Dans un tel contexte, la famille sera chargée d’éveiller le potentiel cognitif de l’enfant dans sa profonde singularité et donc selon les formes particulières à travers lesquelles elles trouveront le mieux à s’exprimer. Quant à l’école, il lui restera à ne pas gâcher le travail en étouffant ce qui a été éveillé ou en ne poursuivant pas le travail entamé par le milieu familial.
L’enfant présenté comme surdoué, successivement désigné « précoce » ou « à haut potentiel » ou même, plus tendrement, par le sobriquet de « zèbre », se pose ainsi comme un défi posé à l’école suspectée de trop se soumettre au souci d’avancer « groupé » et accusée d’une trop faible attention portée à la spécificité des parcours individuels. Dilapideuse de talents, gaspilleuse d’intelligences, rabaisseuse de potentiel, gâcheuse de qualités, l’institution scolaire, trop ancrée dans l’ambition collective qu’elle se fixe quand elle se donne pour objectif d’éduquer des masses, est clouée au piloris pour son inaptitude à s’adapter au rythme particulier de ceux qui, victimes du poids de leur « douance », sont condamnés à ralentir le pas pour attendre le troupeau et, pire même, tolérer que celui-ci ralentisse parfois pour permettre à ceux qui sont en difficulté de rester dans le tempo.
La fable du pauvre petit « zèbre » qui s’ennuie de devoir attendre les moutons et qui, faute de mieux, se met alors à courir dans tous les sens en faisant n’importe quoi finit alors de culpabiliser les enseignants, ces stupides bergers, trop occupés par leur troupeau pour prêter une attention suffisante aux pitreries d’un cheval rayé qui demande juste qu’on avance plus vite ou dans une direction qui correspond davantage à celle que lui fixe la forme particulière de son intelligence. Bref, qui attend qu’on se préoccupe de manière plus exclusive de lui et qui exige que la réalité se mette à sa mesure pour lui permettre enfin de développer son potentiel en éprouvant le bonheur de se réaliser pleinement.
Un tel évangile de la réalisation personnelle ne plaide pas en faveur d’une école attentive à l’intérêt supérieur du collectif dès lors que celui-ci freinerait le plein développement du potentiel de quelques-uns, plus doués peut-être, mieux armés incontestablement dans les formes d’intelligence valorisées dans le monde de l’école et généralement issus d’un environnement social qui considère l’éducation scolaire comme l’alliée de celle de la famille, voire sa subordonnée. L’institution scolaire envisagée comme lieu d’épanouissement et comme source d’émancipation devra ainsi réussir la gageure d’être à la fois attentive à la socialisation de tous et soucieuse du développement de chacun.
Bonheur individuel et développement du potentiel singulier se fondent ainsi dans la notion d’épanouissement personnel à travers laquelle le bonheur se décline sur tous les tons et pour tous les dons. Un enfant tout le temps content doublé d’un élève éternellement satisfait, voilà l’acteur principal de la babycratie qui fait son entrée en scène dans le double champ de l’école et de la famille, ses deux bains de vie essentiels.
—Les dieux sont vaincus : le divin enfant cède face à l’enfant roi
L’acteur est là. Son trône est prêt. Reste à définir l’étendue de son royaume. La famille, l’école, dans un premier temps, avant que le monde socioprofessionnel ne se mette à ses pieds pour promouvoir sa réalisation et assurer son bonheur. Celui-ci est par ailleurs envisagé dans sa finitude dans la mesure où, pour un grand nombre, l’éternité spirituelle ou religieuse n’apparaît plus comme un réel sujet de préoccupation. L’enfant à éduquer ne l’est donc qu’en fonction d’un bonheur ici-bas à atteindre au sein d’un monde que l’on souhaite évidemment faire durer le plus et le mieux possible. D’où les préoccupations écologiques, celles qui, indépendamment de toute transcendance, entendent parier sur l’éternité du monde plutôt que sur un monde spéculant sur une éternité qui se situerait en dehors de lui.
La recherche du bonheur terrestre, le souci d’un épanouissement individuel terrien, la préoccupation d’un développement personnel strictement humain, tout cela va mettre hors-jeu toutes les formes de discours qui spéculent sur le sacrifice du présent au nom d’un avenir transcendant. Pas question d’être malheureux au bénéfice d’un bonheur paradisiaque qui ne serait pas vécu sur terre. Impossible de se satisfaire d’une promesse divine contre laquelle tout ce qui se vit d’humainement inassouvi serait racheté plus tard. Inacceptable de se laisser déborder par les frustrations terrestres au nom d’une divinité qui troquerait ces jours décevants contre l’éternité d’un bonheur béat.
Le divin n’étant plus souverain, aucune religion ne semble, dans nos sociétés occidentales contemporaines, en mesure d’influencer la manière dont le pouvoir conféré au bonheur donnera les moyens de le concrétiser. Les principales religions monothéistes, peu compatibles avec la manière dont on se représente le développement personnel de chacun, apparaissent ainsi, au mieux, en toile de fond pour parfaire le tableau, mais elles ne dictent plus leur loi et sont même tenues pour suspectes quand ce qu’elles promettent (sept vierges, le statut de justes parmi les justes ou le salut éternel) est repoussé dans un au-delà auquel seule la foi autorise la croyance.
Sommée de se mettre à hauteur d’hommes, la religion est d’abord celle qui se vit sur terre et se réalise dans le monde concret des réalités. La spiritualité suit exactement le même chemin. Il suffit, pour s’en convaincre, de prendre l’exemple du bouddhisme au réservoir duquel la psychologie positive est venue puiser sans limite, en le détournant pour cela de sa véritable essence. Le bouddhisme, ce n’est en effet pas qu’une formule de politesse qui permet de s’absenter de la vie pour ressentir la plénitude de la joie (sic). C’est, en principe, une attitude existentielle à travers laquelle toute émotion, en ce compris la joie, apparaît comme un piège pour un individu qui demeurerait contingent des vicissitudes d’un monde terrestre qui dilue sa vie spirituelle et délite son âme. La psychologie positive en a fait une porte d’entrée vers le bonheur, par la méditation, la pleine conscience ou toute autre forme d’exercice de pensée qui permet de se rendre le monde inoffensif parce qu’elle le met pleinement à notre portée, quand il est possible d’agir sur lui, ou nous met hors de son atteinte dès qu’il nous échappe.
Religion essoufflée, spiritualité détournée, il n’est pas étonnant que le trône vide après avoir adoubé son maître, le bonheur, se soit mis en quête d’un autre souverain à qui confier le pouvoir en même temps qu’on lui offre la béatitude. Kratos, ne sachant plus à quels saints se vouer, s’est ainsi décliné, comme nous l’avons vu, de 78 façons. Avec l’happycratie, on pensait être parvenu à le fixer un peu mieux, mais l’analyse du phénomène d’hyper-parentalité et des dommages collatéraux qui en découlaient nous a suggéré, en voyant se décomposer tous ces parents en quête de perfection éducative, l’idée de voir s’ériger un autre maître absolu sur le socle du bonheur continu : celui de l’enfant. Cet enfant, éternellement content, c’est celui auquel tant de parents, immolant leur propre souci de satisfaction continue, acceptent de sacrifier leur propre chance de bonheur en l’aliénant à celui de leur(s) descendant(s).
Sur le trône, ce n’est plus seulement l’enfant roi qui siège mais l’enfant heureux et amené à l’être continuellement par une parentalité sans aspérité qui se pose en vassal permanent de ce suzerain tout-puissant. La bienveillance éducative n’est pas dans ce contexte ce qui pose problème, mais l’attitude qu’elle induit quand, mal comprise, elle suppose l’asservissement constant à la joie de l’enfant, à ses besoins tout-puissants et à ses désirs impérieux.
Deuxième ingrédient : une autorité mouvante
—Une tyrannie chasse l’autre
Le pater familias