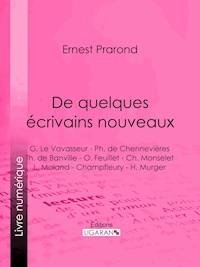
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "On en était au lendemain du succès de Lucrèce; le quartier général avoué des meneurs était dans un coin d'estaminet, caché un peu avant l'angle de la rue Molière et de la rue Vaugirard, sous la maison même de Jules Janin. Pendant que le critique expérimenté souriait en haut de l'œil d'un homme qui regarde une émeute qui passe, la jeunesse emportée,– était-ce bien toujours seulement la jeunesse ?– verdissait de colère en bas et brisait d'enthousiasme les tables du lieu".
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÉCRIVAINS VIVANTS OU MORTS DEPUIS PEU, ÉTUDIÉS OU NOMMÉS DANS CE LIVRE.
Augier (Émile).
Balzac (Honoré de).
Banville (Théodore de).
Barbier (Auguste).
Barbier (Jules).
Barthet (Armand).
Baudelaire (Charles).
Béranger (P.J. de).
Beyle (Stendhal).
Bouilhet (Louis).
Boyer (Philoxène).
Camp (Maxime du).
Carré (Michel).
Champfleury (***).
Chennevières (Philippe de).
Delavigne (Casimir).
Deschamps (Émile).
Desplaces (Auguste).
Doucet (Camille).
Dumas (Alexandre).
Esquiros (Alphonse).
Fauchery (Antoine).
Feuillet (Octave).
Gautier (Théophile).
Héricault (Charles d’).
Hugo (Victor).
Janin (Jules).
Lamartine (Alphonse de).
Le Vavasseur (Gustave).
Lorrain (Jules).
Mérimée (Prosper).
Moland (Louis).
Molènes (Paul de).
Monselet (Charles).
Murger (Henry).
Musset (Alfred de).
Nodier (Charles).
Planche (Gustave).
Ponsard (F.).
Sainte-Beuve (C.A.).
Saint-Victor (Paul de).
Serret (Ernest).
Sue (Eugène).
Tournachon (Félix).
Vigny (Alfred de).
Vitu (Auguste).
J’ouvris il y a deux ans un livre nouveau : c’était un volume de critique ; la première phrase qui me frappa dans un préambule dédié aux Dieux inconnus fut celle-ci :
« Mais parmi nos poètes contemporains, si les aînés, venus en groupe à une époque plus attentive et moins enfiévrée d’industrie, ont su recueillir de plus opulentes moissons dans un champ doré par un meilleur soleil, tout en applaudissant à leur glorieuse fortune poétique, nous unirons volontiers à leurs noms ceux de plus jeunes talents, qui, moins heureux, se sont heurtés à leurs débuts contre l’indifférence, le pire des obstacles en littérature, et qui ont dû se résigner, avec plus ou moins de courage, aux fatalités des circonstances. »
Le livre était signé Auguste Desplaces, poète lui-même et auteur d’un recueil de vers intitulé La Couronne d’Ophélie. Par la phrase qui va nous servir d’enseigne et mieux encore par son âge, M. Desplaces, critique, nous appartient. Cette considération justifiera nos chicanes ; ces chicanes ne porteront en rien, d’ailleurs, sur la délicatesse de ses portraits auxquels on ne saurait reprocher parfois que cette indulgence du monde qui efface trop les distances entre les figures.
M. Desplaces avait donc eu une idée excellente et capable d’assurer à son livre un succès plus méritoire et plus utile ; malheureusement cette idée ne sortit pas du préambule. L’auteur, après avoir, chose permise, généreusement distribué les oboles de sa bourse aux poètes depuis longtemps connus, Lamartine, Musset, Hugo, Barbier, Gautier, Vigny, Sainte-Beuve, etc., se trouva faire, non banqueroute, mais faillite à la plus attendue de ses promesses. Les créanciers, qui purent connaître par les affiches l’appel adressé à leurs titres, reçurent un dividende ; mais je doute fort que le bilan ait satisfait toutes les exigences. M. Desplaces échappa d’une façon un peu fuyarde aux billets à ordre, aux lettres de change et aux protêts ; son livre finit comme ces sonnets ou ces odes qui commencent magnifiquement et tombent émoussés sur la pointe ou alanguis sur la strophe dernière. Un seul chapitre a suffi au poète pour enfouir pêle-mêle les noms qu’il devait si glorieusement mettre au jour, et il ferma la porte au nez des porteurs de titres.
Certes, parmi tous ceux même que l’auteur de la Galerie des poètes vivants a mentionnés honorablement dans ce dernier chapitre, tous n’étaient pas de volée à fatiguer longtemps les yeux de la critique ; beaucoup trop eussent été très honorés d’un blâme plus appesanti, mais quelquefois aussi il y eût eu à louer davantage. La nécessité était-elle bien rigoureuse à l’heure actuelle de nouveaux portraits de MM. Hugo, Lamartine, Musset ? N’avons-nous pas MM. Planche et Sainte-Beuve, les maîtres de la jurisprudence littéraire de nos dernières années ? N’avons-nous pas nos propres tribunaux intimes où se réveillent au besoin nos lectures passées et nos impressions comme des réquisitoires ou des jugements qu’on tire d’un greffe ? Que pourrions-nous apprendre à des auteurs dont la carrière est au trois-quarts parcourue ? En quoi pourrions-nous servir des réputations déjà faites ? L’avenir appartient à ces hommes ; c’est à eux d’en profiter comme ils l’entendront, et bien ou mal ; le succès et la chute sont entre leurs mains. Il n’en est pas de même des jeunes gens inconnus, Dieux ou non. Aux uns il faudrait savoir dire : « Vous n’êtes que des imprudents, sinon plus ; prenez les manchettes d’un employé à paperasseries ou le tablier honorable des forgerons ; » aux autres, il faudrait oser donner de ces conseils qui cinglent l’amour-propre jusqu’au sang, ou de ces encouragements qui relèvent les cœurs abattus ; c’est ce que M. Desplaces n’a pas même tenté.
Quoiqu’il en soit, nous ne lui en devons pas moins l’idée de la présente brochure.
Le temps est venu, en effet, nous ne dirons plus pour les jeunes gens, car de nous tous qui donc sommes jeune encore ? mais pour les auteurs qui travaillent imperturbablement et avec une demi-réputation, d’oser enfin parler d’eux-mêmes hardiment, véridiquement et sans fausse honte ; l’âge, – pourquoi pas la taille, – est arrivé où, sans rien renier des respects qu’exigent leurs devanciers féodaux, ils doivent se mettre hors de pages.
La littérature est un empire plein de révolutions ; les derniers arrivés sont tenus de se hâter, non pour culbuter leurs prédécesseurs, ce qui ressemblerait trop aux procédés politiques de nos commissaires d’émeute, s’intronisant depuis trente ans dans les préfectures prises d’assaut, mais pour prendre date et position ; il est bon qu’ils établissent leurs états de service afin de profiter des premières vacances. Les places ne sont jamais toutes prises, je le sais bien, mais il arrive trop souvent que les gradins d’en bas, obstrués par la foule, interceptent le passage aux gradins supérieurs.
Beaucoup de ces gradins d’en haut, de ces fauteuils donnés par l’opinion, ne seront bientôt plus d’ailleurs, nous demandons pardon de cette hardiesse, que de très beaux postes honoraires. Le plus jeune de nos poètes, nous oublions les actes de l’état-civil bien entendu, est maintenant M. Alfred de Musset. Béranger, à propos de qui il y aura plus tard bien des points à discuter, a merveilleusement rempli le cercle de son temps propre avec la bourgeoisie triomphante de 1830 ; il a eu le bon sens ou la rouerie de se taire depuis ; M. Hugo, infatigable, nous dirions presque dans ses audaces, mais dont il est difficile de parler maintenant sans craindre des soupçons d’influences politiques, ne pourra guère rentrer dans l’arène avec toutes les armes fraîches de sa jeunesse, fourbies par son âge mûr. L’enthousiasme pliera sous lui ; plus que jamais sera-t-il forcé de faire appel à cette science admirable de la main et de l’éperon, à tous ces aides de l’équitation littéraire, à cette rhétorique de la poésie qui s’ajoute à la langue qu’il parle comme l’étude à l’inspiration. Les vivacités très sincères du cœur s’émoussent à la longue en changeant de culte, et le vol des croyances s’égare sans assurance et sans fierté lorsque trop de vents les emportent vers des cieux différents.
Nous ne croyons pas davantage à la pérennité des forces humaines, et M. de Lamartine est arrivé à une telle expansion des puissances de son esprit et de son âme dans la politique et dans le journalisme, que nous craignons bien qu’il ne puisse plus désormais les rassembler pour une œuvre de poésie véritablement digne de ce nom.
Donc, au point où en sont les choses, et c’est une idée sur laquelle j’aime à m’arrêter, il serait consolant de penser que nous faisons halte, en littérature du moins, au règne de Louis XIII ; le beau seizième siècle vient de finir ou agonise ; on cherche la poésie et on ne la retrouve plus. La poésie est-elle morte ? Non ; la poésie ne meurt pas plus que le grain de blé qui dort quelque temps sous la terre. Lafontaine, Racine et Molière sont déjà nés ou vont naître ; Corneille écrit Mélite peut-être dans quelque coin de la province, ou, sans laisser deviner encore l’auteur du Cid, produit de progrès en progrès sur la scène de l’hôtel de Bourgogne Clitandre, La Veuve, La Galerie du Palais, La Suivante, La Place royale, Médée ou L’Illusion comique ; Bossuet soutient peut-être sa première thèse et prêcherait déjà, si l’hôtel de Rambouillet n’était fermé aux graves paroles comme à la couronne de Julie. L’important serait de deviner dès à présent parmi tant de débuts, dont quelques-uns déjà ont déguisé leur date, le signe radieux de Lafontaine, de Molière, de Corneille ou de Bossuet ; nous sommes forcés de l’avouer malheureusement, ces noms se cachent jusqu’ici avec assez de précaution dans la traduction de l’Eunuque de Térence, dans les Frères ennemis, dans la Jalousie du Barbouillé ou dans la Réfutation du catéchisme de Paul Ferri. Allumons notre lanterne et cherchons cependant, cherchons avec ardeur ; et, si par impossible nous nous trompions en tournant à faux notre lentille dans les obscurités opaques, que l’on se souvienne que nous n’avons qu’une lanterne dont la clarté ne peut rien féconder, et que nous cherchons en vain aussi pour rayonner sur toutes les gloires le soleil de Louis XIV.
Nous ne parlerons dans ce livre que des écrivains nouveaux qui font sans découragement de la littérature vraie, ne choisissant parmi ceux-là même que ceux qui s’appliquent particulièrement à la poésie, au roman ou à l’histoire, et je n’ai pas la prétention de les nommer tous. Quelques autres, que j’omets, mériteraient sans doute mieux qu’une page blanche ; j’aime mieux les taire que d’agir à leur égard comme les catalogues de peinture envers les peintres. Je suis loin, d’ailleurs, de regarder ce livre comme complet ; ma seule ambition serait d’en provoquer d’autres du même genre et d’appeler sérieusement la critique sur des œuvres qui retiennent peut-être encore dans l’œuf des réputations prêtes à éclore. Jetez ces fleurs d’Amérique qui ressemblent à de grosses roses sans parfums dans une cave sans jour, vous n’obtiendrez de la germination que de très laids tubercules ; exposez-les à la lumière, leur sève, épanouie en feuilles de toutes les couleurs, mènera le carnaval de l’été.
Parmi les hommes déjà connus, sans être au premier rang, dont j’aurais aimé à marquer les succès obtenus et à activer les promesses, je nommerai cependant M. Paul de Molènes, chevalier et romancier, et tenant aussi bien son épée que sa plume, mérite que l’on voudrait vanter plus souvent dans le monde des gens de lettres.
Parmi d’autres, que nous espérons ne pas voir perdus sans retour, il est par-dessus tous un poète qui a eu cette rare fortune, en récitant parfois pour lui seul ou quelques amis de la grande poésie, d’obtenir presque une renommée sans publier un seul vers ; ce poète, qui a écrit à l’occasion d’une exposition du Louvre tout un catéchisme de la peinture moderne, est M. Charles Baudelaire ; puisse-t-il, poète redevenu et resté, occuper le premier critique qui recommencera l’œuvre que je vais tenter.
À côté des poètes purs, des romanciers et des historiens, se présente une armée nouvelle, et qui, depuis quelques années, s’est recrutée de forces vives et d’espérances vaillantes : c’est l’armée des écrivains et des poètes dramatiques ; il y a dans les noms dont nous allons passer la revue rapide tout un livre à écrire, livre d’initiative, presque dictatorial, et qui pourrait mettre pour quelque temps l’auteur en tête des évolutions changeantes de cette partie de la littérature. Beaucoup des jeunes écrivains dramatiques ne manquent ni de courage, ni de qualités instinctives ; mais ce sont des gardes nationaux dont il faut faire de la troupe de ligne.
En attendant qu’il nous sourie d’en dresser plus scrupuleusement les cadres supérieurs, nommons quelques-uns de ceux qui ont déjà gagné des grades ; ce sera le coup d’œil de la princesse d’Antioche. Godefroy de Bouillon et Renaud laisseront seuls encore pressentir ce qu’ils peuvent devenir un jour.
Au milieu, et le plus en évidence, s’avance Émile Augier, le poète sage et actif, le maître à peu près reconnu aujourd’hui parmi les jeunes gens de la comédie littéraire ; puis aux meilleures places de cette armée sans grande discipline, on remarque Ponsard, le capitaine tragique autour de qui, chances des plus heureuses, se sont, dans un temps, données deux ou trois batailles diversement gagnées ou perdues, et que l’on accepte à peu près définitivement sur le champ laissé libre par Casimir Delavigne ; Armand Barthet, le déterminé compagnon que j’ai vu un jour marcher à l’assaut d’une comédie comme au feu d’une redoute ; Michel Carré, qui a patiemment traduit l’Eunuque de Térence dans une langue assez vieillie pour laisser dans l’oreille un arrière son du dix-septième siècle. M. Jules Barbier, le poète, plein de fougue improvisatrice, qui a écrit quelque part cette phrase de fière augure : « J’accepte avec reconnaissance les louanges comme les leçons de la critique, et je me reconnais volontiers son homme-lige en tout ce qui est du ressort de l’art et du langage ; » M. Octave Feuillet qui, en dehors même du théâtre où il a heureusement paru, a publié un si remarquable recueil de proverbes ; MM. Ernest Serret, Camille Doucet, Jules Lorrain, etc.
Il y aurait lieu d’examiner sous quels caractères s’annonce la jeune poésie dramatique encore tâtonnante et pleine d’hésitation ; la question ne serait pas déplacée de fixer enfin jusqu’à quel point, je ne dis pas le lyrisme, mis hors de cause par quelques pièces de M. Hugo, mais ce mécanisme mesquinement compliqué, d’une école lyrique plus jeune, quoique déjà bien décrépite, sinon morte, aurait droit d’entrée au théâtre ; nous voulons parler de ces emprunts laborieux à la musique et à la sculpture, qui tendraient à transporter les curiosités d’une villanelle et les ciselures d’un sonnet dans la rapidité d’une réplique ou dans l’ampleur d’une période. Déplacement impossible qui, au lieu de faire frémir dans le vers l’âme des grands compositeurs et des grands sculpteurs, ne réussirait qu’à mettre en relief les habiletés de main d’un premier violon ou d’un orfèvre renommé.
Je n’ai jamais entendu qu’une seule fois ces précieux dilettantismes essayés et applaudis au théâtre, et c’était dans un sonnet de M. Mürger, improvisé par le poète de sa Vie de Bohême ; eh bien ! je n’hésite pas à déclarer qu’une pièce écrite d’un bout à l’autre avec ces soins curieux et savants, très à leur place, sans doute, dans les quatorze vers de M. Mürger, fatiguerait indubitablement et n’obtiendrait que deux genres de succès, qui ne sont nullement dans les conditions générales du théâtre, succès laborieux d’étonnement pour la partie lettrée du public, succès d’étude circonspecte pour les hommes qui pratiquent le métier.
Question complexe cependant et qu’il ne faudrait pas résoudre entièrement au profit des sots de tous les étages en littérature, qui n’ont jamais soupçonné rien des adresses inépuisables de l’art.
L’auteur des Poètes Vivants, pour revenir aux idées soulevées par le jeune critique dont nous reconnaissons l’initiative un peu timide dans le projet que nous allons poursuivre, a eu tort, d’ailleurs, d’affirmer que la poésie contemporaine n’avait pu encore s’acclimater au théâtre et s’y jouer à l’aise dans toute l’étendue de son magnifique clavier.
Que signifie cette condamnation, le livre et les portraits étant donnés ?
Est-ce que M. de Lamartine, sans trop se préoccuper de l’éducation actuelle du public, – on le prouverait au besoin, – n’a pas versé tout ce qu’il a pu de la grande musique à larges ondulations de ses vers dans Toussaint-Louverture ? Est-ce que M. de Musset, rompu dans son originalité à tous les secrets des ateliers modernes, n’a pas un beau jour, sans l’avoir espéré peut-être, entendu applaudir sur la scène la plus pudibonde et la plus rigide les indépendances les plus osées de sa prose ? Ce n’est pas au vers qu’il faut s’en prendre si les contes d’Espagne et d’Italie n’ont pu jouir encore de la même faveur ; quant à Louison, plus sagement écrite et plus soumise à l’étiquette, ce n’est qu’un très joli accident dans la vie de l’auteur. Est-ce que l’auteur du poème de Rodrigue, M. Émile Deschamps, a perdu quelque chose de l’adroite flexibilité de son vers toujours rectifié par la rime, dans ses deux tragédies, Macbeth et Roméo ? Est-ce que le doux poète d’Eloa et de Dolorida, M. de Vigny, n’a pas au contraire gagné en hardiesse dans Othello et dans le Marchand de Venise ?
Le Tricorne enchanté et les Prologues de M. Gautier ne sont que de trop rapides et légères drôleries et fantaisies ; mais pour finir par le plus haut des poètes du théâtre, est-ce que M. Hugo n’a pas toujours transporté sur la scène, et très souvent admirablement, les procédés lyriques et plastiques de sa poésie. Nous ne pensons pas que l’on accuse M. Hugo de modération ni de moyen terme dans ses tentatives d’aucun genre. Essayer dans les voies du lyrisme plus qu’il n’a fait eut été méconnaître toutes les lois qui séparent la poésie pure, l’élégie, l’ode ou l’hymne, du langage dramatique qui peut bien vivre de poésie, mais non s’absorber dans la strophe.
Donc, de deux choses l’une : ou l’affirmation de M. Desplaces s’applique à ces écrivains dont il s’occupe particulièrement, et rien n’est plus faux dans ce cas ; ou elle s’applique aux jeunes écrivains dont il n’a pas parlé, et je cherche en vain le sens qu’elle déguise.
Un livre sur les promesses actuelles de la poésie au théâtre est donc encore à faire, et c’est parce que j’en ai remis l’étude et la tentative à plus tard, que j’ai cru devoir d’abord jeter ces quelques points de vue, étrangers aux horizons circonscrits de cette brochure.
Nous nous en tiendrons donc aux écrivains qui se sont annoncés jusqu’ici en dehors du théâtre.
Cette première série de critiques sera divisée en deux parties : la première ne renfermera que des appréciations pures ; la seconde sera composée d’épîtres dans lesquelles l’éloge et le blâme prendront de plus franches coudées dans une mesure toujours relativement juste, quoique moins rigoureuse au premier aspect.
M. Gustave Le Vavasseur a publié quatre volumes : Vie de Pierre Corneille, Poésies fugitives, Farces et Moralités, enfin Dix mois de Révolution. Poète avant d’être biographe et critique, M. Le Vavasseur n’en a pas moins débuté comme s’il était né sous le tiède soleil de l’érudition.
On était au lendemain du succès de Lucrèce ; le quartier général avoué des meneurs était dans un coin d’estaminet, caché un peu avant l’angle de la rue Molière et de la rue de Vaugirard, sous la maison même de Jules Janin. Pendant que le critique expérimenté souriait en haut de l’œil d’un homme qui regarde une émeute qui passe, la jeunesse emportée, – était-ce bien toujours seulement la jeunesse ? – verdissait de colère en bas et brisait d’enthousiasme les tables du lieu. L’estaminet Tabourey s’emplissait chaque soir des amis de l’auteur d’abord, puis de ceux qui aspiraient à en être, – cela n’est pas une raillerie, – enfin des curieux qu’attirait la réputation de cet athénée, où l’on pouvait fumer, boire de la bière et apprendre la littérature ; ces derniers, il faut le dire, étaient du premier coup prévenus favorablement en faveur d’un homme qui n’eut certes su comment se retourner dans la maison de Socrate. L’auteur de Lucrèce n’y pouvait plus suffire ; quelques mois de ces ovations l’eussent réduit à l’état muet de fétiche. Les intrépides qui avaient pu saisir au vol quelques phrases de Lucrèce en récitaient des lambeaux ; les plus timides dissertaient. Il fallait voir comme on traitait dans ces comices les Burgraves de M. Hugo, joués vers ce temps ; jamais leur terrible empereur Frédéric Barbe-Rousse ne les avait étranglés avec de plus durs carcans.
Mais le côté burlesque à part, et pour quiconque y regardait de plus près, cet enthousiaste tohu-bohu, cette hardiesse sans expérience prenait un caractère sérieux d’une toute autre portée. C’était la manifestation d’un mouvement littéraire très justifiable, une aspiration d’instinct, un retour par-dessus nos dernières littératures, par-dessus même la tête du régent et de Louis XV, vers la littérature et l’esprit du grand siècle ; mais là comme partout l’exagération gâtait la cause : après avoir opposé Lucrèce aux Burgraves, on n’allait rien moins qu’à mettre en regard les vers de M. Ponsard et ceux de Cinna et d’Horace. L’impiété du rapprochement n’épouvantait personne ; une certaine affectation de familiarité pouvait, il est vrai, amener dans l’esprit l’idée de Corneille, mais de Corneille réduit de la spontanéité du génie aux combinaisons de l’apprentissage, de l’art qui crée à la manière qui s’inspire.
Qu’on me pardonne ce tableau complaisant d’une insurrection oubliée aujourd’hui. C’était là un souvenir que je tenais à fixer dans ma mémoire comme tous les souvenirs qui s’éloignent, et j’ai été un des spectateurs les plus amusés de cette guerre tombée dans l’eau.
On conçoit cependant l’intérêt que pouvait avoir dans un semblable mouvement une histoire bien faite de la vie, ou pour mieux dire, des œuvres du grand Corneille. Appliquer à l’examen d’un poète dont on s’est peut-être occupé trop peu de notre temps, parce qu’il a toujours été mis hors de cause dans toutes nos querelles de coteries, les habitudes et les idées d’une critique plus avancée, instruite, elle aussi, par tant de révolutions, devenue impartiale à la suite de tant de creuses théories et ramenée à la vérité par cette sorte de scepticisme littéraire qui n’est ni l’indifférence, ni le découragement, mais qui repousse cette foi aveugle au progrès, cette religion d’un présent sans fécondité et sans puissance comme une des utopies les plus dangereuses du temps qui court, en littérature du moins ; retrouver dans le rude et mâle Corneille toutes ces sciences raffinées du vers, si scrupuleusement dissimulées par nos grands poètes du dix-septième siècle, tous ces calculs de rythme enfin, négligés beaucoup trop par le dix-huitième siècle et par l’empire, et que, par une restauration maladroite, nous avons peut-être à notre tour voulu mettre un peu trop en relief dans notre vers brisé, comme ces muscles dénudés dont le jeu trop visible nous choque dans ce que nous appelons des écorchés ; déguiser le précepte sous l’appréciation ; faire en quelque sorte à l’aide de Corneille un cours de littérature sage, modéré, actuel surtout dans la rigueur extrême du mot, plus actuel qu’un article de revue à propos d’un drame de Dumas ou de V. Hugo, telle a été l’intention de M. Le Vavasseur ; voyons l’exécution.
M. Le Vavasseur aborde franchement son sujet, point de considérations générales ou préliminaires, point d’introduction lourde et prétentieuse qui le plus souvent ne dénotent que l’inexpérience ou l’embarras du début, point de promesses exagérées, point de ces préfaces même qui cherchent à prouver beaucoup trop longuement, comme nous venons de le faire, l’opportunité d’une œuvre en la faisant ressortir comme une conséquence nécessaire du tableau convenablement disposé d’une époque. Une exposition rapide de l’état du théâtre en France, au moment où Pierre Corneille parut, nous transporte sans autre préambule dans le milieu littéraire que le grand homme eut à traverser d’abord et qu’il domina ensuite de toute la hauteur de son génie ; puis M. Le Vavasseur prend le poète à sa naissance en quelque sorte, à Mélite, et, sans s’arrêter à Clitandre, cette épigramme en cinq actes, comme il l’appelle, il nous le montre grandissant toujours à travers toutes ces pièces dont nous ne savons presque plus que les noms, tant l’oubli dévore même les choses les plus sacrées : la Veuve, la Galerie du Palais, la Suivante, la place Royale, Médée, l’Illusion comique. Cependant que de verve déjà dans toutes ces comédies, que d’énergie dans quelques-uns des vers de cette Médée, où Corneille, jeune encore, lutte avec Sénèque, comme plus tard il doit lutter avec Lucain dans la mort de Pompée.
Dans cette première période de développement, Corneille s’était trouvé trop malheureusement employé dans une officine littéraire fonctionnant sous les ordres et selon l’inspiration du cardinal, pour que M. Le Vavasseur ne se trouvât point forcé de donner quelques coups de crayon à la physionomie des cinq auteurs chargés d’ajuster aux plans de leur tout-puissant protecteur les produits trop uniformes de leurs cinq métiers. L’âpre, dur et laborieux Claude de l’Étoile, fils et petit-fils de présidents dont les Mémoires servent à l’histoire de Henri III, l’incrédule et joyeux abbé de Bois-Robert, le pauvre Guillaume Colletet, père de celui si bien vilipendé jusqu’à l’échine par Boileau, et enfin Rotrou, qui avec Corneille fait une exception pénible à considérer parmi toutes ces médiocrités désolantes, sont en quelques mots peints par M. Le Vavasseur avec leurs vanités et leur abaissement, avec les faiblesses et les besoins qui les attachaient au cardinal. Mieux qu’une froide dissertation déclamatoire, cette courte peinture du protectorat littéraire sous Louis XIII nous fait comprendre quels obstacles autres que ceux qu’opposent toujours au génie le goût d’une époque et la jalousie de ceux qui sont en possession de l’exploiter, quelles entraves d’idées et de convenances, de position et d’habitude, Corneille eut à briser pour demeurer tout simplement le grand Corneille.
Les querelles jalouses, les clameurs d’admiration qui s’élevèrent autour du grand homme à l’occasion du Cid, les poursuites du cardinal, les fanfaronnades de Scudéry, les critiques de l’Académie, le jugement de Chapelin sont tellement dans la mémoire de chacun, que ce chapitre du Cid eût été le plus périlleux de tous si M. Le Vavasseur ne s’était tiré d’affaire, chose difficile, en raffinant encore sur ses lecteurs d’érudition délicate et de fines remarques sur les remarques des critiques.
Le Cid a fourni de plus à M. le Vavasseur l’occasion de réhabiliter dans l’estime, sinon tout à fait dans la mémoire, ce pauvre du Ryer, si tristement oublié, et cependant si digne d’intérêt par l’austérité de sa vie, sa résignation stoïque et une certaine hauteur de sentiment qui lui fit faire une tragédie passable une fois dans sa vie. Du Ryer n’est pas le seul auteur au reste que M. Le Vavasseur ait cherché à venger du dédain d’une postérité injuste : l’abbé Perrin, le créateur du théâtre lyrique en France, l’auteur presqu’inconnu d’une traduction de l’Énéide trop oubliée, lui doit également cette sorte de reconnaissance posthume que doit la pièce de monnaie remise au jour au déterreur passionné qui cherche à retrouver son effigie sous la rouille. Et dans l’examen de la tragédie de Pompée, où l’imitation de quelques passages de Lucain mettent en pré-présence Corneille et Brébeuf, avec quelle minutie scrupuleuse M. Le Vavasseur ne cherche-t-il pas à faire ressortir les avantages opposés des deux rivaux ! Si bien même qu’en ce parallèle, curieux d’ailleurs entre l’imitation libre du poète et le calque forcé du traducteur, il nous a semblé pousser un peu loin la bienveillance en faveur du dernier.
Ces exhumations suffiraient pour nous faire juger de cet esprit amoureux de recherches, de cette passion un peu facile à s’éblouir des antiquaires, qui a présidé à cette longue étude sur tout ce qui touche de près ou de loin à Corneille ; revenir sur les arrêts injustes et par excès de zèle pousser parfois la justice en façon de représailles jusqu’au point où elle pourrait prendre un autre nom, porter en général cependant dans tous ses jugements cette bienveillance un peu large de toute critique non systématique ; mettre en saillie par de courtes citations l’esprit d’un auteur en ce qu’il a de bon ou de mauvais ; chercher la perle partout où elle se trouve, même dans Pertharite, telle a été la manière, tel a été le procédé suivi par M. Le Vavasseur, procédé obligatoire dans l’examen des écrivains de premier ordre, et dont l’absence choque parfois dans le plus célèbre des critiques du grand Corneille.
Depuis le Cid jusqu’à Théodore, M. Le Vavasseur n’a guère à enregistrer qu’une longue suite de chefs-d’œuvre, un long enchaînement de succès. Ce n’est qu’à force de goût, de finesse et d’esprit, d’érudition et de style, que l’on peut trouver moyen de varier l’éloge à l’infini ; qu’on nous permette donc de ne point suivre l’auteur sur ce terrain. Que pourrions-nous dire d’ailleurs ? Est-il quelqu’un qui, grâce aux Œuvres choisies, cette détestable mutilation que font souffrir à tous les grands écrivains les caprices et le goût des éditeurs, ne nous ait devancé dans ce travail sur chacune des créations de Corneille pendant cette première période de force et de puissance ?
Après Théodore, ce premier échec, Héraclius devient dans le chapitre qui lui est consacré l’occasion d’une comparaison curieuse entre Diego Calderon de la Barca et Corneille, comme le Cid l’avait été d’un rapprochement entre notre poète et Ghilen de Castro, comme enfin le Menteur et la suite du Menteur eussent pu en amener un entre ces deux pièces et celles de Juan d’Alarcon et de Lopez de Vega, si d’ailleurs la faiblesse comparative des originaux n’eût tué tout parallèle.
La dernière période, celle où le génie de Corneille semble baisser, fournit à M. Le Vavasseur de nombreux sujets de lutte, de généreuses indignations contre les critiques méticuleuses de Voltaire, et, ce qui vaut mieux, de charmantes trouvailles de vers pour ceux qui n’ont jamais lu le poète d’un bout à l’autre.
La tragédie d’Othon, ce tableau si fidèlement effrayant de la cour des empereurs romains ; Sertorius, cet effort inconnu de Corneille faiblissant, qui arracha un cri d’admiration au grand Condé, et qu’une scène admirable entre Sertorius et Pompée fait encore citer dans les collèges ; Nicomède, Pulchérie, Attila même, en dépit de l’épigramme de Boileau, ont été pour M. Le Vavasseur des mines respectables dont il a religieusement suivi les riches filons sous le schiste et l’argile.
Voici du reste par quelle comparaison ingénieuse du poète et de ses héros M. Le Vavasseur lui-même relève cette période de décadence.
« L’auteur des Horaces, à la fin de sa carrière dramatique, prit pour héros le dernier des républicains de Rome, comme au début de sa carrière il avait pris un des héros de cet empire au berceau. Horace est le génie naissant, le courage aveugle qui lutte par la force et la ruse contre tous ses ennemis, parfois brutal, mais confiant en sa vertu et en son origine : il descend d’un père qui a prononcé le fameux qu’il mourût, et condamné par les duumvirs, il en appelle au peuple. Sertorius, c’est toujours le génie, mais le génie qui s’étonne qu’après de telles conquêtes et des jours glorieux le peuple ne soit plus l’austère conquérant des premiers âges et dont la vertu proteste contre cette décadence. Entre Horace et Sertorius, il y a toute la République romaine comme toute la gloire de Corneille. »
M. Le Vavasseur se complaît dans ces dernières campagnes de son poète. Là est le véritable terrain de sa critique, là il se trouve à l’aise, et où d’autres ne verraient qu’un labyrinthe décourageant, il s’avance d’un pas toujours sûr et par le meilleur sentier, s’arrêtant à tous les carrefours, plongeant par toutes les avenues dans le génie de Corneille, et partout nous signalant du doigt la pousse verdoyante sur l’arbre à demi dépouillé par le temps, la tige vivace sous les herbes desséchées par l’hiver. C’est ainsi que dans Psyché, cette œuvre charmante due à la collaboration des deux plus grands poètes du dix-septième siècle, nous découvrons avec lui tout ce qu’il y avait de délicatesse souple et de grâce facile dans l’âme austère et fortement trempée du grave Corneille ; c’est ainsi que dans la traduction des Psaumes et dans celle de l’Imitation de J.-C., il établit par d’ingénieux rapprochements de style, par d’adroites comparaisons entre Malherbe, Boileau, Lafontaine, Brébeuf, J.-B. Rousseau et Corneille, l’universalité de ce dernier, sa facilité à prendre tous les tons, et l’élévation, sinon la supériorité de son génie dans tous les genres. Il faut voir avec quel regret M. Le Vavasseur se plaint de n’avoir pu trouver sur le même terrain Corneille et Claude de Malleville, célèbre alors par ses paraphrases des psaumes, pour comprendre l’importance attachée par l’auteur à ces parallèles délicats, où le génie se trouve contrôlé par le génie.
Nous ne reprocherons même à M. Le Vavasseur qu’un certain abus de perspicacité, une certaine prétention à deviner le dessous des cartes, qui lui fait trouver la raison des choses dans les causes les plus minimes, ce qui, vu les petitesses du cœur humain, peut être une excellente manière de raisonner, mais ce qui engage quelquefois hors des limites de la vraisemblance ; c’est ainsi qu’il croit pouvoir expliquer par la haine des jésuites la préférence que Voltaire, dans sa partialité outrée, accordait le plus souvent à Racine sur Corneille, Corneille ayant été élevé par eux, et Racine appartenant à Port-Royal ; c’est ainsi encore que dans un parallèle naturellement amené par Tite et Bérénice, il explique l’influence diverse de Mélite et de la Champmêlé sur les deux poètes.
« Mélite et la Champmêlé, dit-il, ont été toutes deux les causes occasionnelles qui ont développé, l’une le génie de Corneille, l’autre le génie de Racine, mais d’une façon différente. Qu’on n’objecte pas que Mélite était honnête fille et que Marie Desmarest était une comédienne ; Corneille n’était pas né pour marcher heureusement entre les fils d’une intrigue, et, pour caractériser d’un mot ma pensée, avec tout le respect que je dois aux exemples admirables de vertu et à la parfaite régularité de nos deux grands auteurs classiques, Corneille aurait pu être débauché, Racine libertin. »
M. Sainte-Beuve a quelquefois un peu abusé dans les derniers temps de ces finesses de divination rétrospective qui transportent dans la critique les amusements du roman.
Nous ajouterons pour compléter la part du blâme que les cent premières pages du volume demanderaient à être retouchées. On y sent quelque hésitation de la part de l’auteur, l’absence du métier pour la prose ; de mauvais mots, de mauvaises façons de parler y reparaissent fréquemment : notre héros pour Corneille, en ce temps-là vivait, etc.
Cela dit, et pour parfaire l’idée du travail de M. Le Vavasseur, nous devons remarquer que le Corneille qu’il étudie n’est pas seulement celui du Cid et de Cinna, mais aussi celui des poésies diverses, des psaumes, des hymnes, du poème de Saint-Bonaventure, et de l’Imitation. L’étude, on le voit, a pris le contre-pied des œuvres choisies. Cet autre Corneille, si on l’examine, et ici nous empruntons les paroles mêmes de M. Le Vavasseur, a souvent une figure aussi noble et aussi hardie que le premier ; il semble de plus avoir le don d’être universel ; moins collet monté quelquefois, moins fier avec ses auditeurs, il passe avec bonheur du madrigal au sonnet et manie avec la même perfection toute espèce de strophe. Le Corneille qu’on connaît communément est entier, coulé en bronze, d’un seul jet, sans faute ; il est si grand qu’il imprime le respect et qu’on n’ose l’aborder ; le Corneille que M. Le Vavasseur prend à cœur de faire examiner, souvent sévère et grand comme l’autre, parfois enjoué et observateur, semble de temps en temps se pencher sur son piédestal et sourire. Alors il vous apparaît si bonhomme, si rond et si honnête, que vous prendriez avec bonheur sa main, défendue encore par le respect, mais non plus par la crainte.
Nous voici bien loin de l’estaminet Tabourey et des querelles de l’école du bon sens comme on avait la sottise de dire alors ; nous n’y reviendrons pas.





























