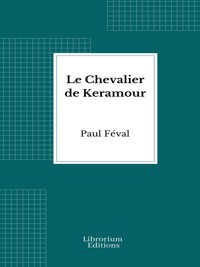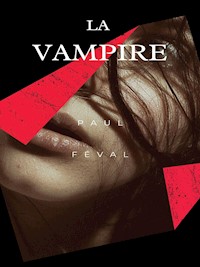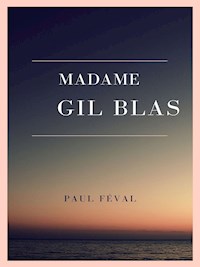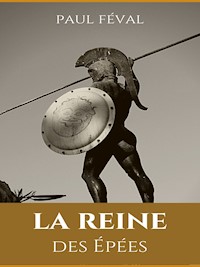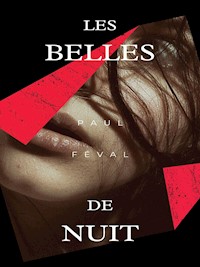Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Depuis quelques jours je remets sans cesse à vous écrire. J'attendais le dénouement d'une romanesque aventure dont je suis le héros, pour vous la raconter en détail. Le dénouement est venu ; je n'ai pas lieu d'en être très fier : néanmoins je ne m'en plains pas. Il m'est arrivé, comme à tous, et vous le savez mieux que personne, vous dont j'ai fatigué la patiente amitié à force de confidences, il m'est arrivé de subir en amour de cruels désappointements."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Madame et chère amie,
Je ne sais pas qui j’aime le mieux de vous ou du maître charmant dont vous êtes le cœur. Me voilà changeant de chemin, sur le tard, à l’heure marquée pour le repos, et je crois que j’irai très loin sur cette autre route.
À la veille d’un grand voyage, entrepris sans idée de retour, l’habitude est de laisser aux siens un souvenir. J’ai voulu vous trier quelques feuillets dans la montagne des papiers anciennement noircis par moi, mais il y en a tant et tant, que je m’y serais perdu si la pensée ne m’était venue de faire mon bouquet avec une douzaine de bonnes consciences.
Mettez cela dans un coin et ne m’oubliez pas.
Paul Féval.
15 Janvier 1877.
Le tour du monde en cinq lettres
Depuis quelques jours je remets sans cesse à vous écrire. J’attendais le dénouement d’une romanesque aventure dont je suis le héros, pour vous la raconter en détail. Le dénouement est venu ; je n’ai pas lieu d’en être très fier : néanmoins je ne m’en plains pas. Il m’est arrivé, comme à tous, et vous le savez mieux que personne, vous dont j’ai fatigué la patiente amitié à force de confidences, il m’est arrivé de subir en amour de cruels désappointements. Leur souvenir est resté vif en moi ; quand j’y songe, j’éprouve encore une sorte de ressentiment mêlé de dépit, de honte et de souffrance : la mémoire est si fidèle à garder ouvert son livre aux pages qu’on voudrait en arracher ! Mais cette fois ma chute a été si doucement ménagée, j’ai trouvé à ma déconvenue une si aimable consolation, que, en définitive, le dépit a eu tort.
Je suis content, j’ai sujet de l’être ; je tremble presque en songeant que mon aventure eût pu se terminer autrement. Ne croyez pas au moins que ceci soit une fanfaronnade de vaincu. En amour surtout, la fable le Renard et les Raisins a son application, je le sais, mais je parle fort sérieusement ; vous allez me comprendre. Qu’eût été le succès ? Lady Wolsley est une charmante femme, belle et jolie à la fois, gracieuse d’esprit, bonne de cœur ; une plus aimable amie ne se trouverait point.
Mais qu’eût été le succès ? une ivresse d’un jour, un bonheur quelque peu plus long, puis… vous savez, Charles, ce qui vient après. Nous sommes ainsi faits, vous, moi, et beaucoup d’autres encore.
Ici, je veux le croire sincèrement, le bonheur aurait eu la plus longue durée possible, mais son terme serait venu trop tôt ou trop tard. Je n’y puis penser sans amertume ; cette femme, que je vois présentement si parfaite, aurait été pour moi, dans un temps donné, une femme semblable à toute autre ; moins que cela, un banal souvenir. Mon échec n’aurait-il eu pour résultat que de prévenir ce désenchantement, je le bénirais encore. Mais ne vous hâtez pas de rire ; mon échec a fait mieux : il m’a donné une sœur.
Je crois vous entendre : « Toutes les sœurs de ce genre sont des sœurs aînées ; cette ravissante lady a-t-elle donc passé la quarantaine ? » Mon Dieu, non. Elle a vingt ans, je pense, ou quelque chose de moins. Vous hochez la tête avec cet air incrédule qui m’a mis souvent en fureur. À votre aise, Charles, vous avez le droit de ne me point croire ; mais, je vous le dis en conscience, je resterai son ami, rien que cela, ou plutôt tout autant que cela. Telle est ma ferme volonté.
Je n’ai point eu de sœur jusqu’ici. À vrai dire, je ne m’étais senti aucune envie d’en avoir, car j’admettais difficilement la pure amitié entre un jeune homme et une jolie femme, à moins que ce ne fût cette amitié bâtarde, reste d’un amour refroidi, qui se noue de raccroc au moment où s’éteint la passion ; de celle-là je ne voulais pas. Lady Wolsley m’a fait comprendre qu’il est une autre sorte d’amitié, noble, suave, solide et pleine de charme. Je ne disserterai point sur ce sentiment nouveau ; quand vous aurez fait l’acquisition d’une sœur comme lady Wolsley, nous nous entendrons à merveille, et il sera temps de causer.
Où pensez-vous que je sois ? À Londres ? Ce nom de lady Wolsley vous induit en erreur et vous êtes loin de compte. Elle est Suédoise de naissance. À Stockholm, donc ? Du tout. Je suis à Dinan, petite sous-préfecture du département des Côtes-du-Nord. Mon grand voyage autour du monde est, comme vous voyez, encore à son début. Mais, patience ! il ne s’agit que de faire le premier pas. Une fois parti, je veux courir quinze cents lieues tout d’une piste.
Je suis arrivé ici vers le commencement du mois dernier, un soir, et je comptais prendre dès le lendemain le bateau à vapeur de Jersey. Le hasard en a décidé autrement.
Fatigué de mes quinze heures de chemin de fer, je descendis vers la Rance, rivière qui, à Dinan, est large comme le canal de l’Ourcq, et qui, deux lieues plus loin, atteint les proportions de la Loire. Je me promenai longtemps ; je songeais à vous, Charles. La lune, qui se cachait derrière les tours du château, dessinait leurs profils gothiques, et, me laissant dans l’ombre, éclairait la ville au-dessus de moi : au-dessous, j’avais les riches bords de la Rance. Votre crayon eût trouvé là un croquis et votre âme une rêverie. Moi, je me demandais à quoi bon quitter la France, si belle et si aimée ! je la regrettais par anticipation, je sentais comme un avant-goût de l’exil ; et pourtant l’idée ne me venait point de renoncer à mon long voyage.
Je n’ai que vous au monde pour m’aimer, Charles, et vous m’avez promis, en quelque lieu que je sois, de venir me rejoindre quand vos affaires seront réglées. Dieu nous a faits orphelins tous les deux ; pour nous qui n’avons point connu les joies de la famille, la vie sédentaire serait une longue série de jours d’ennui. Ce qu’il nous faut, c’est le changement qui étourdit sans cesse, les amitiés de passage si imprévues, si cordiales et si vite dénouées, les excursions vagabondes, les brusques et courtes amours. Autrefois vous parliez de mariage ; heureusement je vous vois converti : prendre femme, vous ou moi, ce serait mentir à notre destinée.
L’heure sonna, non pas au vieux beffroi du château, qui est muet depuis des siècles, mais à une simple pendule. J’étais assis à une centaine de pas de la rivière ; le timbre retentit si près de moi, que je me levai en sursaut. Perdu dans ma rêverie, je m’étais reposé par hasard sur un talus recouvert de gazon et couronné d’une haie vive, derrière laquelle s’élevait une jolie maison.
Une seule chambre y était éclairée. Dans cette chambre, debout et ne me montrant que son joli visage, une enfant de seize ans se tenait immobile. Elle semblait me regarder, et je n’osais faire un mouvement ; je craignais de voir se fermer ce bel œil bleu si tendre, si rêveur. Deux minutes se passèrent ; l’enfant ne bougeait pas et regardait toujours. Enfin la lumière s’éteignit, emportant avec elle la charmante vision. Je repris le chemin de la ville. Mon esprit était resté près de la jeune fille. Pourquoi avait-elle regardé de mon côté avec cette persistance ? Le bon sens me disait qu’elle n’avait pu m’apercevoir, placé comme j’étais dans l’ombre ; mais croit-on le bon sens ? Peut-être un rayon de lune avait glissé jusqu’à moi ; peut-être…
– Au secours ! dit en anglais une voix étouffé. J’étais alors au bas du Jerzual, long précipice bordé de maisons qui joint la vallée à la ville haute. Ce Jerzual, très positivement, a été pavé du temps des druides. Ce sont partout des quartiers de roche anguleux et jetés au hasard ; entre chaque pierre un trou de capacité variable contient de l’eau croupissante, de telle sorte que les pavés sont autant d’îles montrant leurs têtes aiguës au centre d’un océan de fange. Joignez à cela une pente abrupte, inégale et si perfidement ménagée, qu’il semble qu’une homicide influence ait présidé autrefois à la construction de la route ; placez çà et là, sur les côtés, des masures de forme invraisemblable, séparées par des broussailles qui font de chaque fossé une chausse-trape ; à l’aide de cet effort d’imagination, vous aurez une idée trop avantageuse encore du principal faubourg de Dinan.
Le cri partait d’une douve assez profonde ; je m’approchai avec empressement et je vis un vieillard, à demi noyé dans la vase, faisant des efforts désespérés pour débarrasser ses membres d’un écheveau de courroies et de harnais. Près de lui était un tilbury brisé ; un peu plus loin un fort beau cheval rendait le dernier soupir. Dès que le vieillard fut hors de peine, son premier soin fut d’examiner scrupuleusement le tilbury. Peu satisfait de ce côté, il se dirigea en boitant vers le cheval, qui, moins heureux que son maître, avait, en tombant, heurté un rocher ; pendant deux ou trois minutes, il palpa dans tous les sens le cadavre du pauvre animal ; cela fait, il laissa échapper une exclamation chagrine, me salua sans me regarder et s’éloigna en silence. L’apparence de ce vieux gentleman était chétive et souffreteuse ; sa physionomie, où l’orgueil britannique se lisait affiché en gros caractères, ne laissait pas que d’exprimer une certaine bonhomie. Je le suivis de l’œil, et, voyant qu’il avait grand-peine à surmonter les obstacles de la route, je crus qu’il était de mon devoir de l’accompagner. Nous marchions côte à côte ; l’Anglais ne faisait nulle attention à moi, il souffrait, se plaignait et boitait de plus en plus. Néanmoins, il fallut que je lui fisse formellement offre de mon bras pour qu’il se déterminât à jeter un regard de mon côté.
Il s’arrêta, montra sa jambe d’un geste piteux, souleva son chapeau et passa son bras sous le mien ; après cette preuve de confiance, il reprit sa route. Au bout d’un demi-quart de lieue nous arrivâmes à la grille d’une villa isolée.
– Monsieur, me dit-il alors en assez bon français, je vous souhaite la bonne nuit.
À ces mots, il se découvrit une seconde fois et me tourna le dos sans autre cérémonie. J’ai pu reconnaître depuis que ce froid compliment était, eu égard au personnage, une action de grâces en forme. Il y a cinq semaines que je vois lord Wolsley chaque jour, et jamais je ne l’entendis prononcer une aussi longue phrase.
Il ne me restait plus qu’à me retirer ; mais, au moment où je reprenais la montée, regrettant presque ma compassion si mal placée, je jetai un coup d’œil sur la maison de l’incivil étranger ; la lune avait tourné les ruines du château, elle éclairait maintenant le pied de la colline. Je reconnus le talus qui m’avait servi de fauteuil ; en même temps, la porte s’ouvrit, et, derrière un domestique en livrée, ma gracieuse vision se montra. En trois sauts j’atteignis le seuil.
– Monsieur, dis-je à l’Anglais, vous êtes blessé : ma qualité de docteur-médecin me fait un devoir de ne point vous laisser sans secours.
– Blessé ! répéta lady Wolsley en jetant sur son mari un regard d’inquiétude affectueuse.
Je ne puis vous rendre, Charles, tout ce qu’il y avait de douce compassion et de tendresse filiale dans la voix de la jeune femme. En la voyant de plus près, j’avais dû reconnaître mon erreur : lady Wolsley n’était point l’enfant que j’avais aperçue ce même soir à travers la fenêtre entrouverte ; elle avait quatre ou cinq ans de plus que ma vision, qui, à coup sûr, devait être sa jeune sœur. Toutes les deux, du reste, sont également belles ; je sentais déjà que j’aimerais l’une ou l’autre, et ne prenais point souci de me demander laquelle.
Lord Wolsley souleva son chapeau, comme c’est son habitude en toutes circonstances, et regarda la porte d’un air suffisamment significatif ; mais sa femme le prévint, et, me saluant avec grâce, elle me pria de passer au salon.
À ce propos, Charles, je vous sommerai de convenir avec moi que le diplôme de docteur est un incomparable talisman. Si don Juan, notre seigneur, existait encore au dix-neuvième siècle, il suivrait assurément les cours de la clinique, afin de se procurer cette feuille de parchemin qui est la clef infaillible et magique des contes orientaux. Votre pinceau est bien aussi un passe-partout recommandable ; mais le diplôme, Charles, le diplôme ! Souvenez-vous de Figaro, et pensez que ce glorieux fourbe n’était qu’un simple frater.
Lord Wolsley avait une très belle entorse. Je posai le Premier appareil, et pris congé en disant que, ne voulant point aller sur les brisées du médecin de milord je reviendrais seulement m’informer de l’état de sa santé.
Le vieux gentleman fit signe à sa femme de s’approcher ; ils eurent ensemble une courte conversation en anglais : croyant que j’ignorais cette langue, lord Wolsley ne se gênait pas. Il conclut en disant que, n’ayant plus de médecin depuis le départ de sir Thomas… (un nom saxon qui m’échappa), il valait autant me prendre pour le remplacer que d’introduire dans la maison deux Français au lieu d’un. Lady Wolsley fut chargée de m’apprendre le résultat de la conférence, ce qu’elle fit de la façon la plus aimable. Les motifs du choix m’importaient peu ; j’avais mes entrées au Vauvert, c’était tout ce qu’il me fallait.
Le Vauvert est le nom de la maison de lord Wolsley. Mon premier soin, en arrivant à Dinan, fut de prendre des informations sur ce nobleman. Tout le monde le connaissait, bien qu’il vécût seul avec sa femme et ne donnât à personne accès dans sa demeure. On me le désigna sous le sobriquet de l’homme du Jerzual ; je vous dirai dans un instant l’origine de ce surnom. Quant à ma jolie vision, dont je donnai pourtant un signalement minutieux, nul ne put me répondre d’une manière satisfaisante. Avais-je dormi sur le talus, et l’apparition était-elle donc un rêve ? Je l’aurais cru peut-être si l’image de lady Wolsley n’eût passé dans mon souvenir. C’étaient bien les mêmes traits, sauf la différence de l’âge. Ma vision existait ; seulement sa vie s’entourait de mystère. Ne me fallait-il pas soulever ce voile, et n’était-ce pas là un puissant motif pour rester à Dinan ? Mon grand voyage fut ajourné ; je m’endormis en songeant tantôt à l’enfant, tantôt à la femme.
– Ce sont deux sœurs, me disais-je. L’aînée est ravissante, la cadette le sera… Je l’aime.
À votre tour de me demander laquelle. – En vérité, Charles, je ne savais. Il y a pis : aujourd’hui, je ne le sais pas davantage. Pendant quelques jours, j’ai donné tous mes soins à lady Wolsley ; maintenant qu’elle n’est plus pour moi qu’une amie, je me reprends à songer à sa sœur. Mais concevez-vous ce mystère ? Depuis cinq semaines, je n’ai pas revu cette dernière une seule fois ; jamais, devant moi, on n’a prononcé son nom ou dit un mot qui pût avoir trait à elle. Pourtant le Vauvert n’a pas la tournure de ces sombres donjons où l’on emprisonnait autrefois les jeunes filles ; lady Wolsley, de son côté, ne me semblerait point une fort impitoyable geôlière.
Le lendemain, je fis ma seconde visite médicale. À dater de ce jour, je suis retourné chaque matin au Vauvert. Lord Wolsley, vieillard maladif et chagrin, m’a vu d’abord de mauvais œil, puis insensiblement il s’est habitué à ma présence. L’orgueil, chez lui, combat victorieusement la jalousie ; en outre, il a pour sa femme une confiance voisine du respect.
Son entorse est maintenant guérie ; il a acheté un nouveau tilbury et fait tout ce qu’il peut pour se rompre définitivement le cou sur le pavé du Jerzual ; il semble qu’il ait porté à ce damnable faubourg un défi à outrance. Les bourgeois de Dinan ont remarqué son bizarre entêtement et l’ont affublé de ce surnom que je vous ai dit. Faible et tremblotant, il ne souffre point qu’un groom tienne pour lui les rênes ; chaque soir je le rencontre seul, descendant la montagne au galop. Son frêle équipage bondit, craque et menace ruine à chaque tour de roue, mais lui reste impassible sur son double coussin, et jette en passant un provoquant regard à la douve où j’eus l’avantage de faire sa connaissance.
C’était hier que je comptais risquer mon premier pas sur le terrain de cette galanterie que les Anglaises appellent le flirt. Depuis huit jours que la santé de lord Wolsley lui permet de sortir, j’avançais pied à pied ; je croyais m’apercevoir à des signes non équivoques que je ne serais pas trop durement éconduit. Notre tête-à-tête, qui s’était prolongé la veille beaucoup plus que d’habitude, m’avait paru prendre une tournure excellente. J’avais parlé cœur, vaguement et comme par hasard, il est vrai, mais la douce voix de lady Wolsley avait tremblé en me répondant. Elle aussi avait dit quelques mots sur ce sentiment, que je lui croyais inconnu, et j’avais deviné une souffrance sous la sereine tranquillité de son visage.
Vous savez, Charles, que je préfère aux incandescentes passions méridionales cette tendresse calme, constante, profondément sentie, que la commune croyance attribue volontiers aux femmes du nord. Je suivrais au bout de l’univers une blonde chevelure, tandis que l’éclat provoquant de deux beaux yeux noirs m’inspire à peine une éphémère fantaisie. Lady Wolsley semblait être pour moi cette femme que notre étoile nous choisit entre toutes ; je l’identifiais avec l’ange de mes rêveries passées ; c’était elle que, adolescent, j’avais vue en songe ; c’était son image devinée qui était venue plus tard me visiter aux heures de souffrance : nous étions unis dès longtemps par une attache mystique et providentielle.
Charles, n’avez-vous jamais divagué ainsi en vous-même, et cette longue phrase de roman vous fait-elle pitié ? Je le crains. À une âme de poète, vous joignez un esprit tant soit peu positif. En tout cas, je vous exhorte, si vous ne l’avez point fait encore, à vous élever jusqu’aux extatiques régions de l’idolâtrie chevaleresque. C’est charmant. Certains vous nommeront songe-creux : ne les écoutez pas, croyez-moi ; la raillerie, vous savez, est bien proche parente de l’impuissance.
J’arrivai au Vauvert dans de bonnes conditions d’éloquence et d’intrépidité ; lord Wolsley venait de sortir : tout me souriait. Je trouvai lady Wolsley seule, non pas au salon, mais dans une petite pièce où il ne m’avait point encore été permis de pénétrer, et qui ne ressemblait pas mal à un boudoir ; gracieux présage… Mais vous savez l’issue de cette bataille perdue, Charles ; à quoi bon vous faire languir ainsi ?
Je pris un siège, je l’approchai du fauteuil de lady Wolsley. Sans doute ma physionomie laissait transpirer quelque chose de mon présomptueux espoir, car elle me regarda d’un air surpris. Je ne tins compte de ce regard, et saisissant une main qu’on n’essaya point de me disputer, j’ouvris la bouche.
Ce fut lady Wolsley qui parla.
– Je souhaitais votre venue, me dit-elle ; hier, vous m’avez laissé voir votre cœur ; il est noble ; vous serez mon ami si vous voulez… Ne m’interrompez pas, ajouta-t-elle vivement, voyant que j’allais prendre la parole ; un mot de vous m’imposerait silence peut-être, et j’en aurais regret. Je veux vous confier un secret.
Ce début me troubla, et je demeurai fort embarrassé de ma contenance. Que croire en effet ? Était-ce le manège d’une coquette ? N’y avait-il pas dans cette manœuvre habile, qui prévenait l’assaut et déjouait tous mes calculs, une déplorable science du cœur masculin ? J’obéis néanmoins ; bon gré mal gré, je gardai le silence ; un mouvement involontaire fit même glisser mon siège sur le parquet, et je me trouvai à distance respectueuse de lady Wolsley.
Elle, au contraire, se pencha vers moi et me tendit sa main, que j’avais abandonnée dans mon trouble. Puis, après s’être recueillie un instant, elle commença son récit. Elle parla longtemps ; sa voix était calme, mais mélancolique. Que vous dirai-je ? ses yeux restèrent secs ; les miens, quand elle se tut, étaient remplis de larmes.
Je ne vous conterai point son histoire ; son secret n’est pas le mien. Qu’il vous suffise de savoir que, fille d’un marin suédois mort à Saint-Malo durant une relâche, restée seule, sans soutien, en butte aux insultants hommages de la jeunesse mal dorée du haut commerce, qui, repoussée avec dédain, se vengea par la calomnie, elle trouva dans lord Wolsley un généreux protecteur, puis un mari.
Cet Anglais est un digne homme, Charles. Naguère, je me surprenais parfois à désirer qu’il se brisât les côtes sur les pavés du Jerzual ; maintenant je fais amende honorable et lui souhaite du fond du cœur une multitude de prospérités.
Lady Wolsley avait cessé de parler que je l’écoutais encore. Elle me regarda quelque temps d’un air distrait.
– Jugez si je dois l’aimer ! dit-elle enfin. Je ne répondis point. Un sourire franc et affectueux vint se poser sur sa lèvre.
– M’avez-vous comprise ? demanda-t-elle.
– Je ne sais, balbutiai-je en soupirant comme un enfant.
– Moi je le crois ; nous sommes d’accord.
Je baisai gauchement la main qu’elle me tendait, et rompis l’entretien, ne pouvant trouver une parole.
Sur le Jerzual, je rencontrai lord Wolsley, dont le tilbury sautait comme une balle élastique ; il souleva son chapeau, et je crus démêler un sourire narquois entre les rides de son maigre visage. Mais que m’importe ce bonhomme ?
Oui, Charles, je l’ai comprise. J’avais été sur le point de lui dire ce qu’une femme ne peut entendre de la bouche d’un homme sans devenir coupable ou le chasser de sa présence. Elle m’a sauvé la faute pour n’avoir point à m’en punir. Elle a voulu que je la connusse telle qu’elle est, incapable de faillir et de plus gardée contre le mal par le respect, la tendresse et la reconnaissance qu’elle a pour lord Wolsley. Eh bien ! je l’aimerai comme elle veut que je l’aime ; je serai son ami. Aussi bien, si je ne puis m’habituer à ce rôle, rien ne m’empêche de partir demain, après-demain, quand je voudrai. Les voyages, mon ami, les voyages, voilà ma vocation ; je suis, comme le Juif Errant, condamné à marcher sans cesse. Dès que je m’arrête, il m’arrive malheur ; mais n’est-ce pas, Charles, que c’est une adorable femme ?
Savez-vous, Charles, que vous êtes très éloquent ! votre philippique contre le mariage me plaît tout à fait. J’aime à vous voir ces sentiments ; c’est moi qui vous ai inculqué cette haine ; vous êtes mon élève, et je dois reconnaître que vous avez puissamment profité. Tudieu ! quelle énergie ! à vous lire on vous prendrait pour un veuf éprouvé par toutes les calamités du ménage. Sérieusement, cette partie de votre lettre m’a donné de la joie. J’ai songé souvent avec tristesse qu’un jour peut-être une femme viendrait se mettre entre nous deux, une femme qui aurait le droit de réclamer la première place dans votre cœur : Hélas ! tant d’amitiés ont eu cette déplorable fin ! Mais votre style me rassure pleinement ; je suis désormais aussi sûr de vous que de moi, ce qui n’est pas peu dire. Nous pouvons nous donner la main : célibataires à perpétuité !
Changeons de style. Je suis amoureux, dites-vous, et cela vous donne à rire. D’abord, je pense que vous vous trompez ; mais, eussiez-vous deviné juste, l’évènement n’aurait rien en soi de particulièrement ridicule. J’ai vingt-six ans, et je rends grâce à Dieu tous les jours de n’être point blasé comme ces pauvres jeunes messieurs qui, à force de lire ce livre éternellement stupide dont le héros a perdu ses illusions avant sa majorité, ne demandent, pour clore leur existence désenchantée, qu’un revolver et trois lignes de réclame funèbre dans les échos d’un journal bien informé ; mon cœur est neuf et chaud ; c’est à peine si j’ai honte de l’avouer.
En outre, à ma connaissance, je ne suis ni bossu ni manchot ; pourquoi, s’il vous plaît, ne serais-je pas amoureux ? Et, si je l’étais réellement comme vous l’entendez, amoureux fou, c’est votre expression, qui m’empêcherait de vous l’avouer ?
Ce sont là, n’est-ce pas, de bien piètres arguments à opposer à mon séjour de deux longs mois dans un trou comme Dinan ? Me ferez-vous la grâce, vous, Charles, de me dire, dans votre réponse, ce que vous faites depuis trois ans à Pontoise ? S’il m’en souvient, lorsque nous nous séparâmes, vous deviez être de retour à Paris dans quinze jours, dans un mois tout au plus. Je veux penser que vos affaires vous auront retenu ; mais trois ans au lieu de trois semaines !… À Dieu ne plaise que, répondant à l’injure par l’outrage, je renvoie la qualification de trou à la cité de Pontoise ! je vous dirai seulement que l’ignorance vous rend souverainement injuste envers Dinan, qui, malgré son Jerzual, est bien la plus jolie ville qu’on puisse voir. Dinan est situé au centre d’un délicieux paysage ; il a des ruines gothiques, un bateau à vapeur et une source minérale. C’est le Baden-Baden de la Bretagne, ce bon pays tant et si bien exploité par la niaiserie littéraire, qu’on est tout étonné, quand on y vient de Paris, de trouver des aubergistes qui ne s’appellent ni Judicaël ni Cadwallon, et des jeunes demoiselles ne répondant point aux noms de Thiphaine ou de Margwynn. Dinan a, par soi, des charmes capables de fixer un touriste ; le Jerzual lui-même, que j’ai calomnié dans ma dernière lettre, forme de loin un remarquable point de vue ; et, à tout prendre, il n’est pas beaucoup plus mal pavé que la place du Carrousel. Vous voyez bien, Charles, que vous avez engagé l’escarmouche sur un terrain qui ne vous est pas favorable. Quand je serai resté trois ans à Dinan, si vous n’êtes plus vous-même à Pontoise, je me soumettrai de meilleure grâce à vos railleries. Adieu.
P.S. Vous m’engagez à poursuivre le récit de mon aventure ; j’ai peine à vous tenir rigueur ; en outre, je ne veux, sous aucun prétexte, autoriser votre réserve par l’exemple. Mon aventure a pris une face nouvelle. Si vous aviez mis des bornes à votre raillerie, je vous avouerais franchement que mon amitié pour lady Wolsley ressemble en effet un peu à de l’amour. Elle est si belle, si noble et si bonne ! Peut-être aurais-je à craindre près d’elle tous les dangers dont vous me faites complaisamment le compte, si je n’avais une sauvegarde ; mais trêve à votre compassion, je vous prie ; jamais je ne fus moins exposé à devenir fou de tendresse : je les aime toutes les deux…
Après cette entrevue dont le récit termine ma dernière lettre, je devins très malheureux. J’avais formellement résolu de respecter la volonté de lady Wolsley ; mais cet effort m’entraînait dans une préoccupation continuelle, qui, chaque jour, donnait à ma passion de nouvelles forces. Parfois je songeais à partir : n’était-ce pas là un souverain remède et une excellente occasion de commencer enfin mon voyage autour du monde ? Je restais néanmoins ; pour colorer à mes propres yeux cette faiblesse, je me disais qu’il y aurait lâcheté à fuir, que je n’étais pas de ceux dont la conduite peut dépendre du caprice d’une femme ; je me disais, enfin, mille autres raisons de cette force-là.
Ce pauvre lord Wolsley, qui n’a point encore été vaincu dans son duel à mort avec le Jerzual, contribuait lui-même à m’affermir dans ma détermination. J’avais cru remarquer que, depuis le fameux tête-à-tête, ma présence amenait un petit sourire sardonique sur son blême et triste visage. Du plus loin qu’il m’apercevait, il soulevait triomphalement son chapeau, et passait le front haut, comme s’il eût remporté sur moi quelque décisif avantage. C’en était trop, n’est-il pas vrai ? Si l’Anglais savait tout, sa femme avait joué le rôle d’une impitoyable et rusée coquette ; il ne fallait point leur donner à tous deux la joie de garder le champ de bataille.
Je restai donc, mais en brave. Je défendis à ma physionomie toute expression langoureuse ou mélancolique ; j’affectai un franc retour à mon insouciance première, et, pour ne point paraître désirer de secrètes entrevues, je représentai hautement à lord Wolsley le danger de ces fatigantes excursions qui ruinaient sa santé de plus en plus chancelante. Ceci était pur charlatanisme. Le Jerzual est pour le digne homme ce qu’est l’opium au mandarin, l’objet d’une incurable et mortelle passion. Le Jerzual le tuera en détail par la fatigue, ou tout d’un coup, en lui ménageant une accolade avec l’un de ses pavés les plus aigus. C’est là un fait hors de doute. En attendant, il combat vaillamment, crève par mois deux chevaux, et fait visiter tous les huit jours les roues de son tilbury. Si le Jerzual pouvait être vaincu dans cette lutte bizarre, je parierais pour lord Wolsley ; mais celui-ci s’épuise à vue d’œil, tandis que le faubourg dresse toujours à pic sa formidable rampe, qui semble narguer l’administration des ponts et chaussées et l’édilité dinannaise.
Mon stratagème eut un résultat inattendu. À mesure que ma gaieté revenait, celle de lady Wolsley disparaissait. Chaque jour, je la retrouvais plus triste que la veille. Ma vanité ne faillit point à tirer de ces symptômes le plus favorable augure. Je redoublai d’efforts, et parvins à prendre les allures d’un persifleur de moyen mérite. Je m’étais fait sceptique. Je déblatérais si platement contre toutes choses respectées, que je m’émerveillais moi-même. Lady Wolsley baissait les yeux ou me regardait étonnée ; elle ne me répondait point.
Un soir, au beau milieu d’une de mes tirades, je m’interrompis tout à coup et demeurai la bouche ouverte, interdit et vivement ému : j’avais cru voir une larme rouler sous sa paupière demi-baissée. Pour le coup, mon adresse était couronnée d’un plein succès. Le mystère s’éclairait ; cette larme expliquait tout. Lady Wolsley m’avait aimé tout d’abord ; c’était la crainte de faiblir qui l’avait poussée à cette manœuvre tant soit peu théâtrale et affectée, mais bien excusable dans la situation de la pauvre femme. Comme je la plaignais sincèrement ! que de clémence je trouvais dans mon cœur pour cette faute vénielle, rendue pour moi si flatteuse par ses motifs ! Oh ! je me repentais. Toutes ces paroles incisives, amères, pleines de doute et de sécheresse, que j’avais prononcées depuis quelques jours, me revenaient en mémoire, et je me trouvais un monstre de barbarie. Et ma victime était là, devant moi ; elle souffrait avec résignation et sans murmure ! Je sentais mes paupières sollicitées par mes larmes, qui demandaient impérieusement passage. Quel doux moment ! nous allions confondre nos pleurs.
Lady Wolsley, voyant que je ne poursuivais pas, releva sur moi son regard. Son œil était sec et n’exprimait qu’une froide et indifférente surprise, mêlée, je dois le dire, d’une légère dose de pitié.
Vous êtes-vous quelquefois confondu en excuses empressées vis-à-vis d’une personne qui vous laissait dire, ne sachant point ce dont il était question ? Avez-vous demandé à genoux pardon d’une offense, et reçu pour réponse ces mots navrants : « Je n’avais pas pris garde ? »
Si vous vous êtes jamais trouvé dans cette humiliante position, vous avez éprouvé environ la dixième partie de la honte que je ressentis à la vue du calme de lady Wolsley.
Cette fois, quelle que fût ma bonne volonté, je ne pouvais prendre le change : mon rôle atteignait les limites du ridicule ; je me voyais grotesque. En vain je voulus prendre le dessus ; lady Wolsley, en me demandant avec intérêt la cause de ce trouble subit, mit le comble à ma détresse. Je pris congé précipitamment. Tout le long de la route, je me fis à moi-même des reproches furieux. Telle était la violence de mon dépit que, si j’eusse rencontré lord Wolsley désarçonné dans quelque trou, je l’aurais laissé, je crois, à la garde de la providence.
Le soir, je mis en ordre mes bagages, je voulais partir le lendemain avant le jour, sans voir lady Wolsley. – Sans la voir ! quel pauvre dénouement à cette comédie si péniblement soutenue ! N’était-ce pas là une déroute manifeste ? Je repoussai bien vite ce pitoyable expédient, et, dès le matin, je pris la route du Vauvert afin de faire au moins mes adieux dans les règles. Je me munis, pour entrer, d’un visage souriant.
Lord Wolsley voulut battre en retraite et me laisser seul avec sa femme. Cette conduite, à laquelle je devais être habitué, me sembla ce jour-là singulièrement dédaigneuse et outrecuidante. Décidément, le vieux nobleman n’avait pas peur de moi.
– Milord, lui dis-je en l’arrêtant, permettez-moi de vous présenter mes adieux ; je pars demain pour l’Angleterre.
Il souleva son chapeau, me secoua la main à quatre reprises, murmura « un portez-vous bien » anglo-français et prit la porte.
Je me retournai vers lady Wolsley. Elle était pâle et semblait prête à défaillir. Instruit par ma déconvenue de la veille, je feignis de ne point remarquer son trouble, et lui demandai ses commissions pour Londres avec une froideur passablement bien jouée.
– pourquoi ce soudain départ ? me demanda-t-elle à voix basse au lieu de me répondre.
Je me roidis et fis l’impitoyable. Je ne me souviens pas au juste quelle impertinente fadaise je lui donnai en retour de sa question, mais ce dut être bien misérable, à coup sûr, car elle me laissa dès lors le soin de faire à moi seul les frais de l’entretien.
Elle était émue ; plus cette émotion devenait évidente, plus je prenais plaisir à faire montre de ma liberté d’esprit. Je me vengeais avec délices de ma récente peine. Au bout de quelques minutes, lady Wolsley se leva.
– Adieu donc, dit-elle, je souhaite que vous soyez heureux.
Je sentis tout à coup mon cœur se serrer ; j’aurais donné deux ans de ma vie pour pouvoir prolonger d’une heure cette entrevue. Lady Wolsley, cependant, touchait déjà le bouton de la porte.
– Ne désirez-vous plus savoir pourquoi je pars ? balbutiai-je d’une voix suppliante.
Elle se retourna ; moi, je faisais à ma faculté d’imagination un appel désespéré ; que dire ?
– Milady ! m’écriai-je enfin au hasard ; j’aime, je souffre !
Elle fit un mouvement de frayeur.
– Ne vous offensez pas, repris-je en m’élançant vers elle ; je suis bien malheureux ; je croyais…
Je m’interrompis ; une idée m’était enfin venue. Ce que je voulais par-dessus tout, c’était prolonger ce dernier tête-à-tête. Je lisais en effet dans mon cœur, et, pour la première fois, je mesurais l’étendue de ma passion.
– Écoutez-moi, dis-je rapidement ; j’aurais dû sans doute vous parler ainsi depuis longtemps ; une fausse honte me retenait. Je veux à mon tour vous ouvrir mon âme. Vous me direz après s’il faut que je parte.
Une puissante anxiété se peignait dans le regard de lady Wolsley. Elle se laissa conduire jusqu’à son fauteuil et se rassit. En ce moment, n’eût été l’expérience de la veille, j’aurais pu croire qu’elle aussi avait au cœur un sentiment autre que l’amitié.
Et maintenant, Charles, vous souvient-il de cette jolie apparition qui vint interrompre ma rêverie le soir de mon arrivée à Dinan ? C’est elle qui me fournit le prétexte ardemment désiré. Je racontai à lady Wolsley la scène nocturne qui avait précédé ma rencontre avec son mari ; je lui dépeignis scrupuleusement la jeune fille, cela d’autant plus aisément que le propre visage de lady Wolsley venait en aide à mes souvenirs.
– Depuis ce jour, dis-je en finissant, l’image de cette enfant est restée présente à ma pensée ; une seule fois je l’oubliai, milady, et ce fut près de vous. Je l’aime.
Je pense que je mentais. Il est certain pourtant que cette jeune fille, le mystère aidant, a laissé en moi une profonde impression. Quoi qu’il en soit, je m’attendais à une explosion de douloureuse surprise au milieu de laquelle lady Wolsley aurait trahi l’état secret de son cœur. Mais, ou je connais bien peu les femmes, ou celle-ci est, de beaucoup, la plus incompréhensible entre toutes.
Elle ne manifesta aucun chagrin ; seulement, étonnée d’abord, elle me regarda comme si elle croyait que j’avais voulu railler, puis elle baissa les yeux et se prit à réfléchir. Bientôt un sourire d’expression équivoque parut sur sa lèvre et ne la quitta plus. Ce sourire me déplut ; c’était en quelque sorte un nouveau mécompte ; mon irritation, un instant calmée, revint plus vive que jamais. Je repris après un court silence :
– Veuillez excuser mon indiscrétion ; le mystère qui environne cette enfant n’est point chose dont il me soit permis de m’enquérir ; mais il m’a semblé reconnaître dans ses traits… milady, ce doit être votre sœur ?
Elle baissa la tête davantage, son front devint pourpre.
– C’est ma sœur, en effet, dit-elle avec une hésitation marquée.
– Je l’avais deviné, m’écriai-je vivement, et cela m’explique mon amour.
Ce mot était à peine prononcé, que je le regrettais déjà. Lady Wolsley, qui avait recouvré quelque calme, feignit de ne le point comprendre. Un long silence suivit, pendant lequel elle retomba dans sa rêverie. Je sentais croître mon malaise ; j’avais choisi à l’étourdie le premier expédient venu, et je me trouvais affublé d’un rôle qui pouvait devenir pénible. Le souvenir récemment évoqué de la jeune fille ne me laissait pas sans émotion ; mais, près de lady Wolsley, toute autre image se voilait ; je ne pouvais voir qu’elle. En outre, ce silence qui se prolongeait semblait m’inviter à la retraite, et je voulais rester encore. pendant que je torturais ma cervelle pour trouver un moyen de poursuivre l’entretien, lady Wolsley reprit la parole d’une voix basse et mal assurée. Elle s’interrompait de temps à autre pour se recueillir. parfois sa phrase restait inachevée : on eût dit une bouche pure s’essayant pour la première fois au mensonge.
– Vous aimez ma sœur Ève, dit-elle : je ne sais si je dois m’en réjouir. Un mariage n’est pas possible… Non. Il ne faut point espérer une heureuse fin à cet amour… La pauvre Ève m’a souvent permis de lire dans son âme ; elle songeait à vous sans cesse. Souvent, peut-être ne devrais-je point vous le dire, elle vous écrivait de longues lettres. Elle a bien souffert ; elle souffrira plus encore… Ce fut dès la première fois qu’elle vous vit ; elle fut prise d’une de ces passions soudaines, dont nous gardons souvent le secret jusqu’à la mort, nous autres femmes. J’ai combattu tant que j’ai pu : à quoi bon ! Elle vous aime ; elle vous aimera toujours !
Lady Wolsley prononça ces derniers mots avec une énergie que je ne puis vous rendre. J’écoutais, muet de surprise. Tout à coup elle se leva : je l’imitai.
– Restez, me dit-elle, je vais revenir.
– Que veut dire ceci ? m’écriai-je en moi-même quand elle fut sortie. Ève m’aime ! Où m’a-t-elle vu ? Et où est-elle ? Pourquoi me l’a-t-on cachée si longtemps avec tant de soin ? Pourquoi me fait-on maintenant cette incroyable confidence ? Lord Wolsley ignore-t-il ?…
Lady Wolsley rentra. Elle tenait à la main un paquet de lettres.
– Lisez, murmura-t-elle. Celle qui les écrivit n’espéra point qu’elles dussent arriver jusqu’à vous. Elle a laissé parler son cœur. Souvenez-vous qu’elle ne peut être votre femme.
J’ouvrais la bouche pour exprimer enfin mon étonnement jusqu’alors contenu, mais lady Wolsley, comme brisée par une irrésistible émotion, cacha sa tête entre ses mains et fit un geste que je dus prendre pour un ordre : je me retirai sur-le-champ.
Je les ai lues, ces lettres, Charles. Quel esprit ! quel cœur ! Elle m’aime ; elle m’aime comme je souhaitais si passionnément d’être aimé. Moi, je l’aime aussi, j’espère. Oh ! pourquoi ai-je connu lady Wolsley ! Lady Wolsley est entre Ève et moi ; car j’essaierais vainement de me le dissimuler, la pensée de cette femme m’obsède sans relâche.
En lisant ces lettres d’Ève, je me prends à penser parfois que c’est sa sœur qui les a dictées, et je deviens fou de bonheur. Mais je combattrai ; je serai le plus fort ; je veux aimer cette enfant qui me demande une place en mon cœur. Si je ne puis, je partirai.
J’ai revu, depuis, plusieurs fois, lady Wolsley. Je l’ai pressée de questions ; ses réponses ont été obscures, ambiguës ; je n’ai rien appris. Ève ne peut être à moi, dit-elle. Pourquoi ? Je ne sais. La plus simple question trouble lady Wolsley au point de la rendre muette.
Hier, je lui demandais si sa sœur habitait encore le Vauvert. Elle hésita longtemps ; sa réponse négative, tardivement donnée, équivalait presque à une affirmation. Que croire ? Il n’est point de suppositions folles qui n’aient traversé mon esprit. Lady Wolsley m’a réclamé les lettres d’Ève ; je les ai refusées.
Un effroi visible s’est peint d’abord sur sa physionomie ; puis elle s’est efforcée de sourire et m’a demandé ce que j’en prétendais faire. Toute franchise a disparu de nos relations. Son caractère s’est complètement transformé : elle est tour à tour pétulante ou abattue ; à chaque instant, et sans motif apparent, ses yeux se remplissent de larmes. – Ève serait-elle morte, et voudrait-elle me le cacher ? Pauvre Ève ! Peut-être vaudrait-il mieux qu’elle fût morte en effet !
On m’annonce lord Wolsley. Adieu, Charles. C’est la première visite que milord ait jamais daigné me faire.
… Je rouvre ma lettre pour vous dire en deux mots ce qui vient de se passer.
Lord Wolsley, en entrant, m’a abordé froidement, puis, refusant de s’asseoir, il a tiré de son portefeuille deux bank-notes qu’il a déposées sur le marbre de ma cheminée :
– Acceptez nos remerciements, a-t-il dit en se retirant aussitôt. Milady et moi nous avons fait choix d’un autre médecin.
Je suis donc banni de sa présence ! Hélas ! Charles, ayez pitié de moi ! Prenez au sérieux ma peine et envoyez-moi un bon conseil. Puis-je essayer de la voir encore ? Dois-je partir ?… Partir ! cela serait odieux ! Ève, cette pauvre enfant !… Je resterai pour Ève.
Misérable insensé que je suis ! j’ai lu et relu ses lettres et je ne l’ai point devinée ! Comment ai-je pu croire un instant qu’une autre savait écrire ainsi ? Comment, dès la première ligne, n’ai-je pas reconnu sa pensée ? Elle est partie, Charles ! elle est perdue pour moi, perdue pour toujours ! Et elle m’aimait !… Ce matin, un paysan m’a remis une lettre ; j’ai reconnu l’écriture d’Ève et me suis empressé de rompre le cachet. Voici ce que j’ai lu :
Adieu, Robert, je ne puis rester là où vous êtes sans vous voir. Je n’ai point de sœur. Pardonnez-moi une supercherie que vous-même m’avez suggérée et qui a trompé parfois ma souffrance. Je vous quitte parce que je vous aime.
Et moi qui l’accusais ! Moi qui lui faisais un crime de ses continuelles hésitations ! Moi qui prenais en méprisante pitié toute la peine qu’elle se donnait pour me cacher son cœur ! Oh ! pourquoi ai-je repoussé cet instinctif avertissement qui me portait à la bénir pour tout le bonheur que me donnaient les lettres de sa sœur prétendue ? Pourquoi ai-je obstinément fermé les yeux ? Mais j’y songe, qui donc ai-je vu le soir de mon arrivée à Dinan ? Quelle était cette jeune fille ?… Hélas ! cela doit-il m’importer, maintenant ? Elle m’aimait !
Je souffre ; ma tête brûle. Depuis que j’ai reçu cette lettre, une fièvre ardente s’est emparée de moi.
Il faut que je parte néanmoins, Charles, que je parte sur-le-champ. Je la retrouverai. Dussé-je fouiller jusqu’aux villages les plus ignorés de l’Angleterre, je la reverrai.
Au nom de Dieu, répondez-moi, mon ami. Voilà un an et plus que je ne reçois point de vos nouvelles. Sans nul doute, vous avez quitté Dinan depuis longtemps. C’est à peine si j’espère que cette lettre vous parviendra. Mettez fin, je vous supplie, à mes inquiétudes.
Votre dernière lettre, qui a maintenant quatorze mois de date, et que je relis bien souvent, n’est pas faite pour me rassurer. Elle semble dictée par un esprit malade. Tout ce que j’ai pu comprendre, c’est que, à cette époque, vous étiez fort épris et fort malheureux. Ce n’est point ici le moment de vous demander la clef de vos romanesques mystères. Je vous connais, Robert ; lorsque cette merveilleuse beauté vous eut dit adieu, le charme se dissipa comme par magie.
Vous n’êtes point de ceux qui pleurent fort longtemps la perte d’une idole, et je voudrais jurer que ce beau dessein de parcourir l’Angleterre en chevalier errant est encore à exécuter. Tant mieux ! c’eût été une folie de plus sur votre liste, qui n’a nul besoin de se voir allongée. Au lieu de cela, piqué par mes justes reproches, et n’ayant plus rien qui fit obstacle à votre grand voyage, vous avez pris le chemin de fer ou le paquebot, et vous courez encore. Bravo, mon ami, j’aime à vous voir cette ardeur !
Mais pourquoi ne m’avoir pas fait part de vos découvertes ? En quelque pays lointain que vous puissiez être, vous avez dû trouver quelques moyens de faire parvenir vos missives en France. Votre négligence est inexcusable, et vous devez penser qu’elle me chagrine vivement. Moi, je vous ai écrit nombre de fois ; j’ai été jusqu’à faire des démarches aux ministères, sans parler des notes que j’ai fait tenir à divers consulats.
J’adresse un double de cette lettre à Buénos-Ayres, où quelques renseignements me portent à penser que vous pouvez être. En tous cas, je suppose, connaissant votre caractère, que vous voudrez revoir Dinan à votre retour en France. Vous y trouverez la collection de mes dépêches. Adieu, mon ami, répondez-moi, et faites que nous nous embrassions bientôt.
Je ne sais trop quelle excuse vous donner, Charles, surtout pour la peine que vous avez prise d’écrire à Buénos-Ayres. Je n’ai point passé les mers ; je suis encore à Dinan, et mon malheureux voyage autour du monde m’a tout l’air d’être indéfiniment remis. Vous en jugerez.
Depuis plus de quinze mois, je reçois fort régulièrement vos lettres. Pardonnez-moi de les avoir laissées sans réponse. Si dépourvu de motifs que soit mon silence, je l’aurais prolongé encore, sans une rencontre que j’ai faite ici par hasard. J’ai vu un de vos voisins de Pontoise. Quoi, Charles ! vous êtes marié ! Marié depuis trois mois, et je n’en savais rien ! Cette annonce m’a jeté dans un étonnement que je ne puis vous peindre. Il a donc fallu qu’un habitant de Pontoise s’égarât jusqu’en Bretagne pour que j’apprisse cette nouvelle !
Mais ce n’est pas là ce qui me surprend ; bien au contraire, je m’étonne que, pour commettre un acte aussi noir, vous ne vous soyez point retiré au fond de quelque désert. Vous, Charles, marié ! Quand je songe à ces magnifiques morceaux d’éloquence que vous m’adressiez par la poste, quand je me souviens de vos puissantes diatribes contre le mariage, un rire inextinguible me prend.
Moi aussi, je suis marié, Charles ; et s’il ne faut rien vous cacher, telle est la cause de mon long silence. Comment aurais-je osé avouer ma faiblesse au plus Fougueux parmi les apôtres de la vie de garçon ? J’ai eu tort ; vous, davantage ; je suis certain que vous n’entamerez de votre vie l’escarmouche sur ce terrain.
Comme vous dites, à l’époque où je vous écrivis ma dernière lettre, j’étais fort épris et fort malheureux, si malheureux, que j’en contractai une maladie grave qui faillit me guérir radicalement de mes ennuis. Au plus fort de ma souffrance, mon angoisse la plus amère avait trait à lady Wolsley. Je ne pouvais la suivre, chaque minute qui s’écoulait me semblait apporter un obstacle à notre réunion. Où était-elle ?
Je gardai le lit cinq mois. Au bout de ce temps, convalescent à peine, j’arrêtai une place pour Jersey, comptant passer sans retard en Angleterre. Avant de partir, il me prit envie de revoir le Vauvert, cette maison véritablement fatale où j’avais trouvé ma joie et mes douleurs. Il faisait nuit lorsque j’arrivai sur les bords de la Rance. Par un singulier hasard, le paysage était éclairé comme la première fois que j’étais venu en ce lieu. La lune se levait derrière les remparts ruinés du château et laissait le Vauvert dans l’ombre. Une foule de souvenirs vint aussitôt m’assaillir ; je m’étendis machinalement sur le talus, à la place que vous savez ; puis, ce rapprochement éveillant en moi un fol espoir, je me retournai soudain, m’attendant presque à revoir Ève, telle qu’elle m’était apparue à la fenêtre.
Et je la revis, en effet, calme, souriante. Comme autrefois, son regard s’attachait à moi et ne me quittait point. Un cri étouffé s’échappa de ma poitrine ; galvanisé par la fièvre, je franchis la haie d’un bond. Une minute après, j’entrai dans la chambre où Ève m’était apparue.
Une femme en deuil était assise près du foyer. Au bruit que je fis en entrant, elle se retourna. Je reconnus lady Wolsley. À ce moment, ma vigueur factice m’abandonna tout à coup ; je m’affaissai sur un siège et perdis connaissance. Quand je repris mes sens, j’étais seul encore avec lady Wolsley. Je jetai autour de l’appartement mon regard effaré ; il s’arrêta sur le portrait en pied d’une jeune fille vêtue du costume suédois. Lady Wolsley suivait mes yeux et souriait doucement :
– Ne la reconnaissez-vous pas ? me dit-elle ; c’est Ève.
– C’est vous ! m’écriai-je en portant sa main à mes lèvres.
Je dus comprendre alors qu’Ève, ma mystérieuse apparition, n’était autre chose qu’un portrait.
Lady Wolsley, cependant, avait laissé sa main dans la mienne.
Ce fut moi qui m’éloignai avec une sorte d’effroi en songeant que milord pouvait entrer et nous surprendre. Elle comprit ma pensée, une larme vint à ses yeux.
Paix soit à l’âme du digne nobleman, Charles ! Je remarquai seulement alors que lady Wolsley portait des habits de veuve.
Voici le récit authentique de la fin de lord Wolsley, lord par courtoisie, comme disent les Anglais, car il n’était que le septième fils d’un membre de la chambre haute. Le jour même où sa femme m’avait écrit ce billet d’adieu, qui me frappa d’un coup si violent, il avait pris place dans la diligence de Saint-Malo, pour arrêter une cabine à bord du paquebot de Jersey. Au haut du faubourg tout le monde descendit, comme c’est l’habitude. Milord seul ne voulut entendre à aucune représentation, et se jucha sur l’impériale. C’était une dernière bravade qu’il était bien aise de jeter en partant à son mortel ennemi, le Jerzual. Au quart de la rampe, les chevaux prirent le trot ; au milieu, le galop ; un peu plus loin ils culbutèrent, et lord Wolsley, lancé par-dessus leur tête, se rompit le cou.
Sa veuve, au lieu de poursuivre son voyage, revint au Vauvert. Ceci m’explique pourquoi, durant tout le cours de ma maladie, un messager mystérieux venait chaque jour s’informer de mes nouvelles.
Vous pouvez juger si ma convalescence a été douce. Trois mois après la fin de son deuil, Ève (j’aime à la nommer ainsi) est devenue ma femme. N’accusez que vous, séide du célibat, si vous n’avez pas su tout cela plus tôt. Et maintenant mon voyage autour du monde est décidément clos et terminé. Je vous propose de venir me trouver à Dinan. Ici, je me fais une bien grande joie de vous embrasser, et de lire à votre femme vos héroïques diatribes contre le mariage.
La chanson du rouge-gorge
J’ai écrit ces pages au château de K…, dans la Grande-Paroisse (Ploe-Meur), auprès de Lorient, la ville neuve que les Anglais voulurent mordre une fois, mais qui leur cassa les dents.
Voilà un lieu où je voudrais vivre longtemps avant d’y mourir. Personne ne parle politique dans ces sentiers creusés comme des torrents, au-dessus desquels les chênes inclinés arrondissent la voûte de leurs feuillages. On n’y entend que le bourdonnement des abeilles qui, selon Kernaor, sont condamnées à demander toujours un roi. Elles n’ont que des reines, et Kernaor les plaint. Que ferait-il de nous, qui n’avons ni l’un ni l’autre ?
C’est un grand poète, le plus grand de la paroisse de Ploemeur, qui est la plus grande paroisse de toute la Bretagne. Il vint un jour à Paris pour montrer au roi (c’était du temps où il y en avait) le beau costume des gars de Ploemeur, coupé par le propre couturier de Louis XIV. Si vous ne savez pas cette histoire du costume de Ploemeur, la voici :
Jan Jugan était le neveu de l’évêque. Les écrouelles (sauf le respect) lui vinrent pour avoir passé huit jours et huit nuits à la cave, à mettre en bouteilles le vin de monseigneur. À Vannes, où l’on sait tout, il lui fut dit : « Va-t’en trouver le roi, il te guérira, c’est son état. » Et le voilà parti. Et le voilà arrivé, après qu’il eut fait la route.
– Salut, sire et votre compagnie.