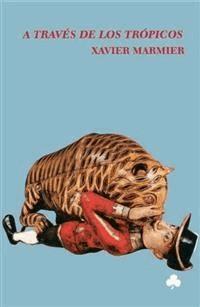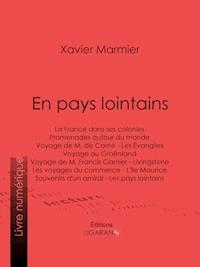
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "En dépit de ses orages et de ses désordres, il faut que l'on aime cette France généreuse ; il faut que jusque dans les régions les plus éloignées, elle conquière sans cesse de nouvelles sympathies. Ceux que ses égarements révoltent, et ceux qui voudraient l'opprimer se sentent à tout instant séduits par son intelligence, subjugués par ses actes de courage et son dévouement. Œuvres d'art et de science, vertus chevaleresques et religieuses, là est la gloire de son passé."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
On dit souvent : la France ne sait pas coloniser
Est-ce vrai ?
Devons-nous, sans le contester, admettre ce reproche ?
Les autres peuples se plaisent à proclamer leur mérite. Nous laissons indolemment déprécier le nôtre, et parfois nous le déprécions nous-mêmes.
On nous accuse de nous abandonner à de futiles vanités. Mieux vaudrait nous maintenir dans une juste fierté.
L’histoire de nos colonies est l’une des pages les plus nobles et souvent les plus attachantes de nos longues annales.
Elle a été éloquemment et savamment racontée à diverses reprises, en différents lieux.
Je n’ai pas la prétention d’en retracer un nouveau tableau. En recueillant mes souvenirs de voyage, en y adjoignant de récentes études, je voudrais seulement faire voir, par quelques traits caractéristiques, les qualités particulières de colonisation dont la France a de tout temps été douée.
La hardiesse dans les entreprises, la générosité dans la victoire, la dignité dans les revers.
D’autres nations ont eu des succès plus éclatants ou plus durables. Pas une n’a montré de telles vertus.
La première dans les croisades, cette héroïque tentative de colonisation religieuse, la France a été la première aussi dans d’autres expéditions nautiques du Moyen Âge.
En 1364, des marins de Dieppe s’en vont par-delà les antiques colonnes d’Hercule, par-delà les Canaries et le cap Vert, le long de la côte occidentale d’Afrique. Ils rassurent, par leurs bons procédés, les noirs habitants de cette contrée, font avec eux d’agréables échanges et organisent des établissements de commerce sur des plages que nul navire européen n’avait encore abordées.
En 1365, des marins de Rouen, s’associant à ceux de Dieppe, s’avancent dans le golfe de Guinée et donnent le nom de Normandie aux rades où ils pénètrent.
Ainsi, comme l’a justement dit un publiciste distingué : « Par ces entreprises heureuses et réitérées, en des parages jusqu’alors inconnus de toute autre nation, les Français ont le droit de se dire les pères de la colonisation moderne. »
Un siècle s’écoule. Pendant ce long espace de temps, nos explorations maritimes sont interrompues par les calamités du règne de Charles VI par les agitations et les guerres des règnes suivants.
Puis voici venir les grands Descubradores ; Christophe Colomb, Vasco de Gama. Une nouvelle ère commence. Le nouveau continent est découvert, et le nouveau chemin des Indes par le cap de Bonne-Espérance. Les Espagnols et les Portugais prétendent garder l’entière possession de cet autre univers. Une bulle du pape la leur accorde : Au Portugal tout l’Orient, à l’Espagne tout l’Occident.
Cependant l’Angleterre et la Hollande veulent avoir leur part de ces archipels embaumés, de ces terres phénoménales dont on extrait des monceaux d’or, de ces royaumes dont on raconte tant de merveilles. En dépit du décret pontifical, elles iront résolument vers ces fabuleuses contrées ; elles s’y établiront les armes à la main.
Et la France ?
En ce temps d’investigations et de conquêtes transatlantiques, la France était comme le poète dont Schiller raconte l’oubli dans un de ses apologues.
Jupiter annonce du haut de son trône qu’il va distribuer aux hommes les richesses de la terre. Tous aussitôt d’accourir et de prendre avec avidité : celui-ci la forêt, celui-là les champs, cet autre les chariots et les marchandises. Chacun ayant son lot, arrive le poète indolent, rêveur. Les distributions étant finies, Jupiter n’avait plus à lui donner que l’auréole de la gloire.
Ainsi attardée au partage du nouveau monde, la France ne pouvait en avoir une portion qu’en la disputant à plusieurs peuples, ou en faisant aussi elle-même quelques découvertes.
C’est ce qu’elle fit.
Pour réparer le temps perdu, elle recommença sur différents points à la fois son œuvre de colonisation, et graduellement l’accomplit d’une façon prodigieuse.
Elle avait de nombreux obstacles à surmonter, de violentes hostilités à vaincre, des luttes perpétuelles à soutenir. Malgré ces difficultés et ces périls, malgré ses essais infructueux et ses fatales défaites, un jour vint où son pavillon flottait librement sur toutes les mers, où, sur tous les continents et dans tous les archipels, elle avait ses domaines.
Oui, au commencement du dix-huitième siècle, la France était la première des puissances coloniales. Admirable succès ! Plus admirable encore si l’on songe par quels moyens elle y est parvenue.
Les projets de colonisation avaient séduit l’esprit aventureux de François Ier et occupé gravement la pensée de Henri IV. Pour affermir et élargir ces projets, Richelieu rédigea diverses ordonnances, institua des compagnies de commerce, créa de nouveaux emplois civils et militaires.
Dans les orages de la Fronde, dans les constantes difficultés de son ministère, Mazarin ne pouvait accorder la même attention à cette œuvre lointaine.
Colbert la reprit avec son lumineux jugement et lui donna une nouvelle extension.
Cependant, pour entreprendre de périlleux voyages, pour porter le drapeau de la France sur des plages inexplorées, pour lutter contre l’ambition de plusieurs peuples puissants, l’État n’arme pas beaucoup de vaisseaux de ligne et ne détache point de grosses sommes de son budget. Plus d’une fois même il paralyse, par son inertie ou ses fausses mesures, les courageux efforts de nos colons, et les compagnies de commerce souvent les entravent par leurs erreurs et leur impéritie.
Mais la France s’élançait dans cette exploration et cette conquête d’un nouveau monde comme dans une nouvelle croisade.
Cavaliers et marins, gentilshommes et marchands, prêtres et ouvriers, toutes les classes de la société, selon leur vocation, leurs rêves et leurs penchants particuliers, se sentaient attirés vers cette Fata Morgana des vaporeux horizons. Ce que l’État ne pouvait faire dans ses embarras financiers, ou ses tourmentes politiques, la France le fit par le mouvement et la puissance de diverses facultés individuelles.
Des marins de Dieppe et de Rouen avaient, comme nous l’avons dit, fondé au quatorzième siècle nos premiers établissements sur la côte d’Afrique. Bien avant Sébastien Cabot, des matelots basques s’avancent jusqu’à Terre-Neuve où nous avons conservé une autre petite colonie. Des négociants de Marseille vont en pleine Algérie organiser un comptoir, construire un édifice qu’ils appellent le Bastion du roi.
Dans cette guirlande de perles et d’émeraudes, qu’on appelle les Antilles, un de nos meilleurs domaines, la Guadeloupe, a été conquis par des soldats dieppois ; un autre, la Martinique, par une centaine de soldats, sous les ordres d’Esnambuc, gouverneur de Saint-Christophe.
Vers les régions inconnues de l’Amérique du Nord, voici venir Jacques Cartier avec deux petits bâtiments de soixante tonneaux. Il contourne le banc de Terre-Neuve et remonte jusqu’à l’île sauvage de Hochelaga le cours du Saint-Laurent.
L’habile et hardi Champlain, avec un bâtiment de même dimension, s’arrête au bord de cet immense fleuve et y forme un établissement qui deviendra la puissante ville de Québec.
Au pied de cette cité naissante, un vénérable prêtre, le père Marquette, animé d’un ardent désir d’études géographiques et de prosélytisme religieux, s’embarque sur un canot d’écorce avec une chétive provision de blé d’Inde et de viandes boucanées ; il traverse résolument le lac Huron, le lac Michigan, arrive au Mississippi et le descend jusqu’à sa jonction avec l’Arkansas. Là, ses provisions étant épuisées, il fut obligé de revenir en arrière ; mais il avait été assez loin pour reconnaître la grandeur du fleuve que les Indiens appellent le Meschacébé, et son cours vers la mer. À son retour à Québec, les cloches sonnaient et les habitants, l’évêque en tête, allaient à l’église chanter le Te Deum pour remercier Dieu de cette découverte.
Dix ans après, un simple enfant du peuple, Robert Lasalle, dont Louis XIV récompensa le courage par un brevet de noblesse, achevait, l’épée à la main, l’œuvre commencée avec la croix par le père Marquette. Il descendait le Mississippi jusqu’à son embouchure, arborait à bannière de France près du golfe du Mexique, et nous donnait la Louisiane.
En même temps, les colons employés à l’achat des pelleteries, ces intrépides aventuriers qu’on appelle les voyageurs ou les coureurs des bois, remontaient avec de légers canots le courant des rivières. Arrivés aux passages où des rocs et des rapides arrêtaient l’effort de leurs rames, ils déchargeaient les cargaisons, et prenant leurs canots sur leurs épaules, doublaient par terre les impraticables défilés, puis, s’embarquant de nouveau, gagnaient les lacs du Nord, et pénétraient au milieu des tribus indiennes étaient nos pionniers, non moins audacieux que ceux des régions de l’Ouest illustrés par Cooper. C’étaient nos géographes. Ils mesuraient le terrain par leurs journées de marche, s’ouvraient des routes ignorées, et parcouraient des espaces inconnus.
Dans l’histoire de nos colonies, combien il y en a de ces faits mémorables accomplis humblement par quelque généreuse aspiration, ou quelque robuste volonté ! Là aussi, entre deux ou trois pelotons d’infanterie, au pied d’une palissade en bois, au bord des fleuves silencieux, au sein de l’immense espace du Nouveau Monde, combien de batailles plus étonnantes que celles des célèbres plaines d’Allemagne ou d’Italie, combien de héros qui n’ont point eu leur Homère, mais dont le nom doit rester à jamais inscrit dans le livre d’or de nos gloires nationales ; Montcalm, le pieux chevalier, si ferme en ses périls, si modeste en ses victoires, si noble en son dernier combat. Le Canada lui garde un religieux souvenir. La France pour laquelle il mourut ne put l’oublier. Bienville ! le fondateur de la Nouvelle-Orléans. Son père était mort, les armes à la main, sur la terre canadienne. Il avait onze fils, tous engagés comme lui au service du roi, et cinq d’entre eux étaient tombés comme lui sur le champ de bataille. Les autres, désireux de se distinguer en quelque entreprise difficile, résolurent de continuer l’œuvre de colonisation commencée par Lasalle à la Louisiane. Les deux premiers furent emportés par la fièvre sur les rives du Mississippi. En mourant, ils léguaient pour tout héritage à leur jeune frère la tâche à laquelle l’un et l’autre venaient de succomber. Il l’accepta et s’y dévoua. Il la poursuivit pendant quarante années, luttant avec une fermeté inébranlable contre tous les obstacles qui s’opposaient à ses efforts, sans cesse aux prises avec l’inquiète jalousie des Anglais, et les haines féroces des Indiens.
Dans sa vieillesse, il retourna en France. Bien faible encore était cette colonie pour laquelle il avait éprouvé tant d’angoisses et supporté tant de fatigues. Mais il pouvait la croire au moins affranchie des principaux périls qui menaçaient de l’anéantir dans son germe. Il y était entré avec deux cent cinquante hommes ; il y laissait une population de six mille âmes.
Si de l’Amérique nous tournons nos regards vers nos anciennes possessions de l’Orient, ai-je besoin de citer Bussy, ce valeureux général que les ennemis désiraient tant ne pas rencontrer, et La Bourdonnais ! Un si grand courage ! Une si belle intelligence ! Et Dupleix qui malheureusement haït et persécuta cet homme éminent ! Ah ! si tous deux avaient pu rester unis dans leur ambition et leurs plans de campagne, quel triomphe pour la France, quelle chute pour les Anglais !
« Dupleix, a dit Macaulay, entrevit le premier la possibilité de fonder un empire européen sur les ruines de la monarchie mongole. Son esprit inquiet, étendu, inventif, conçut cette idée à une époque où les plus habiles agents de la compagnie anglaise ne pensaient qu’à leurs chargements de marchandises et à leurs factures. Cet ingénieux, cet ambitieux Français, le premier, comprit et mit en pratique l’art militaire et la diplomatie que les Anglais employèrent quelques années après avec tant de succès. »
Partout où nos colons voulaient s’établir, ils devaient combattre, tantôt contre les milices européennes, tantôt contre les tribus indigènes : caraïbes, peaux rouges, nègres et malais ; tantôt par une raison locale, tantôt par l’effet d’un des orages de la mère patrie. Quand la guerre éclatait sur l’ancien continent, elle éclatait par contrecoup en Amérique et dans les Indes. Capulets et Montaigus, Guelfes et Gibelins se battaient sur les rives de l’Escaut ou du Danube, et les fils de ces guerriers européens luttaient avec la même ardeur sur les plages de l’Asie, ou dans les forêts du Nouveau Monde.
Nous ne pouvons trop honorer ceux qui ont porté si loin et défendu si vaillamment notre drapeau. Ce n’est pourtant point par ses ardentes batailles et ses nombreuses victoires que la France s’est acquis une place si distincte dans l’histoire des colonisations, c’est par son esprit de justice et de mansuétude, par ses facultés d’attraction et d’assimilation.
Elle n’a point fait de cruelles ordonnances pour obtenir la plus abondante récolte de la terre conquise. Elle n’a point, pour apaiser sa soif d’or, torturé d’innocentes peuplades vaincues. Elle n’a point écrasé, ou refoulé dans de sombres régions, des milliers d’honnêtes familles pour n’avoir plus à leur disputer une parcelle de leurs domaines héréditaires.
Ah ! si en pensant à tout ce que nous avons possédé et à tout ce que nous avons perdu, il ne nous est pas possible de lire sans regrets la chronique de nos colonies, nous pouvons du moins la lire sans remords. Nulle de nos souverainetés n’a fait gémir l’âme d’un Las Casas ; nulle de nos coutumes n’a suscité un désir insatiable de vengeance dans le cœur d’un Montbar, et nul de nos gouverneurs n’a par ses rapacités enflammé la foudroyante éloquence d’un Burke et d’un Sheridan.
Dans nos entreprises de colonisation, il y avait un juste sentiment d’ambition nationale ; pour la plupart de ceux qui s’y associaient, la perspective d’un honnête négoce ou d’un fructueux labeur ; pour d’autres, un rêve de jeunesse, l’attrait de l’inconnu, l’espoir d’une action d’éclat ; sur chaque navire, à chaque migration, le prêtre et le gentilhomme, la croix et l’épée, le sentiment du devoir religieux et du devoir militaire.
Jacques Cartier, le brave marin, dit en commençant sa relation de voyage : « Le dimanche, jour et feste de la Pentecoste, du commandement du capitaine, et bon vouloir de tous, chacun se confessa, et reçurent tous ensemble notre Créateur en l’église cathédrale de Saint-Malo, après lequel avoir reçu furent nous présenter au chœur de ladite église devant révérend père en Dieu, Monsieur de Saint-Malo, lequel en son estat épiscopal nous donna sa bénédiction. »
Le père Marquette, en revenant des sombres forêts où il avait découvert le Mississippi, écrivait dans sa relation ces lignes touchantes : « Quand tout le voyage n’aurait valu que le salut d’une âme, j’estimerais toutes mes peines bien récompensées, et c’est ce que j’ay sujet de présumer, car lorsque je retournai nous passâmes par les Illinois, je fus trois jours à leur publier les mystères de notre foy dans toutes leurs cabanes, après quoy, comme nous nous embarquions, on m’apporta au bord de l’eau un enfant moribond que je baptisay un peu avant qu’il mourût par une providence admirable pour le salut de cette âme innocente. »
En 1641, deux petits bâtiments partaient de la Rochelle pour le Canada. Sur l’un de ces navires était une sainte fille, mademoiselle Manse de Langres, qui renonçait à une brillante situation en son pays pour se dévouer à une œuvre de charité dans les régions sauvages ; sur l’autre navire était un gentilhomme champenois, M. de Maison neuve, un prêtre, des soldats et des ouvriers, en tout, trente personnes.
Au mois d’août, les bons voyageurs arrivèrent à Québec. La colonie de cette ville essaya de les retenir. Elle se composait de deux cents âmes. Trente braves gens de plus, quel précieux renfort ! Mais M. de Maison neuve s’était engagé à aller à Hochelaga, et il voulait accomplir sa promesse. En vain on lui représenta les dangers auxquels il s’exposait en abordant, avec un si petit nombre de soldats, sur cette île occupée par une tribu considérable d’indiens. Il répondait, en vaillant gentilhomme : « Je ne suis pas venu pour délibérer, mais pour agir. Y eût-il à Hochelaga autant d’Iroquois que d’arbres sur ce plateau, il est de mon devoir et de mon honneur d’y établir une colonie. »
Au mois d’octobre il atteignit les rives de Hochelaga, y construisit des cabanes et une chapelle en bois. Mademoiselle Manse organisa, au même endroit, un hôpital, et une religieuse de Troyes fonda l’institution où les jeunes filles devaient être élevées gratuitement.
Quelques tentes, au milieu des bois, une chapelle, revêtue d’un toit de feuillage, une cloche suspendue à un rameau de sapin, un asile pour les malades, une école pour les pauvres, tels furent les premiers éléments de notre ville de Montréal, où l’on compte aujourd’hui quatre-vingt mille âmes.
En 1721, M. le chevalier de Fougères, commandant le Triton, de Saint-Malo, allait prendre possession de cette île si belle, si riante et si charmante, que nous avons appelée l’île de France, et qu’il faut, hélas ! maintenant appeler l’île Maurice. Sur la plage il arborait le drapeau blanc et érigeait une croix décorée de fleurs de lis avec cette inscription :
JUBET HIC GALLIA STARE CRUCEM.
Ainsi, partout la ferme résolution du gentilhomme et les doux enseignements de l’Évangile. Partout aussi une pensée de conciliation et d’humanité.
Quand M. de Flacourt fut envoyé à Madagascar, avec le titre de gouverneur, il adressa aux habitants une harangue où il parlait de la grandeur du roi de France, mais surtout de sa douceur et de sa bonté.
Quelques années après, le gouverneur de Pondichéry, M. Martin, un homme d’un rare mérite, disait à ses amis et à ses subordonnés : « N’oublions pas que les Français, étant ici les derniers venus, doivent, pour réussir, donner la meilleure idée de leur caractère. »
C’est ainsi que nos colons ont inspiré, en pays lointains, ces sentiments d’estime et d’affection qui, souvent, leur ont été d’un si grand secours dans les heures difficiles, dans la faiblesse de leurs armements, dans l’exiguïté de leurs ressources matérielles.
Par la durée de ces sentiments, on peut juger de leur profondeur.
L’Amérique du Nord a rompu violemment les liens qui l’unissaient à l’Angleterre.
L’Amérique du Sud a, de même, longuement combattu pour se soustraire à la domination de l’Espagne.
Aucune de nos colonies n’a suivi cet exemple. Aucune ne s’est détachée de nous volontairement. Je ne parle pas de Saint-Domingue, cette île si fructueuse et si belle, bouleversée tout à coup par la trombe révolutionnaire, par l’éruption volcanique des plus effroyables passions. Nos planteurs étaient là justement aimés. Riches et généreux, ils faisaient de leur fortune un noble usage. Nul d’entre eux n’abusait de ses privilèges, et quelques-uns méritaient d’être cités comme des modèles de bonté. On disait proverbialement : Heureux comme un nègre de Gallifet. Ces heureux nègres prirent, comme les autres, la torche et la hache, incendièrent, pillèrent et se plongèrent dans des flots de sang.
Des guerres désastreuses, des traités lamentables nous ont enlevé la plupart de nos anciennes possessions. Mais nous y avons laissé une profonde empreinte.
Un écrivain distingué de l’Angleterre, M. Anthony Trollope, a visité récemment les Antilles, et là il a vu la persistance de l’attachement à la France dans des îles gouvernées autrefois par la France, non point sans interruption pendant des siècles, mais pendant un petit nombre d’années : la Dominique, Tabago, Sainte-Lucie ; la Trinité ; la Trinité occupée primitivement par les Espagnols, puis par les Anglais, conquise et rendue à l’Espagne par les Français, puis de nouveau reprise par les Anglais ! Quelle langue, dit M. Trollope, croyez-vous que l’on parle dans cette île où nous avons un gouverneur, un conseil administratif, une garnison, et d’importants comptoirs ? L’anglais ? Non. L’espagnol ? Non. Mais le français. Toute la population est française par l’idiome, par les habitudes, par le catholicisme.
À cet honnête aveu M. Trollope ajoute : Il y a là un évêque catholique qui reçoit de l’Angleterre un traitement annuel et l’emploie entièrement en aumônes.
Là, comme partout où l’ancienne France a passé, son souvenir s’allie aux vertus du catholicisme, à l’esprit de charité.
À Saint-Vincent, on peut noter un autre exemple de l’attraction de nos émigrants. Les Anglais s’étant emparés de cette île, les Caraïbes, qui en occupaient une partie, se soulevèrent à trois reprises différentes pour les expulser et faire revenir les Français, dont ils regrettaient la domination.
L’Angleterre a eu plus de peine encore à conquérir et à garder notre île de France. Des colons de Bourbon s’y étaient établis au commencement du dix-huitième siècle, de braves gens, dit un historien anglais, modestes et polis, très simples dans leurs habitudes, très hospitaliers et fort peu soucieux de la fortune. M. de Labourdonnais fut un de leurs premiers gouverneurs, et Poivre le Lyonnais, le savant si sage, le fonctionnaire si zélé pour le bien public, propagea sur leur sol les plus fructueuses cultures. Doucement et dignement, l’honnête colonie grandit. Ses vertus la sauvèrent du cyclone où s’abîma Saint-Domingue. Elle avait cependant aussi ses foyers dangereux. Dès le commencement de notre révolution, une certaine quantité d’individus se mirent à répéter les harangues des Grégoire, des Robespierre, et à proclamer les motions furibondes des jacobins. Dans la stupeur produite autour d’eux par les terribles nouvelles de Paris, ils organisèrent un club, constituèrent, à l’imitation des sans-culottes de France, un comité de salut public, et sur la place de Saint-Louis érigèrent la guillotine. Bientôt, on vit arriver deux commissaires de la république, apportant la nouvelle loi.
Mais la masse de la population n’avait pas le moindre goût pour ces belles réformes, et voulait y mettre fin. Citadins et campagnards se réunirent en si grand nombre et d’un air si résolu, que la bande démagogique n’osa essayer de leur résister. Les commissaires furent reconduits poliment à leur navire, et, malgré leurs protestations, obligés de s’embarquer. Les clubs furent fermés, les jacobins dispersés, la guillotine démolie. L’île entière se confia de nouveau à la direction de M. de Malartic. Elle aimait ce gouverneur, qui lui avait été donné par Louis XVI. Elle aimait l’autorité royale.
Cependant les commissaires, furieux de leur échec, pouvaient la déclarer en plein état de rébellion et demander qu’elle fût sévèrement châtiée. Un amiral anglais, qui stationnait avec une escadre dans le voisinage, lui offrit la protection du pavillon britannique. L’assemblée coloniale lui répondit : « En repoussant les commissaires de la république, nous n’avons fait que conserver cette colonie à la France, nous la trahirions en y laissant entrer ses ennemis. »
Elle voulait rester française, cette loyale petite île, épanouie comme une corbeille de fleurs dans l’océan Indien, à trois mille lieues de la France. On a vu la force de sa bravoure et la persistance de sa fidélité pendant les guerres du Consulat et de l’Empire. Ni les armements des Anglais, ni les rigueurs d’un long blocus, ne pouvaient la décourager. Elle résistait à toutes les attaques et supportait patiemment toutes les privations. Et quelle joie quand une de nos frégates, passant hardiment à travers les croiseurs ennemis, entrait dans le Grand port, ou dans le port Louis, quand un Linois, un Roussin, un Duperré, criblait de boulets un superbe man of war et l’obligeait à se rendre ! Puis l’un après l’autre arrivèrent ces audacieux marins qui ont tant de fois répandu la désolation dans la cité de Londres : Tréhouard, Perrot, Thomasin, Surcouf, le fabuleux Surcouf qui, avec un bateau pilote, enlevait à l’abordage les plus beaux bâtiments de la Compagnie des Indes.
Alors les jeunes gens de l’île de France ne pouvaient rester en repos. Ils sollicitaient l’honneur de servir sous les ordres de ces hommes intrépides, et couraient gaiement à tous les périls.
Mais un jour vint où l’île fidèle devait succomber. L’Angleterre, qui depuis longtemps désirait la conquérir, réunit tous les soldats qu’elle pouvait prendre à Madras, à Bombay, au Cap, à Ceylan ; 20 000 hommes d’infanterie et une formidable artillerie, 20 vaisseaux et 50 bâtiments de transport. Jamais, dit un écrivain anglais, on n’avait vu à la fois tant de canons et de navires dans la mer des Indes.
La pauvre colonie n’avait qu’un régiment et quelques batteries. Elle voulut pourtant se défendre, et ne se rendit qu’en dictant elle-même, pour ainsi dire, les conditions de sa capitulation.
Elle est devenue par la force des armes l’île anglaise. Elle est restée par ses affections l’île de France.
Il y a là des librairies où l’on ne trouve que des livres français, un théâtre où l’on ne représente que des pièces françaises, et dont l’orchestre a longtemps refusé de jouer le chant britannique : God save the king. Le nom de la Bourdonnais, le vrai fondateur de la colonie, est dans tous les cœurs, son portrait dans toutes les maisons, ses Mémoires dans toutes les bibliothèques.
Quand les créoles de cette terre poétique arrivent à nous ; par leur grâce native, par la beauté particulière de leur physionomie, ils nous représentent les vivantes images d’une fiction aimée. Ils sont du pays de Paul et Virginie. Ils ont grandi dans l’avenue des Pamplemousses, près du ruisseau des Lataniers. Par leur langage, leurs prédilections et leur esprit, ils sont Français. Nous devons croire qu’ils sont nés sur les bords de la Seine, et qu’ils y reviennent ayant fait un voyage sous le ciel d’or des tropiques.
Nous avons perdu vers le milieu du siècle dernier une autre colonie, dont nous ne pouvons sans émotion nous rappeler le dévouement et les souffrances : c’est l’Acadie, aujourd’hui la Nouvelle-Écosse. Celle-là aussi nous aimait et désirait garder notre drapeau. Quand elle fut abandonnée aux Anglais, elle se résignait à reconnaître leur pouvoir, mais, à aucun prix, elle ne voulait prendre les armes contre la France. Ni les promesses ni les menaces n’ayant pu vaincre sa résistance, le gouvernement anglais, redoutant de laisser cette inflexible population dans un pays où il n’avait alors que de faibles moyens de défense, prit une effroyable résolution.
En 1754, les villages acadiens furent livrés aux flammes, et, à la lueur de leurs toits embrasés, 7 000 Français furent entassés sur des navires et jetés comme de vils troupeaux sur les côtes de la Pennsylvanie, de la Virginie et de la Caroline, sans autres ressources que le peu de hardes et de provisions qu’ils avaient pu dérober aux ravages de l’incendie. On vit alors ces malheureux errant à l’aventure, repoussant les services de ceux qui parlaient la langue de leurs bourreaux, et ne se reposant que dans le wigwam des Indiens, qui, touchés d’une telle infortune, leur apportaient des aliments et les guidaient dans les forêts. Les Acadiens voulaient rejoindre la colonie française de la Lousiane. Ils voulaient se rallier à la bannière qui les avait abandonnés. Sans s’inquiéter de la longueur de la route, ni des dangers du voyage, ils allaient, dans leur sublime amour pour la France, à la recherche de cette terre habitée par des Français.
La moitié d’entre eux périt en route, sur les fleuves ou dans les marais. Les autres, après des fatigues inouïes, arrivèrent à la Lousiane, où ils furent accueillis avec une tendre commisération. Le gouverneur leur donna des instruments d’agriculture, leur assigna un terrain au bord du Mississippi. Là s’établit, à l’endroit qui a gardé le nom de côte des Acadiens, une colonie de laboureurs, dont les habitants se distinguent encore par la simplicité de leurs mœurs, par leur culte pour les anciennes traditions françaises.
Dans une de ses plus émouvantes compositions, Longfellow, le célèbre poète américain, a décrit la beauté champêtre de notre ancienne Acadie, les coutumes patriarcales de ses habitants, les oies innocentes de leurs foyers, puis le déchirement de cœur de ces braves familles, chassées de leurs villages par le fer et le feu, séparées l’une de l’autre dans leur exil, errant au hasard dans des régions inconnues, sans amis, sans asile, sans espoir (friendless, homeless, hopeless), et le religieux dévouement du prêtre, et l’angélique figure d’Évangéline, la fille du fermier.
Trois de nos colonies ont été ainsi illustrées par trois grands écrivains : l’Acadie, par Longfellow ; l’île de France, par Bernardin de Saint-Pierre ; la Louisiane, par Chateaubriand.
Elle voulait aussi rester attachée à la France, cette vaste terre des Natchez, des Chactas, baptisée du doux nom de Louisiane par la France, conquise par nos Lasalle, nos Iberville, nos Bienville, consacrée par l’enseignement de nos missionnaires et le sang de nos soldats.
Notre fatal traité de 1763 la cédait à l’Espagne. À cette nouvelle, un cri de douleur retentit dans toute la colonie. Une protestation contre cette incroyable cession fut aussitôt envoyée à Paris. Une vive résistance aux désirs de l’Espagne s’organisa sous la direction d’un groupe d’hommes énergiques. Le premier gouverneur espagnol, Antonio de Ulloa, courba la tête devant ce soulèvement et se retira. Son successeur arriva à la Nouvelle-Orléans avec 4 500 hommes. Que pouvait faire notre faible milice contre cette armée ? Elle se soumit. Mais cette soumission ne suffisait point au nouveau maître. Il fit arrêter quatorze des principaux habitants de la Nouvelle-Orléans, accusés, les malheureux ! d’une trop grande fidélité à la France. L’un d’eux fut tué au moment où il disait adieu à sa femme ; six autres, conduits dans la citadelle de la Havane ; et les sept derniers, condamnés à mort, exécutés.
En 1800, l’Espagne nous rendit cette belle colonie ; et en 1803, Napoléon, par une combinaison politique, la vendait aux États-Unis.
On sait par quels combats elle a essayé de rompre ses liens fédératifs. J’ai eu le bonheur de la voir avant cette lutte, où elle a versé tant de sang. Elle était alors riche et riante. En un clair et tiède automne, je m’en allais de village en village, partout admirant la magnificence de la végétation dans ces vastes plaines traversées par le Mississippi, et l’activité du mouvement industriel associé au labeur agricole. Partout aussi dans des mœurs héréditaires, dans des coutumes et des sympathies traditionnelles, je retrouvais les traces de la France ; et, à la Nouvelle Orléans, toute une population française occupant une place considérable dans les diverses classes de la société : ouvriers et rentiers, négociants et magistrats, de hauts fonctionnaires qui, dans leur élévation sur la terre américaine, se plaisaient à parler de la terre de France, et de grandes maisons où, au nom de ce pays aimé, on était accueilli avec une affectueuse courtoisie.
Autour de ces descendants de nos anciens colons, l’élément anglo-saxon est cependant plus actif et plus fort que dans le Canada.
Le Canada ! Jamais je n’oublierai l’impression que je ressentis en le visitant pour la première fois. Je venais de traverser une partie des États-Unis, qui, je dois le dire, ne m’avaient point converti à leur république. Après un dur trajet dans des wagons égalitaires, et sur des bateaux non moins égalitaires, après deux ou trois transbordements au milieu d’une foule tumultueuse et batailleuse, soudain quel changement ! Devant moi, dans des plaines paisibles, s’élèvent des maisons avec le jardin et l’enclos, comme on les voit en Normandie. À mes yeux apparaissent des physionomies dont je me plais à observer l’honnête et bonne expression ; à mes oreilles résonne l’idiome de la terre natale. Mon cœur se dilate ; ma main serre avec confiance une autre main. Je ne suis plus en pays étranger. Je suis sur le sol du Canada, dans l’ancien empire de nos pères. Quel empire ! De l’est à l’ouest, un espace de cinq cents lieues. À l’une de ses extrémités les profondeurs du golfe Saint-Laurent ; à l’autre le lac Supérieur, le plus grand lac de l’univers. Entre ces deux immenses nappes d’eau, des forêts d’où l’on peut tirer des bois de construction pour le monde entier, des pâturages, des champs de blé et de maïs, les rustiques loghouses des défricheurs le long des clairières, les riants villages, les villes superbes au bord des fleuves et des rivières, et toutes les œuvres de l’industrie et de la science moderne : chemins de fer, bateaux à vapeur, télégraphes. Cette belle contrée, trois fois plus étendue que l’Angleterre et l’Irlande, était à nous, et se rejoignait par le bassin du Mississippi à la Louisiane, conquise aussi par nous. Et de tout cela, plus rien à la France, pas le moindre hameau. Non. Mais la France est là vivante en un plus grand nombre de familles qu’au temps où elle avait là ses citadelles et ses gouverneurs. Sa conquête territoriale lui a été enlevée ; sa conquête d’affection s’est accrue par l’accroissement continu de la population. Entre Québec et Toronto, il y a maintenant 700 000 Canadiens d’origine française.
Qu’on se figure une de ces plantes dont un coup de vent emporte le germe sur une plage lointaine où il prend racine, où il se développe, où il produit des rejetons qui, peu à peu, s’élèvent au milieu d’un amas de plantes étrangères. C’est l’image de cette population française si petite d’abord, mais si ferme, qui a grandi entre les tribus indiennes, qui les a graduellement dominées, et qui maintenant conserve sous le régime britannique, dans les villes comme dans les campagnes, les traits distinctifs de sa nationalité ; dans les villes tout ce qui représente l’idée intellectuelle : écoles et musées, livres et journaux, des hommes instruits, des écrivains de talent et des salons où règnent encore ces habitudes de bonne grâce, d’exquise politesse dont la France a donné le modèle au monde entier.
Dans les campagnes, l’humble travail agricole de l’habitant, c’est ainsi que l’on désigne les descendants de nos anciens colons, comme si eux seuls résidaient à poste fixe dans le pays, comme si les Anglais et les Américains qui y sont venus successivement étaient seulement des passagers.
Et le fait est qu’il reste solidement établi dans sa ferme, cet honnête habitant. Si petite qu’elle soit, il ne pense point à la quitter ; il ne se laisse point séduire par tout ce qu’il entend raconter des fructueuses plantations en d’autres contrées, des spéculations du commerce et de l’industrie. Si petite qu’elle soit, il se plaît à la cultiver, content de vivre au lieu où il est né et de faire ce que son père a fait.
Si, en cheminant par les sentiers du bas Canada, vous rencontrez un de ces habitants, soyez sûr que, jeune ou vieux, le premier il vous saluera très poliment, et pour peu que vous témoigniez le désir de vous arrêter dans son village, il vous invitera à visiter sa maison, une très humble maison, mais très propre, les murs blanchis à la chaux et des fleurs sur les fenêtres ; point de meubles superflus ni de provisions luxueuses ; quelques jambons peut-être et quelques bouteilles de vin dans le cellier, pour les jours solennels ; nulle grosse somme dans l’armoire, mais certainement deux ou trois actes qui constatent la filiation de cet honnête paysan et son origine. Ce sont ses titres de noblesse. Il sait par là que son aïeul est venu de la Normandie ou de la Bourgogne, de la Bretagne ou de la Franche-Comté. Si vous pouvez lui parler de la province à laquelle se rattachent ses traditions de famille, il en sera très touché. Heureux philosophe ! La modération de ses goûts écarte de lui la griffe de l’avarice et de l’ambition. Ses habitudes d’ordre et de travail lui donnent le bien-être, sa croyance héréditaire, sa croyance religieuse lui assure la paix du cœur.
Nous devons rendre justice aux Anglais. En prenant possession du Canada, ils s’engageaient à respecter son culte, ses institutions, ses coutumes, et ils ont loyalement tenu leur promesse. Les seigneurs canadiens ont gardé leurs prérogatives, les fermiers leurs contrats, le clergé catholique ses dotations et ses privilèges. J’ai vu à Montréal une procession sortant de la cathédrale en grande pompe, et défilant entre deux lignes de soldats anglais, revêtus de leur uniforme de parade, debout et silencieux dans l’attitude la plus respectueuse.
Jadis notre empire canadien s’appelait la Nouvelle-France. En le voyant aujourd’hui avec ses lois, ses mœurs d’un autre temps et sa langue qui a gardé la sévère élégance du dix-septième siècle, nous pourrions bien l’appeler l’ancienne France, et j’ajouterais, la fidèle, la charmante France.
Hélas ! notre pays a bien souffert quand ces diverses colonies d’Asie, d’Afrique, d’Amérique lui ont été enlevées, et ces colonies, qu’il avait gagnées par sa sympathique nature plus que par ses armes, souffraient aussi d’être séparées de lui. Maintenant, quelle douleur plus cruelle que toutes les autres ! maintenant ce ne sont plus des régions étrangères, des peuplades lointaines qui doivent, par une guerre implacable, nous être arrachées, mais les deux belles branches de notre grand chêne, les deux nobles filles de notre monarchie, les deux chères sœurs de nos provinces ! Ô Dieu, quel déchirement et quel deuil !
Alsaciens et Lorrains condamnés à subir la loi de l’étranger, ils ne peuvent se soumettre à ce fatal arrêt ; ils abandonnent leurs champs, leurs foyers pour fuir le nouvel étendard qui flotte sur leur sol, pour garder leur liberté de souvenirs et d’affection. Comme des enfants effarés et éplorés, ils invoquent le secours de la France, leur mère ; ils désirent se réfugier dans son sein, et la France, éplorée comme eux, leur ouvre ses bras et s’efforce, par son amour, d’apaiser leurs angoisses.
Ah ! si elle devait jamais succomber, cette France qui a été de tout temps si brave et si humaine, qui a tant répandu de toutes parts ses sentiments inépuisables de bon vouloir, de justice et de commisération, si elle devait jamais succomber à la pression d’une force brutale, elle pourrait dire, comme la Thecla de Wallenstein, avec un noble et triste orgueil : « J’ai vécu ! j’ai aimé ! »
Mais la puissance d’attraction dont la Providence l’a douée lui donne une vitalité impérissable. En dépit de ses orages et de ses désordres, il faut qu’on l’aime, cette France généreuse ; il faut que, jusque dans les régions les plus éloignées, elle conquière sans cesse de nouvelles sympathies. Ceux que ses égarements révoltent, et ceux qui voudraient l’opprimer se sentent à tout instant séduits par son intelligence, subjugués par ses actes de courage et de dévouement.
Œuvres d’art et de science, vertus chevaleresques et religieuses, là est la gloire de son passé ; là doit être son soulagement dans ses dernières catastrophes, et son espoir dans l’avenir.
Ceux qui aiment les beaux et bons livres n’ont point oublié l’Histoire de Sixte-Quint, publiée il y a quelques années par M. le baron de Hübner ; une histoire prise aux meilleures sources, composée avec une lumineuse compréhension des hommes et des évènements du seizième siècle, écrite avec un vigoureux talent.
Cette œuvre finie, l’auteur, comme pour secouer la poussière des archives de Paris, Vienne, Venise, le Vatican, Simancas, où il avait compulsé tant de cartons, s’est mis à faire, par terre et par mer, un trajet qu’il appelle tout simplement : Promenade autour du monde. Nouveau livre, nouveau succès.
M. de Hübner n’est point de ceux qui, selon l’expression de Stern, peuvent aller de Dan à Beersheba, aux deux extrémités de la Judée, et dire en revenant : « Tout est désert. » Il a été aux extrémités du globe, s’intéressant à toute chose et nous rendant toute chose intéressante par ses jugements et ses récits. Il aime les voyages, et il possède les principales qualités du voyageur : la bienveillance qui attire la bienveillance, la bonne humeur qui aide à supporter les fatigues, l’art de bien voir et de bien dire, une curiosité infatigable et une activité juvénile.
Dès les premières pages de son livre, à la façon dont il décrit son embarquement dans un des ports de la verte Érin, au pied des collines fleuries, par un beau dimanche, on reconnaît l’homme de cœur et l’artiste. Puis le voilà sur le bateau de l’Atlantique, causant gaiement avec le capitaine, interrogeant avec un désir d’instruction les voyageurs des lointains pays, et s’arrêtant avec une charitable pensée près de ceux qui s’en vont au hasard chercher, par-delà l’Océan, un nouveau gîte ; Alsaciens fuyant le drapeau de la Prusse, Irlandais, Écossais, Allemands poussés à l’exil par la misère.
« Un vieillard octogénaire, beau type de patriarche, appuyé sur les bras de deux jeunes gens de bonne apparence, traverse le pont. Son maintien est digne, ses manières respectueuses. C’est un paysan anglais, un somersetman. "Sir, me dit-il, c’est bien tard pour émigrer. Mais je laisse la misère en Angleterre, et j’espère trouver au moins le pain dans le Nouveau Monde. Voici mes petits-fils, me montrant les deux jeunes garçons avec une expression de tendresse, de confiance, de fierté. Leur père et ma fille sont restés au village. Je ne les reverrai plus. " Et il se met à rire. Mais au moment où mon regard se tourne d’un autre côté, il passe la manche de sa jaquette sur ses yeux mouillés. »
À New York et à Washington, en voyant le luxe des financiers et les prétentions des fonctionnaires, bientôt M. Hübner reconnaît ce qu’il doit penser de ces beaux principes d’égalité proclamés avec tant d’emphase sur cette terre républicaine. M. le duc de Lévis écrivait, il y a cinquante ans : « J’ai connu des partisans outrés de l’égalité à qui il ne manquait qu’une généalogie pour être les plus vains de tous les hommes. »
M. de Hübner dit : « En Amérique, comme dans notre hémisphère, l’égalité n’est possible qu’en théorie… L’Américain a la soif de l’égalité et la manie des titres. Ceux qui peuvent s’appeler : sénateur, gouverneur, général, colonel, ne fût-ce que de la milice, et leur nombre est légion, sont constamment nommés par leur titre. On le leur prodigue à l’infini. Celui qui le donne et celui qui le reçoit se sentent également honorés. Quant aux titres nobiliaires, le fruit défendu des républicains d’Amérique, ils sont évidemment prononcés avec volupté. »
Plus loin, il dit encore : « Si vous voulez vous convaincre de l’inanité des rêves d’égalité, venez en Amérique. Ici, comme ailleurs, comme partout, il y a des rois et des princes. Il y en a toujours eu, et il y en aura jusqu’à la fin des temps. »
Dans ces rêves d’égalité, bien différent pourtant est le démocrate européen du démocrate américain.
Le démocrate européen, au lieu de chercher à atteindre graduellement, honnêtement le rang de ses supérieurs, désire les amoindrir et les rapetisser pour les mettre à sa hauteur, sinon plus bas. Il n’est pas apte à édifier. Il se réjouit de démolir. Les distinctions de naissance et de talent l’offusquent. Il essayera de les flétrir. La fortune qu’il ne peut gagner la révolte. Il tâchera de la détruire. Le temple l’irrite. Il y mettra le feu. L’envie et la haine, voilà ses mobiles. La destruction et le nivellement, voilà ses moyens d’égalité.
Le démocrate américain n’a point de vieilles institutions à combattre, ni de prérogatives héréditaires à supprimer. Devant lui seulement s’élève l’aristocratie financière. Qu’il amasse des dollars, il prendra sa place au sein de cette aristocratie. Il en aura le luxe, les jouissances, les titres honorifiques. Le but est attrayant. La tâche n’est pas impossible. Combien de pauvres petits marchands, d’ouvriers, de mercenaires qui, par un habile labeur ou par un heureux hasard, ont acquis d’énormes fortunes ! L’Amérique est si grande ! Il y a là tant de terres encore à exploiter, tant de nouveaux chemins à construire, tant de richesses souterraines à découvrir, depuis les bancs de houille jusqu’aux pépites d’or !
Dans cette immense arène, démocrates et aristocrates se rencontrent avec la même idée de lucre, auxiliaires ou adversaires les uns des autres. Go ahead ! dit le banquier de Wallstreet regardant d’un œil jaloux l’asservissement de fortune de son voisin. Go ahead ! dit le clerc de comptoir désireux d’être l’égal de son patron. Go ahead ! disent le mécanicien et le mineur rêvant qu’ils peuvent avoir un jour maison de ville et maison de campagne, chevaux et voitures. De là cette passion de l’argent enflammée par l’espoir du succès, cette incessante activité, cette lutte perpétuelle contre les rivalités, ces calculs audacieux et ces entreprises gigantesques qui, souvent, produisent d’effroyables désastres, mais souvent aussi des prodiges.
En la prenant dans sa généralité et au meilleur point de vue, M. de Hübner nous représente en termes éloquents cette ardente action de l’homme sur le sol américain, et ses conséquences morales.
« Dans le Nouveau Monde, dit-il, l’homme naît conquérant. Toute sa vie est une lutte constante, une concurrence forcée à laquelle il ne peut se soustraire, une course au clocher ouvrant, à travers de terribles obstacles, la perspective de gains immenses. Il ne veut, il ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu’il s’engage, et une fois engagé il faut qu’il marche et marche toujours, car, s’il s’arrêtait, ceux qui le suivent l’écraseraient sous leurs pas. Pénétrer dans les forêts vierges, y trouver des clairières qui serviront de route aux frères de la prochaine génération, transformer en terres labourables l’arène verdoyante des prairies, arracher à la barbarie les Peaux-Rouges, ce qu’il fait en les exterminant, créer les voies à la civilisation et au christianisme, vaincre enfin la nature sauvage et faire la conquête d’un nouveau continent, telle est la mission que la Providence lui a assignée.
Sa vie n’est qu’une vaste et longue campagne, une suite non interrompue de combats, de marches et contremarches. Les douceurs, l’intimité du foyer domestique ne trouvent que fort peu de place dans sa fiévreuse et militante existence. Est-il heureux ? À en juger par son air fatigué, triste, inquiet, on serait enclin à en douter. L’excès du travail non interrompu ne saurait convenir à l’homme. Il épuise sa force physique, il exclut la jouissance de l’esprit et le recueillement de l’âme.
Mais c’est la femme qui souffre le plus de ce régime. Elle ne voit son mari qu’une fois dans la journée, une demi-heure tout au plus, et le soir, quand, brisé de fatigue, il rentre pour chercher le sommeil. Elle ne peut alléger le fardeau qu’il porte, partager ses peines, ses soucis et ses travaux qu’elle ne connaît guère, puisque, faute de temps, le commerce des âmes existe à peine entre eux. Comme mère aussi, sa part à l’éducation des enfants est minime. Ils ignorent l’obéissance et le respect dus aux parents. Mais ils apprennent aussi à se passer de leur protection et à se suffire à eux-mêmes. Ils mûrissent vite et se préparent, dès l’âge le plus tendre, aux fatigues et aux luttes de la vie surexcitée, âpre et aventureuse qui les attend. »
C’est maintenant le Far-West qui attire les convoitises de la race anglo-saxonne. C’est là qu’elle a fait, depuis une trentaine d’années, les entreprises les plus étonnantes.
Les livres de M. Gregg et de M. Kindall, d’autres encore, nous ont appris à quelles fatigues, à quels périls s’exposaient les caravanes partant des rives du Missouri pour se rendre à Santa-Fé, dans le Nouveau-Mexique. Bien plus long, plus pénible, plus dangereux est le voyage de Saint-Louis à San-Francisco. Un espace de près de mille lieues à traverser par les prairies inhabitées, par les montagnes Rocheuses, par de longues plaines arides, où l’on ne trouve pas même une source d’eau pure, par les forêts où campent les Indiens sauvages.
En 1847, Brigham Young, expulsé de l’Illinois, conçut l’idée d’aller chercher, dans la vallée de l’Utah, un refuge pour les Mormons, dont il était devenu le chef après la mort de Joë Smith. À cette époque, quelques trappeurs seulement connaissaient ce bassin du lac Salé, situé à environ cinq cents lieues de Saint-Louis.
Quelques années plus tard, des légions d’hommes circulent dans ces prairies naguère si délaissées. Des caravanes s’avancent intrépidement vers les terrains de chasse des Cheyennes et des Sioux. Un Américain, en quête d’une grande affaire, apprend que certaines denrées sont fort désirées aux mines du Colorado ou dans la vallée de l’Utah. Aussitôt il se hâte de se les procurer ; il achète cinquante ou soixante légères voitures, des bœufs tant qu’il en faut, douze bœufs au moins pour chaque véhicule, des mules et des chevaux pour les bagages et conducteurs. Il soudoie une centaine de charretiers, choisit un homme résolu pour gouverner son entreprise, et la caravane est organisée, caravane du désert américain bien autrement aventureuse que celle des chameliers de l’Orient ou des wagons des pampas. Arrivera-t-elle au but ? Nulle compagnie d’assurance n’oserait en prendre la garantie. Elle part pourtant à tout hasard, et s’en va, faisant à peu près quatre à cinq lieues par jour. Vers midi, elle s’arrête pour dîner et laisser paître les troupeaux. Le soir, on campe près d’une source d’eau douce. Toutes les voitures, alors, sont rangées en cercle et enclavées l’une dans l’autre de façon à former un solide retranchement. Les hommes coupent du bois ; les femmes allument du feu, préparent le souper. Les jeunes gens vont à la recherche du gibier, et quelquefois rapportent un buffle ou une antilope. Le souper fini, les bœufs qu’on a mis en liberté sont ramenés au campement et enfermés dans l’enceinte des voitures. Le matin on est debout, avant l’aube, à l’œuvre pour remettre les chariots à la file l’un de l’autre, former les attelages, et en marche aux premiers rayons du soleil.
En cheminant ainsi régulièrement, la caravane n’emploie pas moins de quatre-vingt-dix jours à se rendre des bords du Missouri dans la vallée de l’Utah. Sur cette longue route, en toute saison, que de souffrances et de périls ! En été, les chaleurs suffocantes et les serpents à sonnette ; en hiver, les tourbillons de neige et les loups ; en tout temps la race indienne, furieuse de cette invasion des blancs, épiant, pour les piller ou les détruire, ces insolents convois.
Les charretiers doivent être habitués au maniement des armes, et constamment prêts à faire usage de leurs fusils et de leurs revolvers. Malgré leurs précautions stratégiques et leur courage, un grand nombre d’entre eux sont pris par les Peaux-Rouges, dévalisés et scalpés.
Après ces audacieuses caravanes, les Américains ont organisé, entre New York et San Francisco, un service de malle-poste encore plus audacieux. M. H. Dixon, l’excellent écrivain, a été chercher dans l’Arkansas la voiture à laquelle le chemin de fer de Chicago livre les dépêches destinées à l’Ouest lointain, et dans son humour britannique il en fait un étrange tableau.
« Un vieux coche délabré d’une forme inconnue en Europe. On peut avoir une idée de la difformité incommode de ce vieux carrosse, en se figurant une diligence française dont on aurait supprimé le coupé et exagéré la rotonde, de façon à permettre à l’entrepreneur de la déclarer assez large pour neuf personnes. À notre arrivée, cette voiture était remplie de sacs de lettres (il y en avait quarante-deux quintaux), dépêches officielles, billets d’amour, factures, comptes de banque, toutes sortes de missives agréables ou douloureuses pour une foule de gens : chefs de famille, épouses et jeunes filles, commis et maîtres, artisans et capitalistes.