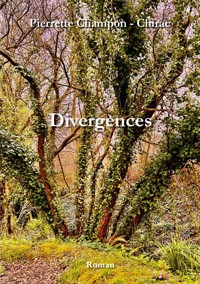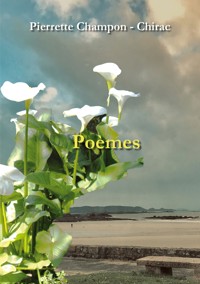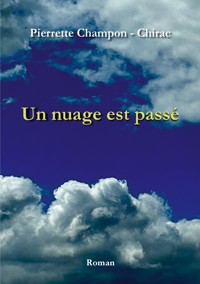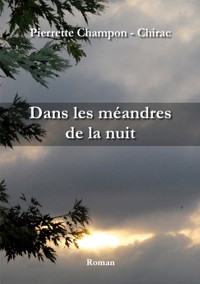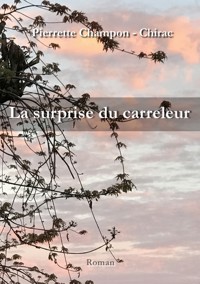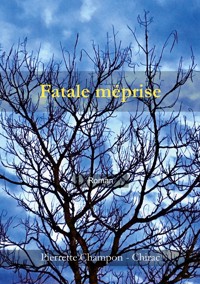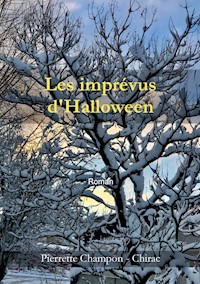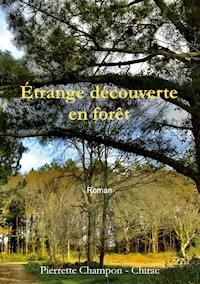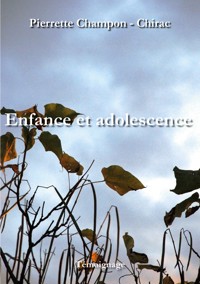
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
À travers les souvenirs d'une enfance marquée par la rigueur des années 40, ce récit de Pierrette Champon-Chirac nous plonge dans un monde où l'éducation sous l'autorité des religieuses forgeait les esprits et où la vie d'antan suivait un rythme bien différent du nôtre. Entre traditions, discipline et petits bonheurs simples, cette biographie promet un retour émouvant et captivant vers une époque où chaque instant d'apprentissage façonnait les destinées.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes enfants Erick et Diane
À mes petits-enfants Charlotte, Hippolyte, William
À mes arrière-petits-enfants Clément, Emma, Killian
Malgré quelques souvenirs parfois teintés d’amertume, je demeure fière d’avoir fréquenté l’école Saint-Joseph, de deux ans et demi jusqu’à quinze ans. Je remercie mes parents d’avoir fait le choix de me confier aux religieuses, car c’est par l’éducation que l’on façonne un enfant, lui offrant les armes nécessaires pour affronter les aléas de la vie. Cette éducation s’élabore à la croisée des chemins, entre l’école et la maison, dans une complémentarité essentielle entre enseignants et parents.
À l’école des sœurs, j’ai appris bien plus que des connaissances académiques : j’y ai assimilé des valeurs fondamentales telles que la discipline, l’assiduité, l’exactitude, la politesse, le respect, la propreté et l’application. On m’a inculqué la notion du travail bien fait, du devoir accompli avec rigueur et conscience. Sous l’égide de la religion, j’ai également reçu une éducation morale, une boussole intérieure destinée à me guider sur le chemin de la vie. Si parfois la sévérité des religieuses m’a semblé pesante, avec le recul, je comprends que l’éducation exige de la fermeté, une autorité bienveillante, mais intransigeante, nécessaire pour placer les enfants sur la voie de la droiture et de l’effort.
Aujourd’hui, cette exigence semble s’être effacée devant une société où l’autorité, aussi bien familiale que scolaire, vacille sous le poids des contestations. Dans un monde où les enseignants doivent désormais composer avec la crainte des reproches parentaux et des blâmes administratifs, où toute forme de sanction est perçue comme un abus plutôt que comme un apprentissage, comment transmettre des repères solides aux jeunes générations ? Faut-il céder au laxisme, sous prétexte d’une liberté mal comprise ? Laisser-faire devient parfois la seule option possible, au détriment des résultats, au risque de voir se diluer des valeurs autrefois fondamentales.
Les religieuses, elles, ont agi selon leur conscience, portées par leur mission éducative et spirituelle. Mes parents ont suivi les mêmes principes à la maison, en accord avec les maîtresses, sans jamais chercher à contester leur autorité. Ils savaient que l’éducation est une œuvre conjointe, un équilibre entre rigueur et affection, entre exigence et transmission. Et pour cela, je leur en suis profondément reconnaissante.
Quand on est enfant, on juge souvent ses parents et ses éducateurs avec une sévérité inconsciente, persuadé que leurs décisions sont arbitraires, leurs interdits injustes et leurs exigences excessives. On se promet parfois de faire autrement, de ne pas reproduire certaines attitudes, convaincu qu'on saura mieux faire. Puis, un jour, en passant de l’autre côté de la barrière, on mesure pleinement la complexité de la tâche. Être parent ne s’apprend pas dans les livres ni sur les bancs d’une école. C’est une aventure semée de doutes et d’épreuves, où l’on avance tant bien que mal, porté par l’amour et la volonté de bien faire.
Papa et maman ont fait de leur mieux, comme tant d’autres avant eux, en s’appuyant sur les valeurs de leur époque, sur leur intuition et leur propre vécu. Ils n’étaient pas parfaits, mais qui peut se targuer de l’être face à une mission aussi immense ? Aujourd’hui, avec le recul, je mesure tout ce qu’ils ont accompli, tout ce qu’ils ont sacrifié pour m’offrir une enfance sécurisée et un avenir solide.
Je leur dois d’autant plus de reconnaissance qu’ils ont eu le courage, à 25 ans, de tout recommencer. Ce choix, si difficile à faire, a changé ma vie. Grandir à Réquista n’a pas été un simple déménagement, mais une nouvelle page écrite pour notre famille. C’est là que j’ai appris à m’ancrer, à comprendre ce que signifie réellement le mot « foyer ». C’est là que j’ai puisé mes premiers repères, que j’ai trouvé ma place dans un monde qui, grâce à eux, m’a semblé plus rassurant.
Aujourd’hui, je les considère avec un profond respect. Ils ont fait ce que chaque parent tente de faire : donner le meilleur d’eux-mêmes, avec les moyens du bord, avec leur cœur, avec leurs doutes et leurs espoirs. Et pour cela, ils méritent toute ma gratitude.
« Lorsque j’étais petit et que Mamy Pierrette me gardait, elle me racontait une histoire pour m’endormir, l’histoire de son enfance, une histoire tellement bizarre que je croyais qu’elle inventait au fur et à mesure. Mais pas du tout, elle était vraie. J’ai beaucoup appris sur la façon dont elle avait été éduquée. Pauvre Mamy ! »
Hippolyte
Table des chapitres
Chapitre 1- Le récit du petit-fils Hippolyte
Chapitre 2 - La jeunesse de Robert
Chapitre 3 - L’exode
Chapitre 4 - De Gaillac à Requista
Chapitre 5 - La famille se retrouve
Chapitre 6 - L’école Saint-Joseph
Chapitre 7- Les restrictions
Chapitre 8 - Événement inoubliable
Chapitre 9 - Retour dans les Vosges
Chapitre 10 - Au cours élémentaire
Chapitre 11 - Approche de la religion
Chapitre 12 - Le cinéma
Chapitre 13 - L’oncle Pierre
Chapitre 14 - Déménagement
Chapitre 15 - La Simca cinq
Chapitre 16 - Au cours moyen
Chapitre 17 - Les ennuis commencent
Chapitre 18 - Au cours supérieur
Chapitre 19 - Les cours d’anglais
Chapitre 20 - L’embrigadement
Chapitre 21 - Les vacances
Chapitre 22 - Le BEPC
Chapitre 23 - Les années de pension
Chapitre 1
Le récit du petit-fils Hippolyte
Avant de mettre son récit par écrit, Mamy a tenu à me confier un précieux souvenir : son enfance qui fut un véritable cocon de douceur, bercée par l’amour attentif de ses parents qui la choyèrent avec tendresse. Elle évoquait avec reconnaissance ces années, où les maîtresses d’école, sévères, mais dévouées, n’avaient d’autre ambition que de lui transmettre le meilleur. Elle ne regrettait en rien l’éducation qu’elle avait reçue, convaincue qu’elle lui avait inculqué les valeurs essentielles pour mener une vie de droiture. Avec un sourire empreint de sagesse, elle concéda néanmoins qu’éduquer un enfant était un défi permanent, une alchimie délicate où chacun avait sa propre recette, avec plus ou moins de succès…
Mamy a ouvert les yeux sur le monde un matin du 27 mars 1939, à Sapois, un petit village niché au creux des Hautes Vosges, à deux kilomètres de Vagney et une dizaine de kilomètres de Gérardmer. À peine née, déjà entourée d’attentions, elle vit se pencher sur son berceau des visages curieux, avides de lui trouver des ressemblances. Les avis divergeaient : certains disaient qu’elle tenait de son père, d’autres de sa mère, mais un détail ne faisait aucun doute - ses yeux, d’un bleu vert, héritage incontestable de Robert, son père, et de toute sa lignée paternelle, dont les prunelles semblaient refléter les ciels limpides des montagnes vosgiennes.
On lui donna le prénom de Pierrette. Était-ce en hommage à son grand-père, Pierre Jacquet, le maréchalferrant du village ? L’explication, bien plus tendre, vint plus tard, murmurée par sa mère : « C’est parce que tu étais ma petite pierre précieuse. »
Le printemps s’était installé timidement depuis quelques jours, faisant éclore ses premières merveilles. Dans les prés, les jonquilles dressaient leurs corolles éclatantes, éclairant le vert tendre des prairies d’une parure dorée. L’air était encore frais, chargé des parfums humides de la terre au réveil. Mamy, serrée dans ses langes, ouvrait de grands yeux sur ce monde nouveau. Impuissante encore à remuer ses petites jambes emmaillotées, elle semblait pourtant déjà observer avec intensité ce décor naissant, comme si elle cherchait à deviner le destin que la vie lui réservait.
Elle était choyée, couvée du regard et entourée de mille attentions, autant qu’un enfant nouveau-né pouvait l’être. Chaque sourire, chaque éclat de rire de sa part était un trésor pour ses parents. La famille vivait dans une maison en bordure de la rue principale qui traversait le village.
Derrière la maison, la fontaine chantait sans relâche, déversant son eau limpide et glacée dans un large bassin de pierre, une eau pure, directement puisée au cœur des montagnes. Plus loin, un pré s’étirait en pente douce vers la rivière où les enfants, armés de baguettes, de bouts de ficelle avec des hameçons de fortune, s’amusaient à pêcher des goujons et à traquer les grenouilles, sous l'œil amusé des adultes.
On raconte que Mamy, malgré sa douceur enfantine, avait un caractère bien trempé. Une jalousie farouche l’animait dès qu’elle voyait sa maman prendre dans ses bras Jacky, le fils de sa sœur. À ces moments-là, rien ne pouvait la consoler : elle tirait rageusement sur la robe de sa mère, trépignait sur place, ses petites mains serrées en poings, et son visage se colorait d’une fureur écarlate. Sa maman riait devant cette adorable emportée, excitant même sa jalousie pour la porter au paroxysme...
Elle devait presque avoir deux ans et demi lorsqu’un jour, derrière la maison, elle surprit un spectacle inédit. Sa grand-mère, les manches retroussées jusqu’aux coudes, lavant le linge dans un grand baquet d’eau mousseuse. Mamy s’arrêta, fascinée. Elle n’avait jamais vu « Mémère » à l’œuvre ainsi, ses bras blancs glissant sur le tissu, frottant inlassablement le linge sur une planche de bois immergée. À chaque pause, malgré l’effort, la vieille femme levait les yeux et gratifiait sa petite-fille d’un sourire complice.
Mais la curiosité de Mamy ne s’arrêta pas là. Tandis que sa grand-mère, concentrée sur sa tâche, s’éloignait un instant pour étendre une chemise au soleil, elle eut une idée brillante… ou désastreuse. Son ours en peluche, rouge éclatant, n’avait-il pas besoin, lui aussi, d’un bon bain ? Sans hésiter, elle le plongea dans l’eau savonneuse. Catastrophe !
L’eau du baquet se teinta aussitôt d’un rouge trouble, avalant sans pitié la couleur de son compagnon de jeu. Immédiatement, un frisson d’effroi la parcourut. Que dirait Mémère en voyant cela ? Son cœur tambourinait dans sa poitrine alors que son grand-père, témoin silencieux de la scène, s’approcha en hochant la tête, un sourire en coin. D’un geste tranquille, il repêcha la peluche détrempée, mais dans quel état ! L’ours ruisselait misérablement, sa fourrure, autrefois éclatante, désormais terne et délavée.
D’un air grave, le grand-père l’accrocha par les oreilles avec deux pinces à linge sur le fil, où il pendit lamentablement, comme un malheureux condamné au séchage. Mamy, désemparée, se laissa tomber sur l’herbe et éclata en sanglots. Elle n’avait pas voulu lui faire de mal ! Et pourtant, à cause d’elle, son ours ne retrouverait jamais son rouge éclatant. Ce fut l’un de ses premiers chagrins, de ceux qu’on n’oublie pas, même en grandissant.
Mamy m’a aussi raconté qu’en 1941, une moitié de la France était occupée par les Allemands. La Deuxième Guerre mondiale faisait rage, et le danger était omniprésent. Dès qu’un avion ennemi tournoyait audessus de la région, une alerte était donnée, et les habitants descendaient précipitamment à la cave, serrés les uns contre les autres dans l’obscurité moite, retenant leur souffle à chaque vrombissement sinistre dans le ciel. L’air y était lourd d’angoisse et de terreur, mêlé à l’odeur du salpêtre et des corps blottis les uns contre les autres.
Elle se souvient particulièrement d’un soldat allemand qui venait s’abriter avec eux. Il n’était pas comme les autres, il n’avait pas ce regard dur et impénétrable des hommes en uniforme. Un jour, il avait voulu la prendre dans ses bras, troublé par la ressemblance frappante entre elle et sa propre fillette restée en Allemagne. Mais Mamy, pétrifiée par la peur, s’était aussitôt réfugiée derrière sa mère, incapable d’oublier que sous cet air bienveillant, il portait l’uniforme de l’ennemi. « Moi aussi, j’aurais eu peur de cet Allemand, même s’il paraissait gentil ! »
Chapitre 2
La jeunesse de Robert
Les souvenirs de cette époque sont rares, non seulement parce que le temps a passé, mais aussi parce que le père de Mamy, le seul à posséder un appareil photo, avait été mobilisé. Il n’était plus là pour immortaliser les instants du quotidien, laissant derrière lui une famille qui survivait comme elle le pouvait. Sa mère, comme presque toutes les femmes du village, travaillait à l’usine de tissage, accompagnée de sa sœur Lucienne. Là-bas, le bruit assourdissant des métiers à tisser résonnait du matin au soir, une symphonie mécanique implacable qui dictait le rythme des journées.
Dès l’âge de douze ans, les enfants étaient envoyés à l’usine à la sortie de l’école. Il n’y avait pas d’autre choix : on obéissait aux parents, on obéissait à la sirène qui hurlait à l’aube, annonçait la pause de midi et sonnait la fin de la journée. Huit heures de travail, six jours sur sept, avec pour seule trêve le dimanche, où le village retrouvait un semblant de vie.
« J’ai eu la chance de ne pas connaître cette époque ! pensais-je en l’écoutant. Les jeunes de ma génération ne se rendent pas compte du confort qu’ils ont, libres de choisir leur avenir, de rester chez leurs parents aussi longtemps qu’ils le veulent, sans rien avoir à donner en retour. »
Dans l’atelier, les apprentis étaient placés sous l’aile d’un ouvrier chevronné qui leur enseignait l’art exigeant du tissage. Il fallait une vigilance constante pour surveiller quatre, parfois six métiers, puis 24 à la fois. Un seul fil cassé, et c’était tout l’ouvrage qui risquait d’être gâché. Il fallait alors détisser minutieusement la partie défectueuse, une perte de temps précieux, car le salaire dépendait du nombre de mètres de toile produits.
Le vacarme était assourdissant. Trois cent soixante machines en mouvement, un tonnerre métallique ininterrompu qui contraignait les ouvriers à communiquer par gestes, développant un langage silencieux propre à l’usine. Pas de casque pour atténuer la cacophonie, pas de précaution contre la poussière de coton qui flottait en permanence dans l’air, s’accrochant aux cheveux, à la peau, aux vêtements et s’infiltrant insidieusement dans les poumons. Beaucoup finissaient leur carrière à moitié sourds, la respiration sifflante.
Et c’est dans cette usine que Robert, mon arrièregrand-père, entre en jeu dans l’histoire de notre famille…
Même si le récit risque de sembler un peu long, je ne peux me résoudre à omettre aucun des traits de caractère de mon arrière-grand-père ni les événements qui ont marqué sa vie, ceux qui l'ont poussé à quitter ses Vosges natales, cette terre qui portait en elle les racines profondes de ses ancêtres, ancrés là depuis des siècles. Il semblait, lui aussi, indéracinable, comme un vieux sapin de la forêt, mais en réalité, son destin a été tout autre. Son enfance, je le reconnais, m'a profondément bouleversée.
À 12 ans, il obtient son certificat d’études. Ce diplôme, je n’en avais jamais entendu parler, mais il paraît qu’il équivalait, à l’époque, à ce que nous appelons aujourd’hui le baccalauréat. Un passage obligé pour celui qui voulait prouver son érudition, son aptitude à saisir les complexités du monde. Pour l’obtenir, il fallait non seulement une maîtrise irréprochable de l’orthographe, de l’histoire et de la géographie, mais aussi un esprit acéré capable de résoudre des problèmes complexes où des bassins se vidaient, des trains se croisaient et des calculs minutieux étaient nécessaires. Il fallait aussi connaître les chants patriotiques, ce qui, en ces temps, n’était pas qu’une simple question de musique, mais d’honneur et d’engagement.
Cependant, à 12 ans, à peine son certificat en poche, son père, inflexible, ne lui accorde même pas un seul jour de repos. Il le fait embaucher, contre sa volonté, dans une scierie. Cette région, dense de forêts de sapins, abritait de nombreuses scieries, où l’on découpait le bois pour en faire des planches. Mon arrièregrand-père se retrouvait là, enfant encore, à scier de lourdes planches, qu’il transformait en caisses, des objets à la fois utilitaires et symboliques de son travail acharné. Il partait de chez lui à vélo, dès l’aube, sa musette au dos, ne contenant qu’un maigre repas qu’il mangeait sur place, sous la pluie ou sous le soleil, sans jamais se plaindre. Les journées de travail, interminables, duraient huit heures, et l’âme des enfants, comme celle de mon grand-père, n’était guère épargnée. Les enfants de la région étaient traités durement : leur salaire, aussi maigre fût-il, était immédiatement remis aux parents, sans le moindre retour pour euxmêmes. Et quand le salaire devenait insuffisant pour subvenir aux besoins familiaux, son père trouvait un autre patron, plus exigeant encore, et ainsi de suite.
Dans cette fratrie, il n’était pas le seul à être en prise avec l’avenir. Son demi-frère, plus âgé, eut la chance d’entrer en apprentissage chez un horloger à Nancy, une chance qui allait profondément changer le cours des choses. Dans cette ville, il apprit le métier d’horloger, mais bien plus que cela. Il développa une passion pour la technique, la précision et la mécanique. Cette expérience, il la transmit généreusement à Robert. Ensemble, ils s’initient à un domaine nouveau, fascinant : la radio, et au cinéma. Ils s’improvisent ingénieurs et créateurs, fabriquant une caméra et un projecteur, qu’ils utilisaient pour tourner leurs propres films comiques. Un projet qui leur valut une reconnaissance locale. Ils projetaient leurs films dans le café du village, rendant à la simple projection une forme de magie. Leur réputation grandit, et bientôt, Robert réussira à arrondir ses fins de mois en capturant des instants de vie pour les familles, immortalisant des sourires et des souvenirs dans des photographies, tout en continuant à rêver d’autres inventions.
Une loi, qui fait passer la semaine de travail de 48 à 40 heures, offre enfin aux ouvriers un jour de congé supplémentaire. Jusque-là, leur unique jour de repos était le dimanche, bien maigre consolation après une semaine épuisante. Robert, met à profit ce temps libéré du samedi pour apprendre à conduire auprès du garagiste du village. À l’époque, les premières voitures commencent tout juste à circuler, symboles d’une époque qui bascule. Quelques séances suffirent à Robert pour obtenir le fameux permis, un précieux sésame qu'il décrocha avec une facilité étonnante.
« De nos jours, obtenir ce permis exige une multitude de leçons, souvent très coûteuses, et rares sont ceux qui l’obtiennent du premier coup ! »
À 20 ans, après une adolescence marquée par le travail, et une jeunesse à la fois morne et éclairée par les heures passées à bricoler avec son frère André, Robert ressent un grand vide intérieur. Les connaissances techniques qu'il a acquises en réparant tout ce qui pouvait être réparé n'ont pas suffi à combler ce sentiment de lassitude. Il veut s’échapper de cette existence monotone, mais comment ? Le quotidien dans l’usine de tissage, où il est réduit à obéir aux exigences d’un patron insensible et aux rouages d’une machine déshumanisante, n’a plus de sens pour lui. Il attend le moment favorable pour se libérer de cette existence terne, en quête d’un sens, d’une vie meilleure.
Robert a de grandes ambitions, des rêves qui ne peuvent se satisfaire d’un quotidien aussi étouffant. En avril 1935, à 21 ans, après avoir passé le conseil de révision, il est déclaré apte pour le service militaire. L’armée l’envoie à la caserne de Dijon. Être éloigné de sa famille, obéir aux ordres des supérieurs, marcher au pas, faire son lit au carré, franchir le mur du combattant, tout cela semblait être un univers à part. Mais pour lui, cette discipline, cette hiérarchie, n’étaient rien de nouveau. Depuis son enfance, il avait appris à obéir, d’abord à ses maîtres d’école, puis à son père et à ses patrons. Ce monde n’était donc qu’un autre pas de plus dans une existence qu’il connaissait déjà bien.
Après trois mois de classes, entre exercices et manœuvres d’armement, Robert est affecté au service photographique de l’armée. Un choix qui, contre toute attente, lui convient parfaitement. La photographie, un domaine qu’il avait toujours trouvé fascinant, devient pour lui une véritable bouffée d’air frais.
En octobre 1936, après 18 mois de service, il est libéré de ses obligations militaires. À son retour, une nouvelle opportunité s’offre à lui : les usines Peugeot de Sochaux recherchent de la main-d’œuvre. Robert s’y rend immédiatement et passe les tests. Les résultats sont positifs, tout comme l’entretien avec le formateur. Il quitte avec soulagement le carcan de l’usine de tissage pour rejoindre Sochaux, un premier pas vers la liberté, un premier pas vers son avenir. Son salaire horaire grimpe considérablement, passant de 2,5 F à 5,45 F. Il loge et prend ses repas à l’hôtel Peugeot. Ce changement de situation est un véritable tremplin pour lui.
Affecté au service électrique, Robert se trouve enfin dans un environnement où il peut prendre des initiatives, plutôt que de se soumettre aveuglément aux exigences d’une machine. Ce nouveau défi l’excite. Il se présente à un examen pour devenir professionnel, et son salaire horaire s’élève encore à 8 F. Mais, au-delà de l’aspect financier, cette évolution symbolise surtout un accomplissement personnel. En automne 1938, il épouse Suzanne dans l’église de Vagney. Avec leurs économies, ils achètent le nécessaire pour meubler leur foyer : chambre à coucher, buffet, table et chaises, vaisselle, linge… Tout ce qui fait le début d’une vie à deux.
À partir de ce moment-là, Robert rentre chaque week-end près de sa femme, pour goûter à la tranquillité d’un foyer qu’il avait tant désiré. Au printemps 1939, Mamy vient au monde, un bonheur tout neuf, une source d’optimisme pour l’avenir. Enfin, il semble que les jours heureux soient venus pour la petite famille. Robert imagine sa vie pleine de projets. Mais le destin en décide autrement.
Le 28 août 1939, un ordre de mobilisation partielle le rappelle à Dijon. Mamy n’a que cinq mois. Les rumeurs de guerre se font entendre, mais personne n’imagine encore l’ampleur de ce qui va se jouer. La France insouciante continue à vaquer à ses occupations quotidiennes. Robert et ses compagnons sont affectés à des travaux inutiles : creuser des tranchées dans la boue. Cinq jours passent ainsi, sans qu’ils ne sachent pourquoi on les prive de toute information. C’est un enfant du village voisin, courant à perdre haleine, qui leur apprend la terrible nouvelle : la guerre est déclarée. Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne, et, deux jours plus tard, la France et l’Angleterre déclarent la guerre.
Mais rien ne change pour ces hommes, qui continuent à végéter dans ce campement sans savoir pourquoi. Ce n’est qu’un peu plus tard que Robert reçoit une autre nouvelle : les usines Peugeot, en manque de main-d’œuvre qualifiée, l’appellent à reprendre son poste. C’est une aubaine pour lui, une chance inespérée, mais cette situation ne dure pas longtemps. Le 10 juin 1940, les troupes allemandes envahissent le territoire français. La panique s’empare des habitants, qui ne savaient pas comment la guerre allait se terminer. La fuite précipitée vers le sud, l’incertitude totale… Ces instants de confusion marqueront à jamais la mémoire de Robert.
Chapitre 3
L’exode
Le 3 juin, il reçoit son troisième ordre de mobilisation, avec l’obligation de quitter Sochaux dans la précipitation et de se rendre à la base aérienne de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Le pays est en guerre, et les heures se comptent. Il a juste le temps de passer dire au revoir à sa famille, un au revoir lourd de sens, tout en se demandant, avec une angoisse sourde, reverra-t-il ceux qu’il aime ?
« Et voilà que la situation se complique, car en un clin d’œil, il va parcourir des distances considérables, s’éloignant de plus en plus de ses proches, et j’imagine l’inquiétude grandissante, celle qui s’empare de lui, mais aussi de Suzanne, qui se retrouve seule, avec Mamy toute petite. »
Tout va aller si vite, comme un enchaînement inéluctable de catastrophes.
Le 14 juin, il se rend à la gare de Vagney, mais l’attente est vaine. La gare d’Épinal, récemment bombardée par l’aviation allemande, a été réduite en ruines. Le train, qui devrait normalement le mener vers le sud, est désormais hors d’atteinte. Par ailleurs, tous les hommes reçoivent l’ordre de se rendre à Beaune en Côte d’Or, à une quarantaine de kilomètres au sud de Dijon. Mais qui a émis cet ordre ? Qui est responsable de ce chaos ? Il se rend à la gendarmerie, mais à son arrivée, les gendarmes ont déjà pris la fuite, les premiers à fuir, abandonnant la population à son sort. Le sentiment d’insécurité est palpable, comme un poison qui se répand dans la ville, envahissant les esprits. L’angoisse devient collective. Les autorités ont déserté, laissant les gens livrés à eux-mêmes, sans réponse aux questions essentielles : Où sont les Allemands ? Et où faut-il fuir ?
Tout le monde est en proie à une angoisse irrationnelle. La panique se diffuse comme une traînée de poudre. La débandade est totale. Les trains, désormais cibles évidentes pour l’aviation ennemie, sont inutilisables. Les quelques chanceux qui possèdent encore un véhicule prennent la route, roulant à toute allure dans une mer de poussière et de détresse. Les autres, les malheureux sans voiture, n’ont d’autre choix que de marcher, hagards, les yeux pleins d’effroi, se dirigeant vers le sud dans une fuite éperdue.
« J’imagine l’impuissance des habitants, paralysés par la peur, ne sachant où aller, cherchant un chemin dans cette nuit d’incertitude. Quelle désolation ! Ce n’est pas un film, c’est la réalité brute ! »
L’oncle Eugène, au cœur de ce tumulte, fait une offre inespérée. Il invite son neveu à monter dans sa voiture, avec d’autres personnes. À l’arrière, ils sont entassés comme du bétail, mais au moins, ils ne sont pas forcés de marcher. Ils quittent la ville dans la soirée, s’enfonçant sur une route saturée de monde. Des files interminables d’hommes, épuisés, au regard perdu, avancent à un rythme douloureux. Ces malheureux regardent les véhicules qui passent, remplis de gens, et un sentiment de frustration rageuse les envahit. Un homme, perdant toute contenance, frappe violemment le capot de la voiture, lançant des insultes à la volée envers les occupants, ces privilégiés qui ne sont pas à pied.
La nuit du 14 au 15 juin 1940 est une nuit d’horreur, où l’angoisse et la fatigue se mêlent. L’avancée vers Dijon devient de plus en plus difficile. La route est bloquée, non seulement par des véhicules, mais aussi par des femmes, des enfants, des vieillards, tous fuyants dans un chaos organisé uniquement par la peur. Les femmes, les bras chargés d’enfants, semblent désemparées. Les pleurs des enfants, assoiffés et affamés, déchirent l’air. Les vieillards, eux, avancent lentement, leurs pas hésitants, ralentissant le mouvement de la foule. La voiture, poussée par un moteur fatigué, avance par à-coups, serrée entre des files humaines qui n’ont plus de direction. À chaque halte, les regards des voyageurs croisent ceux des marcheurs, une douleur partagée, et la honte s’insinue dans leur cœur, car, malgré tout, ils ont la chance de rouler, de ne pas être à pied.
Des éclats lumineux illuminent le ciel au loin, probablement des bombardements. Les hommes, démoralisés, sans repères, sont désormais entremêlés avec les réfugiés, eux aussi fuyant l’horreur, emportant leurs biens les plus précieux, dans un élan de survie collective. La nuit semble infinie.
L'exode concerna dix millions de personnes, une vague humaine dévastatrice, un exode chaotique où des familles entières abandonnaient tout ce qu’elles avaient pour fuir vers le sud, dans l’espoir d’échapper à l’inconnu.
« Je n’aurais pas voulu vivre la situation de Robert, pourtant chanceux d’être dans la voiture de son oncle, un peu à l’abri de ce tumulte. »
Après une nuit interminable à rouler sur des routes encombrées, ils arrivent enfin à Dijon, juste au moment où le jour commence à poindre. La ville, elle aussi, est prise dans le tourbillon de la peur : des foules s’agglutinent sur les quais, les habitants de Dijon terrifiés, tentent de fuir vers le Midi, se bousculant, se pressant comme des moutons pris dans un enclos.
Dans cette folle ruée vers le sud, où chaque individu lutte pour sa place, Robert parvient à se faufiler tant bien que mal dans un wagon à bestiaux, avec une multitude d’autres hommes, entassés dans des conditions déplorables. Il se dit que, malgré tout, il a eu la chance d’obtenir une place, même si elle est loin d’être confortable. Les regards envieux des malheureux qui courent encore sur les quais vers les trains bondés ne font qu’ajouter à la tension ambiante. Il se sent pris dans un tourbillon d’incertitude, où chaque minute qui passe alourdit l’atmosphère de désespoir. Le train roule dans une lenteur insupportable, s’arrêtant sans cesse, repartant comme un vieux train fatigué, offrant à ses occupants un voyage interminable, une épreuve où la sueur, la peur et la frustration se mêlent. Finalement, après une éternité, le train arrive enfin sur le terrain d’aviation de Clermont-Ferrand. Les hommes se précipitent hors du train, fuyant la promesse d’un ennemi qui avance inexorablement. Ils se rendent au bureau d’incorporation, et Robert, épuisé, mais soulagé d’être arrivé jusqu’ici, reçoit une couverture militaire, mais pas de vêtements.
« Donc il portait toujours les mêmes habits depuis son départ de Sochaux ? C’est incroyable ! » pense Hippolyte.
Ils vivent une situation à la fois absurde et inacceptable. La fatigue s’ajoute à la confusion. Robert passe la nuit dans une grange, un endroit insalubre où des hommes déjà arrivés avant lui sont entassés. L’odeur de la paille humide et la promiscuité rendent le sommeil quasi impossible et le matin, l’angoisse refait surface. Les Allemands approchent, et il n’y a pas de temps à perdre. Il faut fuir, fuir encore et toujours, avant d’être pris au piège.
Le lendemain, les hommes sont entassés dans des camions, direction la gare de Clermont-Ferrand. La scène est fidèle à la débâcle : des wagons à bestiaux surchargés, bondés de réfugiés, et la poussière qui s’élève comme un voile épais sur cette fuite éperdue. Les trains sont pleins à craquer, c’est la fuite de l’armée française, une fuite sans gloire, sans bataille, un repli honteux devant l’ennemi. Le tumulte est total, et la peur palpable dans chaque recoin de cette débandade. Le voyage continue, et après une traversée éprouvante, Robert finit par arriver à Rodez, dans l’Aveyron. Un nom qu’il connaît vaguement, seulement à travers l’Affaire Fualdès, et encore, ce n’est qu’une vague idée. Il se retrouve dans cette région inconnue, un étranger parmi les étrangers.
Ils sont logés sur une scène de théâtre, où la paille est leur seul matelas. Mais il ne s’agit pas de confort : la litière est infestée de puces, et, comme tout le monde, Robert passe la nuit à se gratter sans fermer l’œil de la nuit. La situation est déplorable, mais cela semble être le moindre mal. Le lendemain, ils sont à nouveau embarqués dans un train qui les mène à Carmaux, Albi, puis Gaillac, où le voyage prend fin, du moins temporairement. Au cœur de cette région qu’il ne connaît pas, où la chaleur accablante commence à se faire sentir, Robert réalise que le temps a filé, que son passé vosgien est loin derrière lui.
Le 22 juin, l’armistice signé près de Compiègne divise la France en deux : une zone occupée par l’armée allemande, où vit sa famille, et une zone libre, où il se trouve, sans l’avoir choisie. La question de savoir comment revoir les siens semble de plus en plus improbable. Comment se retrouver dans un pays déchiré ? Comment renouer avec ceux qu’il aime, séparés par cette frontière invisible, mais bien réelle ?
« Suspense ! Comment l’histoire va-t-elle se terminer ? C’est un vrai roman d’aventures qu’a vécu mon ancêtre ! »
Et Robert, à l’aube d’une aventure qui le dépasse, se demande lui-même comment il va pouvoir se reconstruire après ce bouleversement total.
Les hommes restèrent à Gaillac dans une longue inactivité, comme suspendus dans le temps, le rythme de leurs journées brisé par l'absence de nouvelles directives. Chacun trouvait refuge dans des occupations simples, presque anodines, pour oublier la lourdeur de l'attente. Robert, avec une branche de noisetier, pêchait dans les eaux calmes du Tarn pour ne penser à rien. Il offrait ses prises à une vieille femme, qui, en échange, lui confectionnait des gâteaux maison dont la douceur réconfortait son âme solitaire.
« Il a aussi fabriqué un tonneau et son support, que je possède encore, » remarque Hippolyte.
Ces petites créations de Robert représentaient le tonneau qui figurait sur une place de Gaillac. Chaque jour, son esprit était hanté par une question qui n'avait de cesse de le tourmenter : quand pourrait-il enfin rentrer chez lui ? Chaque matin, il se rendait à la gendarmerie, dans l'espoir d'une réponse, mais on lui répondait invariablement que la guerre était terminée, mais que seuls ceux qui résidaient en zone libre pouvaient regagner leurs foyers. Robert, bien que pris dans cet enchevêtrement de règles et de zones géographiques, attendait de pouvoir un jour rejoindre sa famille.
Les exilés, dans leur isolement, louaient à plusieurs un poste de radio, comme une bouée de sauvetage dans l'océan de l'incertitude. Grâce aux grésillements de la radio, ils parvenaient à entendre des messages codés. Robert, dans cette quête de communication, fit passer une annonce, une simple phrase qui traversa les ondes et parvint jusqu’au directeur de l’usine de tissage. Ce dernier, un homme plein de bienveillance, informa Suzanne que son mari était sain et sauf.
« Comme elle a dû être soulagée, après des jours et des jours d'incertitude ! »
Cette nouvelle, petite, mais immense, apporta un réconfort inestimable dans leur monde en ruine, redonnant un peu de lumière à Suzanne dans ses moments les plus sombres.
Robert, toujours dans cette même volonté de maintenir le lien, apprit grâce à ses compagnons d’infortune, l’existence d’une filière secrète pour faire passer des lettres au-delà de la zone interdite. Il déposait sa missive sous une enveloppe, avec l'adresse du destinataire, puis enfermait le tout dans une autre enveloppe, cette fois à l'attention d’un passeur, accompagné d'un billet de cinq ou dix francs, monnaie d’échange dans cette guerre silencieuse des informations. Le passeur, un restaurateur de la région d'Arbois, avait l’habitude de passer la frontière entre les zones, risquant sa vie pour que les mots d’amour et d’espoir traversent les barbelés. Pour le retour, la correspondance de Suzanne faisait le même trajet, envoyée à une dame de Montbarcy, elle aussi une complice du réseau, prête à se sacrifier pour les autres. Grâce à ces âmes courageuses, Robert et Suzanne réussirent à maintenir leur connexion malgré l'ennemi qui rôdait partout.
Robert espérait que la situation finirait par s’arranger avec l’arrivée des Alliés – Anglais, Américains, Canadiens. Chaque jour, il attendait, avec une impatience mêlée de crainte, que quelque chose de concret se produise. Mais les mois passaient. Juillet, août, septembre… La guerre, bien que finie en théorie, persistait sous d'autres formes, dans les esprits, dans l'attente insupportable de jours meilleurs. Et pourtant, rien ne venait pour améliorer le quotidien, le laissant dans un suspense cruel et indéfini.
Chapitre 4
De Gaillac à Réquista
En l’espace de quelques mois à peine, la vie du Vosgien bascule. Ballotté de ville en ville – Dijon, Sochaux, Clermont-Ferrand, Gaillac – il ne maîtrise plus son destin. Puis, le 2 octobre 1940, un nouvel ordre tombe. Les autorités militaires, dont dépend sa promotion, décident de l’emmener dans l’Aveyron pour y travailler. Au cœur de ce territoire rural méconnu, il découvre l’âpreté d’une existence dictée par la contrainte.
C’est ainsi qu’il se retrouve à Plaisance, un village reculé où le temps semble suspendu. Lui et ses compagnons sont logés dans une maison en construction, au centre du bourg. Pas de confort, pas d’intimité : un simple châlit en bois surmonté d’une paillasse pour tout repos. Leur mission est éreintante, répétitive, décevante : il leur faut casser des pierres à longueur de journée pour redresser les virages d’une route sinueuse. Pics, pioches, pelles leur sont remis, comme à des forçats. L’analogie avec le bagne est douloureusement évidente. Considérés comme de la main-d’œuvre corvéable à merci, ils sont contraints de travailler, enfermés dans une impasse, car rentrer chez eux, en zone interdite, leur est impossible.
« Quelle injustice ! » s’indigne-t-on. Tout cela, pour satisfaire quelques gradés en mal d’autorité, prêts à exiger l’impossible pour décrocher quelques galons supplémentaires. Pour eux, ces hommes ne sont rien d’autre que des esclaves modernes.
« Ils auraient dû se révolter ! » murmure Hippolyte.
Chaque matin, ils prennent le chemin du chantier, parcourant à pied les kilomètres qui les séparent de leur supplice quotidien. Main-d’œuvre bon marché, exploités sans scrupule, ils sont nourris chichement. Trois fois par jour, une femme leur apporte de la soupe dans une charrette tirée par un cheval. Leur maigre solde, dérisoire, file aussitôt chez l’épicier ou le boulanger, en échange de quelques vivres supplémentaires.
Mais Robert refuse de plier. Un feu couve en lui, une révolte sourde qu’il ne peut plus contenir. Alors, le 9 novembre 1940, il prend une décision audacieuse. Il se fait porter malade. Une ruse ? Une nécessité ? Peu importe, il joue son va-tout. Et cette fois, pour la première fois, il ose défier l’autorité.
Transporté dans une vieille camionnette bringuebalante jusqu’à Réquista, il découvre un bourg animé, aux commerces foisonnants, loin du morne labeur de Plaisance. Il envie ces habitants aux professions libérales, ces gens libres de leurs mouvements, épargnés par la guerre.
L’infirmerie où il est accueilli n’a de médical que le nom : un modeste local réquisitionné, où s’entassent quelques médicaments et des vêtements militaires. Un pantalon, une veste, une paire de souliers… enfin de quoi se changer !
« Après des semaines de labeur, ses habits devaient être dans un état lamentable. Comment faisait-il pour les laver, lui qui n’avait même pas de rechange ? »
La maison, un local réquisitionné, qui donne sur la place du Vatican – une ironie, ce nom qui évoque la grandeur romaine dans ce petit village – abrite l’infirmerie au rez-de-chaussée. À l’étage, deux chambres, dont l’une devient son refuge. Pour la première fois depuis des semaines, il s’allonge dans un véritable lit. Il s’autorise quelques jours de répit, le luxe d’une réflexion. Retourner casser des cailloux ? Impossible. Mais alors, que faire ?
Ici, la guerre semble lointaine. Les habitants poursuivent leur quotidien, indifférents aux bouleversements du monde. Pourtant, le destin va enfin lui sourire.
Le jeune infirmier qui dirige le centre est rappelé dans ses foyers. Le médecin militaire, en manque de personnel, lui propose un rôle inespéré :
– Nous avons besoin de vos services, restez avec nous.