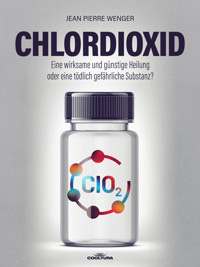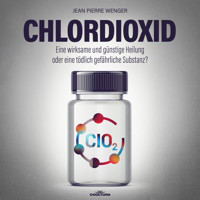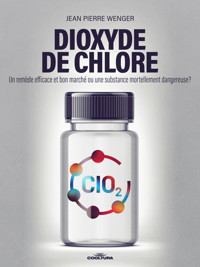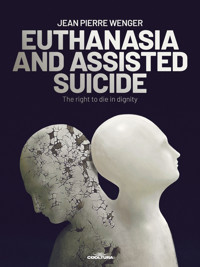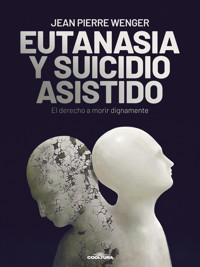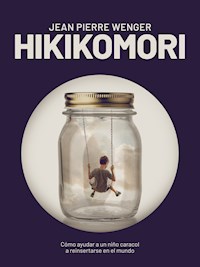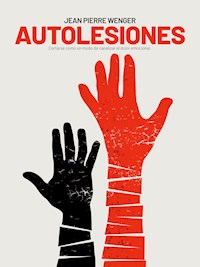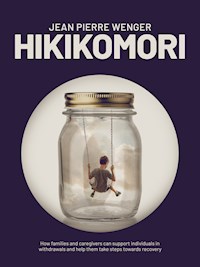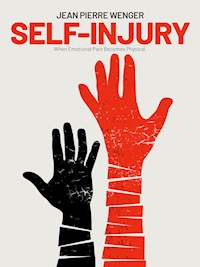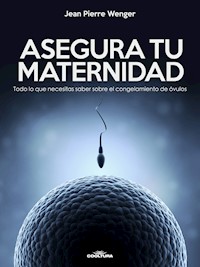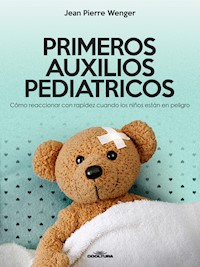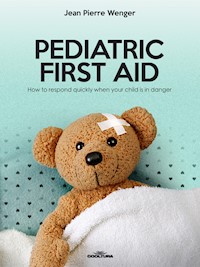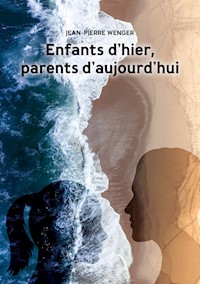
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Selon Carmen de Georges Bizet : « L’amour est enfant de bohème […] / Si tu ne m’aimes pas, je t’aime / Et si je t’aime, prends garde à toi ! » Les enfants sont les fruits des jeux de l’amour. Comment évoluent-ils ? Peut-on choisir ses parents ? Peut-on choisir ses enfants ? L’amour, la tendresse et la compréhension partagés ne sont-ils pas les plus beaux remèdes à l’égoïsme, à la violence et à la méchanceté ? Dans une France rurale et rude, la petite Blanche et sa soeur Marie doivent affronter le deuil de leur mère et subir la méchanceté intéressée de leur marâtre, sous l’oeil indifférent d’un père qui se tue à la tâche. Blanche, la plus fragile, sera marquée, dans son corps et dans son esprit, par ce désamour et les brimades d’une belle-mère n’éprouvant pas la moindre empathie. Comment, dès lors, va-t-elle pouvoir se construire et s’épanouir, de son adolescence meurtrie à sa vie de femme incomprise ? Et qu’en sera-t-il de sa propre famille, de ses enfants et de son mari, un premier amour né dans la douleur d’un autre deuil ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
Le Destin, BoD
Questions fondamentales, BoD
Deux jeunes dans la vie, BoD
« Qui a dit que vous naissiez tous égaux ? […]
Pouvez-vous croire que le monde est beau ? »
Enfants, S. Adamo
Table des matières
UNE VIE D’AUTREFOIS
LA SÉPARATION
AVIS ÉCLAIRÉS
L’ÉLOIGNEMENT
ORIENTATIONS
LES PLIS DE L’ESPRIT
UN AVENIR À CONSTRUIRE
L’ENLÈVEMENT
LA PROMESSE
LES AMOURS
LES TRAVAUX
L’ÉVOLUTION
PRISE DE CONSCIENCE
LES DÉSILLUSIONS
CHACUN POUR SOI
LE DERNIER MOT ?
UNE VIE D’AUTREFOIS
Quand il avait achevé ses chantiers, Gabriel le charpentier montait, avec beaucoup de difficultés, la côte qui le menait à sa maison de Landouge, à l’entrée du faubourg. Le repas de fin de chantier, fêté avec ses compagnons, avait ponctué, cette fois encore, le dressage d’une charpente avec des douleurs aux mains, un corps endolori, et se terminait par une marche chaloupée, entrecoupée de repos, la main appuyée contre les arbres pour rétablir son équilibre. Selon ses dires, il n’était jamais saoul, mais il fêtait dignement la fin des travaux.
Les villageois des maisons environnantes l’entendaient arriver de loin. Il s’en prenait au monde entier, aux politiques de droite, de gauche, du centre, tous des vendus, tous à la merci des patrons, de groupes d’intérêt. Il n’y en avait pas un mieux que l’autre. Pour lui, ils mentaient comme des arracheurs de dents, se disputaient tous le même morceau d’os et « tannaient la laine » sur le dos du pauvre peuple. Il s’en prenait aux curés, aux maires, aux femmes, au bon Dieu, aux mauvais payeurs, aux bourgeois… Tous y passaient.
Quand il arriva chez lui, il posa la main sur l’anneau en fonte de la lourde porte d’entrée, qu’il avait lui-même façonnée comme une véritable œuvre d’art, travaillée et moulurée avec soin. Il dévala les trois marches de l’entrée, emporté par son poids et son élan, et s’appuya sur la grande et large table en chêne massif de la salle à manger. Puis, bien calé, il sortit de ses poches des mouchoirs remplis de pièces d’or qui tintèrent sur la table.
— Regarde, Maria, regarde ! dit-il à sa femme.
Rompu par la fatigue, il fit un pas pour s’écrouler dans son vieux fauteuil, plus usé que le temps, trônant à côté de la cheminée qui crépitait et diffusait une chaleur douce et bienveillante dans toute la maison.
Son organisme était marqué et épuisé par les manipulations, les charges lourdes, le rabotage des poutres et des madriers. Les seules machines en sa possession étaient d’énormes scies électriques à roue ou à ruban et des tours mécaniques très dangereux à utiliser.
La masse sombre de la table, à demi éclairée par les flammes dansantes, s’allongeait dans la pièce, puis s’étalait sur le mur et au plafond. Sa femme Maria l’attendait, enveloppée dans un grand châle, blottie dans son fauteuil, aussi vieux que le premier, face à la cheminée. Régulièrement, elle se penchait pour saisir et disposer de longues bûches, qui aussitôt éclairaient la pièce et projetaient des formes incertaines et gigantesques. Elle était là, fidèle et muette par habitude, par amour simple. La table était dressée. Elle avait préparé une soupe, des tranches de pain, un verre de vin et une bouteille à côté de son assiette. Il mangerait quand il se réveillerait, sûrement avant l’aube, avant le réveil de ses deux filles, Marie, l’aînée, et Blanche, qu’il pourrait embrasser avant leur départ pour l’école. Parfois, son état le clouait dans son fauteuil durant de longues heures, avant qu’il n’émerge et ne s’affale sur le lit tout habillé.
En général, son quotidien était rythmé par des habitudes prises depuis de longues années : un café noir, du pain, un verre de vin, la toilette, un câlin à ses enfants, un petit mot gentil à sa femme et le départ pour l’atelier attenant. C’était une vie sans fioritures, une vie d’habitudes, une vie organisée. Un menuisier-charpentier devait acheter, entreposer, faire sécher ses bois longtemps à l’avance avant de pouvoir les débiter en poutres, en madriers ou en planches à façonner. La conception, le tracé, les triangles de force, les points d’appui et de résistance se calculaient et se reportaient sur les matériaux avec attention, en fonction de calculs précis et de précieux instruments de mesure, le compas, le rapporteur, les grandes équerres, nécessaires pour le travail des charpentes, et de gros outils traditionnels d’autrefois que l’on peut voir, aujourd’hui encore, sur les murs en guise de décoration : des varlopes, des gouges, des limes bâtardes, de gros rabots.
La maison était simple : une salle moyenne en bas, une cuisine, la chambre des parents, un coin d’eau, un petit escalier, un débarras et deux chambres avec placards à l’étage. Un unique conduit distribuait la chaleur, fournie par la cheminée du bas.
Le travail était dur. Toutes les charpentes étaient prémontées dans la cour de l’atelier, puis portées à dos de cheval sur le lieu final d’assemblage, parfois distant de plusieurs dizaines de kilomètres. Qu’importe la rudesse du travail, en ce centre Limousin, les hommes avançaient, animés d’une volonté tenace, soutenus par ce devoir impérieux de travailler coûte que coûte, d’assurer la subsistance de leur famille. Ils devaient créer de leurs mains, avancer quotidiennement, bâtir et reprendre sans cesse. Il semblait que rien ne pouvait les abattre. À quelques questions profondes, ils répondaient : « Que voulez-vous que je fasse ? Il faut y aller, c’est comme cela. Que ça plaise ou pas, il faut y aller. »
Les mères surveillaient chaque départ des enfants pour s’assurer de la propreté des blouses, grises pour les garçons, et à carreaux bleus ou roses pour les filles. Pour Maria, le départ pour l’école était un cérémonial : elle vérifiait le col, les chaussures, la coiffure, l’apparence de ses deux filles. L’école et l’apprentissage avaient une grande importance à ses yeux, car ses filles devaient avoir une certaine instruction et acquérir le savoir, contrairement à elle, qui savait tout juste lire et écrire.
— Écoutez bien vos maîtresses, ne vous dispersez pas en classe. Vous êtes à l’école pour apprendre. Nous, nous n’avons pas eu cette chance d’y aller, nous ne savons pas grand-chose ! Travaillez, mais travaillez donc ! Pour l’instant, vous ne savez pas ce que vous ferez plus tard. Nous, nous devions aller aux champs ou aider à la ferme : notre avenir était tout tracé.
Les gens du village étaient pauvres, mais toujours très propres. Le linge sentait bon la fraîcheur de l’eau de la rivière, le savon et la lavande. Quand elles n’avaient pas école, les filles aidaient leur maman à le porter au lavoir, en contrebas du village, dans une anse du cours d’eau. Les femmes papotaient entre elles en battant leur linge, mais, lorsque des personnes arrivaient, les voix se taisaient un moment. Les commères observaient du coin de l’œil, toisaient de la tête aux pieds, baissaient le ton de leur voix, mais ne se gênaient pas pour juger et chuchoter sur chacun. On savait qui avait souri à qui, qui avait été aperçu derrière le mur de l’église, en train d’embrasser telle jeune fille, ou qui avait fait un tour dans la grange ! Chaque personne était scrutée de fond en comble, le visage, les cheveux, les attitudes, les habits. Tout était décortiqué. Il valait mieux être dans les bonnes considérations de ces commères et langues de vipère, car c’était l’épreuve de la radio locale, avec les jugements et les ricanements les plus démoniaques et médisants, sans aucune retenue. Ce fameux lavoir – ou le jardin des cancans – formait le passage, l’épreuve de vérité, les dernières annonces gratuites, parmi lesquelles on pouvait entendre :
— Et ta fille, elle t’a dit avec qui elle fricote ? Si elle continue, elle ne va pas revenir toute seule. Tu vas devoir la mettre à la porte avec son enfant. Tu verras, si tu ne la tiens pas et ne l’éduques pas ! Ce n’est pas la peine de faire la fière. Surveille-la, sinon tu vas avoir des déconvenues avec tout le village. Ta fille est trop frivole et volage !
Mais il fallait aider les mères, et cela permettait aussi une certaine reprise en main lors du retour à la maison.
— Tu vois ce que tu me fais subir devant toutes ces femmes ? Regarde ce que tu m’infliges. Écoute ce que le village pense de toi. C’est beau ! Ce n’est quand même pas moi qui t’ai fait devenir comme cela ! Tu vas voir : si ton père l’apprend, qu’est-ce que tu vas lui dire ? Il va te coller une bonne trempe. Il va te mettre à la porte. Où vas-tu aller ? Dans la rue ? C’est beau ! C’est ce que tu veux ?
Au lavoir, il fallait faire tremper le linge, le laver par frottements successifs, le rincer, recommencer, jusqu’à ne plus voir la moindre teinte dans l’eau ni la mousse en ressortir.
— Allez, frotte ! Tu ne vas pas t’user. Sers-toi de tes bras. Mets encore du savon, tu vois bien que ça ne mousse pas !
« Elles ne pourraient pas se taire, toutes ces commères ? » pensait la jeune fille en question. Mais non ! Une autre en rajoutait :
— Tu sais te coiffer et te faire belle, mais ici, il faut travailler.
Elles se regardaient entre elles d’un air entendu, en riant, tout en continuant à battre leur linge et à discuter.
— Tu as vu le jeune boucher ? J’ai remarqué que, tous les après-midi, il partait de chez lui vers les seize heures. C’est curieux, c’est l’heure où la petite Germaine n’est plus chez elle.
— Pourtant, personne ne la voit passer !
— Tu es bête et aveugle, tu ne comprends rien ! Tu veux que je te fasse un dessin ? Elle passe par le fond de son jardin, pardi ! Elle est toute belle et bien habillée, pomponnée comme le dimanche. Elle est dégourdie pour relever ses jupes, mais à l’école, elle ne fait rien. Je ne sais même pas si elle sait coudre ou cuisiner.
Seules les fêtes du village, avec les accordéons et les danses du dimanche après-midi, apportaient quelques joies. De nombreux couples se formaient au sein des rythmes, avec des petits gestes, des petits effleurements, les premiers baisers et les jalousies naissantes.
La vie était pauvre, les maisons simples. Les jours passaient avec une inlassable répétition. Les femmes faisaient les courses, balayaient, nettoyaient, cousaient, préparaient les repas et s’occupaient des enfants à leur retour de l’école. Les hommes, pour la plupart artisans ou commerçants, s’échinaient au travail.
Les machines, rares, soulageaient un peu leur labeur.
— Aujourd’hui, en une heure, j’ai pu débiter un tronc en huit planches. D’habitude, à deux, il nous fallait la journée.
Depuis l’aube, c’était la course au temps.
— Allez, les gosses, dépêchez-vous ! Arrêtez de jouer, c’est l’heure de partir à l’école, réprimandaient les adultes, se hâtant pour éviter les retards.
Transis, moyennement habillés, les enfants se précipitaient dans la classe pour se réchauffer, autour d’un vieux poêle bourré de bûches de bois, brûlant, aux tuyaux rougis par la chaleur. Ce moment d’union faisait taire les jalousies entre les élèves. Mais les différences ressurgissaient bien vite, lors de la constitution des groupes et des jeux, dans la cour de l’école. Les écolières et les écoliers avaient leurs préférences et allaient avec des amis bien précis. Il était difficile de savoir pourquoi la fille de l’éboueur, du cantonnier ou du marchand de volailles – nous ne parlerons pas de celle des pompes funèbres – devait forcément sentir mauvais. Pourquoi celle du charpentier était-elle traitée comme une petite ratée, toujours recroquevillée sur elle-même, blottie contre les piliers du préau ? Mais elle n’était pas la fille du médecin, du pharmacien, du policier, du notaire. Elle n’était que la fille d’un besogneux. Chacune avait son image collée à la peau. Les réflexions étaient machinales, inconscientes et bêtes, juste pour faire mal quand l’une ou l’autre passait à côté d’un groupe.
Que voulez-vous ? Sans le savoir, les gosses reproduisaient les attitudes et les considérations des parents et des adultes.
Alors que les récréations étaient instaurées pour que les esprits se reposent, la petite Blanche se crispait de tout son corps dès qu’elle entendait sonner la cloche. La cour n’était qu’un lieu où s’exprimaient les rivalités et les oppositions de la société, bien souvent apprises au gré des histoires entendues au lavoir, dans la rue, mais surtout lors des discussions entre les parents.
— Oh, eux ! Ils peinent à terminer les fins de mois. On se demande comment ils y arrivent. La mère fait des ménages, ce n’est pas haut… Il faut voir comment ils ont obtenu leur commerce : ils ont cru faire une affaire, ils n’avaient qu’à mieux réfléchir… Et puis que veux-tu ? Si la femme se tenait derrière son comptoir, au travail, ça irait peut-être mieux, au lieu de trousser ses jupes dans la remise avec le père Étienne. Mais que fait son idiot de mari ? Est-il aveugle ou cherche-t-il, lui aussi, des compensations ailleurs ? Comment veux-tu que leur magasin marche ? Regarde ceux du fond de la rue, ils ont fait fortune avec du trafic, ils devraient avoir honte. J’ai quelques histoires sur ce commerçant. Il a doublé son commerce sans factures. Il a des considérations et des avis sur tout. Regarde-le, alors qu’il devrait se faire petit, mais alors tout petit. Il joue les grands et parle fort…
Et l’autre lourdaud de père François, qui ne pense qu’à boire et à dormir, comment veux-tu que son commerce fonctionne ?
Certains enfants allaient rudoyer, bousculer des élèves timides ou simplement pauvres et sans moyens. Les isolés, les mal vêtus se liguaient pour réagir, courser et battre les moqueurs, ou se rassemblaient dans leurs propres jeux, sous les quolibets de ceux qui étaient vêtus chaudement ou qui se considéraient comme différents. Les plus costauds des deux bords essayant de casser la figure aux autres. Bien vite, les maîtresses intervenaient et distribuaient les punitions, mais elles n’étaient pas toujours impartiales et faisaient pencher la balance du côté des nantis de la commune ou de ceux qui travaillaient le mieux. Chaque maîtresse avait ses préférés : la société commençait déjà à exercer son œuvre de considération. Alors, des rancœurs se créaient : d’un côté, les punis, les derniers, et de l’autre, les premiers de la classe avec leurs camarades qu’il ne fallait pas sanctionner. Les oppositions et les conflits se perpétuaient. Il suffisait d’un regard, d’un sourire, d’une phrase, et les rancœurs, les éclats de voix surgissaient. Devant les bagarres et les pleurs, les maîtresses devaient séparer et punir les belligérants, parfois distribuer des coups de règle, corriger sévèrement ou isoler violemment les bagarreurs dans le couloir ou chez la directrice quand certains ne voulaient pas se calmer. C’étaient souvent les élèves plus petits et plus pauvres qui étaient la cible des moqueries, des vengeances, et qui, de fil en aiguille, se retrouvaient punis ou mis à l’écart.
— Si vous voulez être tranquilles et ne pas être exposés à la risée des autres, mettez-vous dans un coin ou allez jouer dans la petite cour.
Mais il était difficile de s’isoler et de rester longtemps à distance, car cette séparation accentuait les clivages et les moqueries. S’ensuivaient des disputes, des cris, des bagarres, des coups de poing et de pied. Non, les enfants n’étaient pas tendres entre eux.
Les caractères forts, naissants, la force des convictions sans trop de contrôle et les premières recherches de valorisation exposaient les uns et les autres à des actes multiples de brutalité gratuite. Qu’avaient-ils à s’opposer ainsi ? Bien sûr, ils avaient besoin de se dépenser, de se jauger. Qui leur donnait cette volonté, cette arrogance, cette croyance en leur supériorité, ce droit ? Parce qu’ils étaient issus d’une famille plus riche, plus noble ou plus en vue dans le village ? Ou parce qu’ils possédaient des plumiers, des crayons, des chaussures ou un cartable plus luxueux ? Peut-être, aussi, un autre vocabulaire… Quoique, avec leurs cris, leurs injures, leurs violences et leurs comportements, ils ne se distinguaient pas des autres. Mais voilà, ils s’octroyaient le droit d’isoler quelques créatures, de leur donner des gifles ou, quand elles étaient à terre, des coups de pied sans aucune retenue ni aucun contrôle.
La cour de récréation était un curieux spectacle, un défouloir de forces aveugles. C’était, pour certains, un plaisir de faire mal, de dominer, d’assouvir une brutalité inconsciente. D’où venait cette prétention dominatrice et aveugle ? Qu’avaient-ils de différent ? Les blouses étaient les mêmes selon le sexe. Ce n’étaient pas les chaînes autour du cou qui trahissaient une richesse, car la plupart se voyaient offrir une médaille sainte pour le baptême ou la communion. C’étaient surtout les regards et les attitudes, la constitution des groupes d’amis, les dires mémorisés sur certaines personnes qui commençaient à produire leurs effets. La façon de s’exprimer, de se comporter, de comprendre, d’utiliser les mots révélait le niveau profond des enfants. Il y a toujours des personnes que l’on aime, dont on recherche la compagnie, de préférence à d’autres, avec lesquelles on se sent plus ou moins bien, en raison de la nature des paroles, des jeux, des comportements, que l’on ressent comme plus ou moins franches, plus ou moins proches. Pourquoi y aurait-il, ici, l’origine de comportements haineux et violents ? Les gosses se lançaient des insultes surprenantes ou des accusations qu’ils ne pouvaient pas avoir inventées. Les maîtresses essayaient de combattre rapidement ces propos.
— Tu comprends ce que tu viens de lui dire, ce que ça signifie, au moins ? Comment sais-tu ça, toi ? Et qui donc te l’a dit ?
— Oui, mon père a dit qu’elle…
— Tu me feras cent lignes signées par ton père : « On ne dit pas cela, on ne répète pas des bêtises. » Tu diras à ton père de venir me voir.
Il est évident que, dans un petit village, les cancans allaient bon train, et chacun en rajoutait un peu pour affirmer son autorité, voire pour montrer qu’il en savait plus long que ce qu’il avait révélé. Les gosses, toujours à l’affût des discussions entre adultes, colportaient et modifiaient ces paroles, pour se donner de l’importance, en dires graves, insolents, nuisibles et idiots.
Le lourd cartable, la fatigue, les bagarres, les jeux et les trajets de l’école entamaient les forces des petits corps de Marie et de Blanche.
Quand il faisait beau, il fallait vite revenir pour aider maman Maria à balayer la maison, la cour des hangars de coupe du bois, ranger les armoires, plier les vêtements, les grosses couvertures et les draps laissés toute la journée sur les cordes à linge, au vent ou au soleil, remédier au désordre laissé par les ouvriers, jeter les paquets de sciure envahissant le sol, dégoulinant des machines.
LA SÉPARATION
Avec l’âge, maman Maria se transformait et devenait plus lente. Gabriel désespérait d’avoir un héritier mâle pour reprendre les ateliers de travail du bois.
Les reproches et les disputes surgirent de plus en plus fréquemment, puis se généralisèrent. Le couple s’absenta plusieurs fois du village, puis Gabriel se sépara de maman Maria.
Un matin, en pleurs, les filles la virent prendre quelques valises et des sacs, puis charger une charrette attelée de deux chevaux pour déménager ses affaires en un seul voyage.
— Votre mère n’habitera plus avec nous, dit le père simplement un soir. Nous avons décidé de nous séparer, de divorcer. Vous pourrez continuer à aller la voir. Vous vivrez ici avec moi et une nouvelle femme va arriver. Je vous demande de ne rien dire et d’avoir beaucoup d’égards pour elle. N’oubliez pas qu’ici, c’est moi qui commande, vous n’avez rien à dire ! Maintenant, allez dans vos chambres faire vos devoirs. Je ne veux avoir aucun problème pour l’avenir. Vous devrez la considérer et l’aider !
Les enfants ne posèrent pas de questions devant le visage abrupt et fermé du père. À l’époque, on ne demandait pas de précisions aux adultes et les enfants n’avaient pas le droit à la parole. Il n’y avait rien à dire, tout était réglé : l’une s’en allait, l’autre allait arriver. Les adultes se taillaient un monde simple, vide d’émotions et de ressentis. Ils tranchaient, prenaient des décisions. C’était ainsi, c’était tout.
Les filles étaient maintenant devenues, à leur tour, la risée du village. Chacun se retournait sur leur passage, et elles entendaient :
— Tiens, les enfants des divorcés.
Les enfants de divorcés étaient considérés comme des parias et montrés du doigt. Tout le village jasait, parlait sur eux, et les commentaires ne s’arrêtaient jamais. Chacun avait une anecdote à raconter ou à inventer. Bien que personne ne vive dans l’intimité du couple, chacun y allait de sa médisance. En vérité, le couple n’avait eu que des filles, et l’amour concrétisé de cette manière ne cadrait plus avec les aspirations de Gabriel.
Maria continua à travailler et à vivre sans esclandres ni protestations, comme pour s’excuser d’exister. Elle était partie sans rien dire, sans se plaindre, à l’autre bout du village, un peu plus voûtée, se déplaçant un peu plus lentement, à petits pas, semblant toujours préoccupée par une tâche importante ou une mission fondamentale. Le sourire et la tendresse étaient rivés sur son visage, empreint de douceur et de gentillesse. Elle allait à la messe, faisait quelques rares emplettes et vivait dans une annexe d’un petit domaine, qui l’hébergeait et qui lui donnait quelques légumes, quelques tranches de pain, en échange du ménage et de la vaisselle ; un travail de répétition sans à-coups, sans surprises.
C’était une pièce, une chambre épuisée jusqu’à la trame par le temps et la crasse, au confort spartiate. Face à la porte centrale se dressait une imposante cheminée débordante de suie noire. À gauche, à côté, un vieux fauteuil aux ressorts fatigués et dans lequel elle s’enfonçait avec délectation pour se reposer. À droite, un lit, ou plutôt une planche avec un matelas avachi, sale et plat, recouvert d’une unique couverture. À la suite, une chaise et une vieille armoire, et en face, de l’autre côté de la porte, une alcôve avec une fenêtre et un demi-rideau, un évier, une bassine pour se laver, une table avec une bougie posée dans un coin et une lampe à pétrole. C’était une chambre obscure avec des meubles sombres, on ne savait si c’était à cause de l’usure du temps ou de la saleté, toujours est-il qu’ils dégageaient une forte odeur de cendre brûlée ou d’encens. La première question qui venait à l’esprit était : « Combien d’âmes en perdition se sont réfugiées ici ? »
Maman Maria mit une semaine à tout brosser, frotter, laver pour que ce refuge sente bon, présente bien et soit plus clair. On la voyait peu au village. Elle était discrète et ne se mêlait de rien. Les gens parlaient d’elle, s’interrogeaient sur sa vie. De quoi pouvait-elle bien vivre ? Que pouvait-elle penser ? Quels étaient maintenant ses goûts, ses désirs ?
On la voyait aller et venir, replaçant une mèche de cheveux, sortant d’un foulard – une passante du temps qui fuyait. Que dire d’elle ? Personne ne la connaissait. Ce fut dans cet endroit qu’elle vécut quelques mois, menant une vie simple et tranquille, dans la douceur et le calme étrange des habitudes, de la pesanteur et de la nostalgie de tous les jours. Elle était heureuse de voir régulièrement ses filles, s’élancer et courir vers elle en l’appelant « Maman ». Elle les serrait dans ses bras, souriante, les larmes aux yeux.
— Mes petites, mes petites, vous serez toujours mes petites.
Puis elle se taisait. C’était tout ce qu’elle arrivait à prononcer dans ces moments-là.
Elle était douce et calme par nature. On avait l’impression que rien ne l’atteindrait. Pourtant, ses yeux vifs et son regard pétillant captaient et enregistraient tout, et devinaient bien plus que son niveau scolaire pouvait lui expliquer. Elle ressentait, plus que personne, les intentions réelles et les émotions, le regard sournois et la bonté pure. Un sourire, un visage, et surtout un grand et bon cœur. Sa maxime était : « Ne fais pas le mal, cela n’en vaut pas la peine. Tu te fatigueras moins en créant le bien ! » Discrète, elle ne voulait surtout pas déranger. Elle faisait peu de courses, sauf, parfois, un ou deux compléments, un morceau de fromage, mais c’était rare. Elle se contentait de ce que lui donnaient les cuisines du domaine, ou de quelques cadeaux ou échanges par-ci, par-là. Un grand amour, un énorme cœur, une lueur indéfinissable qui passait discrètement. Était-ce la mélancolie, le changement dans sa vie émotionnelle, sa répudiation ? Toujours est-il que, durant un rude hiver, elle attrapa une méchante grippe, dont elle eut du mal à se défaire. Puis arriva une toux tenace. Régulièrement vêtue de noir, un fichu sur les épaules entourant sa poitrine, elle laissa traîner les choses par manque de moyens et par fatalisme… Un oiseau mangeait plus qu’elle. Pourtant, elle se donnait toujours à son travail, toujours serviable, toujours à la tâche ; elle était toujours présente.
Le jour où elle ne se présenta pas à son travail, étonnée, sa patronne vint la chercher. Elle la trouva allongée sur son lit, livide, une grosse couverture déroulée sur elle, alors que d’habitude elle dormait bien calée dans son fauteuil. Elle était morte.
Tout le petit village fut présent pour l’enterrement, Gabriel aussi, droit, absent, muet. Les deux fillettes furent amenées par leur père, qui les poussa d’une main ferme dans le dos, avec quelques mots d’explication. Il leur dit simplement :
— Nous conduisons votre mère à l’église. Pensez fort à elle. Vous ne la reverrez plus, elle est partie pour le ciel.
Elles ne comprenaient pas tout de ce rituel chez les adultes quand ils meurent. Elles arrivèrent dans l’église. Une foule s’était rassemblée. Même des copines d’école étaient venues avec leurs parents. Gabriel disait bonjour, saluait des gens. On les plaça devant l’homme d’Église, à côté de leur père. Puis le prêtre fit quelques compliments et une très belle présentation de leur mère. Il parla de son exemplarité, de sa douceur, de son respect de Dieu, de son amour du prochain, et termina en disant que le Seigneur lui ouvrait ses bras pour l’accueillir au ciel.
Un chant simple, quelques mots, le Notre Père, que les petites connaissaient et qu’elles purent reprendre à l’unisson, un signe de croix. Puis elles suivirent la sortie du cortège et du cercueil, une charrette, un cheval, et les voilà parties pour le cimetière. Il faisait froid, un peu de bruine, quelques oiseaux noirs dans le ciel. Elles avaient envie de courir pour dégourdir leurs jambes gelées, mais il fallait rester dans la file et marcher au pas du cheval. De grandes portes métalliques ouvertes, des cyprès, des corbeaux, un vent froid, des tombes… Un endroit lugubre les accueillit en ce matin d’octobre. Gabriel marchait devant sans rien dire.
Les hommes en noir du service du cimetière arrêtèrent le cheval près d’un trou, passèrent des cordes autour du cercueil, réunirent les gens devant, les invitèrent pour une dernière prière et s’éloignèrent.
De curieuses pensées s’agitaient dans la tête des filles : « Que voulait dire être mort ? » Jusqu’à présent, c’était un mot. Là, en quelques heures, Gabriel leur avait dit de se lever tôt, de s’habiller comme pour la messe, de ne pas se salir et de le suivre, qu’ils allaient enterrer leur mère, qui était morte. Voilà tout.
Malheureusement, elles furent jetées brusquement, bien jeunes, dans les douleurs et les frustrations de la vie, confrontées à sa dure signification et à sa réalité.
La première question de Blanche avait été :
— Oui, mais quand la reverrons-nous ?
— Vous ne la reverrez plus jamais. Elle ne pourra jamais plus vous serrer dans ses bras, lui avait répondu son père.
Et celui-ci de renchérir :
— Mais tu ne comprends pas ? Elle est morte ! Tu ne la reverras jamais. Et jamais, ce n’est jamais plus. Tu peux comprendre ça ?
Pour la petite fille, c’était dur et nouveau. Elle avait vu un animal mort qui ne bougeait plus. Elle avait entendu parler de gens morts. Mais, là, c’était sa mère. Comment une maman pouvait-elle mourir comme ça et laisser ses enfants, sans rien dire, s’en aller sans les prévenir ?
On est bête quand on est petit. On est peut-être exigeant ou capricieux, on ne comprend pas tout, on n’admet pas tout, et surtout pas l’absence ; le langage du cœur est entier et sans partage.
Une main poussa les deux gosses près du trou pour qu’elles puissent se recueillir. À la suite du prêtre Gabriel leur dit :
— Faites une prière pour votre mère, elle va monter au ciel.
Les gens se signèrent, restèrent un moment silencieux, puis s’éloignèrent. Les deux enfants regardèrent, du coin de l’œil, les hommes en noir du cimetière descendre le cercueil dans le trou à l’aide de cordes.
— Pourquoi la mettent-ils dans la terre alors que le prêtre a dit qu’elle allait monter au ciel ? questionna Blanche.
— Le corps va en terre, puis l’âme se détache pour aller au ciel, dit Marie, la grande sœur.
— Alors, nous sommes deux et nous pouvons être séparées ?
— Oui, et la séparation s’appelle la mort !
À la fin de la cérémonie, ils revinrent à la maison. Gabriel leur demanda de réunir les quelques affaires laissées par Maria dans des sacs et de les déposer sous le hangar, faisant ainsi disparaître tout ce qui lui appartenait.
Deux jours plus tard, les apprentis de Gabriel transportèrent les sacs, les vidèrent dans un champ et y mirent le feu. Ainsi, en quelques heures, tous les souvenirs de maman Maria partirent en fumée. Finie, finie la présence… Les êtres tirent un trait sur le passé ou tentent de l’effacer.
Les enfants étaient un peu surprises de la précipitation de Gabriel et des apprentis. Il avait suffi d’une journée pour enlever toutes les traces d’une existence. Les enfants cherchaient du regard les témoignages du passage de Maria. Mais rien ! Qu’avait-elle fait pour que tout disparaisse ? Pourquoi une telle rapidité, une telle condamnation ? Plus de petites croyances, d’objets d’amour : on effaçait tout, on instaurait l’oubli, l’absence, comme si les hommes pouvaient en décider à la place du cœur !
Voilà à quoi se résume une vie : des objets collectionnés n’ont de sens que pour une personne qui les investit d’amour et d’affection, de signes et de sens, alors qu’ils ne sont, pour les autres, qu’objets de moqueries et de critiques, car ils n’ont pas la même vision ni la même considération que la personne qui les a achetés, reçus ou entretenus. En soi, les objets n’ont aucune valeur, sauf lorsqu’une âme apporte une caution d’amour et de sensibilité, lorsqu’un regard s’arrête pour dire : « Là, tu avais trois ans. Là, c’est toi qui me l’as offert. » Qu’avait-elle à garder une image de la Sainte Vierge, deux petits vases, une fiole d’eau bénite, des cailloux peints et des photos encadrées de ses enfants et de son mari, des petits cadeaux de la fête des Mères ? Ils représentaient des objets d’amour simples. Mais, voilà, elle n’était plus là pour ouvrir son cœur, pour les honorer d’un souvenir vivant et aiguisé. Ces objets avaient perdu leur âme.
La responsable du domaine s’occupa de ranger, dans l’annexe, les dernières affaires de Maria. Elle trouva, dans un tiroir de la table, deux pochettes contenant des dessins des filles, offerts pour Noël, les anniversaires et la fête des Mères. Dans l’autre tiroir, un paquet renfermant deux petits sacs portant leurs prénoms et une enveloppe. Elle les remit au notaire, qui, après avoir pris connaissance du contenu de la lettre, s’engagea à conserver les paquets jusqu’à leur majorité, en fonction des désirs exprimés par la mère.
Devenues « encombrantes », dans la nouvelle vie de Gabriel, les deux petites filles, Blanche et Marie, furent envoyées en région parisienne, chez le grand-père Ernest, garde-chasse d’une grande famille de dignitaires et de capitaines d’industrie, le temps que la douleur s’estompe. Il habitait dans les dépendances d’un château entouré d’un lac, avec une tour ronde, au toit penché. Il était renommé dans l’aristocratie. Fort et trapu, il avait fière allure.
Le grand-père régissait le gibier du parc du château en organisant des chasses, des battues, et servait souvent de « second fusil » pour des invités prestigieux en tirant en même temps que ces derniers. La cible abattue, il avait toujours un compliment pour son hôte invité :
— Joli coup, Monsieur le procureur (ou Monsieur le gouverneur, Monsieur l’ambassadeur). Vous ne lui avez laissé aucune chance. Entre les deux yeux : vraiment, un joli coup de maître !
Les petites filles étaient éloignées de la cohorte des chasseurs, des festivités tardives, des chansons des gardes et de ce qui pouvait se passer à la suite des chasses quand, dans la nuit, certaines créatures étaient amenées auprès de ces messieurs, les chants et les rires s’élevant très fort.
Marie et Blanche avaient été confiées à des servantes, qui s’occupaient de la cuisine, de la préparation des plats, en relatant entre elles certaines anecdotes et des comportements qu’il était théoriquement interdit d’entendre. Les filles en apprenaient plus que certains ne l’auraient voulu.
Revenues dans la maison familiale, il fallut envisager un avenir pour les fillettes. Qu’allait-on faire d’elles ? Quel était leur niveau ?
La plus jeune continuerait ses études pour passer son certificat d’études primaires, c’était autrefois un diplôme envié. La plus grande était un peu plus avancée. Elle devait montrer l’exemple. Il fallait la pousser vers des spécialités avant qu’elle n’entre dans la vie active. Elle fut donc inscrite à des études pratiques et manuelles : apprentissage du tricot, de la cuisine, et plus techniques, la machine à écrire, qui offrait bien plus de débouchés.
Marie était un peu dissipée et bavarde en classe. Une maîtresse sévère la dirigea automatiquement vers l’apprentissage de la machine à écrire, en lui disant :
— Toi, au moins, pendant que tu taperas à la machine et que tu te concentreras sur les touches, tu te tairas.
Mais il fallait trouver l’argent pour l’achat de la machine et payer une partie des cours, non prise en charge par l’Éducation nationale. Le père donna une part très modique en disant qu’il avait des projets avec sa nouvelle femme et qu’il ne pouvait pas tout payer. Ce fut le grand-père, Ernest, qui avança l’argent pour les études des deux petites.
Dégourdie et très dynamique, Marie se débrouilla fort bien la première année et se fit remarquer par la directrice, qui n’hésita pas à la pousser et à l’encourager. Elle la fit travailler, lui passa des livres et la prit sous son aile.
Pendant ce temps, la deuxième femme vint s’installer dans la maison familiale. Un jour, les deux filles virent apparaître, dans l’encadrement de la porte, une femme un peu forte, un peu rougeaude. Gabriel la présenta en disant :
— Voici ma future femme, Louise, donc votre future mère. Elle vient vivre à la maison et nous allons bientôt officialiser son installation. Je vous demande de vous entendre avec elle, de l’aider comme avec Maria. Je ne veux pas de disputes. Chacun doit y mettre du sien, puisque nous allons vivre ensemble. C’est ainsi !
S’entendre, oui, peut-être, mais qu’en était-il de l’amour ? Là, c’était autre chose.
Durant les premières semaines, le quotidien se passa calmement, dans une grande indifférence. Mais, bien vite, le ton changea et tous les projets furent contrariés.
De retour de l’école, après quelques moments passés à réviser dans leur chambre, vint le temps, pour les filles, de montrer ce qu’elles avaient appris à la nouvelle femme de leur père, Louise.
Elle toisa de son regard glaçant les deux enfants et leur dit :
— Alors, ces récitations ?
Cette seule question sèche leur fit oublier la moitié de ce qu’elles devaient énoncer.
— Tu ne sais pas ta leçon, recommence !
Elles n’avaient droit qu’à une erreur. En cas de nouvelle hésitation, c’était :
— Va apprendre ! Tu reviendras quand tu seras sûre, dans une heure, s’il n’y a pas autre chose à faire d’ici là !
Dès le premier soir, Gabriel étant absent de la maison, éloigné sur un chantier lointain, elles ne trouvèrent pas leurs couverts placés sur la table et ne virent que le repas de Louise, fumant dans une assiette.
— Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous mettre la table et vous préparer le dîner ? Vous êtes deux filles, vous pouvez mettre vos assiettes et faire votre repas. Il faut que vous appreniez à cuisiner. Faites-le pour vous, ça vous apprendra les bonnes manières. Vous avez tout dans la remise et le buffet. Lavez les légumes avec de l’eau, faites-les bouillir, placez du chou, des pommes de terre coupées, du lard qui se trouve dans le placard, enveloppé dans un linge, et votre repas sera fait. Le pain est dans le torchon au fond à gauche. Vous devez savoir vous débrouiller toutes seules, vous êtes des filles. Qu’est-ce que vous croyez ? Que je vais jouer à être votre mère ? Que je vais la remplacer ?
Certains jours, c’était plat unique. Pas d’œufs, très peu de légumes, pas de viande, et encore moins de fromage : simplement une soupe claire avec une tranche de lard.
— Eh bien ! Nous sommes loin des habitudes de maman Maria !
— Eh oui, ce n’est pas notre mère. Nous sommes ici des étrangères ! répondit Marie.
— Tu crois qu’elle va aller faire les commissions ? demanda Blanche. Il n’y a plus grand-chose à manger.
— Quand même, Papa lui donne assez, il n’y a pas de raison ! répondit Marie.
En revanche, lorsque Gabriel rentrait tôt de ses chantiers, tous les couverts étaient préparés et une marmite fumante trônait au centre de la table.
Louise avançait ses pions. Elle commença à gérer l’argent à sa façon. Elle prenait ce qui lui permettait de vivre avec Gabriel et excluait petit à petit les enfants en essayant de les dégoûter des plats ou en leur donnant la plus petite part.
Les conflits commencèrent à éclater. Il était normal que les enfants veuillent manger à leur faim, surtout quand elles voyaient la double part que se réservait Louise.
Elles firent, au début, quelques timides allusions à leur père. Puis, devant son indifférence, elles lui expliquèrent carrément ce qui se passait. Comment pouvaient-elles manger une soupe à peine teintée et sans consistance, avec un ou deux légumes, quand Louise se réservait un plat complet et copieux ? Mais le père ne les écoutait pas. Quand il rentrait, il était fatigué de ses chantiers, voulait se reposer, et surtout ne pas entendre de conflits.
— J’en ai assez de vos jérémiades. Faites un effort. Elle fait à manger pour tout le monde, vous donne autant qu’à moi. Je ne comprends pas, du reste, ce que vous me dites. Vous êtes bêtes et capricieuses. Vous êtes jeunes, c’est à vous de vous habituer. J’en ai assez ! Ou vous me laissez tranquille, ou vous montez dans votre chambre. J’ai quand même autre chose à penser !
— Il la croit aveuglément. Que pouvons-nous faire ? murmura Blanche à sa sœur.
— Je ne sais pas, Papa ne veut pas nous écouter.
Louise se plaignait des filles, qui rentraient tard. Elles se défendaient en disant qu’à l’école, les études surveillées du soir les retardaient, qu’il fallait bien qu’elles révisent leurs leçons après la classe avec une maîtresse, puisque personne ne les aidait à la maison. De plus, il était difficile de se concentrer dans la chambre pour étudier avec les demandes incessantes ponctuées de cris de Louise. Du reste, que faisait-elle en journée ? Elle passait le balai dans la maison, lavait la vaisselle, allait rarement au lavoir, et ce n’était pas la variété ni la richesse de sa cuisine qui devaient l’occuper toute une journée…
Gabriel voulait un fils et ne souhaitait pas s’opposer à Louise, qui essayait petit à petit de l’éloigner de ses deux filles ou de les faire partir : au moins l’une au travail et l’autre en pension. Elle voulait être maîtresse chez elle, diriger en souveraine, et la présence de ces filles qui n’étaient pas d’elle contrariait ses plans. Ces deux enfants rappelaient de manière lancinante une autre personne, plus douce, plus aimée et aimante : leur mère. Ce n’était pas le rôle ni la valeur de Louise qui pourraient la remplacer. Elle ne pouvait se faire aimer par les deux filles. Elle n’avait rien à faire de ces incapables. « Mais qu’ont-elles appris ? Que savent-elles faire ? » se demandait-elle constamment.
Elle était là pour fonder sa propre famille avec Gabriel, il n’avait qu’à éloigner ses filles. Maintenant elle devenait le personnage central de la maison.
Elle pensait : « Il n’a qu’à les mettre au travail. Elles commencent à nous coûter cher ! Pourquoi devraient-elles rester à la maison ? »
Un soir, Marie cacha son assiette de soupe, de l’eau claire avec un morceau de pain, et la montra à son père en lui disant :
— Regarde ce qu’elle nous laisse à manger avant ton arrivée ! Toi, tu arrives, tu as correctement à manger, mais regarde ce que nous avons pour faire notre repas !
Gabriel éluda, comme à son habitude, le problème et répondit à côté :
— Moi, je la comprends, dit-il. Vous n’êtes pas ses filles, et pour vous, ce n’est pas votre mère. Bon, entendez-vous, toutes les trois, tout de même. Aujourd’hui, l’une fait la cuisine. Demain, l’autre fait la lessive. Ce n’est pas la mer à boire. Organisez-vous pour vous faire réviser l’une l’autre, vous êtes suffisamment intelligentes. J’ai autre chose à faire que d’entendre sans cesse des histoires d’enfants. J’ai des ouvriers à faire travailler, une entreprise à faire tourner, des chantiers à diriger. Ils comptent sur moi pour leur paie de fin de mois. C’est autre chose !
Gabriel n’aimait pas ces situations, ces conflits, et s’en allait très souvent dans son atelier pour les fuir.
Le soir, le repas dirigé par Louise était loin d’être gai. Chacun regardait l’autre en silence ou baissait le regard pour ne pas faire éclater les ressentis ni donner prétexte à des réflexions, à des disputes ou à des punitions. Il ne fallait pas la regarder avec trop d’insistance, sinon on s’entendait dire :
— Qu’est-ce que tu as ? Tu as quelque chose à me dire, à me reprocher ? Tu as un commentaire à faire ? Tu n’es pas contente ? Tu la veux, celle-là ? ajoutait Louise en montrant une main largement ouverte.
Le regard de la maîtresse de maison était méchant. On voyait de la haine dans ses yeux. Elle tenait les filles à l’écart de tout apprentissage culinaire. Elle n’allait surtout pas leur apprendre quelque chose. C’était sa forme de vengeance : « Elles ne savent pas, elles sont donc dépendantes de moi. Je les tiens. Elles n’auront qu’à m’obéir. »
— Ou vous m’obéissez, ou vous crevez de faim, aimait-elle à répéter. Ici, c’est moi qui commande. Vous êtes à ma botte, les gamines.
Et elle poursuivait :
— Je gère l’argent. C’est à moi que Gabriel le donne. Si vous voulez que ça marche, vous devez m’obéir, sinon vous n’aurez que les restes !
Et elle partait en riant.
C’était l’apprentissage de l’indifférence et du mutisme, de la dissimulation des caractères et des sentiments, l’apprentissage de la comédie… de ce qu’on appelait « la vie ».
Un jour, en rentrant de l’école, la petite Blanche, lasse, répondit un peu sèchement à Louise.
— Tu n’es pas ma mère, je m’en moque !
Ne supportant pas sa réponse, Louise attrapa son poignet en le lui tordant et, à coups de pied, elle la conduisit près de la grande armoire, l’y fit rentrer de force, puis elle s’appuya contre la porte de tout son poids de campagnarde costaude pour l’empêcher de ressortir et ferma à clef. Bien sûr, l’étagère tomba, et la petite fille se trouva dans le noir, coincée et arc-boutée contre la paroi, entre les pots de confiture. Elle était percluse de douleurs. Cette position inconfortable et intenable lui occasionnait des crampes.
Comme elle venait de rentrer de l’école, elle n’avait pas eu le temps d’aller aux toilettes et dut faire ses besoins sur elle, ce qui fit exploser la méchanceté de la Louise quand elle ouvrit la porte, le soir, avant le repas.