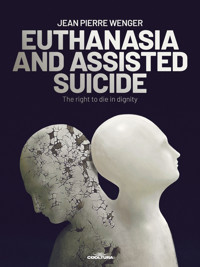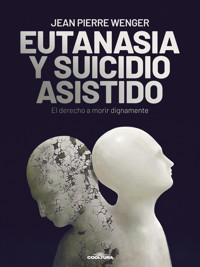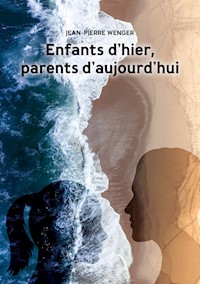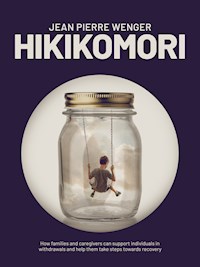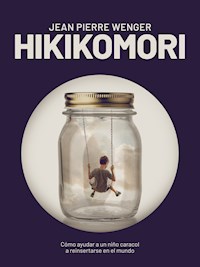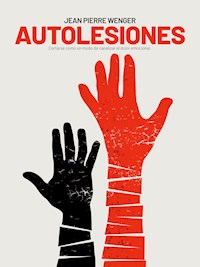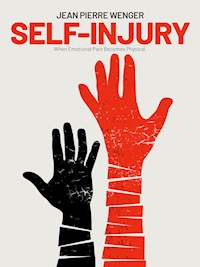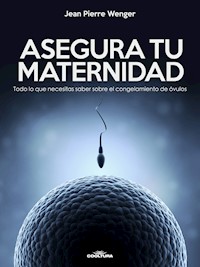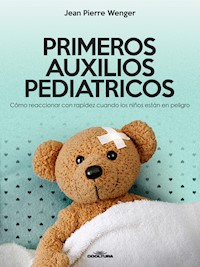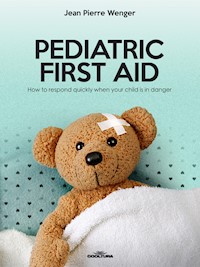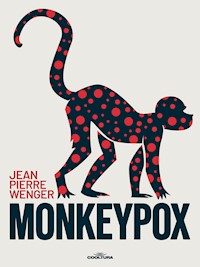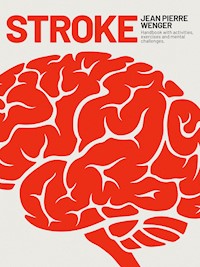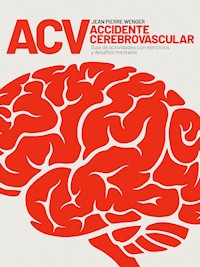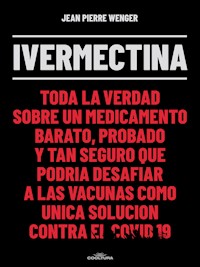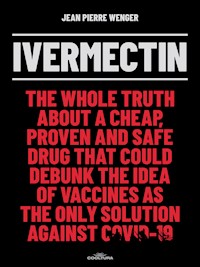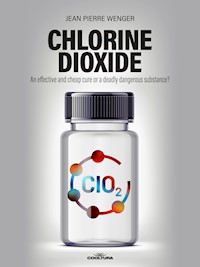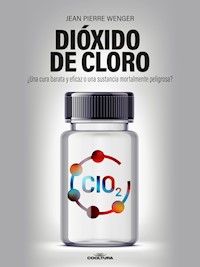9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Qui ne s'est pas interrogé un jour en contemplant, de nuit, l'immensité de la voûte céleste ? Comment tout cela a-t-il commencé ? Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Cet essai aborde toutes ces interrogations fondamentales portées par les thèses des scientifiques et des philosophes. L'origine de l'univers, de la vie ... mais aussi la question du sens : pourquoi la vie, la mort, quel est le rôle des humains ? Il vulgarise ces questions essentielles sous forme d'un dialogue passionnant les rendant accessibles à toute personne qui s'interroge : que faisons-nous de notre vie, du laps de temps qui nous est imparti, qu'apportons-nous ? Un point sur les théories actuelles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Du même auteur (roman) :
LE DESTIN, BoD, 2019
TABLE
AVANT-PROPOS
L’UNIVERS
1°) Thèse d’Edgard Gunzig
L’Univers opaque
L’Univers transparent
2°) Thèse de Léonard Susskind
3°) Le raisonnement d’Albert Einstein
4°) La physique quantique
Premier principe : les incertitudes d’Heisenberg
Qu’est-ce que le vide ?
5°) Théorie des cordes
6°) Quand le doute s’installe
Qu’est-ce que la masse ?
Qu’est-ce que l’énergie ?
Qu’est-ce que la matière ?
Qu’est la distance, la vitesse, l’espace-temps ?
7°) La discrétisation
8°) Principes de thermodynamique
9°) Exemple d’Einstein
10°) Aujourd’hui où en sommes-nous ?
LA VIE
1°) Qu’est-ce qu’une molécule ?
2°) Qu’est-ce qu’une cellule ?
3°) Qu’est-ce qu’une protéine ?
4°) Qu’est-ce qu’une enzyme ?
5°) Intelligence inconsciente
6°) L’inconscient
7°) Ordinateur quantique
8°) Dépendance globale
9°) Le subconscient
10°) Problématique du vivant
11°) Gestion informatique
12°) Le conscient
13°) Sens et non-sens
14°) Intelligence globale
15°) Devenir
16°) Les grandes fonctions
Captation
Traitement
Action
Mémorisation des faits
Fonctions essentielles
17°) Sens de la vie
LA MORT
1°) La mort comme erreur de quantification de l’énergie
2°) La mort comme usure des moyens
3°) La mort comme maladie
4°) La mort comme défaut de programmation
5°) La mort comme limitation
6°) La mort comme coupure électromagnétiques des jeux de forces
7°) La mort comme devenir
8°) Sens de la mort
LE PASSAGE
L’AILLEURS
CONCLUSION
1°) Interrogations
2°) À quoi croyons-nous ou voulons-nous croire ?
AUTEURS DE RÉFÉRENCE
AVANT-PROPOS
Cet essai est inspiré de ma thèse basée sur des textes philosophiques, reprise aujourd’hui sur des thèses, essentiellement scientifiques.
La trame de la pensée demeure, les mots choisis pour la développer ont été simplifiés et les thèmes rendus plus accessibles.
Les définitions scientifiques et techniques sont incluses dans le texte pour ne pas hacher la lecture et la rendre plus fluide.
L’essai est rédigé sous forme de dialogue pour marquer les oppositions et contradictions ainsi que les précisions ou convergence de réflexions ; il permet de reprendre en cas de difficultés les mots pour simplifier la pensée et gagner en clarté et compréhension.
Le chemin suivi est néanmoins celui des grandes interrogations antiques, philosophiques et scientifiques : comment s’est créé l’Univers, d’où je viens, où va-t-on ?
Il est conduit par les questions que se sont posées certains grands savants et auteurs.
Cette démarche permet de manier les problématiques et de baliser un parcours qui ouvre des tentatives de réponses fondamentales sur les questions de la création, de la vie, de la mort…
Les textes et auteurs rencontrés montrent des impossibilités, des croyances, des principes qui s’affaiblissent et laissent entrevoir des développements futurs.
Parcourir ce chemin nous amène vers des inconnues variables de l’origine de la structuration de l’Univers, aux différentes thèses le concernant, puis à nous intéresser à notre sort : quel est le sens de la vie, de la mort ; à quoi nous sert ce parcours semé de maladies et de contraintes ?
Bien sûr nous serons confrontés aux questions : y a-t-il un passage et un ailleurs ?
Ces questions s’imposent à nous comme à tous ceux qui parcourent ce chemin. Personnellement, je pense qu’il est enrichissant pour l’intellect, cadre quelques réflexions et permet des développements fabuleux, mais à chacun de construire ses savoirs, ses croyances.
Si ce travail pouvait servir de base à diverses explications et conjectures, nous en serions très heureux.
I — L’UNIVERS
Par une belle nuit d’été profonde, Audrey et Maurian s’allongèrent sur l’herbe pour contempler la voûte céleste.
— Combien sont-elles ? demanda Audrey, quelle immensité !
— Des milliards, répondit Maurian, plus celles qui sont trop lointaines pour en percevoir la lumière ; il y en a une infinité.
Audrey : Comment sont-elles nées ?
Maurian : Pour l’abbé Lemaître né en 1894, elles proviennent de l’explosion d’un atome unique, puis d’une expansion vertigineuse de l’Univers, c’est-à-dire d’une évolution d’un point de départ, d’une origine : thèse communément répandue dans la communauté scientifique.
A. : Tu te moques de moi… Des milliards de créations ne peuvent venir d’un seul atome !
M. : Il y a des preuves de l’expansion par le décalage du rayonnement des étoiles vers le rouge. En effet, quand elles sont proches, ce dernier tend vers le bleu ; plus elles s’éloignent, plus il devient rouge, – effet aussi nommé « effet Doppler » – et puis il y a l’écoute et la mesure du rayonnement fossile de l’Univers, il y a bien eu explosion.
A. : Je ne comprends pas la thèse de l’explosion. Comment à partir de rien une explosion peut-elle se produire et créer l’Univers, et comment « UN » peut-il créer un infini ? Pour moi, les deux explications sont bancales.
M. : Ce point de départ est invisible, sans références, sans espace ni temps, les scientifiques disent qu’il est partout et nulle part puisqu’il n’y a encore rien. Il est situé sous les dimensions de Planck à 10-35 (les dimensions de Planck sont les plus petites unités concevables et mesurables de notre Univers en ce qui concerne la longueur, le temps, la masse et l’énergie) ; à ces dernières l’espace et le temps n’ont plus de significations. Plus ce point est petit, plus il est dense, d’où sa puissance et son énergie infinie.
A. : Ceci m’interpelle : logiquement on ne peut sortir un infini d’un fini même le plus dense ; ce point d’origine est quasi inexistant et indéfinissable, il existe mais il a toutes les propriétés de la non-existence. On ne peut mettre « Un » et infini sur un pied d’égalité ; il me semble que l’on peut considérer un vecteur, une droite, un fini dans les infinis de chaque catégorie, mais il faut le spécifier, et nous nous trouvons face à un cas limite à considérer un exemple parmi tous les autres. Je ne fais qu’émettre le doute d’Einstein : « L’Univers ne peut se ratatiner à zéro. » De plus, s’il se contracte, il faut dire jusqu’où. Maintenant, c’est peut-être une tournure de phrase pour faire comprendre que de toute façon il est indétectable dans son origine, c’est encore un quasi...
Stephen Hawking parlait de l’Univers réduit à une coquille de noix, Einstein à la dimension d’un atome et précisait que plus il était petit, plus il était dense ; il faut expliquer pourquoi et comment dans un sens il s’est étendu et dans l’autre compressé.
1°) Thèse d’Edgard Gunzig
M. : Je peux te comprendre, tu rejoins en ceci la thèse d’Edgard Gunzig, professeur à la faculté de Bruxelles qui trouve que la science passe là du rationnel à l’irrationnel.
A. : Comment peut-on parler d’infini ? On ne le conçoit pas, il dépasse notre entendement, donc les calculs.
M. : Les savants placent dans leurs équations le symbole d’un huit renversé pour y introduire la notion d’infini et ils s’imaginent qu’ils peuvent produire des cahiers entiers de calculs et qu’ils le manient…
A. : C’est bien ce que je veux te dire : le manier, ce n’est pas le discipliner, le contraindre, enserrer, ce n’est pas parce qu’on joue avec un symbole qu’on l’englobe et le maîtrise : du reste maîtriser l’infini… Cela fait un peu curieux, voire louche.
M. : Les savants pensent que oui et qu’ils peuvent mathématiquement découvrir en toute logique des conséquences qu’on ne voit pas et n’appréhende pas, et heureusement !
A. : Être sûr de quelque chose, c’est, pour eux, le faire rentrer dans leurs calculs… Mais ils ne sont sûrs que des calculs. Pour moi, si nous parlons d’« Un », c’est qu’on peut prendre, déplacer, enserrer.
M. : Du moins, ils veulent le croire.
A. : À la limite le symbole renvoie à quelque chose que nous essayons de représenter, de matérialiser : il y a donc au début un état, une origine pour exploser : comment se sont-ils constitués ? Mais aussi je vois du côté du calcul une incohérence : on ne sait jamais si ce que l’on utilise dans une équation joue constamment ; même les plus grands mathématiciens se demandent jusqu’à quels degré et situation fonctionne une équation et cherchent même la limite de son application.
M. : Les thèses modernes cherchent toujours jusqu’à quel point un résultat demeure invariant.
Les savants cherchent ce qui pourrait la transgresser. (On parle de « constance » ou de « violation d’une loi ».)
La seule chose qu’on pourrait dire, c’est qu’elle est vraie jusqu’à la cause perturbatrice, en général, attendue au niveau des dimensions de Planck. L’origine, c’est un point zéro, mathématique : une densité, une température, une énergie absolue…
A. : Si je comprends bien, tout est déjà là ; et tu places toutes tes conditions idéales au début, comme cela, tu ne risques pas d’avoir de surprise. Pour moi c’est un artifice : un tour de passe-passe.
M. : La science actuelle place comme origine un atome unique, un trou noir, ou un vide primaire, un zéro premier.
A. : Il y a toujours un a priori : il y a quelque chose qui… C’est une contradiction dans les termes.
M. : C’est l’hypothèse actuelle des savants que tu peux juger bancale… Il faut bien, rationnellement, partir de quelque chose… Les scientifiques définissent le point zéro comme la plus petite énergie qui existe dans un point ou dans un système. Un oscillateur immobile continue en fait à vibrer ou à osciller. Tout système quantique (théorie qui se charge d’expliquer l’infiniment petit) possède un point zéro d’énergie qui est supérieur au minimum de son puits de potentiels classiques, c’est-à-dire de son voisinage. Cette théorie a été développée par Max Planck : l’énergie du vide correspond à l’énergie du point zéro de tous les champs d’espace. Le vide possède une énergie. Le point zéro, l’espace zéro cumulent toute l’énergie en un lieu.
A. : Si nous plaçons au début une cause matérielle ou spirituelle, nous devons en expliquer l’objet ou le sujet et leurs moyens d’action. A-t-on besoin d’une « intelligence » pour être adapté et efficient ? Dans ta définition quelque chose me choque : un point d’énergie vu sous cet angle sera toujours supérieur à ce qui l’entoure si tu englobes qu’il est supérieur à son voisinage : mais comment s’est-il formé, condensé ? C’est aussi d’office admettre que dans ce point tout se condense ou se transforme, mais ne disparaît pas. En bonne logique, avant une aventure il n’y a « Rien » et il faut expliquer comment de rien quelque chose est advenu. Comment peut-on dire au début : il y a un point zéro, d’espace zéro mais qui est potentiellement et possède une énergie infinie ? Si l’on part de la potentialité, on part du virtuel, du formel, de l’irréalité pour les transformer en matérialité. C’est un peu facile de dire : il y a un point zéro, d’espace zéro supérieur et infiniment à tout, puisque autour il n’y a rien.
M. : Attends, tu nous refais le coup de la création ex nihilo.
A. : L’évidence, c’est l’évidence. De plus, dans ta remarque précédente il faut que les lois soient constantes depuis la création.
M. : Les savants estiment la masse volumique du premier atome à 1086 à 1094.
A. : Mais enfin, dire au début : « Il y a », c’est similaire au commencement d’une fable, belle, mais c’est une fable.
M. : Tu ne vas quand même pas dire que c’est Dieu !
A. : Non, je ne suis pas croyante et je ne vois pas comment un esprit, même saint, pourrait créer la matière ; je suis bassement logique : avant quelque chose, il n’y a rien. Et tu me dis que ce rien a une densité, une énergie ?
M. : Oui, et colossale.
A. : Il ne sert à rien d’être assis dans un fauteuil devant un écran noir et de dire : « Un point qu’on ne peut voir et concevoir au centre explose, suivi d’une projection énorme de feu et d’énergie » ; et dire : « Voici la création, circulez, c’est terminé, tout est dit ». En somme, quand il n’y a rien, tout peut arriver et peut se produire.
M. : C’est un conflit entre deux logiques et rationalités qui me gêne ; il est tout aussi logique de dire : il faut que quelque chose soit au début, fusse un vide créateur, un point fermé et zéro, que de dire avant l’origine il n’y a rien.
A. : Je commence à croire que ces deux points de vue, aussi logiques soient-ils, ne le sont pas tellement, car ils sont précisément deux.
M. : Je te propose d’aller voir du côté des grands auteurs scientifiques et d’effectuer en conclusion, et si nous le pouvons, le point sur nos convictions. Tu sais à ce sujet qu’Albert Einstein disait que la science n’est que croyance…
A. : Est-ce que tu me comprends ? Tu parles d’explosion, d’expansion, de contraction ; il faut quelque chose de présent qui se contracte, explose… Tu as parlé d’un professeur tout à l’heure ; que dit-il ?
M. : Il s’agit d’E. Gunzig, disciple d’Einstein : pour lui, l’Univers est un bootstrap. Il donne une définition dans son livre Que faisiez-vous avant le Big-Bang ? : se hisser en tirant sur ses chaussures. Pour appuyer sa thèse, il prend deux exemples, deux légendes illustrant sa pensée : celle du baron de Münchhausen qui, tombant dans un lac et s’enfonçant dans la vase, tire sur ses propres bottes pour se sauver, ou celle de Cyrano de Bergerac dans Les États et Empires de la lune qui lance par phases successives dans le ciel un aimant qui l’entraîne vers cette dernière. Pour Gunzig, l’Univers s’autocrée. L’énergie première est celle de l’espace fermé sur lui-même ; c’est une potentialité gigantesque qui engendre un puissant champ gravitationnel dont les effets et la trace sont de puissantes ondes gravitationnelles, originelles.
Là, tu as un élément de réponse : quand il n’y a rien, il y a une énergie potentielle énorme. La forme géométrique de l’espace est première, et la création de la matière résulte d’un mécanisme d’excitation entre la forme de l’espace vide et l’expansion. Ce point, cette forme aurait pu s’effondrer sur lui-même, mais le champ gravitationnel, la masse qu’il engendre l’a ouvert. Au lieu de jouer dans un sens d’écroulement, elle a joué en sens inverse, celui de l’expansion. Depuis le début, espace et vide sont concomitants. Rappelons que, pour Einstein, le vide est dans la réalité des objets.
A. : D’après ce que je comprends, l’espace est une forme géométrique qui s’ouvre sous son propre poids.
M. : Attention ! Il ne faut pas parler de poids, mais de masse qui va engendrer un champ gravitationnel, une expansion, une explosion. Sans cela, il se serait effondré sur lui-même et l’Univers n’aurait jamais existé : c’est ce que l’on nomme « singularité ».
A. : Tu veux dire que toute existence possède une masse et que celle-ci est le premier moteur, condition d’ouverture ? Mais ce qui me choque, c’est d’où vient cette forme d’espace première ?
M. : Tu es dure : c’est l’a priori d’Einstein, la forme géométrique, c’est son point d’origine, son point mathématique, le premier élément de son équation…
A. : Il en faut un comme tu le disais.
M. : Oui, et pour lui ce point grossissant amène l’Univers à ses conditions terminales semblables aux premières, qui, à leur tour, conditionnent une nouvelle création, et ce, perpétuellement. Tu constates que pour Gunzig tout comme Einstein, la gravitation engendre son opposé, l’expansion, que les deux sont jointes dans le principe de dynamisme, et d’équivalence : nous le retrouverons aussi avec L. Susskind.
A. : Pour le moment ce que je comprends, c’est que le rapport entre la forme géométrique et l’expansion crée la matière : il y a entraînement entre les deux, une auto-friction. Par contre, j’ai du mal à comprendre que plus quelque chose tourne sur lui-même, plus il crée de la matière qui s’écarte de son centre d’écrasement.
M. : C’est pourtant ce qu’explique Einstein, c’est l’opposition entre les forces centrifuges et centripètes, tu sais comme quand on est éjecté à l’extérieur d’un tournant. Autre exemple : quand on contemple un trou noir, un cyclone, nous avons au centre, ou proche de la circonférence, des concentrations et à l’extérieur, plus loin des éjections de matière.
A. : Si je comprends toujours, l’Univers dans sa création première aurait pu s’écrouler, mais il s’est expansé à cause de sa masse : cette dernière s’exprime dans tous les sens, écroulement et expansion.
M. : La masse crée avec l’espace un rapport de densité ; l’Univers pourrait donc s’effondrer et disparaître, mais cette même masse s’exprime par un volume ; de plus, elle se caractérise dans l’espace par une giration qui engendre deux forces opposées ; une de concentration au centre et une de refoulement, à la périphérie.
La giration se traduit par des forces de frottement, un échauffement entre l’espace et l’expansion. Nous avons donc deux causes de redistribution : la gravitation pour la relativité et les vibrations des petites particules quantiques pour la théorie quantique ainsi que deux causes de non-disparition : masse pour Einstein, vibrations pour la théorie quantique.
A. : Et donc, il n’y a pas de compression absolue ni d’homogénéité parfaite.
M. : Il semble que non. Cette thèse de l’unification s’appelle « GUT ou théorie de la grande unification » : elle est née de l’unification des interactions électriques et magnétiques, puis des interactions électrofaibles et interactions fortes. Pour le moment, aucune force n’a pu absorber la force gravitationnelle. Elle est pourtant prévue par les calculs. La force gravitationnelle opère à partir de 10-35. E. Gunzig distingue deux phases : l’Univers opaque et l’Univers transparent.
a) L’Univers opaque
Les photons (particules ou quantas de lumière) primaires s’entrechoquent, agités dans un chaos qui empêche toute émission ; ils sont immédiatement associés, dissociés. Cet univers s’apparente à un corps noir (corps fermé sur lui-même et qui ne rayonne plus de lumière, mais uniquement de la chaleur) dont la propriété est de ne laisser passer aucune lumière et de ne rayonner uniquement que de la température. L. Susskind pense aussi à ce moment au trou noir.
b) L’Univers transparent
C’est aux environs de 3 000 degrés et 380 000 ans que l’Univers assez vaste a laissé les photons s’associer, et que l’univers est devenu transparent, lumineux.
A. : Je comprends ici que sans l’expansion, sans la lumière et les photons, l’Univers ne se serait pas révélé et qu’il n’y aurait aucune connaissance. La trace, c’est le premier rayonnement : celui du fond de l’Univers.
M. : Le satellite COBE mesura précisément la température de ce rayonnement ; la courbe correspondait totalement à la courbe théorique de Planck et à celle d’un corps noir parfait. Elle fonde le modèle thermodynamique (théorie des échanges d’énergie et de chaleur) et le modèle standard. Cette image thermique correspond à la première image de l’Univers (âgé de 380 000 ans). Cette région de première ou de dernière diffusion, tout dépend de l’angle de considération, est trop grande pour que la lumière puisse la parcourir et elle contient des régions qui n’ont pas pu communiquer. Que donnent le calcul et le raisonnement de Gunzig alors ? Le rayon visible de notre Univers actuel vaut le produit de son âge par la vitesse de la lumière.
En prenant le rayon de l’Univers, la température actuelle et celle de Planck avec la vitesse de la lumière, nous obtenons que notre Univers visible actuel provient de l’expansion d’une région d’un millionième de millimètre de rayon (10-3). C’est bien trop grand par rapport au temps 10-43 seconde et à la distance de Planck 10-33 cm vis-à-vis de ce que peut parcourir la lumière. L’Univers est donc 1029 plus grand par rapport à ce qu’il était réellement. La conséquence est que les régions comprises à l’intérieur de l’horizon ont reçu l’information, pas les autres.
A. : Je comprends qu’ainsi toutes les régions de l’Univers n’ont pas eu le même développement, ne sont donc pas au même stade.
M. : Oui, et autre paradoxe, celui de la densité. Si elle est trop petite au début, notre Univers se serait effondré ; trop grande, il aurait pris une expansion infinie : les deux cas auraient empêché une évolution telle que nous la connaissons. Cette question est importante, car elle conditionne la forme de l’espace ; en fait :
– La vitesse de l’expansion est ralentie par l’attraction gravitationnelle.
– Plus la densité est grande, plus l’attraction gravitationnelle est grande.
– Plus les masses dans l’Univers sont grandes, plus la densité s’élève.
– Plus grandes sont les masses et la densité, plus la décélération de l’Univers s’accentue.
Dans ce cas, l’Univers, après avoir freiné, se contractera pour atteindre ce que l’on appelle le « Big Crunch » : écroulement sur soi. Si la densité est trop faible, l’expansion se produira à l’infini… densité trop forte ou trop faible… à moins qu’elle ne soit juste à ce que l’on nomme « densité critique ». Ce paramètre détermine le type de géométrie de l’Univers.
Une courbure positive entraîne un espace fini mais sans frontières, comme la surface d’une sphère que l’on peut parcourir sans cesse. Une courbure négative montre une forme de selle de cheval et un espace infini. La courbure nulle montre un univers statique.
C’est une question importante car cette densité détermine la nature de l’univers : il ne faut pas s’étonner que plusieurs satellites soient mis à contribution pour la mesurer.
Le satellite COBE révéla que la densité est juste celle de la densité critique pour répondre à cet ajustement extrêmement fin et qu’elle serait légèrement positive pour E. Gunzig. En réalité, les mesures sont extrêmement critiques et dans la marge d’erreur, tant et si bien qu’à ce jour, on n’a pas de certitude.
Le satellite « SNAP » confirma l’accélération de l’Univers et surtout de petites irrégularités dans la soupe primaire, les mêmes qui ont produit les amas planétaires. Toutes ces études montrèrent autre chose : nous ne connaissons que 5 % de notre Univers, nous en ignorons 95 % ! La grande surprise fut de découvrir que la matière visible et classique, dite « baryonique », donc composée d’hydrogène, de protons et de neutrons ne représentait qu’une petite partie de la matière de l’Univers. Deux matières furent soupçonnées d’exister : la matière cachée et l’énergie noire (par opposition à la matière et à l’énergie visibles et mesurées).
A. : Ceci devrait conduire nos savants à plus de simplicité, d’humilité. Si je comprends bien, en mesurant les systèmes planétaires, en calculant leur masse pour qu’ils s’équilibrent comme ils le doivent et en estimant cette dernière par ce que l’on voit, les scientifiques ne trouvent pas les mêmes chiffres. Ce calcul fut d’ailleurs fait notamment par Fritz Zwicky.
M. : Exact, il y a une différence très nette ; de là est née la thèse de l’énergie noire et de la matière noire. Pour E. Gunzig plusieurs hypothèses s’ouvrent :
1) L’existence d’une énergie répulsive : l’énergie noire comme antigravité. Cachée, elle interfère peu avec la matière, si ce n’est qu’en la tirant ou en la repoussant à l’extérieur et ne se révèle qu’indirectement.
2) L’appel au vide quantique dont on connaît la densité, mais qui ne correspond pas à la puissance recherchée.
3) Un champ scalaire correspondrait à cette définition : ce champ est défini par la même qualité invariante et unique en chacun de ses points. Par exemple, un champ dont tous les composés auraient la même mesure de température ou de densité contrairement à celle d’un champ électrique qui se définit par une longueur et direction. Ce dernier répulsif s’appelle la quintessence. Pour l’auteur, ce terme désigne l’union des énergies, forces et propriétés sous une seule identité.
A. : Si je comprends bien, c’est l’unification consacrée qui trahit une propriété unique et universelle avec une valeur identique.
M. : Oui, c’est cela. Une autre candidate se présente : la constante cosmologique d’Einstein qui, au lieu d’être constante, serait variable et s’inverserait. La valeur de cette constante cosmologique est 10-123, en unités de Planck. Sa valeur suivrait les formes de l’espace.
A. : Comment faire confiance à cette valeur rajoutée à la main ?
M. : Sauf si son auteur a voulu à la limite lui faire jouer un rôle dynamique capable de s’inverser : au début, il l’avait intégrée pour rendre l’Univers statique, mais si elle exprime toutes potentialités, celle de s’inverser est tout aussi réelle et il devient impossible qu’elle soit constante.
M. : Il a d’abord dit que c’était la plus grosse erreur de sa vie, mais elle intervient de nouveau au moment où on l’avait oubliée. Pour Gunzig, l’explication vient du champ scalaire, ce champ cosmologique est déterminé par « l’inflation ». L’énergie potentielle (énergie qui se transforme en une autre, et est fonction du système dans lequel elle se produit, par exemple énergie mécanique d’une chute d’eau en rapport à la hauteur pour créer de l’énergie électrique) antérieure à toute création, détermine toute la suite de l’Univers : ses transformations sont récupérées par le milieu cosmologique. Le champ scalaire la transmet au milieu qui la conditionne et se recycle.
A. : Pourquoi en appeler à l’inflation, puissante accélération de l’Univers ?
M. : Elle explique le paradoxe du gonflement des distances et des différences de densité ; c’est une explication logique et commode pour faire correspondre l’origine, la cosmogénèse et ce que nous observons actuellement ; la science n’a pas d’autre explication.
A. : C’est une explication raisonnable mais non indubitable.
M. : Pour E. Gunzig, notre Univers est le produit d’une confrontation entre l’attraction universelle et l’expansion de l’espace : deux forces arbitrées par la variation de densité, par la constante cosmologique. L’espace dynamique produit l’expansion qui crée l’espace, l’espace et son expansion conduisent au final l’Univers à ses conditions premières… L’évolution de ce dernier conduit à reproduire à la fin celles du début : c’est une autocréation.
A. : Deux forces ou une qui s’inverse ?
M. : Nous connaissons la valeur de la constante cosmologique : pour L. Susskind, c’est 10-122 à 10123.
A. : Ça rappelle celle du vide. Justement, si tu m’en parlais ?
M. : Nous abordons une difficulté réelle surnommée « la catastrophe du vide ». Les savants ne sont pas d’accord sur son évaluation : les cosmologistes en 2011 ont trouvé à partir de l’expansion de l’Univers 10-13 joules par cm3. Par contre, les calculs quantiques donnent 10-107 joules par cm3, le joule étant l’unité de mesure d’énergie du système international pour quantifier le travail, la chaleur, le déplacement d’un objet à l’aide d’une force motrice sur un mètre.
2°) Thèse de Léonard Susskind
M. : Cette thèse naît en réaction à une affirmation de S. Hawking qui disait dans une de ses conférences, face aux universitaires américains de manière globale et provocatrice, que tout ce qui entre dans un trou noir était irrémédiablement détruit. Un pari fut même pris et consigné. (En fait ce dernier s’est expliqué sur son pari ; il aurait parié sur le faux pour gagner dans tous les cas puisqu’il connaissait la vraie réponse ; facétie de savant ?) Cette affirmation niait deux piliers de la science universellement reconnus par la communauté scientifique : la conservation de l’énergie et de l’information ; c’est un pan de la science qui s’effondrait. De plus, il n’y avait plus de réversibilité des lois. C’était d’autant plus curieux que S. Hawking développait aussi la thèse de l’émission de chaleur des trous noirs et en produisait même la formule, mais le temps que durait cette irradiation n’était pas compatible avec la durée vraisemblable de l’Univers.
A. : En quoi cette thèse concerne-t-elle notre possible et impossible création ?
M. : La destruction rompt la thèse des conservations et concerne notre Univers. Pour L. Susskind et J. Bekenstein, tout ce qui tombe dans un trou noir accroît sa masse, donc sa chaleur, donc son émission. Ce qui est perdu de l’objet détruit est converti en masse, en chaleur, en rayonnement et donc, pour les auteurs, en information.
A. : Si je comprends bien, c’est un jeu d’équivalence : il y a perte d’un côté et gain de l’autre. C’est aussi le respect de la première loi de thermodynamique. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », disait Lavoisier. L’énergie est conservée.
Si tout disparaît, il y a violation de cette loi. Je pense que tu rapproches trous noirs et conditions de création pour répondre à nos questions.
M. : Et pour nous rapprocher de notre thèse de la création, L. Susskind écrit dans son livre Trous noirs : La guerre des savants : aux dimensions de Planck, la densité est celle d’un trou noir. Quelles sont les thèses en présence ?
– Celle de Hawking : l’information est absorbée dans le trou noir et quand celui-ci s’évapore elle disparaît aussi.
– Celle de Susskind : l’information est conservée et répartie en une fine couche sur l’horizon du trou noir.
– L’information se retrouve dans un lieu clos, compactée après la disparition du trou noir.
Il y a plusieurs réponses :
– En premier lieu, nous ne pourrons jamais produire cette expérience, car nous ne pourrons jamais nous approcher d’un trou noir.
– En second lieu, éclairer un photon (particule, énergie qui constitue l’émission de la lumière), un objet qui s’y dirigerait, nécessiterait tellement d’énergie que cela modifierait en retour nos observations et nos résultats.
– Enfin, nous nous trouvons en face de situations bien distinctes : avant la pénétration dans le trou noir et au moment du franchissement de l’horizon, ce sont deux moments de temps différents que l’on ne peut accoler. Et L. Susskind de dire : « La science n’est pas schizophrénique. » Et il fonde ainsi le principe de « complémentarité » du trou noir.
En fait, il copie N. Bohr quand celui-ci parlait de la lumière. Il disait : « Supprimez-moi ce ―et‖, la lumière apparaît comme onde ou quanta : elle est les deux à la fois ; les deux sont complémentaires. » Le calcul montre que tout atome qui s’approche est bombardé par ceux dissociés du trou noir et que tout observateur extérieur verrait l’objet s’étirer, se déformer, brûler tandis qu’au niveau de celui-ci, les occupants d’un vaisseau par exemple, verraient leur mouvement et leur voyage ralentir à l’extrême et mettraient un temps infini pour franchir l’horizon, plus que leur vie, et celle de l’Univers, grâce au principe d’équivalence, selon l’auteur.
A. : Si je me souviens bien, Einstein l’avait expliqué en disant qu’étant assis dans un train, on ne peut distinguer celui qui démarre ou celui qui demeure à l’arrêt tant que l’on n’a pas fixé un point dans la gare.
M. : C’est aussi l’expérience de l’ascenseur que l’on tire avec une fusée dans le vide spatial, ou que l’on laisse tomber du haut d’une tour à l’intérieur duquel des observateurs lâchent une pomme. Dans les deux cas, elle va chuter, mais on ne peut pas distinguer si cette dernière est produite par l’effet de la gravitation ou de l’accélération. On parle aussi de la chute d’une plume et d’une boule de plomb qui chutent simultanément et atteignent le sol en même temps.
Cela signifie plusieurs choses : la matière, le champ gravitationnel, la masse ralentissent le temps, la matière dévie la lumière ; l’expérience est indépendante du lieu et du moment où elle a été faite, il n’y a pas de différence entre le mouvement et le repos, car il n’y a pas de repos. Einstein démontre là l’équivalence entre le mouvement de la gravitation et l’accélération. Par rapport à l’espace, il n’y a pas d’objet immobile, de repos.
A. : Un objet immobile sur terre, c’est celui qui va à la même vitesse que cette dernière ; il en va de même pour toute chose et son référentiel dans l’Univers. À quoi cela nous conduit-il ?
M. : Les exemples des ascenseurs, des trains fondent les notions de référentiels et de déplacement, c’est ce qui constitue le cœur de la relativité comme déplacement : tous les référentiels sont équivalents, ce qui consacre et fonde le principe d’équivalence.