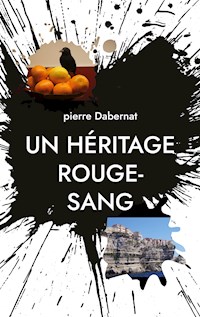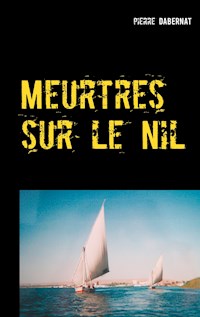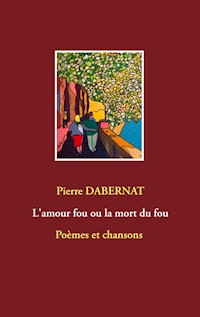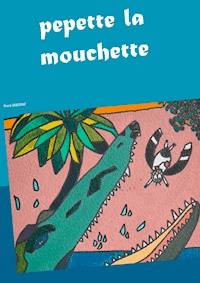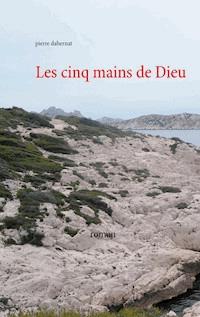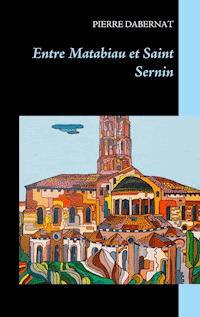
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ces nouvelles dédiées principalement à Toulouse, puisent leurs nombreuses racines dans les souvenirs et dans l'imaginaire de l'auteur, natif de cette magnifique ville. Par contre trois textes comme "L'incendie", "Le pont des Catalans", et "Un week-end-toulousain" sont des épisodes vécus où la réalité n' a eu nullement besoin d'une touche fictive supplémentaire. En outre "Une nuit place des Carmes" a servi de base pour écrire le polar "Le clodo des Carmes". Le début de cette aventure policière se déroule dans un immeuble, 41 place des Carmes, là-même où l'auteur a vécu durant quelques années et où un certain général Ramel fut assassiné par la foule toulousaine le 15 Août 1815.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nouvelles
Sur le marché à Saint Cyprien
Le placard des Mazades
L'incendie
Une nouvelle vie
Un week-end toulousain
Sur le pont des Catalans
L'hôtel d'Assezat
Une nuit place des Carmes
La paire de chaussures rouges
Entre Matabiau et Saint Sernin
La boite de nuit
Dans le train de Toulouse
Là où la Garonne épouse l'Ariège
Le mal d'amour
La tirebouchonnette
Le rêve envolé
Contes
Une nuit à Léran
Une étrange rencontre
Sur le marché de Saint Cyprien
C’est un type bizarre, sans âge, qui un jour de marché à Saint-Cyprien me l’a contée.
Il était assis à l’écart sur un cageot, un chien noir avachi sur ses pieds. Il possédait un visage buriné, d’imposantes moustaches à la gauloise et ne roulait pas les « R » comme chez nous. Il dégustait une saucisse de Toulouse qu’il tenait avec délicatesse, entre ses doigts épais et velus, comme s’il s’agissait d’un calisson d’Aix. Il la mangeait crue. Un verre de vin blanc était posé entre ses jambes à même le ciment.
Je connaissais cet homme rustique, mi-vagabond, mi-conteur et je savais que certaines de ses histoires qu’il daignait raconter, quand il avait un coup de pastis dans le nez, étaient particulièrement étonnantes, certaines voire effrayantes. Ce gars possédait un don réel mais il n’en avait cure. Ce jour-là, j’eus l’excellente idée de lui en voler une pour ensuite vous la conter. Je lui offris une deuxième saucisse, et avec la complicité d’une bouteille de Fronton, il me donna cette chose en héritage. Je vais vous la répéter presque avec ses mots. Par contre vous n’aurez pas son bel accent provençal, celui d'un patelin voisin de Manosque, et c’est là-bas, d’après ce que l’on m’a dit, qu’il s’en retourna, au début de l’hiver, après avoir avalé durant tout un été des kilomètres de saucisses.
Voici donc l’histoire.
La branche dans une déchirure d’air lui cingla brutalement le visage. La fillette poussa un cri de douleur et offrit une caresse potelée à sa joue meurtrie. A travers le rideau de ses paupières baissées, trempées par les larmes, elle tenta malgré ce brouillard de douleur de ne point perdre de vue ce qu’elle suivait.
Le soleil qui cachait ses ardeurs derrière des nuages grisâtres, plombés, choisit ce moment-là pour lancer son premier rayon. Il traversa, éclair de lumière, le feuillage encore mouillé de la nuit et fit mouche dans le regard transparent de la jeune Sofia.
Pour échapper à l’attaque soudaine de l’astre rayonnant, elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, il était trop tard... La chose avait disparu derrière un énorme olivier, noueux, tordu par une danse centenaire pour contourner un bloc de granit, encastré dans cet endroit depuis des temps immémoriaux.
La petite fille envoya voltiger d’un doigt rageur sa dernière larme. Puis, aussi immobile qu’un être humain puisse l’être, elle écouta la forêt.
Le ciel s’était crevé. Un trou de lumière maintenant se déversait sur la végétation ; le maquis bruissait sous la caresse du vent léger ; la terre humide exhalait une vapeur odorante. Au-delà de ce quotidien naturel une vibration étrange planait en ce lieu.
Sofia pour se donner du courage se parla à voix haute comme elle en avait l’habitude quand elle était seule.
- Idiote ! Espèce d’idiote… Tu dois avancer. Va voir derrière cet arbre !
Mais la peur la paralysait. Et si la chose s’était aperçue de sa présence ? pensa-t-elle. Enfin, elle se décida et à pas de loup, elle s’approcha. Quand elle posa la main sur l’épaisse cuirasse du vieil arbre, elle communia instantanément avec la colline entière. L'odeur des pins, le parfum de la bruyère, le chant des cigales, le piaillement des oiseaux, les broussailles qui griffaient ses tendres mollets, les branches mortes qui claquaient sous le poids de son avance, toutes ces sensations captées dans la même seconde, avaient une saveur particulière, mystérieuse, quasi effrayante, qui accélérèrent soudainement les battements de son cœur d’enfant.
Dans un effort de volonté, elle retira sa main qui était restée collée à l’olivier et le contourna. Une falaise à quelques pas de là donnait sur la mer. Le bruit léger du ressac parvenait avec peine et se mélangeait au murmure de la forêt. La chose s’était volatilisée. A moins d’avoir fait le grand plongeon, ce qui était peu probable, il n’existait nul autre endroit où aller. Prête à faire demi-tour son regard arrêta un détail surprenant. Elle comprit alors pourquoi la chose avait disparue : un trou dans le tronc, lugubre, noir, un trou assez gros pour permettre le passage d’une personne, un trou qui exhalait un air froid et qui semblait remonter des entrailles de la terre.
Elle n’osa aller plus avant. Pourtant l’ouverture béante était la solution si elle désirait en savoir davantage. Elle n’était pas très courageuse mais elle était surtout comme beaucoup de petites filles extrêmement curieuse. Pour la première fois de sa vie elle avait échappé à la vigilance de ses parents venus se promener en forêt. Plus bas sur le sentier, près d’une chapelle en ruine, ils s’étaient arrêtés pour souffler, profiter du charme matinal de la nature. Dans sa petite cervelle inconsciente, il n’était nullement question qu’elle les rejoigne sans avoir quelque chose à leur raconter, un quelque chose qui atténuerait la remontrance qui l’attendait.
Ainsi, partagé entre le désir de savoir et celui de ne point se faire gronder, elle se faufila dans le trou.
Dès qu’elle fut à l’intérieur, elle perçut la première marche d’un escalier étroit, en bois, qui invitait à continuer. Prudemment, elle s’aventura donc dans l’obscurité profonde de l’arbre. Elle descendit à tâtons, s’assurant avant de poser son pied devant qu’une nouvelle marche existait. Le craquement qui en résultait la rassurait. En même temps sa frayeur d’être précipitée dans un abîme profond et insondable s'était annihilée.
Après une descente en colimaçon qui lui parût interminable, elle parvint enfin devant une porte en bois. Après une courte hésitation, elle l’ouvrit.
Un couloir faiblement éclairé conduisait à une pièce bizarre. Les murs étaient en bois, d’un seul tenant, agrémentés de nœuds majestueux qui en coupaient l’uniformité, attestant l’ancienneté incroyable du lieu. Une table ornait le milieu et une ouverture ovale, cerclée d’une sorte de fenêtre mais sans vitre ni poignée, s’ouvrait sur le ciel.
Sofia s’approcha et découvrit la mer. L’étrange pièce était logée profondément sous terre, sous l’énorme olivier. Elle donnait sur la falaise. La petite fille se retourna et continua son inspection. Dans un coin de la pièce il y avait un tableau qui représentait un rameau d'olivier avec quelques olives se détachant sur l’azur immaculé d'un ciel avec une montagne saupoudrée de blanc au second plan. Ajouté à cela, une chaise en bois tarabiscoté, un plateau avec quelques noyaux d'olives abandonnés sur la table et l’on pouvait dire que c’était tout du mobilier.
Perplexe, appuyée contre le rebord de la fenêtre, Sofia réalisa alors que cet endroit, cette cachette était un cul-de-sac. Hormis la fenêtre qui tombait sur les vagues qu'elle entendait mugir, il n’existait aucune sortie. Confrontée à l'étrangeté de cette pièce et à la beauté du paysage qui s'ouvrait sur le vide de cette mer démontée, la mignonnette avait oublié un instant le pourquoi de son exploration. Elle se rappela soudain l’existence de la chose. Cette forme qui l’avait conduite ici et qui suivant la logique des êtres qui existent en tant que matière vivante, devait être encore là, tapie dans une cachette, invisible, prête certainement à lui bondir dessus.
Elle fut alors saisie d’une peur incontrôlée, poussa un long cri, perdit connaissance et mollement s’écroula sur le plancher.
Lorsqu’elle reprit conscience elle n’était plus dans la pièce. Un vent frais la fouettait et elle ressentit dans un premier instant, dans ce retour à la vie, une incroyable légèreté.
La mer s’étendait au loin, bleue turquoise, moutonnée, décorée de quelques voiles blanches qui dansaient. Le mugissement des vagues avait cessé. Une ombre planait et la protégeait du soleil. C’était un bouquet de feuilles. Elles étaient épaisses, accrochées à une branche gigantesque qui se balançait au-dessus d’elle.
Peu à peu, la torpeur dans laquelle Sofia évoluait depuis son réveil se dissipa. Elle comprit qu’un événement extraordinaire venait de se réaliser. Elle était suspendue dans les airs, sous une branche d’une taille exceptionnelle de l’olivier géant, sous un parasol de grosses feuilles qui la protégeait du feu ardent et implacable du soleil. C’était pour cette raison qu’elle distinguait avec autant de visibilité le panorama grandiose de la mer.
Elle chercha aussitôt à se dégager avant même de réfléchir à cette incroyable situation. Mais dans sa gesticulation, l’horreur de ce qui lui était advenue lui apparut alors immédiatement.
Elle n’avait plus de jambes... Elle n’avait plus de bras... Elle n’avait plus de corps... Elle n’avait plus de tête... Elle n’était plus une petite fille. Elle n’était plus Sofia. Elle était devenue une olive, une ridicule petite olive verte, gentiment suspendue à une branche qui se dandinait dans la matinée de cette belle et chaude journée du mois d’août.
Avec toute la stupéfaction que l’on peut imaginer, plus tard, elle entendit les appels de ses parents ainsi que ceux de personnes qu’elle ne connaissait pas et qui passaient sous elle en criant son nom, et bien sûr, auxquels elle ne put répondre. Car a-t-on déjà vu une petite olive parler ?
Puis, quand la journée se fut écoulée, que ses parents, ses amis, et les gendarmes qui étaient venus prêter main forte se furent éloignés, tous désespérés comme l’on peut l’imaginer, et que la colline eut retrouvé sa tranquillité habituelle, Sofia, la petite olive verte, aperçut au pied de l’arbre, la chose qui furtivement s’extirpait du tronc… Elle la vit tourner autour de l’olivier, lever sa tête hideuse, ovale, noire, dans sa direction, puis dans un ricanement sinistre, disparaître dans la pénombre de la forêt.
La chose repartait à la recherche d’une autre petite fille, d’une autre victime, d’une autre petite olive.
Le placard des Mazades
J’ai poussé la porte de la petite boutique poussiéreuse. Le calme de la librairie, l’odeur des livres en cuir, mélangée à celle du papier centenaire, me font oublier un instant le mal-être que je me traîne depuis longtemps. En poche, je n’ai qu’un seul billet. De sentir cette boule froissée dans ma paume me rassure ; si mon envie s’arrête sur un titre, un auteur capable de desserrer l’étau de ma main, j’échangerais mon repas de ce soir contre un moment de lecture silencieuse devant la cheminée. Mes doigts effleurent langoureusement les livres un par un. Le libraire qui m’a regardé d'un haussement de sourcils par-dessus sa pile de nouveautés s’est vite replongé dans la lecture de son catalogue. Nous sommes seuls. Le brouhaha de la rue de ce samedi nous parvient filtré, étouffé.
Mes souliers couinent sur le parquet ciré. Cela me gênerait presque. Combien ai-je touché de livres ainsi dans ma vie, dans les bibliothèques, dans les librairies, chez les bouquinistes, les brocanteurs ? Des livres que je n’ai fait que tenir sans les ouvrir, sans savoir ce qu’ils avaient à me dire. Quelle est cette magie qui, on ne sait pour quelle raison, vous en fait ouvrir un puis le refermer à jamais ? Ou bien tel autre que l’on traverse rapidement avant d’en trouver un qui vous séduise, subjugué pour un collier de mots qui correspond si bien à l’appétit de votre intelligence, de votre plaisir et qui parfois vous fait remonter les larmes du creux de votre sécheresse.
Mes doigts accrochent un livre au cuir rouge. Je l’ouvre avec respect. Daté de 1902 il s’intitule « Une vie ». Je le feuillette et je déguste telle une friandise les illustrations qui accompagnent les lignes de ce premier roman écrit par Maupassant. Sur une autre étagère, Alfred de Musset me propose sa confession d'un enfant du siècle. C’est un livre édité par Charpentier daté de 1864. Je me prends à penser que le cuir ce cette couverture, ces pages tâchées, ce papier fragile, ont vu le jour lors de la guerre de Sécession. Cet objet était encore neuf pendant la guerre de 1870, certainement en très bon état en 1914. Il a traversé la deuxième guerre mondiale, puis il a échappé à toutes les autres pour enfin se retrouver, en ce moment précieux, dans le creux de mes mains. Cette pensée me porte un peu plus loin dans le magasin. Le libraire a relevé la tête et il me contemple avec un sourire de connivence. Maintenant c’est une reliure verte que je brandis devant moi. Jack London... Une aventure parmi tant d’autres de cet homme extraordinaire. Celle des vagabonds du rail. Sur la page de garde il y a une petite dédicace « Pour ton anniversaire avec les amitiés de nous deux » La signature est illisible mais la date est celle du 4 août 1948. Que s’est-il passé ce jour là dans le monde, me dis-je ? Que s’est-il passé ce jour là à Toulouse ? Dans cette rue ? A l’endroit même où je me trouve ?
Puis l’errance de ma promenade littéraire me fait poser la main sur un quatrième livre. Un nom en lettres dorées me frappe. C'est celui de Frédérico Garcia Lorca. Il est posé, que dis-je, abandonné, sur la bouffissure d’une pile de vieux journaux gonflés d’humidité et sans doute dans l’attente de la poubelle. Un livre brûlé, portant des blessures noires et profondes. Les pages sont noircies, les bords couverts de suie. Ce bouquin crie sa détresse, m’appelle au secours. Avec précaution je le saisis. C’est un exemplaire d’un recueil de poèmes. Je l’ouvre et je vois qu’il a été édité en espagnol. Les premières pages ont été mangées par les flammes et je suis sur le point de l’abandonner au triste sort du pilon. Mais une dernière pichenette de mon index et le milieu de l’ouvrage s’écarte.
Avec stupeur, je découvre des lignes manuscrites, tracées avec une encre bleue, alignées en travers de la page, le long de la marge. Fébrilement, je reviens en arrière. Apparaît alors le premier mot de cette étrange lettre car c’est bien une lettre… Les bouts de phrase que ma connaissance de la langue de Cervantès m’a permis d’intercepter m’ont déjà justifié dans cette évidence.
« Quérida... » C’est une lettre adressée à une femme. Une lettre d’amour qui allonge sa détresse sur une vingtaine de pages. A la dernière ligne, il y a une date et un lieu qui me propulsent dans les grabats, la poussière, le sang, l’horreur d’une bataille. Teruel le 22 février 1938. Un jour maudit parmi tant d’autres... Les républicains après des semaines de combats de rues acharnées ont perdu la ville. Quinze mille hommes ont été faits prisonnier et tout le matériel de guerre perdu.
Je referme le livre comme un écolier pris en flagrant délit de bêtise. Ce livre déchiqueté, rescapé d’une bataille est déjà ma propriété. Il n’est pas à vendre par son état lamentable mais devant mon insistance, le libraire consent à me le céder pour la moitié de mon billet.
Dehors il fait averse mais mon acquisition est bien à l’abri dans sa poche plastique. Les gouttes qui me lèchent le visage m’indiffèrent ; je suis ailleurs, loin, en Espagne, à Teruel, sous la mitraille, le ventre tordu par la peur.
A la hauteur du Florida, sous les arcades du Capitole, le beau temps semble revenir. Le serveur, en pantalon noir, chemise blanche d’octobre, le stylo rouge glissé dans sa poche italienne comme une signature qui dépasse, essuie les chaises mouillées de la terrasse. Je suis le premier à poser mes fesses sur l’une d’elles. J’allume une cigarette et commande un café et un demi en contemplant la place qui retrouve son animation matinale.
Le soleil perce juste au-dessus du grand hôtel de l’Opéra. Une jolie femme blonde, un agenda sophistiqué à la place de son sac à main, vient s’asseoir à la table voisine. Elle est rejointe par un encravaté qui lui passe un savon de première. Sans doute son patron. Ou son putain de mari.,, Elle ne répond pas, courbe l’échine, subit, en fixant le camion Heineken qui encombre la rue, les bâches rouges rabattues, pour faciliter le déballage de sa cargaison. Le livreur manie le diable avec dextérité et force. Il décharge les caisses de bouteilles, les bidons de bière, dans un tintamarre de verre et de ferraille. Il est habillé en vert et sur son dos de portefaix le nom de son maître s’étale en grosses lettres : France Boisson.
Quelques couples maintenant sont attablés au soleil. Une brune typée dévore un sandwich. Ses lunettes de soleil sont posées sur son nez en un équilibre précaire. Elle observe avec curiosité un homme qui se gratte la tête, l’air perplexe. Il contemple une des fresques qui ornent le plafond des arcades. L’affaire Calas. Puis, il se décale de quelques pas, le menton toujours en l’air, et observe ensuite Riquet et le canal du Midi. A-t-il l’intention de se les faire toutes ? La fille qui a croisé mon interrogation me décoche un sourire complice. Un sourire jambon beurre...
Plus loin et de l’autre côté de la place, le porche noir du géant Capitole aspire de minuscules personnages colorés, empressés, en une espèce d’étirement saccadé et perpétuel. Je lève les yeux et l’horloge indique onze heures dix. J’ai le temps jusqu’à midi. Une femme, cheveux rouges, foulard noir, et téléphone bleu, entre maintenant dans mon champ de vision. Elle est à trois mètres et semble hésiter quant à la direction prendre.
Elle me rappelle Eva, la tignasse en moins, et qui possédait aussi cette manière de rester indéfiniment plantée dans ses incertitudes. Notamment celle de son amour à mon égard. Je me retourne la question devant mon café maintenant tiède. Suis-je doué pour aimer ? J’ai le sentiment du contraire. Ce besoin de solitude qui me taraude, cette facilité à ne pas m’encombrer de la présence des autres, m’assiègent dans une fâcheuse posture. Maintenant que je mène à ma guise mes journées, maintenant qu’Eva est partie, je sais que je suis organisé pour vivre tout seul. Pourtant mon isolement me pèse. Mais une certitude est là. J’ai le mal de vivre.
Une autre cigarette. Mes pensées vagabondes se diluent dans la fumée, dans le goût dévastateur du tabac. La femme a pris enfin une décision. Elle s’en va en direction de la rue Gambetta. Sur la table, ma main n’a pas lâché la poche plastique. Dedans, le livre. Il est temps que je lise cette bouteille à la mer...
Je l’ouvre délicatement et cherche la page qui en marque le début. La place s’estompe. Le roulement des nettoyeuses vertes et municipales décapant le trottoir devient inaudible. Je suis devenu sourd. Je suis repartie à Teruel.
« Querida...
Pardon de n’avoir pu choisir à temps entre ton amour, notre fils et mes convictions pour la république... Pardon pour t’avoir offert cet enfant et qui n’aura connu son père que quelques mois. J’espère que tu es en sécurité et que tu as pu rejoindre la France, que tu as trouvé de l’aide. Je ne sais combien de temps il me reste à vivre. Je suis salement blessé et je suis seul dans cette demeure où nous avons trouvé refuge. Mes compagnons sont morts… Miguel est décédé dans mes bras il y une heure environ. Je suis caché derrière une fenêtre et j’aperçois pendant que je t’écris ces fumiers de franquistes qui vont donner bientôt l’assaut. A cette heure-ci nous avons perdu la ville... Je croyais pouvoir leur échapper et me cacher mais ils savent que je suis là. Ils ne font pas de quartier et je ne me fais pas d’illusion. Et puis surtout, je n’ai pas le courage ou la lâcheté d’agiter un drap blanc. Pardon pour cette faiblesse, pour cette fierté qui va me tuer. Pardon mille fois mon amour mais tu me connais, c’est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas me rendre...
J’écris cette lettre à l'intérieur de ce livre que je replacerai dans la bibliothèque. C’est la maison d’un bourgeois. Quand ils m’auront délogé, les murs seront sans doute encore debout et la bibliothèque sera intacte. Je confie mes derniers instants de bonheur, puisque je suis avec toi mon amour par l’écriture, à ce cher Frédérico Garcia que ces salauds ont fusillé en juillet 36. Tu vois, ils sont allés même jusqu’à massacrer la poésie !
Élève bien notre cher Progresso. Je souhaite qu’il ait une vie meilleure que la mienne. Protège-toi aussi ma chère Maria et je souhaite que tu puisses retourner vivre chez nous à Séville. Et même si je crache sur les églises, recommande-moi auprès de ton Dieu que tu caches dans ton panier de petite anarchiste.
J’espère que le propriétaire des lieux quand il reviendra chez lui ouvrira ce livre et te fera parvenir ces quelques lignes. Un jour on te parlera de moi. Je confie cette lettre à la poésie. Je ne peux pas imaginer qu’un tel livre reste clos durant des années. J’espère que quelqu’un dans cette maison sera touché par ce message et qu’ils t’écriront pour te dire que c’est ici que j’ai terminé ma vie. En pensant à toi et à notre cher enfant. Je t’aime. »
Je reste figé sur ce mot d’amour si simple et qui prend ici au bas de cette page jaunie une couleur de désespoir profond. C’est signé d’un prénom Pablo et c’est adressé à Maria Jaen et à son fils Progresso.
Un raclement m’extirpe de ma lecture… C’est une énorme valise jaune fixée sur des roulettes que traîne péniblement un petit homme. D’où sort-il ? Du parking souterrain ? Le vent tiède d’octobre agite les drapeaux accrochés au balcon de la mairie ; l’européen, le français et l’occitan... Mourir pour une couleur ? En serais-je capable ? Non ! Bien sûr... Cela je le sais.
La cohue m’assaille encore. Ce bruit, ce grouillement, cette vie qui me rassure et m’agace en même temps. Le claquement d’un pas ferré me fait tourner la tête. C’est une paire de santiag et c’est un vieux qui les porte. Il n’y a plus d’âge pour porter des bottes. Un adolescent sur des rollers, la cigarette au bec, comme un éclair, zigzague entre les passants. Trois femmes voilées sortent d’une porte cochère. Un habitué du café s’installe avec des gestes étudiés à une table, et se plonge dans la Dépêche du jour. Derrière, une maman penchée sur une poussette donne à boire à son bébé avec un biberon orange.
Devant, sur la rue, un camion jaune avec une remorque me voile l’horizon de la place. Ce sont des fenêtres. Toulouse n’en finit pas de changer ses fenêtres explosées... Le chauffeur a mis les « warning ». Il est dans le café. Une contractuelle avec son galurin sur sa crinière frisée, radio à la ceinture, s’approche à pas réglementaires, les yeux fixés sur la plaque minéralogique du gêneur.
Mon estomac gargouille. Je me dis que je mangerais bien ici. Le menu annonce une salade gourmande, souris d’agneau et crème brûlée. Le tout pour dix euros. Mais le livre m’en a coûté la moitié. L’horloge marque bientôt midi. Viendra-t-elle ? Elle me l’a promis, pour une ultime explication. Mais je n’y crois plus. Je n’ai pas pris mon portable et si elle ne vient pas, elle ne pourra pas me prévenir. C’est peut-être pour cette raison que je l’ai oublié sur la commode. Pour ne pas l’entendre dire qu’elle est désolée.
A midi trente je repousse ma chaise et je me lève à regret. Il est inutile de patienter davantage. Mon estomac gargouille… Chez moi il reste six œufs...
Le livre est rangé dans ma bibliothèque. Je ne l’ai pas oublié mais Eva est avec un autre mec... Je me suis remis au travail et j’ai passé des annonces. « Un écrivain à votre service ! ». J’ai relancé des prospects et j’ai obtenu deux nouveaux clients : une femme vietnamienne qui a été mariée contre son gré à quinze ans du temps de l’Indochine et une femme superbe mais sans doute folle qui, paraît-il, est accusée du meurtre de son mari et qui vit sur une île à Madagascar, parmi un élevage d’autruches. C’est une histoire bizarre, avec une petite fille qui a été enlevée. Elle tient absolument à ce que j’écrive cette histoire sordide. C’est pour m’innocenter me dit-elle ! Elle n’a pas tiqué sur mes tarifs comme la vietnamienne.
Et puis, tout à l’heure, je me suis amusé sur internet... J’ai fait une recherche sur le nom de « Jaen » mais je n’ai pas trouvé de Maria. J’ai imprimé la liste et j’ai téléphoné. Mais personne ne la connaît. Alors, comme je n’ai rien d’autre à faire pour tuer ma lassitude et l' envie de tout ficher en l’air, je poursuis mon pianotage. Je me concentre sur les noms hispaniques. Cette Maria s’est sans doute remariée et partant du principe qui se ressemble souvent s’épouse, je me dis que son rejeton, qui doit approcher aujourd’hui de l’âge de la retraite, porte le nom de son beau-père. Et comme de nombreux réfugiés espagnols ont fait souche à Toulouse et dans le sud-ouest, je subodore qu’avec de la persévérance, en m’orientant sur ce prénom républicain, Progresso, peu commun, j’ai peut-être une chance de le trouver.
Une idée sert de moteur à mon entêtement. Ce livre n’a pas traversé ces années, il n’a pas franchi la chaîne des Pyrénées, pour finir à la décharge. Ce livre m’était destiné ; ce message j’en suis le facteur. Moi, qui suis au bout de mes envies, qui ne crois plus en rien, mais qui piétine dans mon amour pour Eva, je me sens investi d’une obligation, d’un devoir moral envers ce soldat. C’est étrange mais j’ai l’impression, en agissant de la sorte, de participer à cette lutte contre le fascisme, d’apporter ma contribution active dans ce combat perdu qui fait partie de l’histoire. Cette guerre meurtrière dont les libérateurs s'étaient honteusement détournés.
Quelle est donc cette force qui me pousse à téléphoner à des dizaines d’inconnus ? Une espèce d’échappatoire pour oublier mes déboires sentimentaux, ou effacer les vicissitudes de mon quotidien débarqué sur le quai d’un futur qui n’a plus de saveur. Une façon de m’occuper le corps et l’esprit.
Pourtant, cette curieuse affaire, qui à priori ne me concerne point, a rallumé une étincelle.
Ai-je encore au fond de mon dégoût un reste d’humanité, un sentiment gratuit, une miette d’amour que n’auraient pas voulu les vilains canards ? Ceux de la mare de mes emmerdements !
Je sais que je dois compter sur ma bonne étoile. J’en ai la certitude et lorsque celle-ci se manifeste, je n’en suis nullement surpris. Une jolie voix craquelée par le fil du temps me répond, hésitante, un tantinet effrayée, lorsque je la questionne. Mon pouls s’accélère quand elle me dit que son fils se prénomme Progresso et qu’elle-même répond à celui de Maria depuis quatre vingt-cinq ans. Je suis pris de court. Je ne sais que dire… Heureusement mon métier me donne l’ouverture pour une réponse. Le verbe flue et j’explique sans un bégaiement que je suis écrivain et que je fais une enquête pour écrire un livre dont le sujet porte sur les enfants des réfugiés espagnols. Comme de nombreux anciens, la vieille dame est crédule et prend pour argent comptant mon mensonge vêtu d'un peu de sincérité. Elle me confie qu’elle habite depuis peu chez son fils aîné qui travaille au tri postal. Depuis que son mari est impotent. C’est une gentille bavarde qui a ouvert le robinet des explications, des souvenirs, avec un mot qui en amène un autre, une idée qui pousse la suivante. Je n’ose endiguer ce filet de sons aigus légèrement salés par un vieil accent espagnol dont elle n’a jamais pu se débarrasser, ce lien, invisible mais si fort, qui ne s’est jamais rompu et qui retient une partie de son âme dans un village endormie à l’ombre de son Andalousie natale.
Je réussis pourtant à lui faire entendre qu’elle prévienne son fils ou sa belle-fille que je passerai le soir même pour les voir. J’ai l’impression de forcer le passage, de forcer leur intimité. Mais je dois suivre mon élan, aller jusqu’au bout. Le bouillonnement de mon être m’y contraint et me pousse à agir aujourd’hui et non pas demain. Plus tard, mon esprit refroidi me dira que cette histoire ne me regarde pas, qu’il est trop tard pour ramener en surface une telle épave. A quoi bon réveiller ce drame ! La pauvre vieille a certainement vécu à Toulouse toute sa vie. De quel droit devrais-je lui rappeler des souvenirs si douloureux ?
Mais pour l’instant mon esprit surchauffé me dit le contraire. Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on a renié sa jeunesse. Le plus beau de la vie est toujours enfoui dans le présent de la pensée. Il n’y a que les images du malheur que l’on essaye d’enterrer sous les autres avec plus ou moins d’efficacité, suivant la capacité de survivre que l’on a, suivant le seuil de tolérance à la douleur de chacun.
Il est presque vingt heures. Je gare ma vieille R20 qui roule sans fatigue depuis vingt ans sur le parking qui coudoie le centre commercial de la cité des Mazades. Je jette un œil sur le papier où j’ai noté l’adresse : douze, rue d’Arcachon. C’est bien là ! La tour me toise du haut de ses dix-huit étages et semble me demander pourquoi j’ose ainsi m’immiscer dans la vie de ces gens simples. Je pénètre dans le hall d’entrée puissamment éclairé. Sur la gauche une centaine de boites à lettres ivoires accueillent mon hésitation. Je cherche le nom de « Martinez » puisque c’est celui de la mamie Maria. Ce nom qui est aussi celui de son fils Progresso et que me confirme la plaquette en laiton qui donne un air de respectabilité à ce casier que je déniche parmi tant d’autres. Ils sont au onzième. Je me glisse dans un ascenseur et me retrouve sans tarder devant la porte de leur appartement. Je sonne discrètement.
J’entends du bruit : le journal télévisé, avec le spectacle d’un monde vomissant, que l’on baisse subitement ; quelques éclats de voix, une chaise que l’on traîne puis des pas qui claquent sur un carrelage. La porte s’ouvre sur une odeur de cuisine, une odeur de poissons panés, d’huile d’olive. Une douce chaleur émane de l' appartement. Un homme me dévisage l’air confiant. Il me tend la main et se présente. Sa mère lui a expliqué que je suis journaliste et cette méprise me permet de briser en quelque sorte la glace. Ce sont des gens chaleureux et je suis mis rapidement en confiance. La mamie Maria est telle que je me l’imaginais. Une jolie vieille, ridée, avec des grands yeux profonds où brille encore un soupçon de malice, des cheveux blancs, remontés en un chignon tenu par une pince, pas de bijoux, juste une alliance, et des mains fragiles, décharnées, qu’elle tient serrées contre sa poitrine, dans l’attente muette de ce que je suis venu leur demander. Ils n’en savent rien mais ce sont des gens qui ont toujours porté en eux le poids de l’exil. Ils sont étonnés que l’on vienne les relancer chez eux pour parler de cette chose-là, cette marque qui les a brûlés dans leur chair il y a très longtemps.
Progresso m’invite à m’asseoir sur le canapé qui occupe une bonne partie du séjour ; devant une table ronde sur laquelle cinq assiettes sont posées. La télévision est toujours allumée. Des images de militaires en armes, de chars d’assaut et d’avions projettent leur haine sur la quiétude de la pièce. Mentalement, j’essaye de comprendre pourquoi cinq couverts. J’ai en face de moi Maria et Progresso, j’ai salué son épouse qui s’en est retournée à sa poêle et j’ai aperçu le papi impotent sur sa chaise roulante dans la chambre du fond. Qui est donc le cinquième ? Je me retrouve avec un verre de muscat dans les mains et j’y vais de ma fable sur ce livre que je suis sensé écrire. Je pose des questions à Progresso, en écoutant la Mamie qui me raconte sa fuite avec son fils, son embarquement du dernier instant à Bilbao dans une barque frêle prête à couler sous le poids des désespérés, la traversée sur ce bateau anglais puis leur arrivée en France, la police, les camps de concentration, l’accueil dans les familles où très vite elle sera placée comme bonne à tout faire.
J’attends une allusion à son premier mari mais Maria semble occulter complètement cette partie. Pourtant j’ai le livre dans mon sac mais il est trop tôt pour le sortir et leur montrer. Je crains de comprendre. Je questionne alors innocemment Maria à quelle époque a-t-elle connu son mari ? Elle me répond à Séville bien avant la guerre ; ils étaient les enfants d’un même quartier. Je m’adresse ensuite à son fils et lui demande depuis combien de temps son père est-il malade ? Il ne tique pas lorsque je prononce ce mot de « père » au sujet du vieil homme immobilisé, semble-t-il, toujours assoupi, dans la chambre du fond. J’ai la conviction maintenant que Maria a menti, qu’il ignore tout de l’existence de son véritable père.
J’en suis là de mes réflexions quand la porte de la deuxième chambre qui donne sur le séjour s’ouvre. Un homme sans âge, le visage complètement dévasté par l’alcool, maigre comme un clou, vêtu d’un pantalon velours gris dégueulasse, pull tâché, pantoufles trouées fait son apparition. Il nous dévisage et passe devant nous sans un mot ou presque. Je l’entends grommeler dans sa barbe de quinze jours une suite de sons inintelligibles qui ressemble à de l’espagnol. Progresso a vu mon regard et je saisis le pourquoi de la cinquième assiette. « C’est mon frère ! » me précise-t-il. « Il est malade et habite avec nous depuis des années. » J’entends des éclats de voix à la cuisine, un placard que l’on ouvre violemment, le cliquetis d’un verre contre un goulot de bouteille. Tout le monde s’est brusquement tu. Il n’y a que la télévision qui continue en sourdine de diluer son fiel d’informations. Le frère repasse devant nous avec une bouteille de bière à la main. Et la porte se referme derrière lui. « Il est malade, le pauvre… » répète la mamie Maria comme pour s’en convaincre. Je ne dis rien. Que dire dans ces cas là ! Et je hoche la tête d’un air compatissant.
Pour aller davantage dans mon enquête je pose une question précise à Maria. Je voudrais savoir où est quand elle s’est mariée ? Elle semble gênée... C’est Progresso qui vient alors à son secours.
- Mes parents se sont épousés en France après la guerre, après ma naissance. Vous comprenez ? ajoute-t-il.
Comme je ne dis mot, il poursuit :
- Mon père se battait. Ils n’ont pas eu le temps de se marier. Juste le temps lors d’une permission de me concevoir, juge-t-il bon de préciser comme s’il avait deviné ma pensée.
Je croise le regard de Maria et j’y décèle une peine immense. Où est ce juste le fruit de mon imagination ? A quoi pense donc cette vieille femme à cet instant ? Songe-t-elle à ce Pablo, le véritable père de son fils ? Elle tourne le visage et cherche dans les images stupides de la publicité de la télé une aide, comme pour brouiller celles qui lui reviennent du passé.
Je reste encore un peu avec eux et j’écoute le résumé rapide de leur existence : une vie simple d’ouvrier dans le bâtiment ; des ménages chez les autres ; des boulots précaires au marché gare ; des familles écartelées ; d’un fameux retour à Séville juste après la mort de Franco ; d’un frère et des cousins retrouvés après trente ans de séparation ; plus l’espoir d’y retourner une deuxième fois...